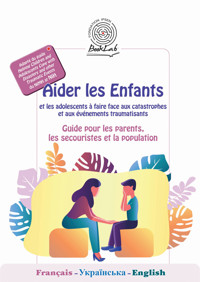Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bernard Campiche Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La science-fiction suisse ? Jamais entendu parler !
"Et pourtant, depuis longtemps, la littérature suisse romande s’est livrée au jeu des fictions spéculatives. Comme ailleurs, des auteurs curieux ou perspicaces se sont posé des questions sur l’avenir, les rapports de la science et de la société, les dangers technologiques, les dérives totalitaires, la vie sur d’autres planètes, la réalité virtuelle ou les délires temporels. Auteurs célèbres, réputés ou oubliés ont exprimé leurs craintes, leurs angoisses ou leurs espoirs par le biais de romans ou de nouvelles.
Composé par Jean-François Thomas, ce recueil est la première anthologie historique de la science-fiction suisse romande. De 1884 à 2004, elle donne à lire des récits qui appartiennent tous au domaine de la
conjecture romanesque rationnelle.
Avec des textes de Léon Bopp, Bernard Comment, Marie-Claire Dewarrat, Michel Epuy, Roger Farney, Gabrielle Faure, Jean Villard Gilles, Rolf Kesselring, Claude Luezior-Dessibourg, Sylvie Neeman Romascano, Georges Panchard, Wildy Petoud, Jacques-Michel Pittier, Odette Renaud-Vernet, Édouard Rod, Noëlle Roger, Albert Roulier et François Rouiller." -
Jean-François Thomas, directeur de la publication
Une anthologie riche et étonnante à découvrir absolument !
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"Dix-huit auteurs qui vous feront passer quelques heures agréables en vous démontrant que la Suisse romande compte des écrivains remarquables même dans ce genre humain, trop humain qu’est la SF. Un petit dictionnaire pour auteurs, utile pour jeter des passerelles entre SF et littérature générale, ce que les Anglo-Saxons appellent mainstream, et mieux situer les choses, conclut le volume." -
Pierre-Yves Lador, Le Passe-Muraille
"Magnifique anthologie de science-fiction, digne des grandes anthologies made in USA. Cent vingt ans de science-fiction suisse romande en cinq cent pages, qui l’eût cru ?" -
Pierre-Yves Lador, Culturactif.ch
A PROPOS DE L’AUTEUR
Jean-François Thomas est né en 1952 à Lausanne. Marié, père de deux enfants, il exerce la profession de formateur d’adultes et travaille actuellement dans la réinsertion professionnelle après avoir exercé son activité dans le milieu bancaire. D’abord bibliothécaire, il a obtenu ensuite une licence en lettres à l’Université de Lausanne. Critique spécialisé en littératures de l’imaginaire (science-fiction, fantastique, fantasy). Auteur, il a publié une dizaine de nouvelles. À l’aise aussi dans le récit policier, il est l’auteur d’une pièce radiophonique
Le Crime du compactus (1982) et a obtenu un prix pour sa nouvelle
Une, deux, trois… dans le recueil
Petits meurtres en Suisse (Zoé, 2005). Il a déjà consacré plusieurs études à la science-fiction suisse romande, dont il est un spécialiste reconnu. Enfin, il préside depuis 2002 le conseil de fondation de la Maison d’Ailleurs, le musée de la science-fiction, de l’utopie et des voyages extraordinaires d’Yverdon-les-bains.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Défricheurs d’imaginaire
LE DIRECTEUR DE PUBLICATION :
JEAN-FRANÇOIS THOMAS est né en 1952 à Lausanne. Marié, père de deux enfants, il exerce la profession de formateur d’adultes et travaille actuellement dans la réinsertion professionnelle après avoir exercé son activité dans le milieu bancaire. D’abord bibliothécaire, il a obtenu ensuite une licence en Lettres à l’Université de Lausanne. Critique spécialisé en littératures de l’imaginaire (science-fiction, fantastique, fantasy), il exerce son activité dans les pages du quotidien 24 Heures depuis 1988, ainsi que dans celles du Passe-Muraille et de la revue spécialisée Galaxies (France). Auteur, il a publié une dizaine de nouvelles, essentiellement dans des anthologies comme Îles sur le toit du monde (Archipel, No 24, 2003), Moissons futures (La Découverte, 2005), ou Ténèbres 2007 (Dreampress.com, 2007). À l’aise aussi dans le récit policier, il est l’auteur d’une pièce radiophonique Le Crime du compactus (1982) et a obtenu un prix pour sa nouvelle Une, deux, trois… dans le recueil Petits meurtres en Suisse (Zoé, 2005). Il a déjà consacré plusieurs études à la science-fiction suisse romande, dont il est un spécialiste reconnu. Enfin, il préside depuis 2002 le conseil de fondation de la Maison d’Ailleurs, le musée de la science-fiction, de l’utopie et des voyages extraordinaires d’Yverdon-les-bains.
L’ILLUSTRATEUR DE LA COUVERTURE :
Né en 1956, père de trois enfants, le pharmacien FRANÇOIS ROUILLER est un véritable homme-orchestre. Dessinateur et illustrateur, son recueil Après-demain : cent vues imprenables sur le futur (L’Atalante, 2002) donne une excellente idée de son travail, mélange d’humour et de folle créativité, s’attachant à l’anecdote, au saugrenu, aux retombées prosaïques et quotidiennes des grandes découvertes du futur. François Rouiller a publié Stups & fiction (Encrage, 2002), un essai sur les drogues et les toxicomanies dans la littérature, le cinéma et la bande dessinée de SF. Il a obtenu le Grand Prix de l’imaginaire 2007, récompense suprême du milieu francophone de la science-fiction, pour son essai 100 mots pour voyager en science-fiction (Les Empêcheurs de penser en rond, 2006), ouvrage de vulgarisation à mettre entre toutes les mains de ceux qui veulent découvrir ce genre de littérature. Il a aussi présidé l’Association des amis de la Maison d’Ailleurs, avant de devenir, de 1998 à 2001, le premier président de son conseil de fondation, dont il est resté membre jusqu’à cette année. Enfin, et non des moindres, il est un brillant auteur de nouvelles et figure à ce titre en bonne place dans cette anthologie.
Défricheurs d’imaginaire
Une anthologie historiquede science-fiction suisse romande
sous la direction deJean-François Thomas
« Défricheurs d’imaginaire »,une anthologie historique de science-fiction suisse romande,sous la direction de Jean-François Thomas
Ce livre de poche paraît avec l’aide dePro Helvetia, Fondation suisse pour la culture
« Défricheurs d’imaginaire »,deux cent trente et unième ouvrage publiépar Bernard Campiche Éditeur,le trente-deuxième de la collection camPoche,a été réalisé avec la collaboration d’Huguette Pfander,de Daniela Spring et de Julie WeidmannCouverture et mise en pages : Bernard CampicheDessin de couverture : François RouillerPhotogravure : Bertrand Lauber, Color+, Prilly,& Cédric Lauber, L-X-ir Images, PrillyImpression et reliure : Imprimerie La Source d’Or,à Clermont-Ferrand (ouvrage imprimé en France)
ISBN papier 978-2-88241- 231-7ISBN numérique 978-2-88241-361-1Tous droits réservés© 1979, 1990 by Éditions de L’Aire, à Vevey,pour Le Trou, de Marie-Claire Dewarrat (1990) ;Homo Ludens, de Gabrielle Faure (1979) ;Ce jour-là, d’Odette Renaud-Vernet (1979)© 1986 by Éditions Denoël, à Paris,pour La Maison de l’araignée, de Wildy Petoud© 1980 by Éditions L’Âge d’Homme, à Lausanne,pour Ego Lane, de Jacques-Michel Pittier (in : La Corde raide)© 2001 by Éditions Buchet-Chastel, à Paris,pour Granules, de Claude Luezior-Dessibourg(in : Venise et autres contes fantastiques)Pour l’ensemble des ©, voir à la fin de chaque texte© pour la présente édition :2009 Bernard Campiche ÉditeurGrand-Rue 26 – CH -1350 Orbewww.campiche.ch
À Claudia, pour son soutien constantÀ Jérôme, pour ses encouragementsÀ Grégoire, qui revient de loin, et YantiÀ Loïc, Mélanie, Zoïa et Tyra
PRÉFACE
ILES RAISONS D’UN CHOIX
UNE ANTHOLOGIE de science-fiction suisse romande. Voilà un projet qui peut sembler bizarre et incongru. Trouverait-on aussi, en nos contrées, des auteurs assez farfelus pour se livrer à l’exploration d’espaces imaginaires sans craindre la mauvaise réputation attachée à ce genre de littérature, dont aucune étude littéraire en Suisse romande ne parle, si ce n’est au détour d’une phrase ou d’une note égarée en bas de page ?
Cette anthologie, qui regroupe dix-huit textes, dont le premier est né en 1884 et le plus récent en 2004 – soit un espace-temps de cent vingt ans –, est là pour le prouver. La science-fiction suisse romande existe bel et bien, sous la plume d’auteurs célèbres, réputés, peu connus voire carrément oubliés.
On ne construit pas sur du sable, sinon l’édifice ne tient pas. Il convient donc d’indiquer ici sur quelles fondations repose cette anthologie.
Ma première pierre angulaire pèse 3 kilos 200. Elle compte 997 pages et se nomme Encyclopédie de l’utopie, des voyages extraordinaires et de la science-fiction. Rédigée par Pierre Versins, cette encyclopédie monumentale a vu le jour en 1972 chez l’Âge d’Homme à Lausanne. Cette œuvre est l’ouvrage essentiel pour qui veut connaître l’histoire, l’évolution et les caractéristiques principales de la science-fiction, notamment d’expression francophone. L’article « Suisse », qui s’étend des pages 840 à 843, recense une belle brochette d’auteurs et d’œuvres.
Ma deuxième pierre angulaire est lourde, massive et célèbre. Elle est aussi due à Pierre Versins. C’est en faisant don à la ville d’Yverdon de toutes ses collections (livres, revues, affiches, jouets, disques) que Pierre Versins est à l’origine de la Maison d’Ailleurs, premier et unique musée-bibliothèque de science-fiction, ouvert en 1976. En plein essor de nos jours, avec l’inauguration d’une nouvelle salle entièrement consacrée à Jules Verne, la Maison d’Ailleurs est connue dans le monde entier.
Ma troisième pierre angulaire est la plus vieille, la plus cachée, la plus difficile à déterrer. Et, comme tous les objets rares, elle est infiniment précieuse…
Le 15 mai 1915, à l’Université de Lausanne, Hubert Matthey, licencié ès lettres, qui sera plus tard lecteur de français à l’Université de Bâle, publie sa thèse sous le titre Essai sur le merveilleux dans la littérature française depuis 1800 : contribution à l’étude des genres. Ce qu’elle a de remarquable ? C’est tout simplement la première thèse jamais consacrée à l’anticipation !
Il faut une quatrième pierre, n’est-ce pas, pour que la maison soit bien solide ? Eh bien quoi de mieux que cette anthologie, qui est justement la quatrième regroupant des nouvelles d’auteurs suisses romands. La quatrième, mais qui présente deux importantes particularités.
En premier lieu, c’est une anthologie historique : elle ne recense que des textes qui ont déjà été publiés, gage de qualité. En second lieu, c’est la première dont le tirage ne soit pas confidentiel et réservé à un cercle d’initiés. Pour les lecteurs amateurs de précision, voici la liste des trois autres anthologies.
1.
L’Empire du milieu : Suisse-fictions, Édition NECTAR, 1982. Regroupe onze nouvelles et quatre articles de fond.
2.
Imagine, No 63, mars 1993. Revue canadienne qui contient cinq nouvelles, deux articles et deux port-folios.
3.
Îles sur le toit du monde : une anthologie romande de science-fiction. Université de Lausanne, revue Archipel, novembre 2003, No 24. Regroupe onze nouvelles et un article.
IIUN PEU D’HISTOIRE
Historiquement, c’est au XVIIIe siècle que l’on voit apparaître les premiers auteurs de science-fiction en Suisse. Le Neuchâtelois Emmerich de Vattel (1714-1767) a publié trois recueils qui contiennent des éléments conjecturaux : Pièces diverses, avec quelques lettres de morale et d’amusement (1746) ; Poliergie, ou Mélange de littérature et de poésies (1757) ; Mélanges de littérature, de morale et de politique (1760). Grâce à un élixir inventé par un philosophe indien, le narrateur parvient à s’introduire dans l’esprit d’animaux. Puis c’est au tour du célèbre savant universel Albrecht von Haller (1708-1777) de rédiger, au milieu de sa vaste production scientifique et littéraire, trois utopies : Usong, histoire orientale (1771) ; Alfred, roi des Anglo-Saxons (1773) et Fabius et Caton, fragment de l’histoire romaine
(1774). Le plus fameux directeur des Salines de Bex (de 1758 à 1764) étudie dans ses ouvrages les avantages respectifs du pouvoir absolu, de la monarchie éclairée et du gouvernement républicain.
Le troisième précurseur vit au début du XIXe siècle. Le Genevois Rodolphe Toepffer (1799-1846) invente non seulement la bande dessinée, mais aussi la bande dessinée de science-fiction avec Le Docteur Festus (1830) et Voyages et Aventures du docteur Festus (1833). Dans ces albums, suite à des mésaventures, le docteur Festus gravite par deux fois autour de la Terre, tel un satellite artificiel !
L’Histoire de la prise de Berne et de l’annexion de la Suisse à l’Allemagne est le premier véritable livre de science-fiction suisse. C’est aussi une superbe supercherie littéraire. On peut lire 1921 sur la page de couverture. En réalité, cette brochure anonyme a été publiée en 1872. Elle est due à Samuel Bury, autrefois juge cantonal genevois. C’est l’histoire d’une guerre imaginaire – une uchronie – qui voit la Suisse balayée par la puissance voisine. L’Allemagne veut en effet récupérer l’argent qu’elle a prêté à la Suisse pour la construction de la ligne du Gothard. Et comme la Suisse est incapable de rembourser… C’est, bien sûr, un livre de combat, un violent réquisitoire contre la centralisation, contre la révision de la Constitution fédérale de 1848, qui sera repoussée par le peuple en 1872, puis acceptée en 1874 après quelques allégements.
Ce thème de la guerre imaginaire sera repris plus tard par Willy-A. Prestre. Tocsins dans la nuit (1934) est un livre dur, alarmiste, haineux, qui vise à mettre en garde la Suisse contre une possible agression des armées hitlériennes. Ou par Pierre Dudan, qui n’a pas seulement bu le café au lait au lit, mais aussi rédigé L’Écume des passions (1982), véritable pamphlet de politique-fiction de droite.
Fort heureusement il existe un antidote à ces récits déprimants qui vont de l’avertissement à la xénophobie : l’humour. C’est ainsi que Léon Bopp, dans Drôle de monde (1940), démontre par l’absurde l’absurdité de toute guerre. Hilarantes et non conformistes, ces nouvelles rappellent que la science-fiction a aussi une origine satirique, n’est-ce pas Monsieur Voltaire ? De Léon Bopp, on lira Une fable dans cette anthologie.
L’utopie, la description d’un monde meilleur, est un des courants anciens de la science-fiction. La Suisse n’est pas prodigue en la matière. Haller, bien sûr, mais aussi Charles Secrétan, qui publie en 1892 Mon utopie, nouvelles études morales et sociales. Il s’y montre particulièrement novateur en réclamant l’égalité entre l’homme et la femme, n’y voyant que des avantages. On citera aussi Tefri, pseudonyme de Thérèse Frisch, qui publiera deux utopies nommées Au Gravitor : fantaisie (1960) et Au Piladoc : fantaisie (1963), planètes sur lesquelles de jeunes héros terriens confrontent leurs idées avec des extraterrestres chrétiens.
L’anti-utopie, dite aussi contre-utopie ou encore dystopie, est la description d’un monde pire que le nôtre. La science-fiction suisse a en revanche beaucoup produit d’anti-utopies. La Suisse est une île au milieu de l’Europe qui n’aime pas voir sa tranquillité perturbée.
Voici Pierre Girard, célèbre auteur genevois, un peu oublié maintenant, qui évoque une révolution à Genève à la fin de Monsieur Stark (1943). Le philosophe Jérôme Deshusses qui, avec Sodome-ouest (1966) puis Le Grand Soir (1971), raconte la même histoire sous deux formes différentes : un jour, les citoyens se croisent les bras et décident de tout arrêter. La Vermine (1970), d’Anne Cuneo, décrit l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement communiste provisoire en Italie suite à une révolution et la rentrée au pays de tous les immigrés italiens, plongeant la Suisse dans le chaos. Véritable manifeste anti-xénophobe, cet ouvrage revu et corrigé par l’auteur vient, par le plus grand des hasards, d’être réédité dans la même collection que ce livre-ci, tant il est vrai que la xénophobie fait encore des ravages aujourd’hui. Le chanteur Michel Bühler, avec Avril 1990 (1973), raconte à son tour une révolution en Suisse. Plus humoristique, François Bonnet et La Montagne de beurre (1979). Plus cynique, Jean-Bernard Vuillème et La Tour intérieure (1979).
Ce courant anti-utopique a produit en tout cas un excellent roman et un chef-d’œuvre. Les Panneaux (1978), de Jean-Claude Fontanet, est l’excellent roman. Le pays entier est envahi par des panneaux de topon, matériau mystérieux que l’on ne sait comment détruire, à l’instar des déchets atomiques. La vie de Joseph Clot, paisible retraité, va virer au cauchemar et le pays se transformer en camp retranché.
Le chef-d’œuvre, c’est Soft goulag (1977), d’Yves Velan. Réactualisation du mythe du paradis perdu, ce livre conte les avatars d’Ad et Ev qui ont gagné le droit de faire un enfant dans un monde surpeuplé et saturé où le gaspillage est un véritable crime. Les citoyens, tenus par leur dette, vivent en réalité dans un véritable enfer, dans un goulag mou, où même les sentiments sont abolis. Mais c’est aussi, par son écriture, une réflexion sur la littérature. Pas d’odeurs, dans Soft goulag. Toute l’histoire est racontée par un narrateur comme s’il la regardait défiler sur un écran, entrecoupée d’interruptions publicitaires. N’en déplaise à ses contradicteurs, la science-fiction produit ainsi parfois des monuments littéraires !
D’autres auteurs classifiés « littéraires » justement ont rédigé des romans que Pierre Versins qualifie de « contre-utopies étouffantes ». Des récits, issus de Kafka, qui ont pour caractéristique de rester énigmatique. Dans cette veine, on citera Jean-Michel Junod, Archipel (1970) ; Claude Delarue, La Lagune (1974) ; Jean-Marc Lovay, Les Régions céréalières (1976) ; ou Maurice Schneuwly, L’Épopée de Soxana (1980).
Revenons à l’uchronie. Car l’une des plus fameuses histoires parallèles de la science-fiction mondiale est due à la plume de Léon Bopp, quantitativement l’auteur suisse qui a le plus produit de pages d’anticipation. Son livre, Liaisons du monde (1938-1944), est unique en son genre.
L’histoire commence en 1929 et, jusqu’à la page 110, Léon Bopp se fait le chroniqueur de son temps et ne semble pas avoir eu l’idée d’écrire une uchronie. Au bas de la page 110, on trouve cette note : « Après avoir esquissé, jusqu’ici, l’état du monde et de la France d’une manière assez conforme à la “ réalité ” ou à la “ vérité ” de l’histoire, nous allons faire, de plus en plus grande, dans notre récit, la part de la fiction. Mais nous voulions que cette fiction s’insère dans un cadre à peu près historique. »
N’importe quel écrivain voulant rapporter l’histoire de son temps, voyant que cette histoire était en train de s’accélérer – nous sommes en 1935 – pour partir dans une direction abominable, se serait fait historien ou se serait arrêté. Mais pas Léon Bopp. Il continue, de 1935 à 1944, à rédiger une histoire parallèle à celle qui se déroule dans la réalité. C’est certainement la seule uchronie au monde à avoir été écrite en même temps que l’époque qu’elle décrit !
La première édition, en partie censurée, compte 1947 pages en quatre volumes. La seconde, 1173 pages sur deux colonnes (1949). Léon Bopp a entrepris de rédiger le roman cosmique, mettant en scène des milliers de personnages, où interviennent aussi bien les hommes que les animaux, les végétaux, les microbes, etc. Catalogue d’inventivité, fourmillant d’idées neuves ou folles, Léon Bopp pousse chaque élément jusqu’à la démesure, montrant que toute action entraîne une infinité de réactions dont certaines sont imprévisibles. Le roman de la démesure.
L’autre auteur majeur de la science-fiction helvétique est Noëlle Roger, qui figure aussi dans cette anthologie et dont on trouvera plus de détail sous la notice qui lui est consacrée à la fin du volume.
Autre auteur prolifique, Jules Pittard, qui sous le pseudonyme de Charles de l’Andelyn a publié six romans de science-fiction. Son premier roman, Les Derniers Jours du monde (1931), est probablement le meilleur. Elle n’est certes pas dénuée d’une grandeur tragique, cette histoire d’amour entre le dernier homme et la dernière femme d’une humanité éradiquée de la Terre par le froid. Le reste de l’œuvre de l’Andelyn est à citer, sans plus, tant la psychologie des personnages y est faible et les péripéties invraisemblables. La Prodigieuse Découverte de Georges Lefranc (1935), c’est l’immortalité. Nara le conquérant (1936), un roman préhistorique. Entre la vie et le rêve (1943), au titre suffisamment explicite. « Quant au Voyage à la lune et au-delà (1959) et Il ne faut pas badiner avec le temps (1964), ils font montre d’une méconnaissance totale de ce qui a pu se passer au point de vue scientifique depuis le temps où Héraclite jouait aux billes. » Le jugement de Pierre Versins est sans appel.
Qu’en est-il des voyages dans l’espace ? Les auteurs de science-fiction suisses sont-ils de joyeux conquérants qui repoussent de plus en plus loin les limites de l’univers connu ? Les fans de « Star Wars » vont être déçus.
En effet, en matière de voyage dans l’espace, les auteurs de science-fiction suisses sont particulièrement frileux. Ils se contentent, tout au plus, d’une virée en banlieue. Gine Victor clame, Je suis allé dans la Lune (1969). Son récit décrit une fusée qui tourne trois fois autour de la Lune pour prendre des photos. Bien. Faut-il rappeler que, la même année, un certain Neil Armstrong… Roque Da Silva se rend Sur la planète Mars (1919), qui est « habitée par des hommes qui me ressemblaient comme des frères et qui parlaient la même langue que moi ». Bien pratique. Alfred Chapuis joue sur les mots avec L’Homme dans la Lune (1929), dans lequel une femme rusée fait revenir à elle son mari volage en lui faisant croire qu’il se trouve sur notre satellite. L’auteur de science-fiction suisse n’est pas un conquérant galactique.
Mais il y a des exceptions. Et de fort belles ! En premier lieu Anthéa ou l’étrange planète (1923), de Michel Epuy, qui figure dans cette anthologie. Une petite merveille en son genre. Blaise Cendrars conte aussi les péripéties d’un voyage spatial avec L’Eubage (1926), sorte de science-fiction poétique, en étroite relation avec les signes du zodiaque. Enfin Jean Hercourt, poète genevois, et son vertigineux récit Astrolabe (1949), longue poésie en prose qui conte le voyage à travers les espaces sidéraux d’un homme volant engoncé dans un scaphandre autonome, vaisseau-mère et nourricier. Astrolabe voyage dans l’infiniment grand en compagnie des nébuleuses galactiques et il évoque la grandeur de l’univers, la petitesse de l’homme, la beauté de la création en un puissant délire d’imagination.
Et le voyage dans le temps, alors ? Il y a bien Jean-Claude Froehlich, qui écrit pour la jeunesse des récits préhistoriques comme Voyage au pays de la pierre ancienne (1962) ou Naufrage dans le temps (1965) et La Horde de Gor (1967). L’illustre savant Auguste Piccard s’y est aussi essayé, avec une nouvelle intitulée César, Cléopâtre et Einstein (1957), dans laquelle il joue avec la théorie de la relativité. C’est à peu près tout. En Suisse, le temps, on le mesure avec des montres ; c’est du sérieux, on ne joue pas avec.
Une exception, cependant : les mondes perdus. Il en existe un certain nombre, dont les meilleurs sont peut-être La Vallée perdue (1940) et Le Soleil enseveli (1928) de Noëlle Roger. Dans ce registre, on peut citer aussi le premier roman de Jacques Chenevière, L’Île déserte (1917). Résolument conjectural à ses débuts, Jacques Chenevière consacre son deuxième roman, Jouvence ou la chimère (1922), à l’immortalité.
Le problème de la mort, qui préoccupe tant les philosophes depuis l’aube de l’humanité, interpelle aussi les écrivains. Édouard Rod décrit par le détail L’Autopsie du docteur Z*** (1884) dans le récit qui ouvre ce recueil. Roger Farney raconte l’étrange destin d’un homme qui vit deux fois dans La Double Formule (1931). Noëlle Roger rapporte les tourments du Nouveau Lazarre (1933). Maurice Sandoz parle d’un homme à l’étrange longévité dans Le Labyrinthe (1941).
Et les robots, androïdes, clones et autres machines copiant l’être humain ? Ces thèmes intéressent-ils les auteurs de science-fiction suisses ? Pas vraiment. Des androïdes, peut-être ? Comme La Créature
(1984), d’Étienne Barilier, dont on ignore la vraie nature à la fin. Ou le héros de L’Étalon-or (1984), de Daniel Wehrli, seul roman de science-fiction érotique helvétique, dans lequel le héros a la fâcheuse, et lucrative faculté, de transformer ses partenaires lors du coït en statues d’or.
Alors, il se cache où, le thème favori de nos défricheurs d’imaginaire ?
Nous avons déjà constaté le succès de l’anti-utopie. Dans la même ligne, ce sont les récits catastrophes qui ont la préférence des auteurs de science-fiction suisses : fins du monde, hécatombes cosmiques, cataclysmes naturels et autres accidents atomiques.
Tout commence avec un chef-d’œuvre d’humour, qui n’a jamais été publié en volume. C’est dans deux livraisons successives de la Bibliothèque populaire de la Suisse romande que paraît, en septembre et octobre 1882, l’Histoire de la fin du monde ou la comète de 1904. Personne n’a encore découvert le véritable patronyme de son auteur, dissimulé sous le pseudonyme de Verniculus (hommage appuyé à Jules Verne qui intervient d’ailleurs en tant que personnage dans le récit). Dans ce roman, une comète va croiser la trajectoire de la Terre. Entièrement composée d’hydrogène carboné, autrement dit de grisou, il faudra éviter toute flamme sur la planète pendant quatre jours, sinon la Terre explosera. Pas facile de tenir la gageure, surtout lorsque des nihilistes russes ont décidé de tout faire péter ! Merveilleuse satire politique, chargée de clins d’œil et d’humour léger, l’Histoire de la fin du monde ou la comète de 1904 est une franche réussite. Blaise Cendrars a rédigé un scénario de film, La Fin du monde filmée par l’Ange N.D. (1916), interprétation surréaliste du Jugement Dernier. Charles Ferdinand Ramuz à son tour décrit l’Apocalypse. Présence de la mort (1922) raconte par le menu la fin du monde sur les bords du Léman. La Terre est en train de tomber dans le soleil ; la chaleur augmente sans cesse ; la société perd de plus en plus sa cohésion, on pille les banques à Lausanne, on se livre à des orgies, on massacre les gens de passage. Le Léman et ses alentours, refuge des vraies valeurs, ont souvent permis à Ramuz de montrer le caractère privilégié de ce lieu, sa capacité à atteindre l’universel. Même dans la fin de tout. Noëlle Roger raconte Le Nouveau Déluge (1922), dans lequel il y a quelques survivants et où le bien triomphera du mal. Nous avons déjà rencontré Charles de l’Andelyn avec Les Derniers Jours du monde (1931). Odette Renaud-Vernet passe aussi par là. Sa nouvelle Ce jour-là, publiée dans Xannt : contes fantastiques (1979), est si originale qu’elle méritait bien de figurer dans ce recueil.
La fin du monde n’est pas toujours due à des causes extérieures. Une de nos grandes craintes, c’est qu’elle provienne de la main de l’homme lui-même.
Charles-Albert Reichen nous promet que La fin du monde est pour demain… (1949), dans un curieux ouvrage qui mélange des chapitres de science et d’autres de fiction. Claude Pearson, pseudonyme de Jean Denoréaz, a écrit un livre étonnant sur le péril atomique, La Mort atomique
(1947). Véritable réquisitoire contre les dangers de la science atomique, ce livre apparaît aujourd’hui comme étrangement prophétique avec une description des effets d’une bombe à neutrons, bien avant que cette arme soit inventée. La science-fiction, parfois, peut se révéler prémonitoire. Comme Verniculus en 1882, dans l’ouvrage déjà cité, qui prévoit le téléphone dans tous les ménages et le développement économique du Japon !
Et après la fin du monde ? Il arrive en effet que quelques êtres survivent. Comme chez Eugène Pénard, dans Le Déluge de feu (1912). Edmond Pidoux, dans Une île nommée Newbegin (1977), sauve d’une guerre nucléaire quelques passagers d’un avion pour leur faire tout recommencer. Les vieux essayent bien d’inculquer leur savoir aux jeunes, mais ceux-ci n’écoutent pas… Les primitifs du futur de La Chronique, nouvelle de Jacques-Michel Pittier, in La Corde raide (1980), jouent malencontreusement avec des déchets radioactifs…
Depuis sa création, la Maison d’Ailleurs a focalisé autour d’elle les amateurs de science-fiction. Un certain nombre d’écrivains se sont retrouvés au sein de l’Association des amis de la Maison d’Ailleurs (AMDA). Parmi ceux-ci on peut citer François Rouiller, Georges Panchard, Wildy Petoud, Pascal Ducommun et l’auteur de ces lignes.
On trouvera plus de détail dans les notices consacrées à François Rouiller, Georges Panchard et Wildy Petoud, dont un texte a été retenu au sommaire de cette anthologie.
On relèvera non sans intérêt que les directeurs successifs de la Maison d’Ailleurs ont été aussi auteurs. Quelques nouvelles à l’inimitable style pour Pascal Ducommun. Plusieurs nouvelles pour le journaliste Roger Gaillard, par ailleurs auteur de textes critiques et anthologiste. Enfin, le directeur actuel, l’historien Patrick Gyger, a publié plusieurs livres. Dont un recueil d’essais aux Éditions Antipodes sous sa direction et celle de Gianni Haver : De beaux lendemains ? Histoire, société et politique dans la science-fiction (2002). Et un solide ouvrage illustré : Les Voitures volantes. Souvenirs d’un futur rêvé (2005) aux Éditions Favre. En 2006, il a été nommé parmi « Les 100 personnalités qui font la Suisse romande » par le magazine L’Hebdo.
D’autres écrivains, non liés au musée d’Yverdon-les-Bains, se sont illustrés dans les littératures de l’imaginaire.
Professeur retraité de l’EPFL, conseiller national, Jacques Neyrinck est probablement le seul écrivain de science-fiction à avoir dirigé le Parlement de son pays ! Auteur, avec Alex Décotte, de Et Malville explosa (1988), roman-catastrophe destiné à lutter contre l’énergie nucléaire, il persévéra dans la même ligne avec Les Cendres de Superphénix (1997). Le Manuscrit du Saint-Sépulcre (1994) est une anticipation religieuse qui se termine par l’élection d’un pape suisse. Dans L’Ange dans le placard (1999), une équipe de chercheurs tente de prouver scientifiquement l’existence de l’âme. Écrivain prolifique, Jacques Neyrinck est auteur d’une quinzaine d’ouvrages, dont des polars historiques et des essais sur la science et les religions.
Prolifique, c’est aussi le cas d’Olivier Sillig, né en 1951, dont le premier roman, Bzjeurd (1995), récit de vengeance déroutant dans un décor boueux à souhait, servi par une écriture originale, a été d’emblée remarqué par la critique et réédité en livre de poche. Depuis, Olivier Sillig a publié quatre nouveaux romans et en a plusieurs en réserve…
D’autres auteurs encore se sont laissé entraîner dans les vastes contrées des littératures de l’imaginaire. Marie-Claire Dewarrat, dont plusieurs nouvelles de En enfer, mon amour (1990), renouent avec la tradition fantastique. De sa plume, on lira Le Trou dans cet ouvrage. Bernard Comment, dont la fable isolationniste, Château d’eau (1998), figure aussi en bonne place dans ce recueil. Jean-Michel Junod, dont plusieurs nouvelles du Cri du dinosaure (1999) font intervenir un détail troublant, déplacé, incongru. Alex Muller, membre de l’association vaudoise des écrivains, est l’auteur de Billets doux (1995), recueil de contes, et d’un Guide du tourisme intergalactique (1999), où l’on trouve même un lexique français/intergalacte à la fin… Dans l’impossibilité de tout lire, il existe certainement d’autres auteurs et/ou textes qui ont échappé à ce modeste recensement. Ces auteurs voudront bien nous pardonner.
IIISPÉCIFICITÉ DE LA SCIENCE-FICTIONSUISSE ROMANDE
On peut estimer à plus de deux cents titres les livres de science-fiction d’auteurs suisses romands. Ces auteurs ne sont pas étiquetés « écrivains de science-fiction » et ne se considèrent certainement pas comme tels. Ils ne publient pas dans des collections spécialisées. Ils viennent des horizons les plus divers. De l’université : Charles Secrétan, Hubert Matthey ; de la science : Auguste Piccard ; des deux : Jacques Neyrinck ; de la littérature : C. F. Ramuz, Léon Bopp ; de la chanson : Michel Bühler ; du droit : Samuel Bury. Tout se passe comme si les écrivains de littérature générale s’abandonnaient parfois à écrire une œuvre de science-fiction, par hasard.
Pourtant, une poignée d’auteurs romands ont produit plusieurs textes conjecturaux, montrant en cela leur intérêt pour les littératures de l’imaginaire.
Noëlle Roger a publié huit romans et un recueil de nouvelles dans le domaine. Léon Bopp a tant publié que sa contribution à la conjecture ne constitue qu’une partie de son œuvre, mais elle est imposante, quantitativement et qualitativement. On trouve aussi des éléments conjecturaux dans son roman Jacques Arnaut et la somme romanesque (1935). Charles de l’Andelyn a touché à plusieurs thèmes, mais de façon maladroite. On peut encore citer Tefri, avec cinq œuvres. Ou, plus près de nous, Jacques Neyrinck.
On peut résumer ainsi les grandes étapes de l’histoire de la science-fiction suisse romande.
1.
Des origines à la fin de la Première Guerre mondiale,on trouve rarement de la science-fiction, mais les œuvres rencontrées sont de qualité. Verniculus et Bury assènent avec humour leur satire politique contre le centralisme helvétique. Secrétan fait montre d’idées sociales révolutionnaires. Hubert Matthey publie sa thèse sur le merveilleux.
2.
Au cours de l’entre-deux-guerres (1919-1939), les auteurs suisses romands se livrent à une vaste exploration des thèmes classiques de la science-fiction. On y trouve toute l’œuvre de Noëlle Roger et la première partie de celle de Charles de l’Andelyn.
3.
Léon Bopp marque la Seconde Guerre mondiale de tout son talent.
4.
Mornes années d’après-guerre. Nombreuses œuvres sans intérêt, comme si l’on ne savait plus quoi dire, alors qu’aux États-Unis la science-fiction dite « classique » est en plein essor.
5.
Un réveil se produit peu avant, mais surtout après Mai 68. Jérôme Deshusses, Yves Velan, Michel Bühler, Claude Delarue, Jean-Marc Lovay, etc. On constate l’arrivée en force de l’anti-utopie, dont le thème dominant est la critique sociale. D’autre part les auteurs savent maintenant qu’ils écrivent de la science-fiction et le font même parfois délibérément.
En définitive, la science-fiction suisse romande, au contraire de ses homologues française et américaine, n’a jamais constitué un mouvement d’ensemble. Les œuvres qui la constituent ont été publiées isolément.
IVAUJOURD’HUI
Depuis quelques années cependant, un mouvement se dessine. Il semble que la science-fiction suisse soit en train de s’organiser, à l’instar de ce qui s’est passé dans les autres pays francophones comme la France, la Belgique ou le Canada.
Sous l’impulsion de Vincent Gessler, les « Mercredis de la SF » sont le lieu de rendez-vous de jeunes auteurs débutants qui se réclament ouvertement des littératures de l’imaginaire : science-fiction, fantastique et fantasy. Ces réunions se tiennent une fois par mois depuis 2003, d’abord à Genève, mais aussi à Lausanne. Il est courant d’y compter une dizaine de personnes, mais parfois le nombre de participants a dépassé la vingtaine.
Parmi ces jeunes auteurs, certains commencent à publier des nouvelles dans des anthologies ou des revues spécialisées. C’est le cas de Sandrine Bettinelli, Sébastien Cevey, Vincent Gerber, Vincent Gessler, Sébastien Gollut, Bertrand Graz, Simon Koch, André Ourednik, Laurence Rodriguez, David Ruzicka, Thomas Sandoz, Laurence Scheurer, Laurence Suhner (par ailleurs dessinatrice), Robin Tecon. En historien de la littérature, Frédéric Jaccaud consacre de nombreux articles de fond aux précurseurs de la science-fiction dans les pages de la revue Bifrost. En cette fin d’année 2008, il lance une nouvelle collection « Terra incognita », aux Éditions Terre de Brume, qui propose de redécouvrir des œuvres anciennes, parlant d’autres mondes ou d’autres temps. Anthony Vallat participe, en compagnie de François Rouiller et de l’auteur de cette préface, à un « Dictionnaire encyclopédique des littératures de l’imaginaire » qui paraîtra en 2010 aux Éditions L’Atalante, à Nantes. Lucas Moreno, auteur et traducteur, a créé avec Marc Tiefenauer un podcast nommé « Utopod » sur lequel il diffuse des nouvelles lues par des comédiens. Florence Cochet a déjà publié un roman, La Prophétie d’Ashen-Shâ (Éditions Bénévent, 2005). Emmanuelle Maia en a publié deux : La Croix du néant (2004) et Résurgences (2006), tous deux chez l’éditeur Nuit d’Avril. Hervé Thiellement en a publié deux aussi : Les Souterriens (2005) et Les Hybrides (2006) aux Éditions Amalthée. Yvan Bidiville commence à publier une trilogie de fantasy avec Les Nouvelles Références (2008). Que ceux que j’aurais oubliés de citer veuillent bien me pardonner !
L’université aussi se manifeste ! Sous l’impulsion de la professeure et vice-rectrice de l’université de Lausanne Danielle Chaperon, la science-fiction a enfin fait son entrée officielle à l’Université en Suisse. Marc Atallah, assistant diplômé dans cette même université, intéressé par la philosophie de la science-fiction, a défendu début juin 2008 une thèse intitulée « Écrire demain, penser aujourd’hui. La science-fiction à la croisée des disciplines : façonner une poétique, esquisser une pragmatique. »
Ateliers d’écriture, participation assidue à des festivals et congrès, réunions informelles sont d’autres aspects de la grande activité déployée par ces jeunes auteurs. Une nouvelle génération d’écrivains gravitant autour des littératures de l’imaginaire semble avoir pris conscience que l’union fait la force. Gageons que nous aurons bientôt l’opportunité de lire des œuvres plus ambitieuses issues de leur plume.
VCETTE ANTHOLOGIE
Les textes retenus pour cette anthologie ont donc tous déjà connu la publication. À travers eux le lecteur pourra voir la diversité des thèmes, des styles et des auteurs qui caractérisent la science-fiction suisse romande. Nous avons privilégié la forme courte et notre promenade en compagnie de ces défricheurs d’imaginaire commence en 1884.
Au sommaire :
1.
Édouard Rod
L’Autopsie du docteur Z***
1884
2.
Michel Epuy
Anthéa ou l’étrange planète
1918
3.
Roger Farney
Les Anekphantes
1931
4.
Albert Roulier
La Grande Découverte du savant Isobard
1938
5.
Léon Bopp
Une fable
1940
6.
Noëlle Roger
Les Secrets de Monsieur Merlin
1949
7.
Jean Villard Gilles
Le Feu de DieuSoucoupes volantesLes SurhommesLes Soudard
1950195419571962
8.
Gabrielle Faure
Homo Ludens
1979
9.
Odette Renaud-Vernet
Ce jour-là
1979
10.
Jacques-Michel Pittier
Ego Lane
1980
11.
Wildy Petoud
La Maison de l’araignée
1986
12.
Rolf Kesselring
Martien vole
1988
13.
Marie-Claire Dewarrat
Le Trou
1990
14.
Bernard Comment
Château d’eau
1998
15.
Claude Luezior-Dessibourg
Granules
2001
16.
Sylvie Neeman Romascano
Mais aussi un cadenas, des menottes, une bille et un désir
2003
17.
François Rouiller
Délocalisation
2004
18.
Georges Panchard
Comme une fumée
2004
JEAN-FRANÇOIS THOMAS
ÉDOUARDROD
L’Autopsie du docteur Z***
Pour moi qui ne sais rien et vais du doute au rêve,
Je crois qu’après la mort, quand l’union s’achève,
L’âme retrouve alors la vue et la clarté,
Et que, jugeant son œuvre avec sérénité,
Comprenant sans obstacle et s’expliquant sans peine,
Comme ses sœurs du ciel elle est puissante et reine,
Se mesure au vrai poids, connaît visiblement
Que le souffle était faux par le faux instrument,
N’était ni glorieux ni vil, n’étant pas libre ;
Que le corps seulement empêchait l’équilibre ;
Et, calme, elle reprend, dans l’idéal bonheur,
La sainte égalité des esprits du Seigneur.
ALFRED DE VIGNY
La Flûte
ON SE RAPPELLE peut-être encore, dans le monde scientifique, le bruit que firent, il y a une trentaine d’années, les découvertes du docteur Z***, qui d’ailleurs eurent le sort de beaucoup de découvertes et furent universellement niées. Au moment où il se décida enfin à publier le résultat de ses patientes recherches, le docteur Z*** habitait Bordeaux, et jouissait d’une renommée de bon praticien. La brochure dont il fit les frais : Observations sur quelques phénomènes de l’existence cérébrale, souleva un « tollé » général, et lui enleva peu à peu toute sa clientèle. Il faut dire aussi que cette brochure – un in-octavo d’environ cent-vingt pages, – bouleversait toutes les notions reçues, menaçant à la fois, par ses conséquences indirectes, la science, la morale et la religion. En effet, le physiologiste prétendait que la vie du cerveau ne s’éteint pas en même temps que celle du corps, qu’au contraire, elle continue pendant une période qui varie de sept à dix jours après le dernier soupir (sauf, bien entendu, dans les cas où le cerveau a été lui-même directement attaqué par la maladie, comme dans les méningites, encéphalites, paralysie générale, ramollissement, ataxie, etc.). Il allait plus loin : il affirmait que, tandis que pendant la vie les cellules cérébrales consumées par la pensée se reforment sans cesse, elles sont irrévocablement détruites après la mort : de sorte que le cerveau, encore intact et en pleine activité au moment où le cœur cesse de battre, quoique déjà dégagé de la sensation par l’usure ou la faiblesse des centres nerveux inférieurs, s’élimine peu à peu dans ce suprême travail.
Aussi bon mécanicien qu’il était excellent chimiste, le docteur Z*** construisit lui-même un appareil – qui, autant que je m’en souviens, ressemblait un peu à l’instrument qu’on inventa depuis et qu’on nomma « photophone » – avec lequel il pouvait, quatre ou cinq jours encore après le décès, suivre le jeu des cerveaux en pleine décomposition. Il détruisit cet instrument, comme il brûla ses observations, en voyant qu’on lui refusait toute créance, que les plus indulgents le traitaient de fou et les autres de charlatan. Rien ne reste donc de ses grands travaux, et, quand la science aura enfin déchiffré l’énigme de la mort, nul ne pourra savoir si l’obscur praticien de Bordeaux était un précurseur ou un faiseur de dupes. Pour moi, qui l’ai connu, qui l’ai vu travailler, qui ai écouté bien des fois, dans son laboratoire, ses causeries toutes pleines d’aperçus lumineux, ses raisonnements partis de la plus minutieuse observation pour s’élever jusqu’à ces hauteurs où la pensée peut enfin se dégager de la tyrannie du fait, ses déductions dont tous les anneaux étaient enchaînés par la logique la plus sévère, – pour moi, je l’ai toujours regardé comme un de ces phares que l’ignorance et la bêtise humaines se plaisent trop souvent à éteindre, par crainte de voir s’illuminer les ténèbres de leur routine.
Je n’entends point m’étendre ici sur les théories du docteur Z***, ni raconter son histoire personnelle, – qui pourtant serait instructive : il convient, je crois, de le laisser dans l’obscurité où la fatalité le relégua, – et à laquelle il se résigna sans peine. Mais il lui fut donné, une fois, de lire avec une absolue clarté dans cette dernière période de la vie que lui seul a connue, – et je veux rappeler les circonstances de ce cas étrange :
Un armateur de Bordeaux, d’origine hollandaise, M. van Gelt, se suicida vers 1854. Sa famille prit tant de précautions pour cacher ce funeste événement, que des bruits malveillants ne tardèrent pas à circuler dans le public, où M. van Gelt était fort estimé : les secrets de sa vie intime, qui avaient transpiré depuis longtemps, donnaient à ces commérages une certaine consistance. La famille elle-même dut demander une enquête, et le docteur Z***, alors encore en vogue, fut chargé de l’autopsie.
Il communiqua ses observations chirurgicales à la justice, mais il garda pour lui toute la psychologie du mort, qu’il avait lue comme dans un livre dans le cerveau à peine assoupi. L’armateur van Gelt était évidemment un homme de haute intelligence et de grand cœur : aussi, ses idées posthumes présentaient-elles un caractère de supériorité que le docteur Z*** n’avait jamais rencontré. Il collationna ses notes avec amour, en leur conservant leur forme personnelle. Le jour où il me les communiqua – lisant son manuscrit comme un auteur vous lit un chapitre de roman, – je restai stupéfait : le mort « vivait », pour ainsi dire, devant moi, sa vie étrange de cadavre. Je suppliai mon ami de me donner un double de son cahier. Il y consentit, – sous la réserve expresse que je ne le publierais pas avant qu’il ait publié le grand ouvrage dont ses « observations » n’étaient que la préface. J’ai dit quel avait été le sort de ses écrits. Il est mort lui-même : je puis donc me regarder comme délié de ma parole et livrer au public ce curieux document, qui, si je ne me trompe, jettera un jour nouveau sur les mystères jusqu’à présent insondés de l’éternité. Le seul changement que je me permette d’y introduire, et qui m’a paru nécessaire à l’intelligence de l’écrit, porte sur l’ordre des faits : j’ai réuni dans les premières pages les détails relatifs aux circonstances du suicide, qui, dans les notes, se trouvaient dispersés comme au hasard du souvenir.
… J’avais épuisé ce qu’on est convenu d’appeler le calice de la souffrance : depuis quelque temps, les catastrophes se superposaient sur moi comme de lourdes pierres sur un homme qu’on murerait vivant, le malheur me poursuivait avec une ténacité presque incroyable à force d’être féroce. D’abord, ce fut mon fils unique, un garçon de vingt-six ans, qui s’enfuit avec une créature, après m’avoir « volé » comme un caissier infidèle. Puis, ma fille mourut d’une fièvre typhoïde au moment où j’allais la fiancer à un jeune homme qu’elle aimait. Peu de temps après, je découvris que ma seconde femme – que j’avais épousée sans dot, par amour, moi, vieillard, – me trompait avec un de mes neveux, auquel j’avais fait une situation dans ma maison, que je regardais, hélas ! comme un second fils : rendu lâche par cet amour presque sénile, presque ridicule, dont les racines étouffaient mon courage, j’acceptai avec des tortures intérieures mon rôle de mari trompé, mendiant à la misérable le rebut de ses tendresses, m’ingéniant à cacher une blessure qui s’élargissait chaque jour. Abattu par tant d’émotions, je me trouvai peu bien. Je consultai : le médecin reconnut que mon état morbide était causé par les premiers symptômes d’une affection cancéreuse à l’estomac. Enfin, à la suite d’un sinistre qui coïncidait fatalement à une crise financière à Lyon, je vis arriver le moment où je ne pourrais plus faire face à mes échéances. À soixante-deux ans, à la fin d’une carrière honorable, après avoir travaillé et fait le bien, je me trouvais donc entouré d’affections mensongères, trompé, malade et pauvre.
Parmi le peu d’idées qui pouvaient encore germer dans mon cerveau labouré comme par des serres d’oiseaux de proie, il se glissa une comparaison entre mon sort et celui de Job. Et je me trouvai plus malheureux que le patriarche : il avait Dieu ; moi, pendant mon existence surmenée, je ne m’étais point occupé des choses surnaturelles, qui m’inspiraient une insurmontable méfiance et même un peu de ce dégoût que les hommes d’action ont pour les rêveries des contemplatifs. À cette heure, arraché à toute activité, forcé à d’amers retours sur moi-même, rêvant pour la première fois peut-être de ma vie, et rêvant devant ma douleur, je me pris à désirer la foi, que les malheureux regardent comme la panacée suprême. Mais, pour l’acquérir, il aurait fallu du temps ; et puis, parviendrais-je jamais à vaincre mon scepticisme enraciné ? le besoin de vérité inné en moi ne triompherait-il pas toujours des suggestions de mon sentimentalisme ? Certainement, malgré mes efforts, des doutes subsisteraient en moi, empoisonnant les consolations du prêtre. Cet asile m’était donc refusé. Il m’en restait un autre, plus sûr : la mort ; je l’acceptai.
La crainte de la faillite vainquit mes dernières hésitations. En d’autres temps, j’aurais tendu mes muscles, raidi ma volonté, lutté jusqu’à la défaite finale. Mais je me sentais paralysé par une lassitude définitive, comme un naufragé dont les membres s’alourdissent, qui perd les sens et s’abandonne. Je n’attendis même pas que la certitude de mon désastre fût absolue : la probabilité me suffit, et j’achetai un revolver américain.
… Je rentrai chez moi, je m’enfermai dans mon cabinet de travail ; et là, tout en promenant les yeux sur ces cartons remplis de papiers où stagnait mon activité entière, sur les vieux meubles curieusement travaillés dont j’aimais à m’entourer, sur les quelques tableaux de prix appendus aux murailles, je rêvai longuement. Ma vie repassa devant moi par images dont les couleurs chantaient des symphonies étranges : je me mis à remonter le cours du temps en m’arrêtant à des dates inoubliables ; j’arrivai à ces lointaines années de jeunesse où je bataillais furieusement pour vivre, le cœur gonflé d’ambitions démesurées, tourmenté par des appétits irrassasiés ; et je m’y reposai avec délices, tandis que certains détails charmants émergeaient peu à peu de la teinte monotone du passé, pareils à des trouées de lumière dans le brouillard. Un souvenir entre tous les autres me poursuivit longtemps, et me faisait sourire : c’était au mois de mai ; j’avais quitté la mansarde obscure de la rue des Jeûneurs où je rentrais après mes longues journées de travail ; je me promenais dans les bois de Meudon avec ma première maîtresse, – une modiste blonde, svelte, rieuse, qui m’aimait comme je l’aimais, sans arrière-pensée, sans idées de lendemain, pour le plaisir que nous nous donnions l’un à l’autre. Nous avions un peu d’argent, et nous buvions du lait chaud dans une ferme. Tout à coup, elle fit un mouvement, le lait se répandit sur sa belle robe des dimanches. Elle fut consternée. Nous étions cachés par des touffes d’arbres : je l’embrassai longuement, elle oublia son chagrin. Elle s’appelait Marguerite. Il y avait des fleurs partout…
… La pendule, sonnant minuit, me tira de ma rêverie : les intervalles entre chaque coup me semblaient longs ; le timbre, cuivré, sonore, était lugubre. Je compris que cette heure avait réellement quelque chose de solennel ; en l’entendant tomber dans le lourd silence de ma dernière nuit, je m’expliquai pourquoi on la désignait pour le crime. Et je me dis qu’il fallait en finir. Aussi bien, je n’avais plus rien à faire : ni testament, puisque ma succession se bouclerait probablement par un déficit, ni lettres, puisque ceux que j’aimais ne m’aimaient pas et apprendraient ma mort d’un œil sec. J’écrivis seulement sur une grande feuille de papier que je mis en évidence :
« Aujourd’hui, 26 juin 1854, je me suis donné la mort. »
Et je signai. Comme minuit venait à peine de sonner, j’avais eu, pour mettre la date, une légère hésitation.
(Cette feuille de papier, égarée d’abord, fut retrouvée par l’enquête judiciaire, quelques jours après que le docteur Z*** m’eut communiqué ses notes, et leva tous les doutes sur la fin de M. van Gelt.)
Ma décision était bien prise ; je conservais tout mon calme, mais il me semblait que j’agissais dans un rêve, que rien de ce qui se passait n’était définitif, que je m’éveillerais tout à coup avec des horizons nouveaux devant moi, comme dans une splendide aurore, – et sans avoir pour cela besoin d’agir. Alors, je me renfonçais dans mon fauteuil, les yeux attachés sur l’arme dont le canon reluisait aux feux de la lampe, m’hypnotisant. Une grande torpeur m’envahissait. Des visions de plus en plus vagues flottaient devant moi et par moments me faisaient sourire. J’aurais voulu rester éternellement ainsi, laissant couler le temps sans perdre la conscience de sa durée et pourtant sans plus sentir, sans plus penser… Puis, tout à coup, le souvenir de la résolution qu’il fallait exécuter me revint, la réalité me reprit : je me secouai comme un homme prêt à s’endormir qui se rappelle soudain une affaire négligée, et, d’un effort, chasse le sommeil.
Ce fut presque machinalement que j’ouvris ma redingote, mon gilet, ma chemise. Je cherchai la place du cœur, qui se mit à battre avec violence sous ma main, comme pour affirmer, par ses coups précipités, sa force de vivre. En même temps, je sentais un froid glacial courir dans mes os : je crois que mes dents claquèrent ; pourtant, mon front était inondé de sueur. Je fis des gestes d’angoisse : je souffrais comme un malade auquel on va faire une douloureuse opération, qui a peur et qui veut quand même, et qui repousse le chirurgien en lui criant : faites donc !… Cependant, la volonté triompha des dernières révoltes de l’instinct, dans une lutte suprême, si rapide et si passionnée qu’elle me parut un spasme : je pus prendre le revolver, dont la crosse d’ivoire me brûlait la main. Je plaçai la bouche un peu au-dessus de l’endroit où mon cœur bondissait, en ayant soin de ménager quelque espace entre ma chair et le canon de l’arme, qui tremblait tellement que je dus l’assurer à l’aide de la main gauche. Enfin, dans un frémissement de tout mon être, dominé par une terreur épouvantable de l’inconnu dressé devant moi, repris soudain par des désirs de vivre poignants comme des remords et par des regrets plus aigus eux-mêmes que toutes les douleurs, – je pressai la gâchette. Vraiment, je crois que ma volonté, à cet instant précis, était annihilée, – consumée qu’elle avait été par son dernier effort : les nerfs abandonnés exécutaient simplement d’eux-mêmes un mouvement commencé. Je sentis une douleur atroce, mais ne perdis pas connaissance : sans doute, je n’avais fait que me casser une côte ; c’était à recommencer. Mais j’étais pris d’une sorte de délire : machinalement, je pressai encore deux fois la détente, sans entendre le bruit des détonations. Le dernier coup frappa juste, car je sentis mon cœur qui cessait de battre, mon sang qui s’arrêtait dans mes veines et une grande raideur qui étirait mes membres, comme la main d’un géant invisible…………………………………………………… Je suis mort, je n’en puis douter. Alors, par quel miracle la Pensée et la Sensation s’obstinent-elles à subsister en moi ? Mes yeux ne voient plus, et j’ai la vision merveilleusement précise de ce qui m’entoure ; mes oreilles n’entendent plus, et les moindres bruits – le bourdonnement d’un papillon de nuit resté dans la chambre, les lointains murmures du dehors, le crépitement de la lampe qui va s’éteindre – me semblent répercutés en moi-même comme par un écho très clair, mes membres sont déjà raides, et je sens, à peine adoucie par un tapis épais, la dureté du parquet sur lequel j’ai glissé ; je perçois jusqu’à l’odeur de poudre qui remplit la pièce. J’analyse ma situation avec une lucidité supérieure à celle que j’ai jamais déployée. « Sans doute, me dis-je, cet état ne va pas se prolonger : mes pensées s’arrêteront peu à peu, comme mes membres se glacent et se raidissent (cette double sensation de froid et de raideur m’est excessivement pénible) ; et tout mon être s’endormira dans le bon repos final. » Même il me revient à la mémoire – car mes facultés continuent leur jeu comme tout à l’heure, mieux peut-être – que j’ai entendu exposer, dans une conférence, les effets de l’empoisonnement par le curare : et je pense qu’il se produit en moi un phénomène de même nature, que je ne mourrai pas d’un seul coup, qu’il faut patienter………………………………………. Mais non ! Aucune diminution appréciable dans mes souffrances physiques, pas le plus léger trouble dans mes raisonnements ; et ce froid, ce froid terrible qui me glace jusqu’à la moelle sans que je puisse même grelotter comme jadis, lorsque j’étais jeune et couchais dans une chambre sans feu !… Et voilà qu’à ces douleurs précises une poignante inquiétude vient s’ajouter : si c’était là cette immortalité de l’âme dont on parle ? S’il fallait rester ainsi pendant le cycle des âges éternels, à la fois mort et vivant, la Pensée persistant dans le corps raide et froid, et qui se décomposerait ?… Qui sait ? peut-être que Dieu existe, peut-être que c’est là la dernière torture qu’il nous inflige, peut-être punit-il ainsi ceux qui n’ont pas su l’entrevoir dans son infini ou qui ont transgressé ses lois mystérieuses ?… Y a-t-il des prières qui pourraient le toucher ?…
Les minutes et les heures tombent avec une indicible lenteur : je me mets à songer aux cataleptiques qu’on enterre vivants, qui se réveillent dans la tombe avec des hurlements que la terre étouffe, et se rongent les poings, et se convulsent dans les affres de l’asphyxie. Si, par suite d’une lésion étrange, comme il ne s’en est jamais produit, que la chirurgie ne soupçonne même pas, – si j’étais seulement en catalepsie ? Si j’allais me réveiller dans trois, quatre, huit jours, et hurler dans le silence de la terre, et me convulser avec un poids immuable sur la poitrine ?… Mais non, c’est impossible : je suis mort, je suis bien mort. Le corps humain est soumis à des lois précises, on l’a démonté pièce à pièce comme une machine dont on connaît les moindres rouages : or, j’ai senti la balle passer dans mon cœur ; donc, je n’ai plus rien à craindre : mes idées vont se calmer peu à peu, le silence va se faire en moi. Mon état actuel est logique : sans doute tous les morts l’ont connu, tous ont éprouvé les mêmes angoisses, – et tous se sont apaisés comme je m’apaiserai…
… Cependant, le petit jour commence à poindre en des lueurs blafardes qui traînent sur moi. Des bruits se font dans la rue, qui me parviennent comme au travers d’une épaisse paroi. Encore quelques instants, et mon valet de chambre, habitué à m’éveiller de bonne heure, viendra frapper à la porte ; ne recevant pas de réponse, il entrera… C’est un brave homme, qui me sert depuis dix ans. J’ai été bon pour lui, en plusieurs circonstances : il me regrettera peut-être… Puis, ma femme entrera à son tour, et mon neveu… Et je sens un frisson passer en moi à l’idée que je pourrai tout à l’heure mesurer irrévocablement leur affection…………………… On frappe à la porte : depuis dix ans, les mêmes coups étaient frappés chaque matin, et c’était ma voix qui répondait… Comme la réponse ne vient pas, on frappe de nouveau, plus fort… La porte s’ouvre…
… Jean devient aussi pâle que je dois l’être, étouffe un cri, fait un mouvement pour sortir, hésite sur le seuil, rentre et ferme la porte avec précautions… Il s’approche de moi, met la main sur mon cœur, écoute… Il me porte sur mon lit. Pourquoi me regarde-t-il d’un air si effrayé ? Pourquoi me tourne-t-il contre le mur ? Je le vois quand même, puisque mes facultés sont en quelque sorte dégagées de mes sens, puisque je vis une vie supérieure et indépendante, puisque ma vision est plus vaste malgré la fixité de mes yeux…
Que va-t-il faire ?…
Il s’approche de mon secrétaire, auquel j’ai laissé la clef… Il l’ouvre… Il fouille dans les tiroirs, s’acharne à faire jouer un secret qu’il ne connaît pas, compte l’argent… J’entends le bruit sec des louis dans sa main… Et, le vol accompli, quoique ses jambes flageolent, quoique ses dents claquent encore d’épouvante, tout défait, il s’élance hors de la chambre en appelant au secours… On dira : « Ce domestique était bien attaché à son maître, bien fidèle, on n’en trouve plus de pareils aujourd’hui… »
… Après tout, c’est un pauvre homme. Il n’aurait jamais eu le courage de me voler vivant, peut-être pas l’idée ; et pourtant, la vue de mon cadavre l’épouvantait plus que la justice, à laquelle il ne songeait point. Il faut donc qu’il ait été poussé par un motif bien puissant : sans doute, il a deviné tout de suite les causes de mon suicide, il a été frappé par l’intelligence nette et subite de sa situation : il n’est plus jeune, il avait compté rester à mon service jusqu’à ce que je lui fisse une petite rente, ou, si je mourais avant lui, qu’il serait porté sur mon testament ; au lieu de cela, c’est le hasard des places qui recommence, tout l’arrangement paisible de sa vie est troublé… Et puis, qui sait par quelle école précédente il a passé, qui sait les circonstances qui l’ont rendu mauvais ou défiant ? des jours sans pain ont peut-être développé en lui des appétits plus forts que la conscience, qui tôt ou tard devaient le plier à leur irrésistible domination. Il a vécu dix ans à côté de moi, sans que je me sois jamais informé de sa vie : peut-être qu’il a été abandonné tout enfant ; ou bien son père le battait sans raison, ou sa mère ne l’aimait pas… Et puis, après tout, je n’ai plus besoin de l’argent qu’il m’a pris. Il me faut un effort de mémoire pour me rappeler que j’ai travaillé toute ma vie pour en gagner, que je me suis tué parce que j’allais en manquer, que d’autres se tuent pour la même raison et vivent comme j’ai vécu… Il y a deux jours, si j’avais trouvé dans la conduite de Jean la moindre irrégularité, je l’aurais chassé, sans hésitation ; pour le plus léger délit, je l’aurais impitoyablement traîné devant les tribunaux, parce que j’étais rigide, et de ceux qui regardent comme un devoir pour les honnêtes gens de poursuivre le mal. À présent, je voudrais pouvoir me lever pour dire à cet homme, dont la conscience est sans doute en tourments, que je lui pardonne. C’est sans doute le détachement qui commence ; ou peut-être les choses m’apparaissent-elles sous un autre jour ?………………………………..
Ma femme entre dans la chambre, elle dit :
— Laissez-moi seule !…
Nous voilà face à face, le bourreau et la victime. Et la mort a interverti les rôles : c’est elle qui souffre, maintenant ; je vois passer sur son visage les traces de ses émotions ou de ses remords ; c’est moi qui suis placide et tranquille. Elle s’approche de moi, lentement, comme fascinée ; elle ferme mes yeux, dont la fixité la gênait sans doute ; puis elle recule… Je ne connaîtrai jamais ses pensées.
Peut-être, moi qui voulais son bonheur, l’ai-je rendue malheureuse. Je me rappelle comme elle était triste avant le mariage ; et cela ne m’inquiétait pas ; je me disais : « C’est l’inconnu de sa vie nouvelle qui la trouble… » Ses parents la forçaient, j’en suis sûr. Elle en aimait peut-être un autre, avec la chasteté toute-puissante du premier amour, et j’ai sans doute blessé ses délicatesses de vierge comme je renversais ses rêves de jeune fille. Elle a dû me maudire…
Elle se rapproche de moi, toute pâle. Elle touche ma main. Elle recule de nouveau avec un mouvement de crainte, comme si cette main glacée la brûlait…
Je ne me fais pourtant nul reproche, car j’ai agi comme les autres hommes : l’égoïsme m’aveuglait, j’ai cru donner le bonheur en le prenant ; c’est là une illusion commune. Elle a souffert par moi : qu’importe ? Il ne reste rien de ses larmes, pas plus qu’il ne subsistera quelque chose de ses regrets. Moi aussi, j’ai pleuré pour elle : déjà je m’en souviens à peine ; et qui le sait ?…
La porte s’ouvre de nouveau : c’est mon neveu.
Il s’arrête à quelques pas d’elle, il vient plus près. Tous deux sont graves… Je n’ai jamais calculé leurs luttes, je ne me suis pas dit que leur faute leur avait sans doute coûté bien cher, qu’ils s’aimaient et se rendaient compte de ce qu’ils appelaient leur infamie, mais que l’amour triomphe de tout selon la loi de la nature : que de choses que les vivants trouvent monstrueuses leur paraîtraient naturelles, si les passions du moment ne les aveuglaient pas !…
Cependant, elle appuie sa tête sur son épaule, avec ce mouvement gracieux de la femme qui demande protection ; et la gorge pleine de sanglots, elle dit :
— Il était pourtant bien bon !…
… Ai-je été bon ? Je ne le crois pas. Je ne valais ni plus, ni moins que qui que ce fût, la règle qui mesurait mes actions était la règle communément appliquée. J’ai donné à des mendiants et j’ai laissé mourir de faim des pauvres ; selon le caprice des circonstances, j’ai senti mon cœur prêt à fondre à la pitié ou plus dur que les pierres ; j’ai respecté les lois, mais je me servais aussi d’elles pour la défense de mes intérêts ; entre deux partis, j’ai toujours choisi celui auquel j’étais le plus fortement déterminé par des motifs qui tyrannisaient ma volonté. En somme, à présent que je puis juger ma vie dans son ensemble, je ne regrette rien de ce que j’ai fait et ne voudrais point avoir fait autre chose ; et pourtant, mon activité m’apparaît comme bornée, inutile et fatale.
… Après un silence, il répond :
— C’était un vrai père pour moi !
… Je me trompais donc sur son compte. Je le croyais ingrat : il a été malheureux. Elle reprend :
— Mon Dieu, que nous sommes coupables !
Et ils restent honteux devant moi ; puis, elle se jette en pleurant dans ses bras…
Ah ! je voudrais me lever et leur dire : « Aimez-vous ! aimez-vous ! non certes pour la jouissance de l’amour, qui n’en vaut pas la peine, mais parce qu’il ne vaut pas la peine non plus de lutter contre ses désirs ! » Ils sont jeunes, ils sont beaux, le sang fermente dans leurs veines : de quel droit, moi, vieillard, qui avais eu déjà ma part de joies, voulais-je les séparer ?…
… Les heures marchent. Il me semble qu’une modification s’est produite dans mon état : je n’éprouve plus aucune douleur physique, la sensation de froid a disparu, je crois même que je jouis d’être étendu, comme après de lourdes fatigues, et les idées qui continuent à passer en moi ne me troublent plus.