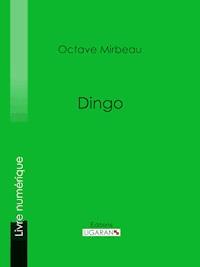
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Il y a quelques années, – exactement neuf années, un mois et cinq jours, – la veille de Pâques, au matin, Vincent Péqueux, dit La Queue, qui fait le service des messageries entre la gare de Cortoise et le village de Ponteilles-en-Barcis, où j'habitais alors, me livra, venant de Londres, une boîte."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AU PROFESSEUR ALBERT ROBIN
Témoignage d’affection et de reconnaissance.
O.M.
Il y a quelques années, – exactement neuf années, un mois et cinq jours, – la veille de Pâques, au matin, Vincent Péqueux, dit La Queue, qui fait le service des messageries entre la gare de Cortoise et le village de Ponteilles-en-Barcis, où j’habitais alors, me livra, venant de Londres, une boîte. De sapin grossièrement barbouillé de noir, son couvercle percé de deux ouvertures grillagées, cette boîte avait un aspect funèbre. Volontiers, on l’eût prise pour un menu cercueil d’enfant, ou pour un capot défraîchi d’automobile, ou encore pour un de ces consternants emballages dans lesquels les horticulteurs japonais expédient leurs pivoines en Europe.
Pendant que j’examinais avec méfiance ce curieux objet, Vincent Péqueux, dit La Queue, me présenta une feuille et une sorte de registre ouvert.
– Tenez !… Signez là…, fit-il… Le port est payé… tout est payé… Moi, avec votre permission, je vais dire deux mots à la cuisinière… hein ?…
Il me laissa ses paperasses. Bien que la journée commençât à peine, il était déjà très gai… pas tout à fait ivre, mais en bonne voie de le devenir.
– Oh ! se rappela-t-il soudain… J’ai encore pour vous là-bas… à la gare, des poules… Ma foi oui !… Trois forts paniers, vous savez… Et pas de place sous la bâche… Ma foi, non !… Je vous les apporterai ce soir, ou demain… Ah ! sacristi, pas demain, c’est Pâques… Enfin, un de ces jours… J’ai recommandé au chef des bagages de leur donner à boire et à manger… Un bon garçon… Je lui offrirai, sur votre compte, un petit verre pour la peine, pas vrai ?… Ne vous inquiétez pas…
Je ne m’inquiétais pas, du moins je ne m’inquiétais pas de cela. Fasciné par cette étrange boîte, je cherchais ce qu’elle pouvait bien contenir, et vraiment je ressemblais à ce paysan qui, ayant reçu par hasard une lettre, la considère avec terreur, la tourne, la retourne, la soupèse dans sa main, la montre à tous ses voisins, s’écrie : « Tiens !… tiens !… qu’est-ce qui m’envoie une lettre ?… Ah ! Bon Dieu, qu’est-ce qu’il y a dans cette lettre ? » et ne se décide pas à l’ouvrir.
Moi, non plus, je ne pouvais me décider à ouvrir la boîte, pour voir ce qu’il y avait dedans.
La feuille d’envoi mentionnait bien ceci : « chien vivant ». Mais, en plus de mon nom et de mon adresse, elle n’indiquait que le nom et l’adresse de la maison anglaise de Messageries chargée de l’expédition. Rien d’autre. Rien d’autre que des rangées de chiffres en diagonale ; ici et là, des opérations d’arithmétique, auxquelles je ne comprends jamais rien. Et puisque tout était payé…
Tout était payé, sans doute ; c’est ce qui me paraissait le plus louche. De qui me venait ce chien ? Et pourquoi un chien, un chien qu’on insistait à qualifier de vivant ? Quelle bêtise !
Je me pris à crier tout à coup, en levant les bras au ciel :
– Il n’eût plus manqué, parbleu, que ce chien fût un chien crevé…
J’étais intrigué, un peu énervé… Enfin, je n’avais commandé de chien à personne, je n’en attendais de personne, je n’en voulais de personne. Un de ces merveilleux chiens d’Irato, en porcelaine blanche, à la bonne heure !… Mais un vrai chien… un chien en chair et en os ?…
De sombres histoires de résurrectionnistes me revinrent à l’esprit… Je pensai :
– Si j’allais trouver dans cette boîte, au lieu d’un chien vivant, des tronçons de corps humain ?
Mon imagination ne m’en fait jamais d’autres. Des tronçons de corps humain !
Je frissonnai pour la forme et aussi parce qu’il m’est agréable de frissonner. Mais, repoussant aussitôt cette idée romantique et peu cordiale, je finis par ne plus redouter au pire qu’une de ces mystifications macabres, où excellent, après boire, certains Anglais inventifs et lugubres… humoristes, comme on dit.
J’ai l’horreur des mystifications et je manque de l’esprit qu’il faut pour en rire. Je me disposais donc à refuser sévèrement ce colis et la chose morte ou vive qu’il contenait, lorsque Vincent Péqueux, dit La Queue, revint goguenard de la cuisine, où, pour entretenir sa gaîté, il était allé boire son verre traditionnel de vin blanc.
– Patron… s’écria-t-il… vous savez ?… j’en retiens un petit…
Et, riant, il essuya ses moustaches au revers de cuir de sa manche. Malgré ce geste poli, l’atmosphère, tout autour de lui, était imprégnée d’une forte senteur d’ail et d’alcool.
Je ne voulus pas rendre ce loustic plus longtemps témoin de mes tergiversations. Sans contrôler la contenance de la boîte, j’apposai ma signature sur le registre, que je lui rendis. Il approuva :
– Bon… bon !… Quant à vos poules, ne vous tourmentez pas… Un jour ou l’autre, vous les aurez… On les a rangées, à l’ombre, sur le quai… Elles regardent passer les trains, comme les promeneurs du dimanche… Çà les distrait un peu, quoi !… Dites donc, patron… mon petit pourboire, s’il vous plaît…
Je lui donnai quelques sous…
– Ça va bien… ça va bien… Ne vous tourmentez pas, allez.
Il partit et, vite, je déclouai le couvercle de la boîte. Je n’étais pas très rassuré. Les outils tremblaient dans ma main.
Bientôt, j’aperçus, gisant sur de la paille hachée, – sorte de boule fauve et molle – un très jeune chien, ou plutôt un tout petit chiot, si jeune, si petit, qu’il n’avait pas la force de se tenir sur ses pattes. Je le délivrai de son cachot… Dieu ! qu’il était grotesque à voir !
Figurez-vous un museau de vieux petit fonctionnaire… tenez, d’employé aux contributions… tout plissé de mauvaise humeur ; une tête beaucoup trop grosse, beaucoup trop lourde pour le corps ; un corps vaguement ébauché ; des yeux à peine ouverts, à peine visibles dans la fente des paupières boursouflées. Sur le ventre rose, plein, glabre, tacheté de roux, un reste séché de cordon ombilical se tortillait comme un ver… Un chien au maillot, si j’ose m’exprimer ainsi. J’étais furieux.
Soit ironie, négligence ou routine, l’expéditeur, en guise de provisions de bouche pour le voyage, peut-être en guise de hochet, avait dérisoirement placé à portée des dents et des pattes du pauvre animal, qui ne pouvait jouer ni manger et qui d’ailleurs n’avait pas de dents, un formidable os de gigot, luisant comme un morceau d’ivoire, et une énorme tranche de pain aussi dure que du ciment. Il paraissait affamé et, plus encore qu’affamé, indigné par l’inconvenance d’un régime alimentaire tel qu’on le pratique dans les maisons de bienfaisance. Dois-je noter, pour compléter la comparaison, que les parois et le fond de la boîte étaient tout souillés de déjections ? Il s’en exhalait une odeur écœurante de lait aigre, de sérosités, fermentées, particulière aux enfants charitablement élevés dans les crèches.
Dès que je l’eus caressé, – oh, bien timidement, et cela me fut désagréable, car j’ai une répulsion physique invincible pour tous les nouveau-nés, – il se mit à trembler, puis à pousser des plaintes et des cris de protestation… Des cris de protestation, je dis bien. Cette précocité si rare m’émerveilla.
Respectueusement, je le déposai sur le sol, où ses cris redoublèrent. Et, vraiment, je ne pus m’empêcher de rire de ses mines revendicatrices, de son tapage irrité. Croyez bien qu’il n’y avait nulle moquerie, en dépit du ridicule équipage dans lequel m’arrivait ce petit pensionnaire, mais de la sympathie et de l’admiration pour lui.
Je l’avoue, l’idée seule que cet embryon protestât déjà et si spontanément, et sans aucune littérature, contre la stupidité, la malignité, la malpropreté des hommes ou contre leurs caresses, m’enflamma. Oui, j’avoue que ce pessimisme, en quelque sorte prévital, me réjouit dans mon pessimisme invétéré et fit que je m’intéressai davantage au sort de cet être larvaire qui, encore noyé dans les limbes et sans l’avoir jamais vu, allait entrer dans le monde avec une conception de l’humanité si parfaitement conforme à la mienne.
Spectacle émouvant et nouveau.
Un savant – je dis, bien entendu, un vrai savant – qui en eût été le témoin averti, n’eût point manqué d’écrire sur son carnet de notes cette observation psycho-systématique, capable de révolutionner toutes nos idées sur les chiens, et aussi, je pense, sur les hommes :
« Le chien naît misanthrope. »
Quant à notre petit animal, il ne consentit à s’apaiser que lorsqu’on lui eut apporté une jatte de lait frais, qu’il se mit à boire avec une avidité d’ivrogne, si tant est qu’il existe des ivrognes qui boivent du lait avec l’avidité d’un chien…
Le surlendemain seulement, je reçus une très longue lettre explicative. Elle était signée : « Sir Edward Herpett ». Ah ! comment n’avais-je pas tout d’abord songé à Sir Edward Herpett ? Mais je songe si peu à lui…
Sir Edward Herpett est un de mes amis, un ami de tout repos, un de ces excellents, de ces précieux amis, comme j’en ai beaucoup à Paris, beaucoup à Londres, Rome, Berlin, New-York et aussi, je suppose, à Calcutta. Entendez qu’il ne me fatigue pas de son amitié et que je ne l’accable pas de la mienne. À peine si je le connais… Je le connais si peu que, s’il m’arrive – oh ! une fois tous les cinq ou six ans – de penser à lui, il ne m’arrive pas toujours de reconstituer son visage… Un visage, autant qu’il m’en souvienne, très régulier, très rouge, entièrement rasé, sans la moindre expression caractéristique par où il puisse se distinguer d’un autre visage ami… un de ces froids portraits britanniques qu’on voit, toujours le même, sous les dénominations les plus diverses, dans les magazines illustrés de la plus grande Bretagne.
Un soir de mai, je l’ai rencontré à Londres, dans un club de vieux savants en tous genres, et ce que je me rappelle le mieux de lui, c’est que, ce soir-là, nous nous sommes grisés très confortablement, en l’honneur de la science.
Voici que, grâce à une photographie fortuitement retrouvée par mon valet de chambre au fond d’un tiroir, le visage si impersonnel de mon ami maintenant me revient et se reprécise à quelques détails près… Mais non, mais non, pas si impersonnel que je le croyais.
Un charmant garçon, vraiment, ce qu’on appelle dans les bars de chez nous un véritable gentleman. Des cheveux blonds collés au crâne et séparés par une raie médiane qui les divise en deux parties symétriques, également plates et luisantes ; des yeux légèrement bridés dont on ne sait s’ils sont clairs, foncés, gais ou tristes ; des narines pincées au bas d’un nez droit et fin ; une lèvre supérieure retroussée sur des dents pas très blanches et dont quelques-unes sont baguées d’or. Sir Edward Herpett dont la tête petite se perche sur le col, comme un gobe-mouche au haut d’un roseau, est exagérément haut de jambes, et ses bras maigres d’orang-outang, attachés par de gros nœuds à des épaules tombantes, se terminent par deux fortes mains couleur de brique. Linge éblouissant, vêtements amples, coupés avec chic, bottines épaisses en cuir jaune sortant d’un pantalon relevé jusqu’à la cheville, courte badine en jonc de Java. Les journaux disent d’Herpett qu’il est très élégant, et d’une élégance strictement appropriée à ses occupations du moment. Il est aussi très entraîné à tous les sports, cela va de soi : boxe, golf, tennis, ski, toboggan, yachting, etc. Et, bien qu’il vive dans les courants d’air les plus violents, qu’il soit presque toujours nu-tête, surtout quand il pleut et que le vent souffle en cyclone, des casquettes, des casquettes pour toutes les circonstances de la vie d’un Anglais.
Pour le moral, voici : amateur de bibelots chers et laids, de collections scientifiques et anecdotiques, curieux de toutes les excentricités coloniales, il passe pour très riche, très curieux et très savant. Pas un coin du globe qu’il n’ait exploré, comme tous les Anglais, d’ailleurs. En ce moment, je sais qu’il explore les cocotiers de Monte-Carlo. Oui, oui, je le revois. Il a la manie des lointaines études biologiques, linguistiques, sismographiques, océanographiques, anthropologiques, je ne sais plus trop. Pourtant, on m’a cité le titre d’un de ses ouvrages : La Dentition des Grands singes, grâce à quoi on pourrait peut-être spécialiser la nature de ses recherches : ouvrage considérable textuellement copié dans Huxley.
Or, après un silence de sept années, sir Edward m’annonçait, dans sa lettre, ceci :
Il débarquait d’Australie. Il en rapportait, outre un gros travail économique – c’est peut-être un économiste – sur la production agricole, minière, industrielle du groupement australasien, une chienne sauvage capturée par lui dans la brousse. Le soir même de son arrivée en Angleterre, cette chienne sauvage, capturée par lui, mettait bas clandestinement, comme une pauvre domestique séduite, six petits chiens.
Désireux de m’être agréable, et pour se rappeler à mon souvenir, mon ami Herpett s’empressait donc de m’offrir un de ces petits chiens – le plus beau – pour mes Pâques… Il en offrait un autre – le plus beau aussi, naturellement – à sa majesté Édouard VII, pour ses Pâques… Un autre encore – toujours le plus beau – à je ne sais plus quel établissement zoologique : Anvers, Rotterdam, Amsterdam, Hambourg ou Cologne, pour ses Pâques… Un chien de sa chienne, pour nos Pâques ! Non que sir Herpett soit religieux ou antireligieux… Il a de l’élégance et il sait vivre, voilà tout.
Avec une complaisance un peu lourde, il insistait sur l’originalité, la rareté, l’exceptionnelle valeur du cadeau et me donnait ces renseignements édifiants. Ne connaissant pas très bien l’anglais, surtout l’anglais d’Edward Herpett, je les traduis, comme je peux.
« Je dois tout d’abord vous prévenir, écrivait cet obligeant ami qui, non content de m’envoyer un chien, poussait la bonne grâce jusqu’à me conter son histoire, m’expliquer son mécanisme et la manière de m’en servir… je dois vous prévenir que ces chiens ne sont pas, du moins ne sont plus, à proprement parler, des chiens. Par une habitude séculaire et aussi, je suppose, par une illusoire ressemblance, ils tiennent toujours un peu du chien… un peu du renard, du renard de Guinée, mais plus grands que ce dernier. Ils tiennent surtout du loup, du loup de Russie, à ce détail près que, n’ayant ni son pelage gris ni son échine basse, ils rappellent, sans l’excuse de la faim et même sans un goût très violent pour la viande, sa férocité carnassière. Il n’est pas douteux qu’ils aient été réellement, complètement, des chiens, autrefois, en ces temps ténébreux où la science balbutiait ses timides essais de classification. Heureusement, de même que les modes, les méthodes changent, les moyens d’investigation se perfectionnent. Chaque jour ; avec la vie plus profondément pénétrée, la science évolue, se transforme, nous transforme et son domaine sans cesse s’élargit. Rien n’est immuable. Tel qui était poisson jadis est devenu oiseau ; tel qui fut singe est aujourd’hui pape, roi, ministre, général ou philosophe. Depuis soixante ans, il semble absolument démontré que ces chiens, qui, auparavant, étaient bien des chiens, ne sont plus des chiens, plus du tout. Des naturalistes très respectables – et ma foi qu’est-ce qu’il risquait ?… il me citait l’infortuné Gray, Neyring, Pelzeln, Hardwick et d’autres – prétendent que c’est une espèce intermédiaire, quoique autonome, entre le chien et le loup et qu’on nomme le dingo… opinion adoptée au fameux congrès de Palmerston, malgré de très acharnées et très rares dissidences sans aucune autorité, par conséquent sans la moindre importance… Ne nous y arrêtons pas. Physiologiquement, histologiquement, ostéologiquement, odontologiquement, paléontologiquement, historiquement, je dirais même : philologiquement, la question est tranchée. Ni chiens, ni loups : des dingos. J’ai appris à Melbourne d’un Hollandais, professeur de langue malaise, que dingo est un vocable nègre qui, précisément, signifie : ni chien, ni loup. Avouez que voilà une langue ingénieuse, concise, pittoresque et qui dit bien ce qu’elle veut dire…
Vous aurez donc un dingo, cher ami ; ce qui est très confortable, croyez-moi… Je puis vous le prédire avec certitude, les dingos seront tout ce qu’il y a de mieux porté à notre prochaine saison de Londres. Désormais, on ne pourra plus prétendre à être un véritable gentleman, si l’on ne promène derrière soi, au lieu d’un petit fox irlandais, un dingo. Et je vais vous confier une chose que je n’ai encore dite à personne Sa Majesté Édouard VII a daigné me promettre qu’Elle remplacerait désormais par son dingo cet éternel et insupportable lord Ponsomby, qui la suit partout, comme un chien. »
Ici, mon ami Herpett voulait bien quitter les régions ingrates de la science et ses lourds adverbes, pour s’élever sur des adjectifs ailés jusqu’aux sommets du plus pur lyrisme.
« Ces animaux, continuait-il, sont extraordinaires et magnifiques. Vêtus d’or et de feu, avec des dessous de bistre clair, hardis, fiers, très souples, les muscles puissants, la mâchoire terrible, la tête allongée que surmontent deux oreilles pointues toujours dressées, la queue touffue, traînant à terre majestueusement, comme un gros boa de zibeline, ou bien, tout à coup, sous l’empire de la passion, se relevant en panache éclatant, ils sont la gloire du jardin zoologique de Melbourne. Ils sont aussi la terreur de l’élevage dans les prairies australiennes. Par les nuits sans lune, par les froides nuits sans lune de ce curieux continent, il n’est pas rare que les dingos se réunissent en bande, dix, quinze, souvent moins, jamais plus. En quelques heures, ils abattent trois cents, cinq cents moutons et autant de bœufs, cela pour le plaisir, par gaîté naturelle, en artistes du massacre, comme des hommes. Mais plus artistes que les hommes, conséquemment plus généreux, plus désintéressés, ils ne mangent pas leurs victimes. Étant d’un naturel très sobre, ils se contentent des petits lapins marsupiaux qui minent le sol australien et de ces minuscules kangourous qui, à chaque pas, sautillent dans l’herbe, comme les sauterelles dans nos prés. On m’affirme qu’en excellents tacticiens, avant de se jeter sur les troupeaux, ils se ruent sur les chiens et même sur les hommes qui les gardent. En un tour de gueule, ils ont vite fait de les mettre hors de défense et de combat. Après quoi, ils peuvent travailler, sans être dérangés, tout à leur aise.
Discrétion admirable que devraient bien imiter nos petits fox terriers si bruyants, si agaçants et si délicieux, les dingos n’aboient jamais. Ils ont déjà planté leurs crocs au bon endroit dans la gorge de l’ennemi, que celui-ci ne les a pas entendus venir, qu’il n’a perçu ni un frôlement dans les feuilles ni le moindre bruit d’herbe foulée. Ils ont le secret, presque surnaturel en vérité, de rendre à leur passage plus silencieuse la brousse épaisse et serrée, plus muet le sol sous le bond de leur course rapide, ardente et légère. De leur présence toujours cachée, de leur invisible cheminement, jamais aucune trace, même d’odeur, même de son, ce qui en fait les plus redoutables d’entre les “hôtes de ces bois”. Il est vrai que les dingos sont, avec les colons, les seuls animaux féroces de ces contrées pacifiques et – veuillez le remarquer, c’est très important – les seuls aussi, avec les colons toujours, ai-je besoin de le dire ?… qui n’aient pas une origine marsupiale. Je vous répète donc que les dingos n’aboient jamais : ils hurlent. Et seulement dans les circonstances graves de leur vie aventureuse et forcenée. Je vous assure, cher ami, que ce hurlement qu’il m’a été donné deux fois d’entendre à la nuit tombante, au bord du désert rouge, alors que le vent faisait siffler comme des locomotives l’écorce arrachée des eucalyptus et que dans les arbres le lampfing jacass riait de son rire démoniaque, est mille fois plus sinistre que le hurlement des loups. J’ai connu là des minutes d’effroi que plus jamais je ne pourrai oublier. »
J’aurais bien voulu savoir comment, avec sa lourdeur européenne, mon ami sir Edward Herpett avait pu surprendre et capturer de si subtils animaux dans cette brousse de spinifex, impénétrable à un lapin, même à un Anglais. Par malheur, – modestie ou lacune, – la lettre n’en disait mot.
Quelques phrases encore que je passe, quelques renseignements insignifiants que je supprime, et la lettre reprenait ainsi son cours imperturbable :
« L’occasion me vint, plus vite que je l’eusse souhaité, de vérifier, par moi-même, la plupart de ces détails biographiques. Au retour, durant la traversée, ma chienne, – je continue à l’appeler hermétiquement une chienne pour la clarté de ces notes indispensables, – ma chienne donc, trompant la vigilance du boy malais à qui je la confiais durant la nuit, se précipita un matin – il pouvait être trois heures du matin – vers l’arrière-pont où se trouvent les cages à poules et le parc à moutons. On la surprit au moment où, ayant exterminé toutes ces bêtes en un rien de temps, elle achevait de les aligner sur le plancher par espèces et par rangs de taille, l’une contre l’autre, méthodiquement, ainsi qu’on fait sur la pelouse d’un parc pour le gibier abattu, le soir d’une chasse. Le tableau, mon cher ! Ils connaissent le tableau ! Des bêtes ! Ils pratiquent nos plus anciennes, nos plus élégantes habitudes de vénerie. Des sauvages ! Comme c’est troublant, n’est-ce pas ? Et surtout, comme c’est important pour l’histoire des origines de la civilisation ! Le tableau ! Ah ! je ne voulais pas y croire… C’était trop imprévu, je ne voulais pas y croire. J’étais tellement ahuri par cet incident que je ne démêlais pas bien encore les idées qu’il devait me suggérer par la suite… Vous pensez si cet intermède cynégétique divertit les passagers. Ce qui les divertit plus encore, je dus payer une indemnité de quatre cent cinquante-cinq livres à l’administration du bord ; car, j’ai oublié de vous le dire, outre les poules et les moutons, ma chienne avait étranglé quantités d’oiseaux bizarres, précieux, enfermés dans de solides cages d’osier et destinés au Zoological-Garden de Londres, entre autres un Ichtyète Jokowuru, oiseau de proie rarissime, qui porte une espèce de longue chevelure en éventail, un bec charnu de juif et une énorme barbe, broussailleuse et sale, qui font ressembler cet étrange animal à saint Jean-Baptiste. Mon premier mouvement avait été, je l’avoue, de la colère et de “l’embêtement”. Je me reprochai fort mon imprudence. Mais quoi ? Cette chienne était si douce, si caressante, si gentille avec tout le monde ! Elle faisait la joie du bord, en particulier des femmes, à qui toute la journée je devais raconter l’histoire, les mœurs des dingos, les péripéties scientifiques par où ils avaient passé. Cela me rendait populaire. Ma foi, je la laissai libre d’aller et de venir sur le pont. Comment prévoir une telle aventure ? J’aurais dû lui mettre une muselière, objecta le capitaine. Fort bien. Eût-elle accepté une pareille entrave à sa liberté ? Rien n’est moins sûr. Et puis, tout d’un coup, je ne regrettai rien. Non seulement je ne regrettai rien de ce qui était arrivé, j’en éprouvai une fierté infinie, car, enfin, je compris que ce jour-là j’avais fait une observation scientifique capitale. Herbert Spencer, en juillet 1873, découvrit dans la danse du scalp des Fijiens l’origine de la musique, du drame, et même de la biographie. La même année, dans je ne sais plus laquelle des pratiques fétichistes et anthropophagiques des mêmes Fijiens, il découvrit l’origine de la carte de visite. C’était un record. Moi, je venais de découvrir, dans le geste d’un chien, quelque chose de bien plus considérable au point de vue sociologique. Je venais de découvrir tout simplement l’origine du tableau de chasse. Et je pensai que je n’avais pas payé assez cher cette gloire !… À la relâche que nous fîmes à New-York, je m’empressai d’adresser à mon club une triomphante dépêche, par laquelle j’annonçais que j’avais battu le record d’Herbert Spencer… Mais vous savez, mon ami, la jalousie des savants !… »
Venait ensuite un passage, tout de mélancolie :
« Hélas ! les jours des dingos sont comptés. Bientôt cette merveilleuse race n’existera plus. Elle a déjà complètement disparu de la Terre de Van-Diémen. Dans l’Australie proprement dite, elle va diminuant d’année en année. Les colons, qui ont presque entièrement ravagé ces incomparables forêts d’eucalyptus, uniques dans le monde, et, poussés par une folie sauvage de destruction, détruit cette innocente curiosité botanique : le cappari, arbre paradoxal, rigolo, comme vous dites, je crois, en français, d’où coule, des blessures qu’on fait à son écorce, une espèce de gomme qui ressemble au macaroni et en a le goût…, ces affreux colons mènent contre les dingos une guerre exterminatrice, la même que les Yankees firent aux Peaux-Rouges. Il faut regretter que, dans notre siècle, la beauté cède partout le pas à l’utilitarisme imbécile et passager et qu’un des plus intéressants exemplaires de la zoologie soit menacé de disparaître, pour permettre à de gros hommes ignorants, sans délicatesse, de frigorifier encore plus de moutons et de conserver dans des boîtes en fer-blanc de plus innombrables culottes de bœuf. En vérité, je ne sais pas où les savants, disons les hardis pionniers de la science, pourront aller désormais, sur un globe dépeuplé de sa faune et rasé de sa flore, surprendre les mystères de la vie. Tenez, supposons un instant que les dingos eussent été complètement détruits, quand je vins en Australie… Eh bien, la science serait peut-être à jamais privée de cette découverte de l’origine du tableau de chasse, dont j’aime à croire que vous comprenez toutes les conséquences, malgré le silence intéressé qui se fait autour d’elle… Quant aux dingos, dans quelques années nous ne les retrouverons plus que dans les jardins d’acclimatation, où ils perdent très vite de leur magnificence originelle, où s’appauvrissent, s’étiolent, jusqu’à s’effacer totalement, les caractères spécifiques d’une race qui n’avait pas dit son dernier mot et qui n’était point au bout de son histoire. Alors les dingos redeviendront des chiens comme tous les chiens domestiques. Quelle pitié ! Imaginez leur navrement… Imaginez le mien, si un beau matin je me réveillais dans un arbre, le corps entièrement velu, avec quatre pattes et une queue prenante, en train d’éplucher une orange ou de grignoter une noix… Infortunés dingos !… À travers des grillages, dans des niches ou sur de mornes pelouses désherbées, nous les verrons, dépouillés de leurs belles formes et de leur fière allure, avec des oreilles cassées et des queues amoindries, malades, galeux, stériles, déchus, jusqu’au jour prochain où nous ne les verrons plus du tout. Ces choses-là me font toujours un peu pleurer. Croyez-vous que, parfois, je m’attendris sur la disparition du plésiosaure, et que – je vais vous paraître un peu trop sentimental, excusez-moi – je regrette, comme un ami qui a mal tourné, ce fameux diplodocus devenu, ainsi qu’un tableau de M. Cormon ou une statue de M. Frémiet, un vulgaire objet de musée ?… C’était bien la peine qu’ils aient été une si prodigieuse mystification de la nature ! Heureusement, il nous reste encore quelques survivances humaines, sur lesquelles nous pouvons étudier avec fruit les formes de la Préhistoire. Heureusement aussi, – et mon désir de vous plaire s’en exalte, – tout cela donne du prix au dingo que je vous envoie. Élevez-le bien, surveillez-le bien, étudiez-le bien ; gardez-le bien et aimez-moi ! »
Pour ne pas me laisser sur une impression trop triste, ce délicat mais prolixe ami plaçait ici, ingénieusement, un souvenir qui vous amusera :
« Cela me rappelle ce chien sauvage de l’Alaska… vous savez, ces chiens trapus, touffus, tout noirs, dont le pelage est huileux et laineux et dont l’encolure épaisse se recourbe comme celle des chevaux frisons. Les connaissez-vous ? J’en sais peu d’aussi sympathiques et industrieux. Je ne suis pas très sûr que ces chiens soient tout à fait sauvages, mais j’affirme qu’ils sont tout à fait des chiens, aucun Congrès n’ayant jusqu’ici décidé qu’ils puissent être autres. Curieuse particularité anatomique, on remarque à la jointure postérieure des os de leur crâne un énorme muscle bombant, extrêmement mobile, qui se tend, se détend, s’actionne comme des bielles et leur sert à soulever dans la gueule des poids très lourds. Ce qui n’est pas moins curieux, ils ne vivent que de poisson. On raconte qu’ils creusent la glace jusqu’à l’eau. Accroupis des journées entières au fond de leur trou transparent, le nez au ras du courant, ils attendent le passage d’un brochet, d’une carpe, d’une truite, d’un saumon, qu’ils attrapent, sans jamais les rater, avec la dextérité surprenante d’un phoque. Plus adroits qu’Herbert Spencer, qui fut, en même temps que le plus fameux philosophe, le pêcheur de saumon le plus fameux du Royaume-Uni, ils prennent de la sorte jusqu’à deux cents kilos de poisson par jour. Ils en font d’énormes provisions, qu’ils gardent dans un autre trou creusé de leurs pattes, bien à l’abri de toute corruption aérienne, et ils viennent en manger aux heures régulières de la faim. Malheur à ceux, hommes ou bêtes, qui découvriraient leur cachette et tenteraient de la cambrioler ! Depuis longtemps, je désirais posséder un de ces animaux extraordinaires. Je fis part de ce désir à mon correspondant de là-bas, où j’ai quelques intérêts. Six mois après, un beau jour, j’appris par un message administratif qu’un chien m’attendait à la gare. J’allai, comme il convient à un tel personnage, le recevoir solennellement. Son accueil fut simple, cordial, des plus empressés. En une minute de caresses et de causerie familière, – venant de l’Alaska, il comprenait fort bien l’anglais, naturellement, – nous devînmes aussitôt les meilleurs amis du monde. Je n’en avais pas moins apporté, par prudence, une forte chaîne et un solide collier que cet animal libre se laissa mettre au cou très docilement. Je n’étais pas fâché de lui faire au débotté les honneurs de la capitale ; je voulais surtout, dès le début, l’intimider par notre organisation policière. Nous rentrâmes à pied, flânant dans les rues, dans les squares, dans les parcs, comme deux paisibles bourgeois. J’étais ravi du chien et le chien paraissait ravi de moi. J’admirai son caractère calme, souple et gai et la force spontanée de ses facultés d’assimilation. Rien ne l’étonnait. N’ayant pourtant jamais connu que les lacs gelés, les solitudes rocheuses et forestières couvertes de neige, nullement emprunté, il se montrait bien moins surpris qu’un paysan du Yorkshire, au spectacle si brillant, si bruyant, si nouveau qu’il avait sous les yeux. Un régiment de highlanders passa et ne l’effaroucha point. Dans un square où une grande foule s’était assemblée, il entendit une très vieille femme, hissée sur un banc, qui prêchait à des eunuques du Soudan l’excellence des doctrines malthusiennes, et ne s’émut pas davantage. À tous les promeneurs que nous rencontrions, il semblait dire, en flairant leurs mollets : “Bonjour, Monsieur… Bonjour, Madame… Bonjour, Mademoiselle. ” Nulle incongruité nulle part. Sa bonne humeur amicale, son urbanité faisaient sensation parmi les chiens, à qui, sans restriction de race et de sexe, il prodiguait abondamment les gestes courtois que vous savez, qui sans doute sont de tous les pays, comme l’amour… Une seule chose m’inquiétait. Comment nourrir cet ichtyophage ? Je ne suis pas avare et ne mesure la nourriture à personne. J’avoue pourtant que l’idée de ne servir à ce monsieur que de la carpe ou du saumon m’ennuyait un peu… “Bah ! me disais-je, tout cela s’arrangera. ” Comme nous passions dans Old Bond street, devant un de ces magnifiques étalages à poisson qui sont l’orgueil de Londres, comme les architectures de saucisses et de jambons sont l’orgueil des cités allemandes, je ressentis tout à coup au poignet et dans le bras une secousse violente, si violente que je crus qu’on me les arrachait. Je poussai un cri de douleur. Et, dans le même temps, car j’avais lâché la chaîne, je vis mon chien qui avait bondi sur l’étal, entre deux icebergs de belle glace blanche, engueuler, telle une plume, un gigantesque saumon d’au moins trente livres, s’enfuir, disparaître avec sa proie, son collier, sa chaîne, au coin d’une rue… Plus jamais je ne l’ai revu. La police fouilla Londres, fouilla la banlieue de Londres, fouilla l’Angleterre… Rien… Ah ! ne me parlez pas de Sherlock-Holmes, qui échoua piteusement dans ses recherches, lesquelles finirent par me coûter quinze cents livres… Aucune trace, nulle part, de mon chien. Le seul résultat de tout ceci, c’est que, malgré les embrocations, tous les remèdes de cheval qui me furent appliqués, je restai avec un bras inerte et douloureux, durant quatre longues semaines… Au Club, sir Thomas Lavenett, qui a fait de si remarquables travaux sur le sens de l’orientation chez les pigeons voyageurs, m’expliqua, au moyen de graphiques et de diagrammes, que ce diable de chien, après de longs voyages, de port en port, de paquebot en paquebot, de randonnées en randonnées à travers les plus extravagants pays, était sûrement retourné dans l’Alaska… Je le crois… ma foi ! je le crois. Je le crois, parce que sir Thomas Lavenett est une autorité scientifique des plus respectables et surtout, parce qu’en fait de roublardise, de connaissance de la vie, d’habitudes civilisées, de notions géographiques, militaires, culinaires, policières, rien ne m’étonne plus désormais des chiens sauvages. »
Et, revenant aux dingos pendant quatre longues pages encore, sir Edward terminait enfin son interminable épître, ainsi :
« Au demeurant gentils, d’humeur allègre, très doux à l’homme, pourvu que l’homme ne les embête pas… comprenez-moi bien, ne-les-em-bê-te-pas !… »
Pendant que je lisais non sans quelque effarement cette lettre, le petit chien jappait à mes pieds et s’efforçait vainement de téter le bout de mes pantoufles. En dépit de son irritation à ne pouvoir traiter mes chaussures comme des mamelles nourricières, en dépit même de ses méfaits ancestraux, et bien qu’il me fût surabondamment prouvé par tant de Compétences scientifiques que ce chien n’était pas, du moins n’était plus jusqu’à nouvel ordre, un chien… il ne m’effraya pas. D’abord, dans mes jours heureux, dans mes jours de soleil, je suis de ceux qui pensent que l’hérédité n’est pas un principe rigide, que beaucoup d’êtres vivants y échappent, qu’en tout cas, elle peut être combattue victorieusement par l’éducation… Et puis, sans doute, comme voyageur, sir Herpett exagérait un peu et, comme ami, il se plaisait à me mystifier. Et puis, ce petit chien était si petit, si petit… Vraiment, j’avais bien le temps de m’alarmer.
Je l’adoptai donc définitivement, et le baptisai aussitôt : Dingo, du nom de sa race.
Comme je procédais sommairement à cette cérémonie, une voix cria dans le jardin :
– Patron !… Eh !… Patron !
Je reconnus la voix avinée de Vincent Péqueux, dit La Queue.
– Eh bien ? demandai-je, en me penchant par la fenêtre ouverte, qu’est-ce qu’il y a encore ?
Je reçus cette réponse :
– J’apporte vos poules. Il y en a quatre de crevées… le coq aussi… ne vous inquiétez pas…
Je l’élevai sans trop de peines et sans alertes. Une constitution robuste, un formidable appétit, un ardent désir de vivre, de se dépêcher de vivre, de se dépenser à vivre, hâtèrent son développement, qui fut rapide. Dingo poussa, d’un jet vigoureux, comme un sauvageon d’églantier.
Depuis le jour où, un peu dégoûté de lui et ne sachant par quel bout le prendre, je l’avais retiré de sa boîte, mon sentiment sur l’esthétique des petites bêtes avait bien changé.
L’enfance de l’animal est un délice, un perpétuel enchantement. Plus encore que sa fraîcheur adorable de matin, ce sont les disproportions de ses formes et leur apparent désaccord, « ses fautes de dessin », dirait l’École des Beaux-Arts, son aspect radieusement caricatural qui me ravissent et qui rendent si émouvants, pour moi, barbare, cette fleur d’esquisse, ce prestige tout neuf d’une chose qui commence. D’autre part, les petits animaux n’apportent pas dans la maison une insupportable tyrannie, ni dans les cœurs le désarroi des transes quotidiennes. Ils sont de tout repos, discrets, joyeux, bien portants, respectent nos méditations, notre travail, notre sommeil, ne crient jamais, ne réclament jamais rien, ni qu’on les berce, ni qu’on les baigne, ni qu’on les fouette, ni qu’on demeure, des nuits et des jours, fiévreusement penché sur leur niche. Et ils n’accueillent pas nos soins, nos caresses, nos anxiétés qu’avec des grimaces. Oh ! ces douloureuses grimaces, qui font d’un enfant que l’homme a conçu dans l’inquiétude, la maladie, la misère ou la haine, une sorte de minuscule vieillard, rabougri et hargneux !
Exquis et cocasse à regarder, parce qu’encore disproportionné dans ses formes, – j’y insiste, – gauche dans ses membres avec gentillesse, si spirituellement « mal dessiné », dessiné comme une petite image de pierre, au portail d’une église gothique, Dingo avait toujours la tête beaucoup trop grosse, beaucoup trop lourde, pour cette raison, je pense, que c’est à la tête, qui ensuite les répartit avec justice, qu’affluent toutes les énergies nerveuses et sanguines d’un corps. Il l’avait si grosse qu’il semblait gêné par elle, uniquement gouverné par elle, incliné par elle, comme par un poids étranger, vers le sol. Il l’avait si lourde, que parfois s’aidant de ses pattes malhabiles, il cherchait à se l’arracher et à la poser par terre, pour ensuite courir plus librement. Savait-il que des saints renommés en avaient usé de la sorte avec la leur ?
Malgré cette préoccupation hagiographique, sa physionomie commençait à se dégager des hésitations, des incohérences de l’ébauche initiale, à prendre un caractère que je ne pourrais pas bien définir d’un mot, qui était, qui allait être plutôt de la gravité, de la gaîté, de la malice, une sorte d’effronterie bizarre et gracieuse… Quoi encore ?… De la cruauté, peut-être ?… Peut-être de la bonté ?… Enfin quelque chose d’impétueux et de calme à la fois, quelque chose de comique et de noble, de candide et de rusé… je ne sais trop… ce que vous voudrez, après tout.
N’ayant pas encore assez de muscles, il avait les nœuds des articulations trop saillants, la peau mal tendue sur l’ossature, ici plissée, lâche et flottante, là trop ajustée, trop étroite, comme si elle n’eût pas été taillée pour lui et qu’on l’eût achetée dans un magasin de confections, au petit bonheur. Il avait les pattes trop fortes, pareilles à celles des jeunes lions ; les oreilles trop molles, trop ouvertes, intérieurement bourrées de peluches protectrices et passagères qui, à chaque pointe, s’ébouriffaient en aigrettes, comme chez les guépards. Sa queue était ridicule, une queue de rat filiforme et vermiculaire. Mais on y sentait sourdre, tout au long, un foisonnement de poils, légers comme un duvet, fins comme le gazon qui sort de terre, et elle promettait bientôt de devenir un magnifique objet. Aucun doute que, sous le nez, le menton, au bas du poitrail, il ne lui vînt de la barbe, comme à un vieux sculpteur. Sa démarche restait toujours vacillante, désunie. Il s’irritait de glisser comme un rustre sur les parquets cirés, de butter au moindre obstacle, à la moindre inégalité du terrain. Et il zigzaguait en courant, tel un gamin qui aurait trop bu. Mais quel délicieux gamin, ingénu, effronté, cordial, roublard, n’ayant peur de rien et de personne… Et si drôle.
Je m’étonnai que vis-à-vis de moi, vis-à-vis des familiers de la maison, il ne gardât rien de la méfiance farouche qu’ont toujours les bêtes sauvages – et comme elles ont raison ! – au contact des humains. Quant aux passants, il se tenait fermement à leur égard sur le pied, sur les quatre pieds, d’une réserve prudente et soupçonneuse. Non qu’il redoutât les hommes, ah ! parbleu non ! Nous avons vu déjà qu’il n’en pensait rien de bon.
Dingo en était alors, si je puis ainsi dire, à cette période éruptive, à ce moment critique du bourgeonnement, où sous la peau de l’animal comme sous l’écorce du jeune arbre, les afflux de sève fermentent, bouillonnent, se concrètent en bosses, en plis et vont jaillir de partout en germes éclatés. Avec un intérêt passionné, je surveillais les moindres incidents de sa croissance, de même qu’au printemps on surveille à la pointe des tiges les efflorescences d’une plante, pour épier ce qui va naître d’elle. Sans jamais m’en lasser, je m’amusais à sa gaîté désordonnée qui pouvait paraître souvent de la folie, mais que dominait, que dirigeait une raison d’être supérieure, inconnue de lui, raison d’équilibre physiologique, d’ajustage mécanique, de canalisation vasculaire, d’endurance. J’applaudissais à sa joie de destruction, si touchante, à sa férocité dans le déchirement, si naïve, par quoi, à son insu, s’entraînaient dans le sens de sa destinée les forces naissantes, encore mal distribuées, de ses organes.
C’est ainsi qu’il réglait par ses divers jeux, qu’il mettait au point, mécanicien inconscient, la puissance d’étreinte de sa mâchoire, le fonctionnement musculaire de ses épaules, de son encolure, la souplesse de ses jarrets et de ses reins, en déchiquetant, avec des grondements déjà terribles, le cuir des chaussures, en rongeant le pied des fauteuils, des lits, des tables, les bas de portes, avec un acharnement de fauve affamé, en emportant dans sa gueule, comme de pesantes dépouilles conquises à la bataille, tout ce qu’il pouvait atteindre de fourrures, de vêtements de laine, de chapeaux emplumés, de gants, de brosses de crin, de peignes d’écaille, de bibelots d’ivoire, de corne et d’os, où son flair retrouvait à travers l’espace et à travers le temps, avec l’odeur originelle, l’originelle haine des bêtes, des parcelles de bêtes, que ces choses avaient été jadis. Et je jouissais infiniment, comme devant l’un des plus impressionnants spectacles de la nature, à suivre les progrès de ce lent et sûr travail, les épisodes de ce drame grandiose et obscur, où pourtant j’apercevais, clairement défini, le but vital pour lequel les gestes, les mouvements, les ruées soudaines de l’instinct et leurs nécessaires violences acquéraient, pour la défense et pour l’attaque, une force, une élasticité, une grâce aussi et une précision de jour en jour plus marquées. Il avait l’air de jouer au méchant tigre, de même qu’un enfant, dont la conscience s’éveille, commence à jouer, tout naturellement, au soldat ou au brigand.
Dès qu’il fut davantage en possession de soi-même et maître à peu près de ses organes, Dingo m’émerveilla par une faculté prodigieuse et comique d’adaptation au milieu nouveau où l’avait transplanté l’ingéniosité de notre ami, sir Edward Herpett.
Bien qu’il ne connût absolument rien de la civilisation européenne ni d’aucune autre civilisation, il en accepta immédiatement les douceurs et même il les revendiqua bruyamment, avec une âpre autorité.
Sans qu’il y eût été encouragé par mes conseils et par de préalables conférences sur l’esthétique de la décoration et du mobilier, il choisissait, pour s’étendre, dormir, s’y caresser, les soies les plus douces, les plus molles velours et les plus harmonieux tapis. Ce sauvage enfant de la brousse avait une préférence obstinée pour les bergères, pour les chaises-longues Louis XVI et leurs coussins gonflés de duvet. À s’y enfoncer, il montrait une volupté en quelque sorte provocante. En revanche, il détestait l’Empire, non par esprit de parti, je suppose, – heureusement son adaptation n’alla pas jusqu’à l’opinion politique, – mais comme dénué de confortable, et par trop voyant. Il avait particulièrement horreur du rouge vif et du vert cru. Cela devint si évident, si persistant que je n’hésitai pas à me débarrasser – j’en demande pardon à M. Frédéric Masson – d’un canapé Empire, ayant, comme il convient, appartenu sinon à Napoléon, du moins à quelqu’un de ses frères, de ses femmes, de ses maréchaux ou de ses cuisiniers, et à propos de quoi la mauvaise humeur de Dingo avait fini par me gagner.
Un jour que la querelle avait été plus vive qu’à l’ordinaire, je me dis :
– Dingo a raison. Ce vert acide qui pique les yeux, ces lignes rigides de lit de camp, ce dossier droit qui brise les reins et endolorit les omoplates, cette impersonnalité bureaucratique, cette raideur disciplinaire de salle de police, décidément, ça n’est pas beau. Et que le diable emporte aussi ces accumulations de bronzes ridicules, ces palmes, ces lyres, ces lions, ces torches et tous ces emblèmes de comice agricole, où nous accrochons, Dingo, son poil encore tendre, moi, mes vieux fonds de pantalon. Je vais m’en défaire.
Je le vendis en effet à un ministre radical-socialiste, qui adorait l’Empire, je veux dire le style Empire, et « seulement, rectifiait cet homme d’État, dans l’ameublement, diable » !
Dingo fut ravi. Il s’empressa de manifester sa satisfaction en dévorant une sorte de grand divan en belle peau de cochon, confortablement capitonné, par quoi j’avais aussitôt remplacé le canapé qu’il détestait. Il en eut une telle indigestion et fut si malade que je pensai le perdre.
Il avait, en toutes choses, des idées exclusivement réalistes. Contrairement aux défunts poètes symbolistes qui, par une ironie vengeresse du sort, sont devenus académiciens, bookmakers, critiques de théâtre, placiers d’automobiles, réparateurs de porcelaines, il se refusait avec la plus belle énergie à vivre, dans un « chenil d’ivoire », d’abstractions prosodiques et – autant que cela fût possible à un chien – d’idéales chevauchées avec des crémières neurasthéniques, d’immatérielles amours avec des fruitières de rêve. Non… Il était très fermement résolu à n’exiger de la vie que ce qu’à un chien d’esprit sain, de forte santé, ennemi des théories préconçues, elle peut apporter de jouissances moins raffinées sans doute, vulgaires, grossières à coup sûr, mais tangibles et certaines. Aussi repoussait-il, comme illogique et stérile, la conception de l’art pour l’art, condamnée d’ailleurs avant lui par les meilleurs esprits. Il ne séparait pas le bien-être de la beauté. Il entendait que le beau fût utile et que l’utile fût beau. Et, pour lui, la beauté des choses, c’était leur comestibilité. Par exemple, il ne lui suffisait pas qu’un tapis persan fût reconnu par d’infaillibles experts pour de la belle époque d’Aubusson. Il fallait en plus qu’il le jugeât assez bien conservé, assez riche en haute laine, pour qu’il prît plaisir à se coucher dessus ; il fallait surtout qu’il pût en avaler, facilement, la matière précieuse, si telle était son humeur du moment.
Comprenez-moi, je vous prie.
Jamais Dingo ne me fit, ne fit à personne de confidences intellectuelles sur la formation de ses idées et le développement de sa vie morale. Vous me direz qu’il était bien trop jeune. Ce n’est pas une raison. Il n’y a que les jeunes gamins pour cultiver ce genre de divertissement morose, et ils finissent toujours par se noyer dans le biberon sans fond de leur âme. Dingo était bien trop avisé pour cela. Je ne voudrais donc pas affirmer que ce furent réellement là ses pensées profondes, ses pensées de derrière la tête. Je ne voudrais pas non plus calomnier son bon goût, au point de prétendre qu’il employât couramment, dans la conversation, ce fatigant, cet éternel vocable : la beauté, si inlassablement galvaudé par les collégiens, les architectes et les femmes de lettres, dans leurs banquets de corps, et qui ne signifie rien… rien du tout. C’est moi seul, je le confesse, qui, par une sotte et orgueilleuse manie d’anthropomorphisme – non dans une intention d’imposture – me plais à tirer des actes d’un chien ce commentaire humain, dans l’impuissance où je suis à en concevoir un autre, honnêtement canin. Je dois aussi à Dingo cette justice – et je m’empresse de la lui rendre – que s’il eut jamais ces idées et s’il employa ce malencontreux vocable, ce fut toujours avec une parfaite ingénuité. Car, tout en lui, me démontre qu’il ne haïssait rien tant que le pédantisme des psychologues, des sociologues, des idéologues littéraires, non moins que la prétentieuse absconsité chère aux critiques d’art.
D’ailleurs, comme vous le verrez, par la suite, il me donna de bien autres sujets d’étonnement.
Sur la nourriture, il était inflexible et – qu’on me pardonne ce mot qui, appliqué à un chien pourra paraître bien irrespectueux pour la Royauté, pour l’Empire, pour la République et pour tous les systèmes de gouvernement qui en dérivent – traditionaliste. Oui, Dingo était traditionaliste – en cuisine, du moins. Il n’admettait aucune synthèse, aucune chimie alimentaire. Avec dégoût, avec indignation même, il repoussait tout lait qui ne fût pas très pur, à qui manquât ce que mon pharmacien appelait son « coefficient de buthyrification », toute soupe qui n’eût pas été confectionnée, selon les règles, hélas perdues, de la plus parfaite cuisine française d’autrefois. Quant à ces biscuits modern-style, composés, sous prétexte d’hygiène et de commodité domestiques, d’on ne sait quelles grattures toxiques, ma foi, il en riait. Bien que les observateurs prétendent que les chiens ne rient jamais, je vous assure qu’il en riait. Certes, il ne riait pas à la manière des hommes qui se tordent de rire, qui se tiennent les côtes de rire : gestes qui lui eussent été difficiles et probablement répugnants. Mais il avait un rire sévère, un peu morne, un rire immobile… le rire classique des augures et des grands comiques.
Au fait, on ne pouvait pas le tromper. Il flairait, de très loin, dans sa pâtée, l’odeur suspecte, l’ingrédient étranger, s’arrêtait net dans son élan, s’allongeait ensuite sur le ventre, les pattes de devant croisées l’une sur l’autre, la tête dédaigneusement levée vers le plafond et ne bougeait plus. À mes appels, il ramenait en arrière ses oreilles brusquement couchées, se fouettait les flancs par de lents mouvements de sa queue, – ce qui était le signe d’un grave mécontentement, au rebours des mouvements précipités qui étaient un signe de joie, – et ne bougeait pas davantage. Si, agacé, je l’amenais de force, en le traînant par la peau du cou, devant sa pâtée, si je lui disais sur un ton impératif : « Allons, Dingo, mange… mais mange donc… sacré nom d’un chien ! » il secouait la tête comme un enfant qui refuse d’obéir. Je crois aussi qu’il ne me pardonnait pas ce jurement… Le « sacré nom d’un chien », l’offusquait, lui semblait aussi blasphématoire qu’à une dévote le « sacré nom de Dieu » d’un vieux général boulangiste.
– Voyons, mon petit Dingo, reprenais-je sur un ton complètement changé, un ton doucement suppliant… mange… je veux que tu manges… Pour me faire plaisir…
Il fallait le voir alors se remettre debout, plisser son front maussade, trépigner, gratter le tapis, renverser sur la nappe de linoléum son assiette ou son bol d’un coup de patte bref et sans réplique. Et il s’en allait, lentement, en affectant de regarder à droite, à gauche, il ne savait quoi, avec un air détaché, un air d’être ailleurs, très loin de sa pâtée et de moi.
Ce qui ne l’empêchait pas, quand il découvrait dans le bois, sous un tas de feuilles mortes, ou bien enfouies profondément dans la terre, d’innommables ordures, de s’y délecter avec gloutonnerie.
Chaque fois qu’il m’arrivait de le surprendre en l’un de ces ignobles festins, je lui disais, avec un chagrin amical, dans l’espoir de lui donner de la honte et du remords :
– Ah ! Dingo !… toi !… toi si bien élevé ! ah ! fi… que c’est laid ! que c’est vilain !
Et je lisais sa réponse dans ses yeux étonnés :
– Eh bien ?… quoi ?… Ce n’est pas de la nourriture… c’est de la chasse. J’appelle nourriture ce que tu me donnes… chasse ce que je trouve… Et tu sais, ce n’est pas fameux ce que tu me donnes… c’est toujours la même chose… Avec ça que tu manges des choses propres, toi… et qui sentent bon… Tiens, justement… le fromage de ce matin…
Que pouvais-je dire ? C’était là répondre… Et, précocité merveilleuse, il n’avait pas encore six mois !
En quelques heures, il apprit la propreté corporelle et la pratiqua minutieusement, jusque dans les plus intimes détails, comme une demoiselle d’opéra. Mais passons.
J’avais remarqué que Dingo apprenait très facilement, sans le moindre effort, tout ce qu’il jugeait devoir lui être agréable et utile dans la vie. Pareil en ceci aux cancres, aux délicieux cancres de collège, tout ce qui lui déplaisait, c’est-à-dire tout ce qui ne correspondait pas à sa sensibilité, à sa mentalité de chien, – Dieu sait que ce n’était pas rare ! – aucune force humaine, ni la sévérité, ni la ruse, n’était capable de le lui faire accepter. Vous ne me croirez pas : il simulait l’incompréhension pour n’avoir point à obéir, et qu’on ne pût vraiment pas lui savoir mauvais gré de ses résistances.





























