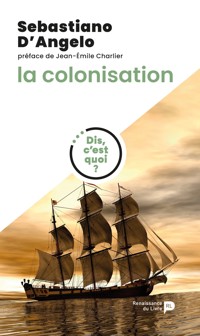
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Renaissance du livre
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
La colonisation a laissé des traces indélébiles sur l’histoire de notre humanité. Des caravelles de Christophe Colomb à la vague d'indépendance des années 1960, la conquête de ces nouveaux territoires a redessiné les frontières du monde connu. Elle a aussi bouleversé les sociétés d’ici et d’ailleurs : exploitation des ressources, accroissement des richesses, hiérarchisation de l’espèce humaine, marchandisation des corps, résistances des peuples et mission civilisatrice... Dans un contexte où les conséquences du colonialisme continuent à pétrir nos réalités, ce livre propose d’éclairer les événements marquants du passé colonial et d’en questionner l’héritage mal connu et parfois oublié.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 91
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIS, C’EST QUOI
la colonisation ?
Sebastiano D’Angelo
Dis, c’est quoi la colonisation ?
Renaissance du Livre
Drève Richelle, 159 – 1410 Waterloo
www.renaissancedulivre.be
Directrice de collection : Nadia Geerts
Maquette de la couverture : Corinne Dury
Mise en page : CW Design
e-isbn : 9782507057121
dépôt légal : D/2021.12.763/03
Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.
Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est strictement interdite.
Sebastiano D’Angelo
DIS, C’EST QUOI
la colonisation ?
Préface de Jean-Émile Charlier
Préface
La période contemporaine est marquée par l’affirmation fière d’identités multiples qui supportent autant de « luttes pour la reconnaissance » (Honneth, 2000) : de nombreux groupes entendent faire reconnaître la spécificité de leurs besoins et obtenir qu’ils soient pris en compte dans l’organisation générale de la société et dans toutes les politiques publiques. Si cette exigence de reconnaissance est générale, elle est exprimée avec une insistance particulière par les catégories de population qui ont été, sont ou se sentent touchées par des mécanismes d’exclusion ou de relégation fondés sur la race, le genre ou l’identité. Pour chacune de ces catégories, la reconnaissance d’une égalité formelle de droits semble aujourd’hui acquise dans nos pays ; dans tous les cas, elle a été obtenue de haute lutte et elle est toujours susceptible d’être remise en question. Les porte-paroles de ces catégories de population ne s’y trompent pas et estiment que cette égalité formelle de droits n’est pas suffisante et qu’elle doit aller de pair avec une reconnaissance sociale qui la rend incontestable dans les faits en l’intégrant à la culture et à la morale collectives.
Les arguments des mouvements porteurs de ces revendications identitaires ont ébranlé les fondements des théories critiques qui dénonçaient les inégalités dans les sociétés occidentales démocratiques. Dans une perspective marxiste, ces théories n’ont d’abord accordé d’attention qu’au facteur économique ; avec Bourdieu, elles ont ensuite intégré l’influence du facteur culturel ; Fraser (2011) a réussi une synthèse de ces perspectives et de bien d’autres en avançant que la justice sociale exige à la fois la redistribution, pour corriger l’injustice économique, et la reconnaissance, pour effacer les injustices symboliques. Pour se réaliser, pareil programme devrait aussi composer avec l’« intersectionnalité » (Crenshaw, 1989) qui assure un effet cumulatif aux attributs individuels, qu’ils soient connotés positivement ou négativement : pour user d’unecaricature en apparence facile, mais qui pointe impitoyablement la manière dont les catégorisations sociales ordinaires se combinent et amplifient leurs effets, il est incontestable que l’homme blanc, hétérosexuel, urbain, diplômé, protégé par un contrat de travail à durée indéterminée, jouit d’avantages significatifs, économiques et symboliques sur la femme de couleur, transsexuelle, rurale, sans diplôme et sans emploi fixe.
La remise en question de l’ancien ordre du monde ne se fait pas sans heurts. Quelle que soit la vertu des causes qu’ils défendent, les hérauts des identités brimées sont susceptibles d’user de violence symbolique avec autant de talent et de cynisme que leurs adversaires. Bruckner (2020) a mis en évidence le mouvement qui a conduit de l’anticolonialisme, du féminisme et de l’antiracisme des années 1960-1970 à la mise en accusation du « mâle blanc hétérosexuel », dont les comportements privés et politiques ne peuvent inspirer que la répulsion : il est soupçonné d’être ontologiquement un violeur, il est postulé responsable du colonialisme, de l’impérialisme et de l’esclavage.
Il ne peut être question de renvoyer dos à dos ces deux argumentaires. Celui de la tradition a incontestablement percolé dans les consciences de manière longue et il les a irriguées bien plus en profondeur que celui des chantres de la diversité. Il a assimilé cet homme blanc hétérosexuel à la réalisation la plus accomplie des potentialités du vivant et a fait de lui l’étalon permettant de jauger la qualité de tous les humains. L’ordre moral qu’il prône repose sur des postulats définitivement indéfendables, comme celui de la supériorité de l’homme blanc sur tous les autres humains. Sous peine de générer de nouvelles injustices, la dénonciation des aspects inacceptables de cet ordre moral traditionnel ne peut toutefois pas conduire à exonérer les hérauts des identités brimées de toute critique. Elle doit tout au contraire être accompagnée d’une mise en lumière des éléments factuels qui ont permis à cet ordre moral de se mettre en place puis de se maintenir longuement. La reconnaissance sociale des différences passe en effet par la compréhension des mécanismes sociaux qui les ont niées.
L’ouvrage de Sebastiano D’Angelo est sans conteste de ceux qui servent cet idéal de fournir aux lecteurs les éléments nécessaires pour pouvoir comprendre et se construire une opinion. En peu de pages, sans user de ces artifices rhétoriques qui camouflent les questions qui fâchent et font croire à une unanimité des points de vue, il présente un panorama large de ce qu’ont été toutes les colonisations en relevant à la fois ce qui les distingue et ce qui les rend comparables. L’érudition sur laquelle repose ce panorama a la vertu de se faire discrète. Les références aux meilleurs ouvrages sont indiquées, elles guident de façon claire le lecteur soucieux de s’informer davantage.
De toute évidence, l’auteur n’est pas neutre, il condamne sans aucune réserve l’entreprise coloniale, quelles qu’en aient été les expressions. Les arguments moraux qui soutiennent sa position sont très solides et sont partagés par la majorité des citoyens qui continuent de penser que la démocratie et son postulat d’absolue équivalence de poids politiques entre tous les humains adultes est le moins mauvais des systèmes politiques. Son livre nous rappelle que cette majorité n’inclut pas, par définition, la totalité de la population et que la mobilisation reste impérative, jour après jour, pour préserver les valeurs de tolérance et de reconnaissance de l’autre que les fondateurs de cette démocratie ont réussi à faire accepter.
La réflexion de Sebastiano D’Angelo sur la colonisation s’enracine dans des recherches qu’il a conduites tant dans des archives que sur le terrain au Sénégal sur des objets qui avaient a priori peu de points communs avec la colonisation. Il a livré les résultats de son travail dans une thèse de doctorat en sociologie prolongée par un livre dans lequel il les a rendus aisément accessibles (D’Angelo, 2013). La lecture de cet ouvrage atteste que l’analyse de la colonisation qu’il nous propose aujourd’hui ne constitue pas un exercice académique, mais qu’elle s’inscrit dans une trajectoire intellectuelle et morale dont il nous permet d’être les spectateurs.
Jean-Émile Charlier
Bibliographie
Bruckner, P., Un coupable presque parfait. La construction du bouc émissaire blanc, Paris, Grasset, 2020.
Crenshaw, K., « Demarginalizing the Intersection of Race and Sex : A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics » in University of Chicago Legal Forum (14), 1989, pp. 538-554.
D’Angelo, S., Politique et marabouts au Sénégal (1854-2012), Louvain-la-Neuve, Academia, 2013.
Fraser, N., Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution, Paris, La Découverte, 2011.
Honneth, A., La lutte pour la reconnaissance, Paris, Cerf, 2000.
8 minutes et 46 secondes. Le 25 mai 2020, George Floyd agonise sous le genou du policier Derek Chauvin pendant 8 minutes et 46 secondes. Sur place, une adolescente de dix-sept ans filme puis diffuse la scène sur les réseaux sociaux. La vidéo devient virale et révulse les États-Unis. En quelques jours, plus d’une centaine de villes sont ébranlées par des manifestations et des émeutes raciales. D’un bout à l’autre du pays, on peut entendre l’écho des derniers murmures de George Floyd, « I can’t breathe ». Sur les pancartes et derrière les barricades, les revendications de dizaines de milliers de citoyens s’accordent. « Black lives matter. » Cette fois, c’en est trop. « No justice, no peace. » Cette fois encore, la question raciale se reflète dans le miroir de l’oncle Sam.
De l’autre côté de l’Atlantique, le mouvement fait tache d’huile. Claquemurées depuis des semaines, les populations se retrouvent dans l’espace public pour porter à leur tour la contestation. À Rome, Londres, Paris, Bruxelles et dans d’autres villes du Vieux Continent, on s’indigne, le plus souvent un genou au sol et parfois un pavé à la main, du racisme qui s’exerce sous toutes ses formes : brutalités policières, insultes, discriminations à l’emploi et au logement, discours de haine, etc.
À Bruxelles, plus de 10 000 citoyens se rassemblent pour honorer la mémoire de George Floyd sans oublier celle de Semira Adamu, Mawda Shawri, Mehdi Bouda et les autres. Parmi eux, des militants antiracistes relancent le débat sur le passé colonial de la Belgique. Sur la place du Trône, la statue équestre du roi Léopold II est vandalisée. Ses yeux et ses mains sont imbibés par la couleur du sang. Son buste arbore un « pardon » en guise de repentance. Dans la foulée, des voix se font entendre pour que les statues à l’effigie du roi bâtisseur soient déboulonnées de l’espace public et l’histoire coloniale revisitée.
Dis, c’est quoi la colonisation ?
Je ne comprends pas très bien… Tu ne penses pas que relier un crime raciste commis aux États-Unis et le passé colonial de l’Europe, c’est mélanger des choses qui ne devraient pas l’être ? Les USA ne sont pas l’Europe et inversement.
Si par là tu veux dire qu’il y a des différences sur le plan politique, économique ou social, tu as en bonne partie raison. Mais à y regarder de plus près, je pense que le rapprochement entre un crime raciste et des statues de bronze sur piédestal n’est pas totalement dénué de sens. Les rapports de pouvoir à l’époque coloniale ont laissé des traces, en partie oubliées et déformées avec le temps, mais toujours bien présentes dans nos sociétés.
Avant d’aller plus loin, tu peux me dire en quelques mots ce que tu entends par coloniser ?
Disons que coloniser, c’est s’emparer d’un territoire étranger, bien souvent par la force, l’occuper, au moins en partie, et l’organiser en vue d’exploiter ses ressources comme l’or, le coton, le riz ou encore le caoutchouc. Cependant, toutes les colonisations ne se ressemblent pas trait pour trait. S’il existe des similitudes, il y a aussi des spécificités propres à la période historique donnée, au lieu géographique ciblé et au projet du colonisateur, si toutefois il existe. Autrement dit, à ne pas y prendre garde, on risque de diluer la colonisation dans une bonne partie de l’histoire de l’humanité. Celle qui s’étend des premiers Empires de l’Antiquité au projet ambitieux du fondateur de SpaceX, Elon Musk, d’établir une colonie sur la planète Mars à l’horizon 2050.
Restons sur terre si tu le veux bien. On va parler de quelle colonisation alors ?
Pour simplifier les choses, on va mettre de côté tout ce qui précède l’époque moderne et commencer avec les grandes découvertes. À partir de là, les historiens ont délimité deux périodes coloniales. Un premier âge qui s’amorce au XVe siècle pour se terminer vers 1800-1850. Et ensuite, le colonialisme du début du XIXe





























