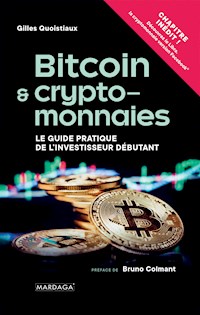Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Renaissance du livre
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
NFT, blockchain, minage... Autant de nouveaux termes apparus dans le vocabulaire des économistes sans que l’on comprenne toujours ce qu’ils recouvrent. Pourtant, l’économie numérique et les cryptodevises représentent un tournant majeur dans notre Histoire et dans la façon dont nous pouvons investir.L’idée ici n’est pas de savoir où ni comment faire fructifier son patrimoine, mais plutôt de comprendre le mode de fonctionnement de ce nouveau monde parallèle. La finance décentralisée constitue-t-elle notre futur ? Quel sera le rôle des États dans ce système moderne ? Est-il accessible à tous ? Autant de questions que nous allons explorer ensemble afin de comprendre ce que sont les cryptomonnaies, des bitcoins aux Dogecoins en passant par Ethereum.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 84
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIS, C’EST QUOI
les cryptomonnaies ?
Gilles Quoistiaux
Dis, c’est quoi les cryptomonnaies ?
Renaissance du Livre
Drève Richelle, 159 – 1410 Waterloo
www.renaissancedulivre.be
Directrice de collection : Nadia Geerts
Maquette de la couverture : Corinne Dury
Édition et mise en pages : [nor] production – www.norproduction.eu
e-isbn : 9782507057619
Dépôt légal : D/2022/12.763/14
Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.
Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est strictement interdite.
Gilles Quoistiaux
DIS, C’EST QUOI
les cryptomonnaies ?
Préface de Philippe Ledent
À Aubane et Emeline
Préface
La monnaie a quelque chose de fascinant. Bien sûr, la théorie monétaire a un volet technique, un contenu théorique solide, complexe et mathématique. Mais l’histoire de la monnaie est également faite de cultures, de traditions, de conventions qui dépassent la rationalité des chiffres. Non, les équations mathématiques ne suffisent pas à comprendre comment les monnaies se sont imposées ou ont disparu.
Il faut dire que la monnaie a quelque chose d’étrange, de paradoxal. En effet, il ne faut pas de monnaie pour qu’il y ait des échanges entre les individus qui composent une économie. Le troc (l’échange d’un bien contre un autre) suffit. Il ne faut même pas de monnaie pour qu’il y ait des prix. Si une pomme s’échange contre deux poires aux yeux des consommateurs, on sait que le prix d’une pomme est deux fois plus élevé que le prix d’une poire. De même, la monnaie n’est pas indispensable pour qu’il y ait de la richesse : cette dernière s’exprime d’abord par des actifs tangibles : des bâtiments, du mobilier, des moyens de locomotion, des outils, des entreprises, etc. Et pourtant, même si elle n’est indispensable ni aux transactions ni à l’accumulation de richesse, la monnaie a paradoxalement réussi à s’imposer comme un outil central du fonctionnement des économies, même primitives. La raison en est que la monnaie facilite la vie. Elle facilite d’abord les échanges : il ne faut plus trouver LA personne qui détient ce dont j’ai besoin et qui en même temps a besoin de ce que je détiens. Avec de la monnaie, je peux découpler mes ventes et mes achats de ressources, en ce compris dans le temps. La monnaie devient alors un simple moyen de conserver de la richesse en attendant une nouvelle affectation. Bref, la monnaie est l’agent facilitateur d’une économie.
Sans entrer dans les détails des fonctions de la monnaie, c’est sur ces bases que certaines choses se sont petit à petit imposées comme monnaie. On retrouve dans le désordre des pains de sel, des boisseaux de blé ou encore des métaux basiques ou précieux au fil de l’histoire. C’est intéressant, car cela montre que très longtemps la monnaie est restée un objet du quotidien, qui pouvait avoir une utilité alternative. La confiance dans la monnaie, élément essentiel de l’existence de celle-ci, n’avait donc rien d’irrationnel : si vos interlocuteurs ne veulent plus de votre monnaie, il vous suffit de la manger ou d’en faire des outils.
Plus étonnante est la découverte de monnaies primitives de type coquillages ou dents d’animaux. Dans ces cas, l’utilisation d’un objet comme monnaie est le fruit d’une convention entre les individus d’une communauté. Cette convention peut être fondée sur le symbole du pouvoir ou sur le simple produit des traditions. Mais cela veut dire que la confiance dans une monnaie peut se détacher de l’utilisation alternative que l’on peut en faire. On en trouve d’ailleurs encore des illustrations aujourd’hui. Prenez les « magasins de fleurs » organisés à la côte belge par les enfants sur la plage. Il ne s’agit pas de troc, mais d’une économie (ludique) monétaire où les coquillages (quel intéressant rappel à l’histoire monétaire !) jouent le rôle de monnaie. Les enfants ont pleinement confiance dans la monnaie qu’ils utilisent. Ils savent qu’en ramassant des coquillages sur la plage, ils seront acceptés en échange de fleurs. Il faut toute la naïveté (au sens positif du terme) des enfants pour utiliser quelque chose de disponible en quantité illimitée comme monnaie. Mais voilà, c’est leur convention et, à partir de là, la confiance dans la monnaie peut avoir quelque chose d’irrationnel… et donc de fascinant.
Au travers de ces exemples, on voit que plonger dans la compréhension des monnaies, c’est aussi mieux comprendre les sociétés qui les utilisent. En tout temps, une monnaie apparaît en phase avec son époque et bénéficie de la confiance d’une très large communauté d’utilisateurs. S’agissant de l’époque, les cryptomonnaies ne font pas exception, et ce, à plusieurs égards :
– Notre monde est de plus en plus digital, dématérialisé. Le commerce physique laisse la place au e-commerce, le travail au bureau laisse la place au télétravail, et ainsi de suite. La digitalisation fait bel et bien partie de nos vies et s’accélère. Dès lors, qu’une monnaie ne trouve plus de forme matérielle est assez logique au regard de notre époque.
– Nos sociétés se détournent de la centralisation comme garantie de qualité. Celle-ci est jugée et notée par les utilisateurs eux-mêmes et non par une autorité centrale. Ainsi, les avis sur un site de réservations de restaurants ont aujourd’hui plus de valeur que les macarons du célèbre Guide rouge. De même, les notes sur une plateforme de location de véhicules avec chauffeur ont plus d’importance que la législation contraignante et gage de qualité des traditionnels taxis. Enfin, la parole d’un influenceur ayant une large communauté de followers peut avoir plus de valeur qu’une publication dans une revue scientifique évaluée par l’autorité d’un comité scientifique. De la même manière, les cryptomonnaies se détachent de l’autorité monétaire (une banque centrale) pour ne s’en remettre qu’à la validation des utilisateurs de la monnaie. Bref, la relation de confiance change : ce n’est pas la confiance dans l’autorité qui stimule la confiance dans la monnaie, mais la confiance dans la communauté.
– Enfin, nous sommes depuis plus de vingt ans dans un monde de plus en plus globalisé. Le commerce international a explosé. Les échanges, les voyages, les études : tout est plus international. De ce point de vue, l’idée de monnaies nationales perd de sa valeur et il paraît logique que dans un monde globalisé, les monnaies le deviennent également.
Restons objectifs par rapport aux cryptomonnaies. Elles ne sont pas nécessairement une révolution. Leur développement trouve au contraire une certaine logique au regard de l’histoire monétaire : les cryptomonnaies sont simplement en phase avec leur époque. Est-ce suffisant pour qu’elles aient un avenir ? La réponse n’est pas simple. Les monnaies « classiques » évoluent aussi avec leur époque et ne sont pas faciles à détrôner. Mais surtout, être en phase avec son époque ne suffit pas. Encore faut-il, comme indiqué plus haut, que la monnaie soit UTILISÉE par une très large communauté qui lui fait CONFIANCE. C’est peut-être là le talon d’Achille (ou le défi) des cryptomonnaies.
D’une part, il n’est pas aisé d’obtenir la confiance du plus grand nombre. C’est pour cela que l’histoire monétaire est aussi faite d’impasses. Par exemple, il y a deux siècles (ce qui est peu au regard de l’histoire monétaire), chaque banque commerciale émettait ses propres billets de banque. Dès lors, dans une même économie, différentes monnaies pouvaient coexister, acceptées par l’ensemble de la communauté. La confiance dans la monnaie n’était pas attachée à une banque centrale (qui n’existait donc pas), ni même à l’autorité publique, mais à la réputation de l’institution bancaire. Confiance dans la banque commerciale et confiance dans la monnaie ne faisaient qu’un. Une crise bancaire (par peur d’une faillite par exemple) se doublait alors inévitablement d’une crise monétaire. C’est justement pour en finir avec ces crises que l’émission monétaire a été octroyée exclusivement à une autorité (semi-)publique. La monnaie émise est la seule à recevoir « cours légal », c’est-à-dire l’obligation par le vendeur de l’accepter.
La coexistence de différentes monnaies, issues chacune d’une initiative privée n’est pas sans rappeler les multiples cryptomonnaies qui coexistent aujourd’hui. Arrivent-elles à gagner la confiance du plus grand nombre ? Pas vraiment, sans oublier qu’elles n’ont pas cours légal. Existeront-elles toujours toutes dans quelques années ? Probablement pas. Peut-être que l’une ou l’autre s’imposeront dans le paysage virtuel, tout comme une sélection naturelle s’est opérée dans les billets au gré des crises bancaires et monétaires. Mais il leur faudra alors gagner une confiance d’un autre ordre que celle dont elles font preuve aujourd’hui.
D’autre part, la magie d’une monnaie, c’est que ses utilisateurs ne s’y attachent pas, alors même qu’ils lui font confiance comme moyen de paiement et comme instrument de conservation de richesse. Le moment venu, pour faire une transaction de consommation ou acquérir un actif tangible, les utilisateurs d’une monnaie n’hésitent pas à s’en séparer. Une monnaie, on l’aime, mais on s’en sépare sans scrupule !
Or, sans nier qu’une petite communauté utilise les cryptomonnaies pour ce qu’ils veulent qu’elles soient, à savoir des instruments de paiement, la plupart des détenteurs de cryptomonnaies n’ont qu’une idée en tête : combien de dollars valent-elles ? N’est-ce pas un peu étrange de se référer à une autre monnaie pour évaluer la valeur de celle que l’on détient ? Vous dites-vous souvent en recevant votre salaire ou votre argent de poche : « Chouette, j’ai reçu 100 euros, c’est quand même 90 dollars ! » ?
Pour cette raison, beaucoup de détenteurs de cryptomonnaies ne veulent pas s’en séparer « parce qu’elles vont prendre de la valeur » ou « parce qu’elles ont perdu de la valeur, mieux vaut attendre qu’elles remontent ». Le comportement du détenteur de cryptomonnaies est celui d’un investisseur, et non d’un consommateur. Mais que devient une monnaie si elle n’est pas utilisée ? Un boisseau de blé peut redevenir du pain, une pièce de bronze peut redevenir un outil, mais quid d’un alignement de 0 et de 1… ?
Philippe Ledent