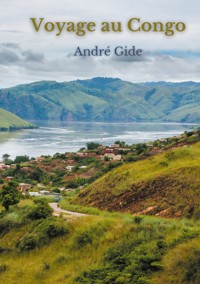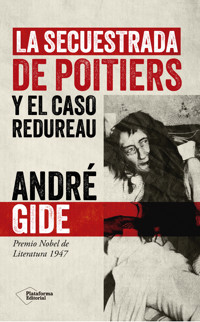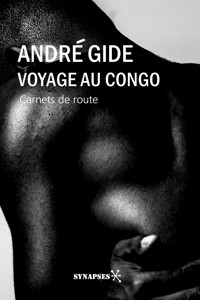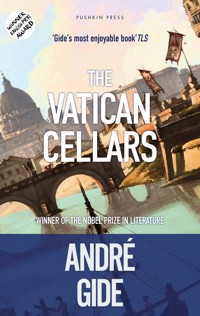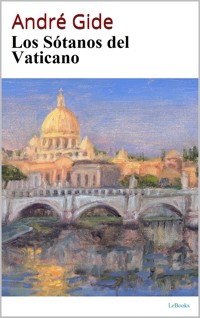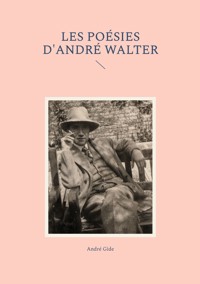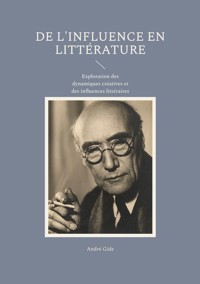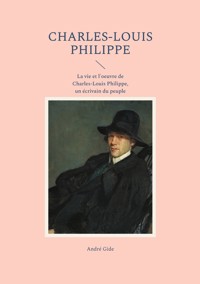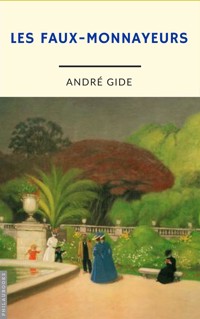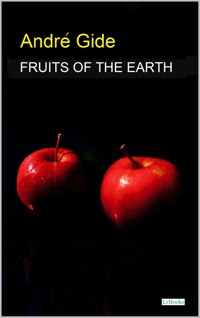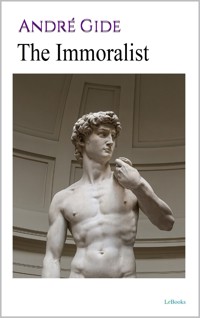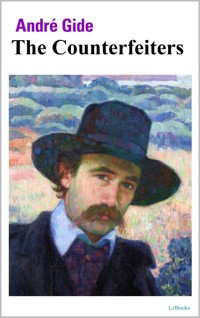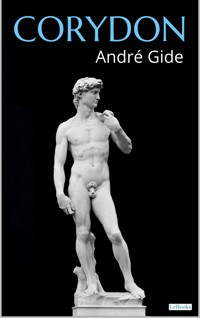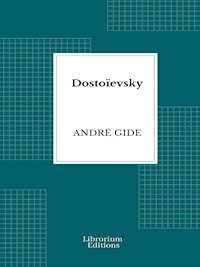
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
On s’attend à trouver un dieu ; on touche un homme — malade, pauvre, peinant sans cesse et singulièrement dépourvu de cette pseudo-qualité qu’il reprochait tant au Français : l’éloquence. Pour parler d’un livre aussi nu, je tâcherai d’écarter de moi-même tout autre souci que celui de la probité. S’il en est qui espèrent trouver ici art, littérature ou quelque amusement d’esprit, je leur dis aussitôt qu’ils feront mieux d’abandonner cette lecture.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
DOSTOÏEVSKY
PAR
ANDRÉ GIDE
Dostoïevsky… le seul qui m’ait appris quelque chose en psychologie… Sa découverte a été pour moi plus importante encore que celle de Stendhal.
Fr. Nietzsche.
1923
© 2022 Librorium Editions
ISBN : 9782383835424
TABLE DES MATIÈRES
Dostoïevsky d’après sa correspondance
« Les Frères Karamazov »
Allocution lue au Vieux-Colombier
Conférences : I
— II
— III
— IV
— V
— VI
Appendice
DOSTOÏEVSKY D’APRÈS SA CORRESPONDANCE (1908)
À Pierre-Dominique Dupouey.
La masse énorme de Tolstoï encombre encore l’horizon ; mais — ainsi qu’il advient en pays de montagnes où l’on voit, à mesure que l’on s’en éloigne, par-dessus la plus proche cime, la plus haute, que la plus voisine cachait, reparaître — quelques esprits avant-coureurs peut-être remarquent-ils déjà, derrière le géant Tolstoï, reparaître et grandir Dostoïevsky. C’est lui, la cime encore à demi cachée, le nœud mystérieux de la chaîne ; quelques-uns des plus généreux fleuves y prennent source, où les nouvelles soifs de l’Europe se peuvent abreuver aujourd’hui. C’est lui, non point Tolstoï qu’il faut nommer à côté d’Ibsen et de Nietzsche ; aussi grand qu’eux, et peut-être le plus important des trois.
Il y a quelque quinze ans, M. de Vogüé, qui fit le noble geste d’apporter à la France sur le plateau d’argent de son éloquence les clefs de fer de la littérature russe, s’excusait, lorsqu’il en vint à Dostoïevsky, de l’incivilité de son auteur ; et, tout en lui reconnaissant une manière de génie, avec des réticences de bon ton, gêné par tant d’énormité, il en demandait pardon au lecteur, avouait que « le désespoir le prenait d’essayer de faire comprendre ce monde au nôtre ». Après s’être allongé quelque temps sur les premiers livres qui lui semblaient les plus susceptibles, sinon de plaire, du moins d’être supportés, il s’arrêtait à Crime et châtiment, avertissait le lecteur, bien forcé de l’en croire sur parole puisque à peu près rien d’autre n’était alors traduit, que, « avec ce livre, le talent de Dostoïevsky avait fini de monter » ; qu’il « donnerait bien encore de grands coups d’ailes, mais en tournant dans un cercle de brouillard, dans un ciel toujours plus troublé » ; puis, après une présentation débonnaire du caractère de l’Idiot, parlait des Possédés comme d’un « livre confus, mal bâti, ridicule souvent et encombré de théories apocalyptiques », du Journal d’un écrivain comme d’ « hymnes obscurs échappant à l’analyse comme à la controverse » ; ne parlait ni de l’Éternel Mari[1] ni de l’Esprit souterrain, écrivait : « Je n’ai pas parlé d’un roman intitulé Croissance, fort inférieur à ses aînés », et plus désinvoltement encore : « Je ne m’arrêterai pas davantage aux Frères Karamazov ; de l’aveu commun, très peu de Russes ont eu le courage de lire jusqu’au bout cette interminable histoire. » Enfin il concluait : « Ma tâche devait se borner à appeler l’attention sur l’écrivain, célèbre là-bas, presque inconnu ici, à signaler dans son œuvre les trois parties (?) qui montrent le mieux les divers aspects de son talent : ce sont les Pauvres Gens, les Souvenirs de la maison des morts, Crime et châtiment. »
De sorte qu’on ne sait trop ce qui doit l’emporter ici, de la reconnaissance, car enfin il fut le premier à nous avertir, — ou de l’irritation, car il nous présente, comme à contre-cœur semble-t-il, à travers son évident bon vouloir, une image déplorablement réduite, incomplète et par cela même faussée de cet extraordinaire génie ; et l’on doute si l’auteur du Roman russe a plus servi Dostoïevsky en attirant vers lui l’attention, qu’il ne l’a desservi en limitant cette attention à trois de ses livres, admirables certes, déjà, mais non des plus significatifs et au delà desquels seulement notre admiration pleinement s’étendra. Peut-être au demeurant Dostoïevsky, pour une intelligence salonnière, n’était-il pas commode à saisir ou pénétrer du premier coup… « Il ne délasse pas : il fatigue, comme les chevaux de sang toujours en action ; ajoutez-y la nécessité de se reconnaître… il en résulte pour le lecteur un effort d’attention… une courbature morale…, etc. » ; les gens du monde, il y a trente ans, ne parlaient pas très différemment des derniers quatuors de Beethoven (« Ce qui est compris trop rapidement n’est pas de longue durée », dit Dostoïevsky dans une de ses lettres.)
Ces jugements dépréciatifs purent retarder, il est vrai, la traduction, la publication et la diffusion de Dostoïevsky, décourager d’avance bien des lecteurs, autoriser M. Charles Morice à ne nous servir d’abord, des Karamazov, qu’une version procustement mutilée[2], ils ne purent faire, heureusement, que l’œuvre entière, lentement, chez divers éditeurs, volume après volume, ne parût[3].
Si pourtant, à présent encore, Dostoïevsky ne recrute que lentement ses lecteurs et parmi une élite assez spéciale ; s’il rebute non seulement le gros public à demi cultivé, à demi sérieux, à demi bienveillant, que n’atteignent guère plus, il est vrai, les drames d’Ibsen, mais qui sait goûter Anna Karénine et même la Guerre et la Paix, — ou cet autre public moins aimable qui se pâme devant Zarathustra, — il serait peu sérieux d’en faire M. de Vogüé responsable ; je vois à cela des causes assez subtiles que l’étude de la correspondance nous permettra d’atteindre pour la plupart. Aussi bien n’est-ce point de l’œuvre entière de Dostoïevsky que je prétends parler aujourd’hui, mais simplement de ce dernier livre qui parut au Mercure de France en février 1908 (la Correspondance).
I
On s’attend à trouver un dieu ; on touche un homme — malade, pauvre, peinant sans cesse et singulièrement dépourvu de cette pseudo-qualité qu’il reprochait tant au Français : l’éloquence. Pour parler d’un livre aussi nu, je tâcherai d’écarter de moi-même tout autre souci que celui de la probité. S’il en est qui espèrent trouver ici art, littérature ou quelque amusement d’esprit, je leur dis aussitôt qu’ils feront mieux d’abandonner cette lecture.
Le texte de ces lettres est souvent confus, maladroit, incorrect, et nous savons gré à M. Bienstock, résignant tout souci d’élégance factice, de n’avoir point cherché à remédier à cette gaucherie si caractéristique[4].
Oui, le premier abord rebute. Hoffmann, le biographe allemand de Dostoïevsky, laisse entendre que le choix des lettres livrées par les éditeurs russes eût pu être mieux fait[5] ; il ne me convainc point que la tonalité en aurait été différente. Tel que voici, le volume est épais, étouffant[6], non point en raison du nombre des lettres, mais de l’énorme informité de chacune d’elles. Peut-être n’avions-nous pas exemple encore de lettres de littérateur si mal écrites, j’entends : avec si peu d’apprêt. Lui, si habile à « parler autrui », lorsqu’il s’agit de parler en son propre nom, s’embarrasse ; il semble que les idées, sous sa plume, ne viennent pas successives mais simultanées, ou que, pareilles à ces « fardeaux branchus » dont parlait Renan, il ne les puisse tirer au jour qu’en s’écorchant et en accrochant tout au passage ; de là, ce foisonnement confus, qui, maîtrisé, servira dans la composition de ses romans, à leur complexité puissante. Lui, si dur, si âpre au travail, qui corrige, détruit, reprend inlassablement chacun de ses récits, page après page, jusqu’à faire rendre à chacun d’eux l’âme profonde qu’il contient — écrit ici tout comme il peut ; sans rien biffer sans doute, mais se reprenant constamment ; le plus vite possible, c’est-à-dire interminablement. Et rien ne laisse mesurer mieux la distance de l’œuvre à l’ouvrier qui la produit. Inspiration ! ô flatteuse invention romantique ! Muses faciles ! où êtes-vous ? — « Une longue patience » ; si jamais l’humble mot de Buffon fut à sa place, c’est ici.
« Quelle théorie est donc la tienne, mon ami, — écrit-il à son frère, presque au début de sa carrière, — qu’un tableau doit être peint en une fois ? — Quand as-tu été persuadé de cela ? Crois-moi ; il faut partout du travail et un travail énorme. Crois-moi qu’une pièce de vers de Pouchkine, légère et élégante, de quelques lignes, paraît justement écrite en une fois parce qu’elle a été longtemps arrangée et reprise par Pouchkine… Rien de ce qui a été écrit de chic n’est mûr. On ne trouve pas de ratures dans les manuscrits de Shakespeare, dit-on. C’est pour cela qu’on y trouve tant de difformités et de manque de goût ; s’il eût travaillé, c’eût été encore mieux… »
Voilà le ton de la correspondance entière. Le meilleur de son temps, de son humeur, Dostoïevsky le donne au travail. Aucune de ses lettres n’est écrite par plaisir. Constamment il revient sur son « dégoût terrible, invincible, inimaginable, d’écrire des lettres ». — « Les lettres, dit-il, sont des choses stupides ; on ne peut pas du tout s’y épancher. » Et mieux : « Je vous écris tout et je vois que du principal de ma vie morale, spirituelle, je ne vous ai rien dit ; je ne vous en ai même pas donné une idée. Ce sera ainsi tant que nous resterons en correspondance. Je ne sais pas écrire les lettres ; je ne sais pas écrire de moi, m’écrire avec mesure. » Il déclare par ailleurs : « On ne peut jamais rien écrire dans une lettre. Voilà pourquoi je n’ai jamais pu souffrir Mme de Sévigné : elle écrivait ses lettres trop bien. » Ou encore, humoristiquement : « Si je vais en enfer, je serai certainement condamné pour mes péchés à écrire une dizaine de lettres par jour » — et c’est bien, je crois, l’unique plaisanterie qu’on puisse relever au cours de ce sombre livre.
Il n’écrira donc que pressé par la nécessité la plus dure. Chacune de ses lettres (si toutefois l’on en excepte celles des dix dernières années de sa vie, d’un ton tout autre, et sur lesquelles je reviendrai spécialement), chacune de ses lettres est un cri : il n’a plus rien ; il est à bout ; il demande. Que dis-je : un cri… c’est un interminable et monotone gémissement de détresse ; il demande sans habileté, sans fierté, sans ironie ; il demande et il ne sait pas demander. Il implore ; il presse ; il y revient, insiste, détaille ses besoins… Il me fait souvenir de cet ange qui, sous les traits d’un errant voyageur, ainsi que les Fioretti de saint François nous le racontent, vint au Val-de-Spolete heurter l’huis de la naissante confrérie. Il frappait si précipitamment, est-il dit, si longuement, si fort, que les frati s’en indignèrent et que frate Masseo (M. de Vogüé, je suppose), qui enfin lui ouvrit la porte, lui dit : « D’où viens-tu donc pour frapper si peu décemment ? » — Et l’ange lui ayant demandé : « Comment faut-il frapper ? » Masseo répondit : « On frappe trois coups espacés, puis on attend. Il faut laisser à celui qui vient ouvrir le temps de dire son patenôtre ; ce temps passé, s’il ne vient pas, on recommence… » — « C’est que j’ai si grand’hâte », reprend l’ange…
« Je suis dans une telle gêne que me voici prêt à me pendre », écrit Dostoïevsky. — « Je ne puis ni payer mes dettes, ni partir, faute d’argent pour le voyage et je suis complètement au désespoir. » — « Que deviendrai-je d’ici la fin de l’an ? Je ne sais pas. Ma tête se brise. Je n’ai plus à qui emprunter. » — (« Comprenez-vous ce que cela veut dire n’avoir plus où aller ? » disait un de ses héros.) — « J’ai écrit à un parent pour lui demander six cents roubles. S’il ne les envoie pas, je suis perdu. » De ces plaintes ou de semblables, cette correspondance est si pleine que je cueille tout au hasard… Parfois cette insistance encore, qui revient naïvement tous les six mois : « L’argent ne peut être aussi nécessaire qu’une seule fois dans la vie. »
Dans les derniers temps, comme ivre de cette humilité dont il savait griser ses héros, de cette étrange humilité russe, qui peut bien être chrétienne aussi, mais qui, affirme Hoffmann, se retrouve au fond de chaque âme russe, même de celle où la foi chrétienne fait défaut, et que ne pourra jamais parfaitement comprendre, dit-il, l’Occidental qui fait de dignité vertu : « Pourquoi me refuseraient-ils ? D’autant plus que je n’exige pas, mais je prie humblement. »
Mais peut-être cette correspondance nous trompe-t-elle en nous montrant toujours désespéré celui qui n’écrivait qu’en cas de désespoir… Non : aucun afflux d’argent qui ne fût aussitôt absorbé par les dettes ; de sorte qu’il pouvait écrire, à cinquante ans : « Toute ma vie j’ai travaillé pour de l’argent et toute ma vie j’ai été constamment dans le besoin ; à présent plus que jamais. » Les dettes… ou le jeu, le désordre, et cette générosité instinctive, immesurée, qui faisait dire à Riesenkampf, le compagnon de sa vingtième année : « Dostoïevsky est un de ces gens auprès desquels il fait pour tous très bon vivre, mais qui lui-même restera toute sa vie dans le besoin. »
À l’âge de cinquante ans il écrit : « Ce futur roman (il s’agit ici des Frères Karamazov, qu’il n’écrira que neuf ans plus tard), ce futur roman me tourmente déjà depuis plus de trois ans ; mais je ne le commence pas, car je voudrais l’écrire sans me presser, comme écrivent les Tolstoï, les Tourgueniev, les Gontcharov. Qu’il existe donc au moins une de mes œuvres qui soit libre et non écrite pour une époque déterminée. » — Mais c’est en vain qu’il dira : « Je ne comprends pas le travail fait à la hâte, pour de l’argent » ; cette question d’argent interviendra toujours dans son travail, et la crainte de ne pouvoir livrer ce travail à temps : « J’ai peur de ne pas être prêt, d’être en retard. Je n’aurais pas voulu gâter les choses par ma hâte. Il est vrai, le plan est bien conçu et étudié ; mais on peut tout gâter avec trop de hâte. »
Un surmenage effroyable en résulte, car s’il met son honneur dans cette ardue fidélité, il crèverait à la peine plutôt que de livrer de l’ouvrage imparfait ; et vers la fin de sa vie, il pourra dire : « Pendant toute ma carrière littéraire, j’ai toujours rempli exactement mes engagements ; je n’y ai jamais manqué une fois ; de plus, je n’ai jamais écrit uniquement pour de l’argent afin de me débarrasser de l’engagement pris » ; et peu avant, dans la même lettre : « Je n’ai jamais imaginé un sujet pour de l’argent, pour satisfaire à l’obligation une fois acceptée d’écrire pour un terme fixé d’avance. Je me suis toujours engagé — et vendu à l’avance — quand j’avais déjà mon sujet en tête, que je voulais réellement écrire et que je trouvais nécessaire d’écrire. » De sorte que si, dans une de ses premières lettres, écrite à vingt-quatre ans, il s’écrie : « Quoi qu’il en soit j’ai fait le serment : même parvenu aux dernières limites de la privation, je tiendrai bon et n’écrirai pas sur commande. La commande tue ; la commande perd tout. Je veux que chacune de mes œuvres, par elle-même, soit bien », — l’on peut dire sans trop de subtilité que, malgré tout, il s’est tenu parole.
Mais il garde toute sa vie la conviction douloureuse qu’avec plus de temps, de liberté, il eût pu mener à mieux sa pensée : « Ce qui me tourmente beaucoup, c’est que, si j’écrivais le roman à l’avance durant une année, et puis deux ou trois mois pour copier et corriger, ce serait autre chose, j’en réponds. » Illusion, peut-être ? Qui peut le dire ? Grâce à plus de loisir, qu’eût-il pu obtenir ? Que cherchait-il encore ? — Une plus grande simplicité, sans doute ; une plus parfaite subordination des détails… Tels qu’ils sont, ses meilleurs ouvrages atteignent, en presque chaque partie, un point de précision et d’évidence qu’on imagine difficilement dépassé.
Pour en arriver là, que d’efforts ! « Il n’y a que les endroits d’inspiration qui viennent tout d’un coup, à la fois, mais le reste est un travail très pénible. » À son frère qui sans doute lui avait reproché de ne pas écrire « assez simplement », croyant dire ainsi : assez vite, et de ne pas « se laisser aller à l’inspiration », il répondait, encore jeune : « Tu confonds évidemment l’inspiration, c’est-à-dire la création première, instantanée du tableau ou le mouvement de l’âme (ce qui arrive souvent), avec le travail. Ainsi, par exemple, j’inscris une scène aussitôt, telle qu’elle m’est apparue, et j’en suis enchanté ; ensuite, pendant des mois, pendant un an, je la travaille… et crois-moi, le résultat est bien meilleur. Pourvu que l’inspiration vienne. Naturellement, sans inspiration, rien ne peut se faire. » — Dois-je m’excuser de tant citer — ou ne me saura-t-on gré bien plutôt de céder la parole à Dostoïevsky le plus souvent possible ? « Au commencement, c’est-à-dire vers la fin de l’année dernière (la lettre est d’octobre 70), je considérais cette chose comme étudiée, composée, et je la regardais avec hauteur. (Il s’agit ici des Possédés.) Ensuite m’est venue la véritable inspiration — et soudain je l’ai aimée, cette œuvre, je l’ai saisie des deux mains, et je me suis mis à biffer ce qui était déjà écrit. » — « Toute l’année, dit-il encore (1870), je n’ai fait que déchirer et changer… J’ai changé mon plan au moins dix fois, et j’ai écrit de nouveau toute la première partie. Il y a deux ou trois mois, j’étais au désespoir. Enfin tout s’est constitué à la fois et ne peut-être changé. » Et toujours cette obsession : « Si j’avais eu le temps d’écrire sans me presser, sans terme fixe, il est possible qu’il en serait résulté quelque chose de bien. »
Cette angoisse, ces mécontentements de lui-même, il les a connus pour chaque livre :
« Le roman est long ; il a six parties (Crime et châtiment). À la fin de novembre, il y en avait déjà un grand morceau d’écrit, tout prêt ; j’ai tout brûlé ! Maintenant, je peux l’avouer, ça ne me plaisait pas. Une nouvelle forme, un nouveau plan m’entraînaient ; j’ai recommencé. Je travaille jour et nuit, et cependant j’avance peu. » — « Je travaille et, rien ne se fait, dit-il ailleurs ; je ne fais que déchirer. Je suis affreusement découragé. » Et ailleurs encore : « J’ai tant travaillé que j’en suis devenu stupide, et ma tête est toute étourdie. » Et ailleurs encore : « Je travaille ici (Staraia Roussa) comme un forçat, malgré les beaux jours dont il faudrait profiter ; je suis jour et nuit à l’ouvrage. »
Parfois un simple article lui donne autant de mal qu’un livre, car la rigueur de sa conscience reste aussi entière devant les petites choses que devant les grandes :
« Je l’ai traîné jusqu’à présent (un article de souvenirs sur Bielensky, qui n’a pu être retrouvé) et enfin je l’ai terminé en grinçant des dents… Dix feuilles de romans sont plus faciles à écrire que ces deux feuilles ! Il en est résulté que j’ai écrit ce maudit article, en comptant tout, au moins cinq fois, et puis je barrais tout et je modifiais ce que j’avais écrit. Enfin, j’ai achevé mon article tant bien que mal ; mais il est si mauvais que cela me tourne le cœur. » Car s’il garde la conviction profonde de la valeur de ses idées, il reste même pour ses meilleurs écrits, exigeant le travail, insatisfait après :
« Il m’est rarement arrivé d’avoir quelque chose de plus neuf, de plus complet, de plus original (Karamazov). Je puis parler ainsi sans être accusé d’orgueil, parce que je ne parle que du sujet, que de l’idée qui s’est implantée dans ma tête, non pas de l’exécution, quant à l’exécution, elle dépend de Dieu ; je puis la gâcher, ce qui m’est arrivé souvent… »
« Si vilain, si abominable que soit ce que j’ai écrit, dit-il ailleurs, l’idée du roman, et le travail que je lui consacre, me sont à moi malheureux, à moi l’auteur, ce qu’il y a de plus précieux au monde. »
« Je suis mécontent de mon roman jusqu’au dégoût, écrit-il lorsqu’il travaille à l’Idiot. Je me suis terriblement efforcé de travailler, mais je n’ai pas pu : j’ai le cœur malade. À présent, je fais un dernier effort pour la troisième partie. Si je parviens à arranger le roman, je me remettrai ; sinon je suis perdu. »
Ayant écrit déjà non seulement les trois livres que M. de Vogüé considère comme ses chefs-d’œuvre, mais encore l’Esprit souterrain, l’Idiot, l’Éternel Mari, il s’écrie, s’acharnant sur un nouveau sujet (les Possédés) : « Il est temps enfin d’écrire quelque chose de sérieux. »
Et l’année de sa mort, encore, à Mlle N…, à qui il écrit pour la première fois : « Je sais que moi, comme écrivain, j’ai beaucoup de défauts, parce que je suis le premier, bien mécontent de moi-même. Vous pouvez vous figurer que dans certaines minutes d’examen personnel, je constate souvent avec peine que je n’ai pas exprimé, littéralement, la vingtième partie de ce que j’aurais voulu, et peut-être même pu exprimer. Ce qui me sauve, c’est l’espoir habituel qu’un jour Dieu m’enverra tant de force et d’inspiration, que je m’exprimerai plus complètement, bref, que je pourrai exposer tout ce que je renferme dans mon cœur et dans ma fantaisie. »
Que nous sommes loin de Balzac, de son assurance et de son imperfection généreuse ! Flaubert même connut-il si âpre exigence de soi, si dures luttes, si forcenés excès de labeur ? Je ne crois pas. Son exigence est plus uniquement littéraire, si le récit de son labeur s’étale au premier plan dans ses lettres, c’est aussi qu’il s’éprend de ce labeur même, et que, sans précisément s’en vanter, du moins s’en énorgueillit-il ; c’est aussi qu’il a supprimé tout le reste, considérant la vie comme « une chose tellement hideuse que le seul moyen de la supporter, c’est de l’éviter », et se comparant aux « amazones qui se brûlaient le sein pour tirer de l’arc ». Dostoïevsky, lui, n’a rien supprimé ; il a femme et enfants, il les aime ; il ne méprise point la vie ; il écrit au sortir du bagne : « Au moins j’ai vécu ; j’ai souffert, mais quand même j’ai vécu. » Son abnégation devant son art, pour être moins arrogante, moins consciente et moins préméditée, n’en est que plus tragique et plus belle. Il cite volontiers le mot de Térence et n’admet pas que rien d’humain lui demeure étranger : « L’homme n’a pas le droit de se détourner et d’ignorer ce qui se passe sur la terre, et il existe pour cela des raisons morales supérieures : Homo sum, et nihil humanum… et ainsi de suite. » Il ne se détourne pas de ses douleurs, mais les assume dans leur plénitude. Lorsqu’il perd, à quelques mois d’intervalle, sa première femme et son frère Mikhaïl, il écrit : « Voilà que tout d’un coup je me suis trouvé seul ; et j’ai ressenti de la peur. C’est devenu terrible ! Ma vie est brisée en deux. D’un côté le passé avec tout ce pour quoi j’avais vécu, de l’autre l’inconnu sans un seul cœur pour me remplacer les deux disparus. Littéralement il ne me restait pas de raison de vivre. Se créer de nouveaux liens, inventer une nouvelle vie ? Cette pensée seule me fait horreur. Alors pour la première fois j’ai senti que ]e n’avais pas de quoi les remplacer, que je n’aimais qu’eux seuls au monde, et qu’un nouvel amour non seulement ne serait pas mais ne devait pas être. » Mais quinze jours après, il écrit : « De toutes les réserves de force et d’énergie, dans mon âme est resté quelque chose de trouble et de vague, quelque chose voisin du désespoir. Le trouble, l’amertume, l’état le plus anormal pour moi… Et de plus je suis seul !… Cependant il me semble toujours que je me prépare à vivre. C’est ridicule, n’est-ce pas ? La vitalité du chat ! » — Il a quarante-quatre ans alors ; et moins d’un an après, il se remarie.
À vingt-huit ans déjà, enfermé dans la forteresse préventive, en attendant la Sibérie, il s’écriait : « Je vois maintenant que j’ai une si grande provision de vie en moi, qu’il est difficile de l’épuiser. » Et (en 56) de Sibérie encore, mais ayant fini son temps de bagne et venant d’épouser la veuve Marie Dmitrievna Issaiev : « Maintenant, ce n’est plus comme autrefois ; il y a tant de réflexion, tant d’effort et tant d’énergie dans mon travail… Est-il possible qu’ayant eu pendant six ans tant d’énergie et de courage pour la lutte, avec des souffrances inouïes, je ne sois pas capable de me procurer assez d’argent pour me nourrir et nourrir ma femme ? Allons donc ! Car surtout personne ne connaît ni la valeur de mes forces, ni le degré de mon talent et c’est surtout là-dessus que je compte ! »
Mais, hélas ! ce n’est pas seulement contre la misère qu’il lui faut lutter !
« Je travaille presque toujours nerveusement, avec peine et souci. Quand je travaille trop, je deviens même physiquement malade. » « Ces derniers temps j’ai travaillé littéralement jour et nuit, malgré les crises. » Et ailleurs : « Cependant les crises m’achèvent, et après chacune je ne peux remettre mes idées d’aplomb avant quatre jours. »
Dostoïevsky ne s’est jamais caché de sa maladie ; ses attaques de « mal sacré » étaient du reste trop fréquentes, hélas ! pour que plusieurs amis des indifférents n’en eussent été parfois témoins. Strakhov nous raconte dans ses Souvenirs un de ces accès, n’ayant pas, plus que Dostoïevsky lui-même, compris qu’il pût y avoir quelque honte à être épileptique, ou même quelque « infériorité » morale ou intellectuelle autre que celle résultant d’une grande difficulté de travail. Même à des correspondantes inconnues à qui Dostoïevsky écrit pour la première fois, regrettant d’avoir fait attendre sa lettre, tout naïvement et simplement il dira : « Je viens de supporter trois accès de mon épilepsie — ce qui ne m’était pas arrivé de cette force et si souvent. Mais, après les accès, pendant deux ou trois jours, je ne puis ni travailler, ni écrire, ni même lire, parce que je suis brisé de corps et d’âme. Voilà pourquoi à présent que vous le savez, je vous prie de m’excuser d’être resté si longtemps avant de vous répondre. »
Ce mal dont il souffrait déjà avant la Sibérie s’aggrave au bagne, se calme à peine durant quelque séjour à l’étranger, reprend en empirant. Les crises parfois sont plus espacées, mais d’autant plus fortes. « Quand les crises ne sont pas fréquentes et qu’il en éclate une soudain, il m’arrive des humeurs noires extraordinaires. Je suis au désespoir. Autrefois (écrit-il à l’âge de cinquante ans) cette humeur durait trois jours après la crise, maintenant sept, huit jours. »
Malgré ses crises, il essaie de se cramponner au travail, il s’efforce, pressé par des engagements : « On a annoncé que dans la livraison d’avril (du Roussky Viestnik) va paraître la suite (de l’Idiot), et moi je n’ai rien de prêt, excepté un chapitre sans importance. Que vais-je envoyer ? Je n’en sais rien ! Avant hier, j’ai eu une crise des plus violentes. Mais, hier, j’ai écrit quand même, dans un état proche de la folie. »
Tant qu’il n’en résulte que gêne et douleur, passe encore : « Mais, hélas ! Je remarque avec désespoir que je ne suis plus en état de travailler aussi vite que dernièrement encore et qu’autrefois. » À maintes reprises, il se plaint que sa mémoire et son imagination s’affaiblissent et à cinquante-huit ans, deux ans avant sa mort : « J’ai remarqué depuis longtemps que plus je vais, plus mon travail me devient difficile. Alors, par conséquent, des pensées toujours impossibles à être consolées, des pensées sombres… » Cependant il écrit les Karamazov.
Lors de la publication des lettres de Baudelaire, l’an passé, M. Mendès s’effaroucha, protesta, non sans emphase, par des « pudenda moraux » de l’artiste, etc. Je songe, en lisant cette correspondance de Dostoïevsky, à la parole admirable, attribuée au Christ lui-même, et remise au jour depuis peu : « Le royaume de Dieu sera quand vous irez de nouveau nus et que vous n’en aurez point de honte. »