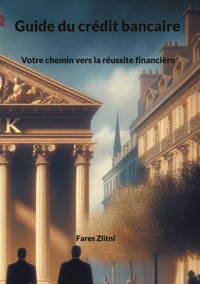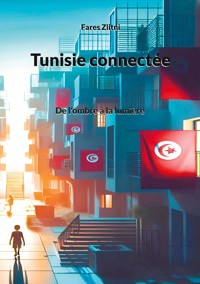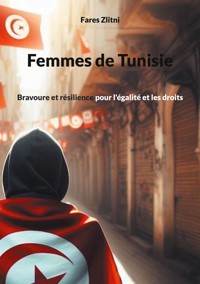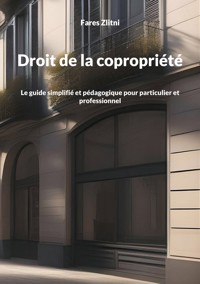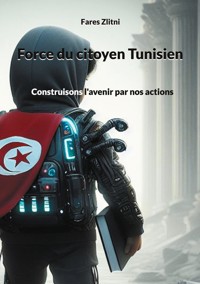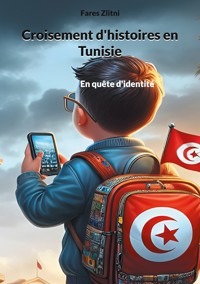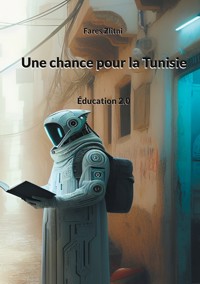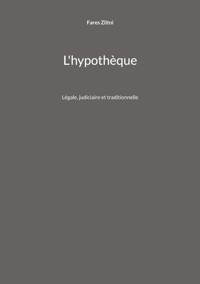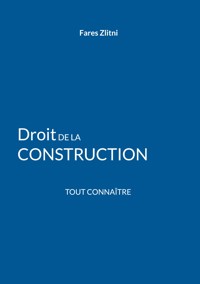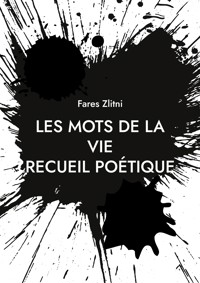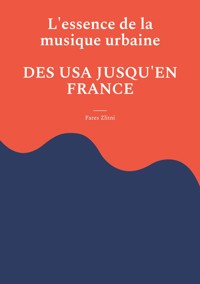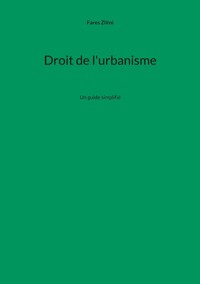
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
Le droit de l'urbanisme demeure encore aujourd'hui un domaine complexe qui requiert une profonde connaissance du droit public, privé et des connaissances juridiques approfondies. Dans ce livre, Fares Zlitni revient aux sources, définitions, rouages et aux nombreux enchevêtrement de ce droit avec les différentes juridictions et lois. Sous toutes ses facettes, permis, obligations, insécurité juridique, cas spéciaux, protection de l'environnement ou transition énergétique. Nous passerons au crible et en détails les champs d'application de ses règles ainsi que les spécificités régionales et les contentieux inhérents. Avec des exemples pratiques et des cas d'école, nous constaterons les évolutions ainsi que les obstacles qui peuvent encore aujourd'hui mettre à mal la compréhension de ce droit, son respect et sa mise en pratique. Écrivain et entrepreneur immobilier. Fares Zlitni est également le fondateur de F-Groupe, un groupe spécialisé dans le conseil immobilier aux investisseurs. Il nous offre à travers cet ouvrage un recueil complet des procédures, définitions, lois et législations relatives à ces vaste domaine.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SOMMAIRE
PRÉAMBULE
CHAPITRE1
I
NTRODUCTION AU DROIT DE L
’
URBANISME
À
QUOI SERT LE DROIT DE L
’
URBANISME ?
Q
UELS SONT LES DOMAINES D
'
INTERVENTION DU DROIT DE L
'
URBANISME
?
C
ONTENTIEUX DE L
'
URBANISME
CHAPITRE 2 : REGLES GENERALES D'OCCUPATION DU SOL ET DE L'ESPACE (CONSTRUCTIBILITE LIMITEE ET RNU)
I-C
HAMP D
'
APPLICATION DU
R
EGLEMENT NATIONAL D
'
URBANISME
I.1. Introduction générale
I.2 Règles applicables à l'ensemble du territoire
I.3 Règles applicables aux zones non équipées de PLU ou de documents d'urbanisme alternatifs
I.3.1.1. R
EGLES DE LICENCE
I.3.1.2. R
EGLES IMPERATIVES
I.3.2.1. R
EGLES DE LICENCE
I.3.2.2. R
EGLES IMPERATIVES
I.3.3.1. R
EGLES DE LICENCE
I.3.3.2. L
A REGLE IMPERATIVE
II. R
EGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS DE CONSTRUCTION POUR LES MUNICIPALITES SANS DOCUMENTS D
'
URBANISME
II.1. Introduction générale
II.2 Notion de Section d'Urbanisation Actuelle (PAU)
II.3. Dérogations
II.4. Un meilleur encadrement de la constructibilité limitée
CHAPITRE 3 : REGLES SPECIFIQUES POUR DES REGIONS SPECIFIQUES (COTIERES ET MONTAGNEUSES)
1. N
ORMES APPLICABLES AUX PLU EN TERMES DE COMPATIBILITE OU DE CONSIDERATION
A. Catégorie standard de montagne
R
ELATION ENTRE
PLU
ET
C
HARTE
P
ARC
G
UIDE DU PAYSAGE
L
A PRESCRIPTION SPECIFIQUE DE LA PARCELLE
R
EGLEMENTATIONS ENVIRONNEMENTALES
B. C
LARIFICATION SUR LES NORMES PLUS ELEVEES APPLICABLES A CERTAINS SECTEURS DE MONTAGNE
Présence de DTA ou de documents d'urbanisme influents
C. R
ESPECT DU
PLU
ET DE LA
L
OI
M
ONTAGNE
Généralités sur la traduction du droit montagne en PLU montagne
Motifs de compatibilité du PLU avec les dispositions particulières de l'article L. 145-1 et des lois d'urbanisme en montagne suivantes
La concrétisation des différents espaces visés par la réglementation spécifique montagne
2. A
UTRES CRITERES A PRENDRE EN COMPTE PAR
PLU
MONTAGNE
A. Servitudes de services publics et PLU de montagne
B. La Convention alpine et ses conditions d'application
C. Les inventaires du patrimoine naturel et paysager et les sites Natura 2000
CHAPITRE 4 :PROTECTION DES INTERETS SUPRA LOCAUX : PRINCIPES ET MOYENS
I – L
E DEVELOPPEMENT URBAIN LOCAL
A.Séparer l'urbanisme local de l'aménagement du territoire
B. Le développement urbain local après la décentralisation
II – U
N AMENAGEMENT URBAIN DESORMAIS PARTAGE AVEC L
’É
TAT
A.L'influence de l'omniprésence de l'État sur l'idée de développement urbain
B – La préservation de la notion d’aménagement urbain par un droit commun préservant l’échelle locale
CHAPITRE 5 : LA PLANIFICATION LOCALE STRATEGIQUE : LE SCOT
I
NSTRUMENTATION DE L
’
ACTION PUBLIQUE
, SC
O
T
ET GOUVERNANCE TERRITORIALE
Instrumentation des politiques publiques
Le SCoT, un outil d'action publique
Le SCoT, un instrument de gouvernance territoriale
C
ONSULTATION ET INFORMATION
L
E DELAI FIXE PAR LE MAITRE D
'
OUVRAGE POUR LA TECHNOLOGIE UTILISEE
E
FFETS AUTO
-
INDUITS ET INDUITS DES PROCESSUS PARTICIPANTS ENTOURANT LE DIAGNOSTIC
SC
O
T
C
ONCLUSION
CHAPITRE 6 : LES REGLES LOCALES D'URBANISME : LE PLU ET LA CARTE COMMUNALE
Peut-on modifier la carte civique ?
CHAPITRE 7 : LE CERTIFICAT D'URBANISME
1.L’
OBJET DU CERTIFICAT D
’
URBANISME
1.1. Certificat d'urbanisme neutre
1.2. Certificat d'urbanisme pré-opérationnel
2. P
ROCEDURE DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT D
'
URBANISME
2.1. La demande
2.2. L’instruction de la demande
3. L
A PORTEE DU CERTIFICAT D
’
URBANISME
3.1. Le rôle du certificat d'urbanisme
3.1.1. Garanti par le Certificat d'Urbanisme
3.2. Le contentieux particulier des certificats d’urbanisme
CHAPITRE 8 : PERMIS D'URBANISME : REGLES GENERALES DE DELIVRANCE ET D'EXECUTION
1.C
ADRE D
'
INTERVENTION DES REGLES COMMUNES
1.1. Hypothèse de contrôle
1.2.Hypothèse d'absence de contrôle
2. R
EGLES RELATIVES AUX DEMANDES
2.1. Les personnes compétentes pour présenter une demande
2.2. Nombre de copies de documents
2.3. Contenu du fichier
2.4. Dépôt et réception des archives
2.5. Instructions d'utilisation
3. L
A DECISION
3.1. Autorité compétente
3.1.1. Principe : Décisions prises au nom de la commune
3.1.2. Développements : décisions prises au nom du pays
3.2. Contenu de la décision
3.3. Applicabilité des mesures et décisions de plaidoyer
3.4. La durée de validité des décisions
4. C
ONTROLE ADMINISTRATIF DES DECISIONS
4.1. Décision de contrôle
4.2 Contrôle de l'exécution des décisions
4.2.1. Contrôle général
4.2.2 Contrôle des liens avec la réalisation des travaux
4.2.2.1. Déclaration de fin de travaux
4.2.2.2. Vérification des travaux
4.2.3. Plage de contrôle
CHAPITRE 9 : PERMIS DE CONSTRUIRE ET DECLARATION PREALABLE
Q
UELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE ET UNE DECLARATION PREALABLE
?
D
ECLARATION
P
REALABLE OU
P
ERMIS DE
C
ONSTRUIRE
: R
EGLES
Q
UELLES SONT LES ETAPES PRE
-
ANNONCEES
?
CHAPITRE 10 : LE PERMIS D'AMENAGER ET LE PERMIS DE DEMOLIR
1.P
ERMIS DE CONSTRUIRE
1.1. Portée du permis d'urbanisme
1.2. La demande d’autorisation
1.3. Instructions d'utilisation
1.4. Décision
2. L
E PERMIS DE DEMOLIR
2.1. Portée
2.2. L’objet de la demande
2.3. La décision
2.4. Impact de la licence
CHAPITRE 11 : L'URBANISME OPERATIONNEL
U
RBANISME OPERATIONNEL ET URBANISME PROVISOIRE
U
RBANISME AVANT ET PENDANT EXPLOITATION
Urbanisme avant exploitation
L’urbanisme opérationnel
CHAPITRE 12 :LE CONTENTIEUX DE L'URBANISME
D
ROIT DE L
'
URBANISME ET QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES
ÉPILOGUE
GLOSSAIRE DES LOIS ET SIGLES
À PROPOS
PRÉAMBULE
Les services d'urbanisme sont généralement considérés comme très complexes. Une introduction aux grandes lignes, aux détours et aux rouages du droit de l'urbanisme pour favoriser la compréhension du secteur est l'objectif principal de cet ouvrage. L'urbanisme est au centre de l'action publique, car il est souvent porté par des personnalités publiques. Le département se concentre sur la bonne utilisation des terres. En effet, il permet le suivi et la supervision des potentielles possibilités d'utilisation des terres. À cette fin, le département contrôle strictement l'autorisation ou l'interdiction de construction et/ou d'activités dans des endroits spécifiques.
Le droit de l'urbanisme est une branche du droit administratif. Il est vrai qu'une complémentarité semble s'établir entre ces droits, mais le droit de l'urbanisme s'appuie sur des acquis juridiques et des connaissances tirées du droit public et privé de la construction. L'urbanisme, bien que mis en œuvre dans l'intérêt général, se heurte souvent à l'insécurité juridique. Nous verrons l'enchevêtrement des intérêts publics et privés dans cet espace.
Compte tenu de ses objectifs, la loi d'urbanisme impose des restrictions sévères aux droits des propriétaires privés. Les villes ont subi plusieurs changements au fil des ans. En particulier, l'urbanisation pose plusieurs problèmes, notamment en termes de solidarité territoriale, entre zones urbaines et rurales d'une part, et zones rurales et métropoles de l'autre. Lorsque l'on prend en compte la taille de la ville, l'urbanisme propose un modèle urbain qui permet de répondre à différents enjeux tels que la transition énergétique, la protection de l'environnement et des ressources, la maîtrise de l'étalement urbain par la densification, la lutte contre la gentrification, le refroidissement et le verdissement urbains, les alternatives au déplacements en voiture, les moyens de déploiement des technologies numériques pour les villes intelligentes et connectées, la revitalisation urbaine et commerciale.
Chapitre 1 : Introduction au droit de l’urbanisme
Pour comprendre les objectifs du droit de l'urbanisme, il est nécessaire d'en donner une définition générale.
Le droit de l'urbanisme est l'une des branches du droit public. Il est étroitement lié au droit administratif. La loi sur l'urbanisme est un ensemble de règles juridiques établies pour garantir que l'aménagement du territoire répond aux objectifs de la gestion publique. Il fonctionne dans toute la France. Organisant l'occupation du sol, les lois d'urbanisme affectent les droits de cette liste :
Loi criminelle ;
Droit fiscal ;
Les lois des autorités locales ;
Droit administratif de la propriété ;
Droit de la construction et de l'habitation ;
Loi environnementale ;
Droit de la santé ;
Loi sur les successions ;
Lois sur les transports.
Il y a une différence entre le droit de l'urbanisme et le droit de la construction. Ce dernier est une branche du droit privé, plus précisément une branche du droit civil. Elle réglemente les relations entre le maître d'ouvrage, le concepteur immobilier (promoteur, architecte) et le maître d'œuvre chargé de la réalisation du projet, c'est-à-dire les maçons, électriciens, couvreurs, etc.
À quoi sert le droit de l’urbanisme ?
Les règlements d'urbanisme ont plusieurs objectifs, dont voici une liste :
Coordination de l'esthétique urbaine et de la protection de l'environnement.
L'urbanisation conduit le plus souvent à la pollution de l'eau et de l'air et à une grave déforestation. Pour les prévenir, plusieurs lois ont été votées afin d'harmoniser l'esthétique urbaine avec la protection de l'environnement.
Cohérence des équipements publics et des logements.
Les équipements publics ou collectifs sont tous les réseaux, équipements et bâtiments qui répondent aux besoins de la population. Pour créer l'espace hospitalier, des dispositifs d'urbanisme ont été mis en place afin d'assurer une cohérence entre ces équipements et les habitats.
Rationalisation de l'utilisation des terres
Les lois d'urbanisme visent également à éviter la fragmentation de l'habitat et à assurer un équilibre entre les zones urbaines et rurales.
Contribution à la politique urbaine
Cette focalisation sur le droit de l'urbanisme est relativement récente. En effet, l'idée de mettre la réglementation d'urbanisme au service de la politique de la ville a émergé en 1990. Il s'agit notamment de diversifier les activités urbaines et d'assurer la mixité sociale dans les zones urbaines.
Quels sont les domaines d'intervention du droit de l'urbanisme ?
La loi d'urbanisme traite principalement des éléments de la liste suivante :
Loi sur l'urbanisme réglementaire
En droit français, l'urbanisme réglementaire regroupe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour l'élaboration des documents d'urbanisme ou documents d'urbanisme. En effet, les règles fondamentales de l'urbanisme sont fixées par le code de l'urbanisme. Or, le droit de l'urbanisme est un droit partiel. Ainsi, la plupart des règles applicables à l'urbanisme sont définies au niveau local. Toutefois, les documents d'urbanisme doivent respecter les dispositions de la Loi sur l'urbanisme.
Voici une liste des principaux documents d'urbanisme :
Plan de Cohérence Territoriale (SCoT), qui est un outil de planification prospective ou stratégique à l'échelle des aires urbaines, des grands bassins d'habitation ou des bassins d'emploi.
Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) : Ils définissent les règles d'aménagement du territoire et les projets d'aménagement de la commune sur plusieurs années (terrain constructible, constructions autorisées, emprise au sol et hauteurs maximales à respecter, aspect, espaces qui doivent rester naturels, etc. Attendez. ).
Cartes publiques : Ces documents d'urbanisme simplifiés délimitent les secteurs constructibles ou non. Ils conviennent aux villes et villages à faible vitalité.
A défaut de documents d'urbanisme dans la commune relevant directement de l'Etat, l'élaboration et la construction des permis d'urbanisme sont régies par le règlement national d'urbanisme.
Bon à savoir :
Les quartiers d'habitation peuvent être définis comme les plus petites zones où la population peut recevoir des services quotidiens. Une zone d'emploi est la zone géographique où vit et travaille la majorité de la population active.
Urbanisme opérationnel
Par définition, l'urbanisme actionnable précise les actions destinées à inciter les acteurs privés à contribuer à l'aménagement de l'espace. Sa vocation est de créer ou de transformer le tissu urbain. A cet effet, les pouvoirs publics utilisent généralement les opérations d'urbanisme de cette liste :
Ø Lotissements ;
Ø Zones d'Aménagement Collaboratif (ZAC) : Ce sont des zones délimitées par des projets d'aménagement.
Les autorisations d’urbanisme
Généralement, un permis de construire est requis pour le développement ou la construction. Il en existe plusieurs types, voici la liste :
permis de construire ;
permis d'urbanisme ;
décompte préalable ;
Permis de démolition.
La loi d'urbanisme confère les privilèges des pouvoirs publics suivants aux autorités exécutives afin qu'elles puissent exercer leurs missions d'intérêt général :
Expropriation d'utilité : permet au gouvernement d'obliger les propriétaires immobiliers à les leur vendre ;
Droit de préemption : Il s'agit du droit de préemption d'une communauté pour expulser les acquéreurs de biens à vendre.
Droit de renonciation : Les propriétaires immobiliers peuvent exiger de l'arrondissement qu'ils achètent leur propriété si celle-ci fait l'objet d'un projet ou d'une action d'urbanisme.
Contentieux de l'urbanisme
Les personnes concernées par les documents d'urbanisme peuvent les contester par voie d'action ultra vires. Le permis d'urbanisme et certaines actions liées à la ZAC peuvent également faire l'objet d'un recours.
En résumé, les lois d'urbanisme définissent les règles juridiques liées à l'aménagement des espaces à des fins de sécurité, de santé et d'esthétique. Il habilite et privilégie les autorités locales pour atteindre ces objectifs. Si le service administratif ne respecte pas les dispositions de l'urbanisme, le personnel concerné peut être tenu pour responsable.
Chapitre 2 : Règles générales d'occupation du sol et de l'espace (constructibilité limitée et RNU)
I-Champ d'application du Règlement national d'urbanisme
Il commence par une brève introduction au Règlement national d'urbanisme. On distinguera les règles qui s'appliquent à l'ensemble du quartier et les règles qui ne s'appliquent qu'aux quartiers non équipés de PLU ou de documents d'urbanisme alternatifs.
I.1. Introduction générale
Le RNU a élaboré une réglementation applicable aux terrains bâtis dans les villes sans plan d'affectation des sols (POS), plan local d'urbanisme (PLU) ou documents alternatifs. Cependant, certaines règles sont d'ordre public et s'appliquent à l'ensemble du territoire.
Outre la production agricole, les règles générales applicables à l'utilisation des terres, notamment en ce qui concerne l'emplacement, l'accès, l'aménagement et la construction des bâtiments, les méthodes de clôture, et l'entretien décent des propriétés foncières et des constructions, sont déterminées par décret au Conseil d'Etat.
Ces lois du Conseil exécutif de l'État peuvent prévoir des dérogations aux règles qu'ils édictent dans certains territoires.
I.2 Règles applicables à l'ensemble du territoire
Les dispositions du RNU s'appliquent aux constructions, équipements, installations et travaux soumis à permis de construire, permis d'urbanisme ou déclaration préalable, ainsi qu'aux autres affectations des sols relevant du code de l'urbanisme. Toutefois, l'article R. 111-1 exclut certaines dispositions qui ne s'appliquent pas aux zones où un PLU ou un document d'urbanisme est substitué. Il n'existe donc que 4 dispositions d'ordre public : les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 11115 et R. 111-21 de la loi d'urbanisme.
Ces règles portent sur la protection de la santé et de la sécurité publique (1.2.1), la protection des sites ou monuments archéologiques (1.2.2), la protection de l'environnement (1.2.3) et la protection des abords (1.2.4)).
I.2.1. La protection de la salubrité et de la sécurité publique
Les projets qui affectent la santé ou la sécurité publique en raison de leur emplacement, de leur caractère, de leur importance ou de la proximité avec d'autres installations peuvent être rejetés ou acceptés, sous réserve de réglementations particulières.
Ayant dû se pencher sur la question, l'ALJ a ainsi pu considérer qu'il existait un risque naturel justifiant le rejet du projet (CE, 16 février 2007, Préfet de Charente-Maritime). De même, les maires ne peuvent délivrer de permis de construire à proximité d'installations classées pour la protection de l'environnement, créant ainsi un risque mortel (CE, 20 mai 1994, préfet du Rhône et Rhône-Alpes).
I.2.2. Protection des sites ou monuments archéologiques
De même, les projets peuvent être rejetés si leur emplacement et leurs caractéristiques peuvent affecter la conservation ou la valeur d'un site ou d'un monument archéologique, ou seulement acceptés sous réserve d'une réglementation spéciale.
I.2.3. Protection environnementale
Les autorisations ou décisions fondées sur des déclarations préalables doivent respecter les enjeux environnementaux mentionnés dans la réglementation environnementale. Là encore, le projet ne sera accepté que s'il répond à certaines exigences, à condition que son ampleur, sa localisation ou sa destination puissent avoir des conséquences néfastes pour l'environnement.
I.2.4. Protection des abords
L'emplacement, la construction, les dimensions ou l'apparence du bâtiment ne doivent pas avoir une vue qui affecte le lieu adjacent, le site, le paysage naturel et urbain et préserve la monumentalité. Si tel n'est pas le cas, l'envoi ne pourra être refusé ou accepté que sous réserve d'une réglementation particulière.
Par exemple, le Conseil d'État a estimé que la construction de 240 logements à proximité des marais salants de Guérande pouvait porter atteinte au caractère du site adjacent (Directrice générale, 3 mai 2004, Madame Barrière).
En outre, les dispositions de l'article R.111-21 ne s'appliquent pas aux réserves ou zones patrimoniales architecturales, urbaines et paysagères faisant l'objet de plans de conservation et de mise en valeur agréés, assortis d'un règlement propre.
I.3 Règles applicables aux zones non équipées de PLU ou de documents d'urbanisme alternatifs
Les règles contenues dans le RNU limitent le droit de construire dans un certain nombre de situations pouvant affecter les intérêts de l'urbanisme, la santé ou la sécurité, et la santé.
Ces règles portent sur l'emplacement du bâtiment, les accès, les aménagements, les ouvrages, la disposition et le volume du bâtiment ainsi que son aspect. Des dispositions spécifiques existent également concernant les opérations de défense d'intérêt national.
I.3.1 Localisation des bâtiments, services, aménagements, aménagements et travaux
Il convient de distinguer les règles permissives et obligatoires.
I.3.1.1. Règles de licence
Elles confèrent à l'autorité compétente un pouvoir d'appréciation lui permettant de refuser ou de donner d'éventuelles prescriptions. L'article peut être refusé :
Si cela menace la santé ou la sécurité publique,
S'il risque d'être fortement perturbé, notamment à cause du bruit,
Si sa situation et ses caractéristiques peuvent nuire à la préservation ou à l'amélioration du site ou des vestiges archéologiques,
Si aucune voie publique ou privée ne dessert le terrain dans des conditions correspondant à l'importance du terrain ou à la destination envisagée de construction ou d'aménagement, notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou le recours à la lutte mécanique contre l'incendie ; Si ces passages posent un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou la sécurité de ceux qui les utilisent.
Si, par sa localisation ou sa taille, il oblige la commune à construire de nouveaux équipements publics disproportionnés par rapport à ses ressources existantes, ou à augmenter significativement les coûts de fonctionnement des services publics.
Si sa localisation ou sa destination est susceptible de favoriser une urbanisation fragmentée incompatible avec la vocation de l'espace naturel environnant, de nuire aux activités agricoles ou forestières, notamment du fait de la valeur agronomique du sol, de la structure agricole, de la présence d'appellations d'origine contrôlées ou les Terres délimitées par des indications géographiques protégées, ou les terres contenant des équipements spéciaux importants, et le périmètre d'aménagement des terres et des eaux, ou l'exploitation de substances préjudiciables à l'article 2 de la loi minière ou comprises dans les zones précisées à l'article 109.
L'autorisation ou les décisions sur les déclarations préalables peuvent imposer :
Construction d'aménagements aptes à assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques, conformes aux caractéristiques du projet, et construction de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire pour répondre aux conditions de sécurité des services de voirie publique.
Maintenir ou créer des espaces verts à la mesure de l'importance du projet. Ainsi, si le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente peut exiger des constructeurs qu'ils construisent des aires de jeux et de loisirs correspondant à leur superficie à proximité de ces habitations.
L'autorisation ou les décisions relatives aux déclarations préalables doivent également respecter les préoccupations environnementales.
I.3.1.2. Règles impératives
Elles impliquent que le projet ne peut être autorisé que si ces règles sont respectées. Ces règles concernent spécifiquement la desserte du projet par le réseau public.
En premier lieu, l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement des eaux usées domestiques, la collecte et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux usées industrielles doivent être assurés.
Ensuite, si les bâtiments sont prévus à usage d'habitation, ils doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé au réseau public.
Toutefois, s'il n'existe pas de réseau public de distribution d'eau potable, et lorsque l'assainissement général et la protection de la santé sont garantis, l'approvisionnement en eau peut être assuré par un seul point d'approvisionnement ou, à défaut, par le moins de points d'approvisionnement possible. De même, en l'absence de systèmes de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif est possible si les exigences techniques sont respectées. Dans tous les cas, l'équipement collectif est aménagé de manière à pouvoir être ultérieurement raccordé au réseau public.
En outre, l'obligation de construire des installations collectives de distribution d'eau potable peut être exceptionnellement exonérée. Ces hypothèses sont que la grande surface ou la faible densité de construction de la parcelle et la facilité d'élevage individuel font que ce dernier semble plus économique. Dans tous les cas, la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de contamination doivent être assurées. De même, l'obligation de construire des installations collectives peut être exemptée lorsque les installations d'assainissement individuelles ne peuvent avoir d'effet néfaste sur l'hygiène.