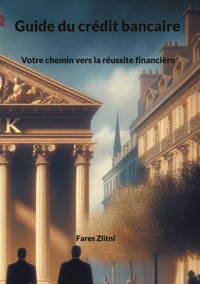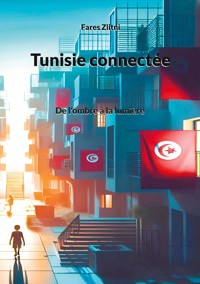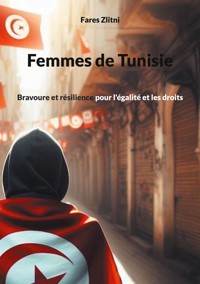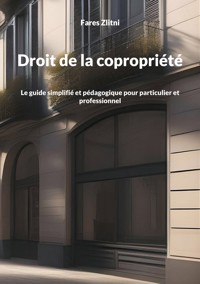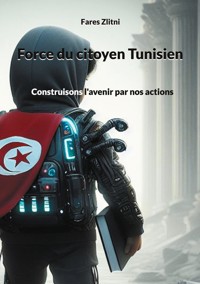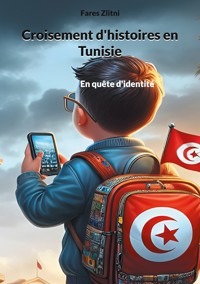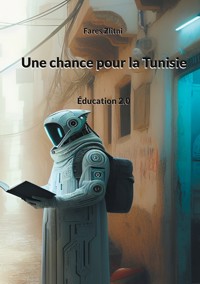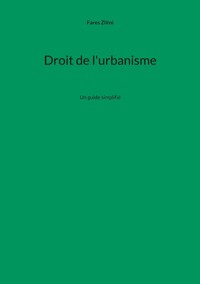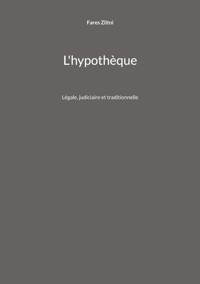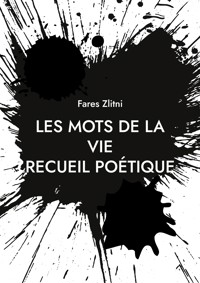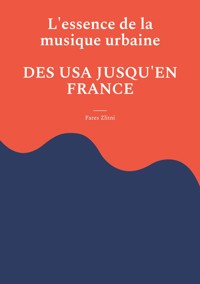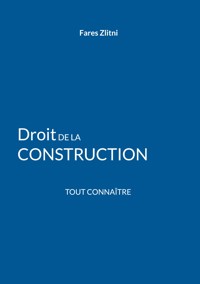
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
"Le secteur de la construction immobilière est un domaine qui mobilise diverses connaissances juridiques de droit public et privé. Ainsi, les acteurs de la construction immobilière doivent respecter les règles d'urbanisme qui confient aux pouvoirs publics la responsabilité d'organiser l'occupation du sol (aménagement du cadre de vie, gestion économique du foncier, conservation de la nature...). Cet ouvrage a pour principal objectif de vous présenter le droit privé de la construction de manière exhaustive afin de fournir les rouages de base et les principes généraux. L'étude du droit de la construction est complexe car elle associe les règles du droit des biens (théorie de l'union, immeubles à destination, biens immobiliers, droits immobiliers, etc.) aux règles du droit des obligations (contrats, passifs)." Fares Zlitni, jeune expert de l'immobilier, est une étoile montante des problématiques immobilières sur le web. Il produit et réalise l'émission "Les bulletins immo de JDH.TV" sur la web TV Jdh.TV. Il est aussi le directeur de la collection, "Les pros de l'immo" chez Jdh ÉDITIONS.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
SOMMAIRE
PRÉAMBULE
CHAPITRE 1 : DEFINITION DU DROIT DE LA CONSTRUCTION
CHAPITRE 2 : INTRODUCTION AU DROIT DE LA CONSTRUCTION
A/ EVOLUTION HISTORIQUE
LES ENJEUX DU DROIT DE LA CONSTRUCTION
CHAPITRE 3 : RESPONSABILITES DU CONSTRUCTEUR LORS DE LA RECEPTION
NOTION DE TRAVAIL
CHAPITRE 4 : CONSTRUCTEURS, RESPONSABILITES APRES RECEPTION
CHAPITRE 5 : OBLIGATIONS DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE
CHAPITRE 6 : ASSURANCE FACULTATIVE ET SOUSCRIPTION PENDANT LA CONSTRUCTION
QU'EST-CE QUE L'ASSURANCE FACULTATIVE DU CONSTRUCTEUR ?
CHAPITRE 7 : PERFORMANCE ENERGETIQUE ET RESPONSABILITES DU CONSTRUCTEUR
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET LABELLISATION
SECTION 1: ROLES ET STATUTS DES ORGANISMES D’APPROBATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE.
SECTION 2 : CONSEQUENCES DE LA CERTIFICATION DES BATIMENTS : EMERGENCE DE NOUVEAUX OUTILS OU ADAPTATION D'OUTILS EXISTANTS.
OBLIGATION DE RESULTAT
CHAPITRE 8 : RT 2012
SECTION 1 : NOUVEAUX REGLEMENTS.
SECTION 2 : CERTIFICAT D'ECONOMIE D'ENERGIE.
CHAPITRE 9 : DES IMPACTS SUR LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION
SECTION 1 : RESPONSABILITES DU CONSTRUCTEUR
SECTION 2 : CHEF DE PROJET ET CONTROLEUR.
CHAPITRE 10 : DOMMAGES DU TRAVAIL, RECLAMATIONS
QUE FAIRE APRES AVOIR DECOUVERT UN SINISTRE ?
COMBIEN DE TEMPS POUR ETRE INDEMNISE ?
CHAPITRE 11 : LA PROCEDURE DE LA VENTE D'IMMEUBLE
I. LES VENTES D’IMMEUBLES
A. L’EXIGENCE D’UNE VENTE
II.1. VENTE D’IMMEUBLES A. CRUQUENAIRE
A. LA NOTION D’IMMEUBLE
B. QUELQUES CAS PARTICULIERS
1. la vente mixte
2. l’option d’achat
3. la vente affectée d’une condition
4. la vente a réméré
5. la vente aléatoire
2. LES PARTIES À L’ACTION EN RESCISION
I. Le demandeur a l’action en rescision
II. le defendeur a l’action en rescision
III. Cas particuliers : la pluralité de vendeur(s) et/ou d’acquéreur(s)
3. LES CONDITIONS DE L’ACTION EN RESCISION
I. Le délai de l’action
II. L’EXIGENCE D’UNE LESION ENORME
I. Une procédure en deux temps
II.1. Vente d’immeubles
II. L’APPRECIATION DE LA LESION
A. L’évaluation de la valeur de l’immeuble vendu
B. L’évaluation de la contrepartie financière
4. LES OBSTACLES À LA RESCISION
I. LA PERTE DE LA CHOSE VENDUE
II. LA RENONCIATION
5. LES EFFETS DE LA RESCISION
I. Le droit d’option
II. LA RESCISION
III. LE PAIEMENT DU SUPPLEMENT DU JUSTE PRIX
ÉPILOGUE
GLOSSAIRE DES LOIS ET SIGLES
DROIT DE L’IMMOBILIER
DROIT PENAL
WEBOGRAPHIE
À PROPOS
PRÉAMBULE
Le secteur de la construction immobilière est un domaine qui mobilise diverses connaissances juridiques de droit public et privé.
Ainsi, les acteurs de la construction immobilière doivent respecter les règles d'urbanisme qui confient aux pouvoirs publics la responsabilité d'organiser l'occupation du sol (aménagement du cadre de vie, gestion économique du foncier, conservation de la nature...).
Cet ouvrage a pour principal objectif de vous présenter le droit privé de la construction de manière exhaustive afin de fournir les rouages de base et les principes généraux. L'étude du droit de la construction est complexe car elle associe les règles du droit des biens (théorie de l'union, immeubles à destination, biens immobiliers, droits immobiliers, etc.) aux règles du droit des obligations (contrats, passifs).
Bien entendu, la théorie générale des contrats est mobilisée, ainsi que le droit spécial des contrats du Code civil et le droit des contrats plus spécifique du secteur de l'habitation (contrats de construction de maisons individuelles, contrats de vente de maisons à rénover, etc.).
Dans ce domaine, les lois sur les valeurs mobilières jouent un rôle important pour protéger les acheteurs contre le risque de construction inachevée en fournissant les garanties financières nécessaires. La première partie introduit le droit commun de la construction, qui se trouve dans le Code civil et qui est à la base du problème : le contrat de travail, le droit commun de la vente des immeubles à construire et le droit commun des biens immobiliers. Les contrats de promotion immobilière, garanties et responsabilité du constructeur.
La deuxième partie traitera des lois spéciales de construction qui ont été faites en dehors du Code civil et qui ont obtenu leur propre code, le Code de la construction et de l'habitation. Tous les contrats réglementés du secteur de la construction immobilière sont recensés : Contrats de construction de maisons individuelles, renforcement du régime des contrats de promotion immobilière, vente d'immeubles à construire, vente d'immeubles à rénover, baux d'immeubles d'exposition et baux de restauration. Respecter l'objectif du travail de devoir restituer l'essence du droit de la construction, ne pas traiter des codes de la construction et des baux d'habitation, car il relève plus du droit immobilier que du droit de la construction, du fait de l'absence d'obligation de construire ou de réaliser des travaux de construction (Bail en servitude, bail immobilier, bail immobilier en copropriété).
Ce livre s'adresse principalement aux étudiants en droit intéressés par le droit de la construction, le droit immobilier, le droit notarial, ainsi qu'aux étudiants du CFPN, des écoles notariales et de l'industrie immobilière.
Chapitre 1 : Définition du droit de la construction
Le droit de la construction est une branche du droit civil et immobilier qui traite de :
Copropriété et servitudes ;
Constructeurs (Architectes, entrepreneurs, promoteurs, particuliers) ;
Garantie et assurance construction :
Garantie de trente ans ;
Garantie décennale ;
Garantie de deux ans ;
Garantie de parfait achèvement ;
Contrats de construction de maisons individuelles et leur exécution ;
Contrats de promotion et de ventes immobilières (VEFA) en état futur d'achèvement ;
Contrats et contrats de travail des entreprises de construction ;
La réception des travaux ;
Lotissement ;
Bail à construction ;
Bail commercial ;
Baux de mise à plat ;
Meilleures pratiques et normes professionnelles de construction ;
Vices de construction, expertise judiciaire.
Il comprend également des dispositions législatives et réglementaires sur :
Normes de construction et d'habitabilité ;
Classement et protection des monuments historiques.
En France, les textes juridiques relatifs au droit de la construction sont contenus dans le Code civil (notamment les articles 1792 et suivants ainsi que le Code de la construction et de l'habitation) et ne doivent pas être confondus avec le Code de l'urbanisme qui comprend toutes les matières de droit public et administratif relatives à l'aménagement du territoire.
Il existe plusieurs professions qui doivent connaître le droit de la construction : Architectes, juristes d'entreprise spécialisés en droit de la construction, etc.
Chapitre 2 : Introduction au droit de la construction
A/ EVOLUTION HISTORIQUE
Le droit de la construction est un droit relativement jeune, car c'est une discipline qui n’est vraiment née sous sa forme actuelle que dans les années 1970 (§1 avant le Code civil). Les lois sur la construction sont des lois qui ont toujours existé cependant, tant la construction de bâtiments ou de villes a toujours été plus ou moins réglementée. Les premières traces du droit de la construction se trouvent dans le Code sumérien d'Hammourabi (17 av. J.-C.). Il existe des réglementations concernant les contrats de construction et les responsabilités des constructeurs.
Dans les temps anciens et dans les villes grecques et romaines, la loi s'appliquait déjà. Ces villes obéissaient à un ordre précis, qui était un ordre légitime. A cette époque, la différence entre droit de l'urbanisme et droit de la construction n'était pas encore évidente. Les villes romaines ont toujours été construites selon les plans de souverains expérimentés. En particulier, de nombreuses villes romaines étaient basées sur le plan des casernes romaines, avec un plan en damier et deux axes principaux que l'on retrouve dans toutes les bases romaines. Paris : L'axe nord-sud est la rue Saint-Jacques, l'axe est-ouest est la rue Saint-Honoré. Cette séquence de villes nous conduira à essayer d'imposer des techniques de construction standard. À Rome, nous aurons des logements pas chers, des insolas. Les auteurs romains ont souligné qu'ils avaient tendance à s'effondrer, mais les personnes qui venaient des pays conquis par Rome et débarquaient dans la grande ville devaient être réinstallées. Il existe certaines réglementations dans les réglementations du droit de la construction. De la chute de l'Empire romain au Moyen Âge, il existe une échappatoire historique : la période mérovingienne, le franc.
On a trouvé des règles précises de prise en compte de ces phénomènes au Moyen Age. Les règles applicables étaient toujours des règles locales. Il n'y avait pas de réglementation nationale. C’est la ville qui réglementera ces éléments.
La limitation de ces villes réside dans le fait que la taille de la cité ne peut pas être facilement modifiée, car avant, nous avions des murs autour de la ville. A Paris pour exemple, il y a eu 5 ou 6 enceintes consécutives depuis le Moyen Age. Nous avons refait un peu l'enceinte car il fallait densifier la ville à l'intérieur des murs, ce qui revenait chère. L’autre contrainte est la faiblesse face aux incendies dans un habitat très dense dans lequel le bois jouait souvent un rôle important.
Des règles devaient être mises en place pour protéger les bâtiments et éviter les incendies dévastateurs. Nous devions appliquer des règles de construction essentielles. Probablement des règles de hauteur pour éviter de construire des bâtiments trop hauts qui seraient plus difficiles à éteindre lors d’incendies ou qui pourraient s'effondrer. Par rapport à d'autres villes, Paris compte peu d'édifices médiévaux à colombages. Les Parisiens ont exigé que ces parties en bois soient recouvertes de plâtre pour éviter que le feu ne se propage. La technique à l'époque était que les façades sur rue étaient relativement étroites et les immeubles étaient profonds (ex. Marais, rue Saint Jacques). Les personnes les plus riches vivront dans la rue. Ils auront une "vitrine".
Peu de changements dans la cité médiévale jusqu'au XIXème siècle où l’on continuera à suivre les règles locales. Même si la couronne allait s'affirmer, il y aura peu de règles étatiques. L'aménagement de certaines parties de Paris s'est fait selon les règles (ancienne place Vendôme, place de la Concorde), tandis que les grands travaux dans d'autres villes comme Bordeaux au XVIIIe siècle sont l'œuvre des gouverneurs qui tentaient d'embellir leur politique urbaine. Avec de fortes incitations d’Henri IV qui avait des contacts parmi les marchands qui régnaient à Paris.
Le dominant conseilla à Henri IV de ne pas laisser les ouvriers hors des murs et que la population la moins aisée devait rester à l'intérieur (le faubourg Saint-Martin était en construction). Le roi Henri IV répondit que toutes les catégories de population devaient être préservées dans la ville avec un problème de brassage des populations.
La spéculation étant toujours menée par ceux qui anticipent les changements de la valeur des marchandises, il y avait donc un moyen de s'enrichir à l'époque, si on pouvait élargir le mur, un certain nombre de personnes pouvaient le savoir d'avance. Si les bâtiments sont à l'intérieur des murs, ils gagneraient plus de valeur. La bourgeoisie de l'époque commence alors à spéculer sur le quartier Saint-Germain. Les villes se développeront selon des règles d'urbanisme purement locales, relativement libres, et selon des règles locales de construction, qui ne sont pas l'apanage de l'État, mais qui constituent les règles douanières. Nous aurons des coutumes parisiennes à Paris, où nous trouverons les règles du droit de la construction, qui sont d’abord du ressort des constructeurs, et qui seront ensuite intégrées au Code civil.
Au 18ème siècle, il existait un livre intitulé « Les Lois des Bâtiments », qui énumérait les textes applicables à la construction des bâtiments. A l'époque, la construction était réalisée par des professionnels encadrés par un règlement intérieur. C'est l'âge de l'entreprise : Un système qui fonctionne comme un maçon, un charpentier, etc. Vous devez faire partie d'une entreprise où leurs conditions de vie, de salaire et de travail sont réglementées. La loi « Le Chapelier » de 1790 interdit les corporations, ils ne seront pas remplacés.
Il y avait cependant des problèmes au XIX car il y avait un vide législatif entre le règlement intérieur de l'entreprise et les lois sociales qui n'ont émergé qu'à la fin du siècle.
La Révolution française n'avait pas pour objectif principal l'architecture et l'urbanisme. Même si le souhait premier était de créer un axe dans Paris, celui-ci serait le point de départ de la rue Rivoli et de l'hôtel Tallerin. (§2 Du Code civil au Code de la construction). A l'ère des empires, Napoléon va revoir le système juridique sans oublier complètement le droit des successions, mais en le considérant avec des concepts pertinents à son époque. Il traitera des dispositions douanières relatives à la construction dans le Code civil, et les articles 1789 et suivants du CCiv sont issus de l'ancien droit. A la fin du 18éme siècle et au début du 19éme, un des premiers plans d'embellissement de Paris est réalisé : "Le plan des Artistes". Dans ce programme, la rue de Rivoli sera présentée dans son intégralité. Napoléon traversera la première partie de la rue Rivoli jusqu'au palais des Tuileries.
Le XIXème siècle débutera par une importante transformation sociale dans les années 1830 avec l'industrialisation et l'exode rurale. La ville n'avait pas changé depuis l'ancienne loi, bien qu'il fût nécessaire de la revoir. Nous allons alors commencer à développer une politique publique fortement soutenue par l'État dans un effort d'amélioration du fonctionnement des villes.
Il y a eu plusieurs épidémies de choléra. En 1830, la médecine de l'époque notait que le taux de mortalité était plus élevé dans les quartiers densément peuplés du centre de Paris, du Palais Royal à Notre-Dame. Ils ont vu les inconvénients des villes surpeuplées. Sans trains, les ouvriers qui voulaient travailler à Paris devaient vivre dans le centre de Paris. Lui et sa famille s'entassaient derrière la cour : la classe ouvrière se rassemblait dans des habitations mal éclairées et mal ventilées.