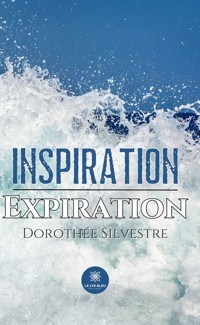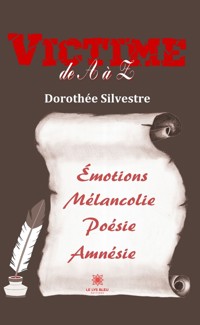Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Ce témoignage de vie retrace le parcours de Dorothée, victime d’inceste, qui décide de briser le silence. Alors qu’elle souffre moralement et physiquement, elle essaie de ne pas sombrer ; la famille qui est au cœur de ce récit sera tantôt un sujet de rejet tantôt une bouée de sauvetage. C’est ainsi un chemin de guérison intérieure proposé au lecteur.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Issue d’une famille catholique pratiquante, Dorothée Silvestre est passionnée de littérature et a fait des études de lettres. Du tabou au pardon est pour elle un moyen de prévention pour la jeunesse et les lecteurs qui auraient un vécu similaire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dorothée Silvestre
Du tabou au pardon
Roman
© Lys Bleu Éditions – Dorothée Silvestre
ISBN : 979-10-377-7133-9
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
À tous ceux et celles qui ne peuvent pas parler.
À mes familles.
Préface
Ce livre que vous tenez entre les mains n’en est pas vraiment un, c’est une vie. En tournant ces pages les unes après les autres, vous ne serez pas emmené dans un monde imaginaire ou dans une histoire abstraite, vous plongerez dans une expérience personnelle, celle de Dorothée, qui accepte de dire avec des mots forts et justes, avec un grand réalisme et sans outrances son vécu de femme abusée sexuellement dans un cadre familial pendant de longues années.
En cela, ce livre est infiniment précieux et il faut saluer le courage de Dorothée d’avoir parcouru toute sa vie et mis sur le papier cette expérience terrible. Fallait-il écrire cette expérience ? Devait-elle dire avec une certaine précision les détails sordides de ce qu’elle a subi ? Oui, je le crois et c’est l’une des richesses de ce témoignage. Les violences sexuelles pourront être plus efficacement combattues dans la mesure où elles pourront, comme elles le sont ici, recevoir des noms et des mots. L’une des principales stratégies des abuseurs consiste à imposer le silence à la victime : Pierre-Yves a obtenu, pendant de longues années, le silence de Dorothée. Il a obtenu non seulement le silence mais l’oubli, le refoulement de l’horreur dans des profondeurs inaccessibles, que seul le temps, l’amitié et les thérapies ont pu faire resurgir. C’est ainsi, je le crois qu’il faut lire et accueillir ce témoignage. Dorothée nous permet de comprendre, de l’intérieur, ce que peut vivre une victime, depuis le viol subi jusqu’au long chemin de prise de conscience, de justice, de reconstruction et même de pardon.
Faut-il encore parler des abus sexuels après les commissions et autres procédures qui ont été mises en œuvre, dans l’Église Catholique et dans d’autres contextes, ces dernières années et plus spécifiquement ces derniers mois ? Oui, bien sûr et ce serait une très grande tentation de vouloir croire que le travail de prise de conscience est fait. L’Évangile, auquel Dorothée fait constamment référence, met en garde l’homme libéré d’un esprit mauvais : sept autres esprits plus mauvais que lui se tiennent prêts à prendre place chez cet homme qui serait trop confiant et imprudent dans sa guérison. C’est ce qui pourrait nous arriver si nous refermions trop rapidement ce « chapitre » des abus.
Car l’histoire que Dorothée nous livre est malheureusement une histoire fréquente, omniprésente. Il ne faudrait pas croire que ce qu’elle a vécu serait un phénomène isolé, quelque chose d’extraordinaire, une perversité inouïe. Un certain nombre d’entre vous, lecteurs, pourrez recevoir ce témoignage comme une occasion de mettre des mots sur votre propre histoire. Beaucoup sans doute, en lisant ce livre, pourront prendre conscience de ce qu’ils ont eux-mêmes vécu et découvriront des chemins de libération et de guérison pour lesquels Dorothée pourra être profondément remerciée. Oui, l’histoire de Dorothée est unique, mais nous devons prendre conscience de la prégnance de ce mal, de cette gangrène muette omniprésente dans notre société. Nous n’avons pas encore assez conscience, individuellement et collectivement, de ces violences intimes qui s’insinuent dans tous les compartiments de notre vie sociale et en premier lieu dans nos familles. Ce sont ces violences sexuelles, beaucoup plus fréquentes qu’on ne veut le croire, ces gestes ou paroles déplacées dont on s’illusionne à bon compte en croyant qu’ils sont anodins.
On a dit des violences sexuelles dans l’Église qu’elles étaient systémiques. On ne peut en douter. Elles ont été manifestées dans l’Église : c’est le début d’un long chemin d’accueil, d’écoute, de réparation et peut-être de pardon. Mais cette mise au jour du scandale à l’intérieur de l’Église n’a manifesté, nous le savons, qu’un aspect du mal. Ceux qui tiennent à distance l’institution ecclésiale seront tentés de croire que le scandale ne les concerne pas. Ceux qui s’identifient à l’Église souffriront de ce coup de projecteur sur une réalité douloureuse à accueillir. L’étape suivante, dans laquelle Dorothée et bien d’autres peuvent nous accompagner, consiste à prendre conscience et à soigner cette corruption toujours cachée et omniprésente.
Les démarches vécues par l’Église Catholique en France ces derniers mois auront sans doute eu ce mérite de souligner la nécessité vitale d’écouter les victimes. L’Église l’a-t-elle suffisamment fait ? Sans doute pas assez et encore une fois ce chemin ne doit pas être un événement ponctuel mais un changement profond, radical, de mentalité : écouter les victimes. L’enseignement social de l’Église, largement incarné par le ministère du pape François, tient à ce principe de ce choix privilégié pour les plus pauvres. Comme il est difficile de le mettre en œuvre réellement ! Dorothée nous montre avec précision comment la victime, consciemment ou inconsciemment, se trouve isolée, marginalisée, réduite au silence. Elle est enfermée dans sa solitude.
La seule réponse, c’est l’écoute. Pour laisser cette voix émerger au-dessus du brouhaha des multiples avis et prises de position : écoute ! Pour entendre cette petite voix, cette esquisse d’appel au secours, écoute ! Pour commencer à envisager d’accueillir ce qui te semble impensable, inacceptable, inimaginable, écoute ! Écoute cette femme qui te dit simplement ce qu’elle a vécu, ce qu’elle a compris, ce qu’elle a ressenti, en un mot ce qu’elle a vécu.
C’est bien ce que nous avons à apprendre nous-mêmes. C’est ce que nous avons à transmettre aux nouvelles générations qui devront pouvoir accueillir librement, sans obstacle, ceux que des hommes et des femmes comme Dorothée ont vécu. La commission Sauvée a voulu accompagner son rapport aux évêques et aux supérieurs religieux d’un volume de témoignage : « de victime à témoin ». Le titre donné à cet ouvrage, autant que les textes de ceux qui ont accepté d’y témoigner, est éloquent. Il porte en lui le chemin et l’espoir d’une « conversion systémique », d’une société où le pauvre n’aura plus besoin de s’excuser d’être pauvre, où la personne qui souffre deviendra le centre de l’attention plutôt que le problème à résoudre, où la victime pourra parler et être écoutée naturellement et sans crainte.
Le titre de Dorothée ne reprend pas les mots « de victime à témoin », mais il reprend, dans un clin d’œil peut-être inconscient, la même structure : « du tabou au pardon ». Dans les deux cas, c’est un chemin qui est indiqué, un processus à vivre personnellement et ensemble. Dorothée a vécu ce chemin et peut-être celui-ci n’est-il jamais terminé, mais qu’importe tant qu’il sort de l’ombre pour jaillir à la lumière. Car c’est cet itinéraire que le lecteur pourra parcourir dans ce livre. Il entrera dans les mécanismes pernicieux du tabou, imposé et subi, avant de parcourir le long chemin de libération auquel Dorothée a pu donner le nom de pardon. On pourra rester déçu par certains aspects du témoignage : en nous identifiant à Dorothée, on aurait peut-être voulu plus. On aurait voulu que l’abuseur soit condamné, on aurait voulu que la victime puisse tirer un trait définitif sur son passé. C’est un témoignage réel, d’une histoire réelle. Les miracles existent, certainement, et l’on en perçoit dans l’histoire de Dorothée, mais les histoires laissent des traces. Et pourtant, entre les lignes, nous recevons de belles lumières pleines d’espérance. Le regard de Dorothée n’est jamais accusateur ou vindicatif. Elle peut reconnaître le beau travail de la justice tout en évoquant ses limites. Elle garde un amour profond pour les membres de sa famille alors que c’est en son sein qu’elle a connu l’horreur. Elle regarde avec enthousiasme et optimisme l’humanité, alors que tout aurait pu la conduire au désespoir. Ne considérons pas cette perspective comme naïve ou illuminée. Dorothée n’a rien de cela. C’est sans doute même le fond de la personnalité de Dorothée, au-delà de son histoire traumatique, que de porter l’énergie et la joie. En nous livrant son histoire, elle ne nous plonge certainement pas dans du pessimisme ou du fatalisme, mais elle nous ouvre un chemin de lumière à l’intérieur des ténèbres.
Nous ne pouvons terminer sans accueillir également de Dorothée un témoignage de foi. Dorothée a reçu la foi en même temps que la vie dans sa famille. Cette foi a été plantée comme une bonne graine au milieu de l’ivraie de la perversité. Cette foi, qui est devenue progressivement une relation personnelle et intime avec Dieu, n’est en rien idéalisée. Comme beaucoup d’histoires humaines, elle a connu des crises et des relèvements. Cette foi, vécue personnellement et dans la chaleur d’une communauté devient, au fil des pages, un soutien en même temps qu’un appel à la confiance pour avancer sur un chemin inconnu.
Puisse ce chemin inspirer chacun des lecteurs qui accepteront d’accueillir ce témoignage !
Père Alain de Boudemange
Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
Désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
Sur ceux qui le craignent ;
Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
Renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur,
Il se souvient de son amour,
De la promesse faite à nos pères
En faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles.
Amen.
Chapitre 1
C’est toi qui m’as formé les reins,
Qui m’a tissé au ventre de ma mère ;
Je te rends grâce pour tant de prodiges :
Merveille que je suis, merveille que tes œuvres.
Psaume 139, 13-14
Je suis arrivée dans ce monde au soir du 3 décembre 1981, mais j’avais déjà vécu avant cela. En apparence, rien d’extraordinaire : la banlieue parisienne, une famille soudée, des parents aimants. Je suis la cinquième de la fratrie. Thibault et Clément, mes frères les plus vieux ont sept ans et demi lorsque je pousse mon premier cri. Viennent après eux Paul, quatre ans et demi et Marie-Astrid, deux ans.
Évidemment, cette période est absente de ma mémoire et je dois me fier aux histoires de famille, de celles qu’on raconte au coin du feu, à la fin d’un bon repas ou sur le rebord d’un lit pour satisfaire la curiosité de l’un ou de l’autre.
Je m’annonce donc pour la fin de l’année mais avec déjà quatre enfants, les parents prévoient un déménagement pour s’agrandir. À force de s’affairer et d’être sur tous les fronts, entre l’école, le déménagement et l’inévitable agitation que provoquent quatre enfants au quotidien, maman finit par faire une petite hémorragie et se fait une belle frayeur autour de trois mois de grossesse. Allant contre son caractère, pour préserver son enfant à venir, elle lève un peu le pied et estime qu’il ne s’agit que d’une question de surmenage. La voilà donc à ralentir un peu son rythme de vie pour faire attention de peur de faire une fausse couche. Les médecins lui avaient déjà annoncé depuis la naissance des jumeaux, qui ne s’était pas bien déroulée, que la maternité allait tenir du parcours du combattant la concernant.
Les parents demeurent bien entourés par mes grands-parents qui chacun à leur manière étaient extraordinaires au sens étymologique du terme. Du côté de Papa, il y a Grand-Père, né en mille neuf cent treize à Phnom Pen, en Indochine, puisque son père et son grand-père y ont été gouverneurs chacun leur tour. Il a été envoyé en pension chez une de ses tantes en métropole à l’âge de sept ans et a grandi éloigné de ses parents. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il a été fait prisonnier à Dunkerque, ratant le dernier bateau qui partait pour l’Angleterre. Il a passé le reste du conflit dans un camp de prisonniers pour officiers en Poméranie. Il ne nous a jamais parlé de cette période et gardait une réserve bienséante qui le faisait ressembler à un gentleman du dix-neuvième siècle. Il était d’un caractère très silencieux mais très observateur et lorsqu’il nous partageait sa pensée, il n’était pas rare de voir un éclair de malice et d’amusement enfantin dans ses yeux. Le sentiment d’abandon familial et la profonde blessure de la guerre ont déclenché chez lui un réel souci d’être rattaché à ses racines. D’aussi loin que je me souvienne, il n’a pas arrêté de faire des recherches généalogiques, ne cessant de nous répéter qu’on ne peut savoir où l’on va si l’on ne sait pas d’où l’on vient. Après la guerre, il s’est marié avec Mamie, de onze ans sa cadette. Elle avait grandi avec une mère profondément blessée et dépressive, la psychologie et la psychiatrie n’étant pas encore à cette époque une solution. Élevée dans un climat janséniste, aînée de sa fratrie, elle a dû prendre en charge l’éducation de ses cinq frères et sœurs au point d’avoir l’interdiction paternelle de poursuivre des études de mathématiques qu’elle aimait tant. Avec tout ce bagage, l’arrivée de ses propres enfants a été très difficile à vivre, disant à qui voulait l’entendre qu’elle avait déjà éduqué ses frères et sœurs et que ses cinq fils n’avaient donc que peu d’intérêt à ses yeux. Il lui a été très difficile, voire impossible de créer des liens avec plusieurs personnes de la famille, provoquant chez elle une profonde culpabilité. Elle s’est battue toute sa vie contre cette enfance imposée et avait donc peu de place pour montrer son affection. Celui qui trouvera grâce à ses yeux jusqu’à sa mort sera son mari dont elle s’occupait avec beaucoup de délicatesse et d’attention à grand renfort de surnoms et de petites plantes. Ils avaient tous deux une foi profonde et intérieure, très marquée par le jansénisme, et jusqu’à leur mort, ils ont récité le chapelet aux intentions de la famille, ensemble, tous les soirs. Ils ne commençaient pas un repas sans le bénédicité qu’ils clôturaient par un énergique « et sauvez la France ! » plein de conviction. Ils avaient un grand souci de la bienséance et là où mon grand-père restait silencieux, ma grand-mère n’hésitait pas à donner son avis sur telle ou telle situation même si elle n’était pas concernée. Aujourd’hui, on dirait qu’ils étaient très « Vieille France ».
Du côté de Maman, en revanche, l’ambiance était bien différente. Bon-Papa était militaire dans la Marine et Bonne-Maman l’a secondé dans son travail, prenant en charge la famille de cinq enfants, dont deux paires de jumeaux à un an d’écart, et organisant les réceptions professionnelles. Bon-Papa était également un homme blessé. Orphelin de père à l’âge de quatorze ans, il a fait vivre sa famille dès qu’il a pu avec sa solde de marin. Ayant un grand souci des autres, il était très actif pour aider tous ceux qui étaient dans le besoin, des marins sous ses ordres à sa mère. Suite à des problèmes d’héritage, cette dernière s’est retrouvé « sans le sou » à devoir quitter un château en Beaujolais pour aller vendre de la lingerie à Paris. Bon-Papa ne cessait de dire qu’il était né avec une cuillère d’argent dans la bouche et qu’il était de son devoir d’aider les autres. Il était passionné d’histoire et de politique et avait un certain talent de meneur d’hommes au dire de ses collègues. Il était très soucieux de la messe et de la prière quotidienne où il confiait toute sa famille au fur et à mesure qu’elle grandissait. Il me semble que deux éléments principaux ont conduit sa vie, deux paroles bibliques qu’il ne cessait de nous répéter. « Vous avez beaucoup reçu, il vous sera beaucoup demandé. » Ainsi que la parabole des talents à laquelle il faisait souvent référence. Dans cet esprit, dès qu’il le pouvait, il mettait à profit ce qu’il était pour aider les autres à avancer et à réaliser leurs rêves. Il a été professionnellement très actif dans des associations et autant qu’il a pu dans sa famille. Il avait un profond amour pour la Vierge Marie et nous encourageait lorsque l’énergie nous manquait en ponctuant son discours d’une devise qui me reste encore gravée dans le cœur aujourd’hui : « courage et confiance, Salut de la France ! ». Bonne-Maman, pour sa part, nous aimait à sa manière. Blessée dans sa relation avec sa mère, ses démonstrations d’affection à notre égard passaient par une grande activité et beaucoup de conseils qui sonnaient souvent comme des critiques à nos oreilles. En réalité, elle était aussi exigeante avec nous qu’elle l’était envers elle-même. Toutes ces petites choses du quotidien un tant soit peu blessantes n’étaient pour elle qu’une manière de nous dire à quel point elle nous aimait et voulait le meilleur pour chacun de ses petits-enfants et « pièces enrichissantes ». Elle était dans sa foi très accrochée également à la prière quotidienne et à la messe comme son mari. Au ciel, ses interlocuteurs préférés étaient son Ange Gardien et Saint-Joseph même si elle pouvait de temps en temps se mettre en colère contre lui ou le bouder s’il n’exauçait pas ses prières comme elle l’entendait. Avec Bon-Papa, lors de leurs insomnies, ils avaient pris comme habitude d’égrener les prénoms de tous les membres de la famille, dans l’ordre, s’il vous plaît, pour les confier à la Vierge Marie.
J’arrivais donc dans une famille profondément catholique et pratiquante et mes parents n’avaient en rien renié ce que leurs propres parents leur avaient transmis. Je venais donc gonfler les rangs d’une famille déjà nombreuse et malgré toute la bonne volonté de maman, il était particulièrement compliqué de gérer cinq enfants en sept ans. Les questions et les angoisses, bien naturelles, avaient déjà fait des dégâts avant même mon arrivée pourtant assumée. Mes parents avaient envisagé dès le début de leur mariage avoir entre cinq et huit enfants mais sans doute ne les avaient-ils pas imaginés si rapprochés !
Chapitre 2
Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Donc ne craignez pas : vous valez tout de même mieux qu’une volée de moineaux.
Matthieu 10, 30-31
Je mettrais seize ans à comprendre à quel point les neuf mois dans le ventre de ma mère ont été marquants pour le reste de ma vie. L’hémorragie dont maman a été victime n’était pas le fruit de son surmenage mais le départ de mon jumeau. Tout ceci restera inconscient pendant des années mais au lieu de grandir au calme, dans un lieu sécurisé, entouré de l’amour de ma mère, ce ventre me semblera un tombeau : je sais au plus profond de mes entrailles que je vais devoir grandir seule et faire face à la vie sans mon jumeau. Je suis en vie, c’est le plus important mais je suis sans ma moitié Les médecins, plus tard, colleront à mon état l’étiquette de syndrome du survivant mais à ce moment-là, il ne s’agit pour moi que d’un vide intérieur abyssal incompréhensible qui se traduit par un refus de m’alimenter. J’arrive toute neuve dans ce monde avec déjà cette blessure qui interroge mon instinct de survie : pourquoi suis-je suis cette terre ? Pourquoi est-ce moi qui ai survécu ? Comment vivre avec ce vide intérieur ? Autant de questions que le bébé que je suis, dans le ventre de sa mère, va devoir assumer pour essayer d’avancer dans la vie sans pouvoir encore mettre des mots dessus.
Le fameux 3 décembre arrive avec ses contractions. Mes quatre frères et sœurs sont tous à la maison, de retour de l’école pour les plus grands. Maman appelle donc au plus vite au bureau de papa pour qu’il revienne et que la famille s’organise, maman ne voulant pas laisser les enfants seuls à la maison. Mais voilà, il y a un souci, la secrétaire annonce que Papa est en réunion et qu’il a demandé à n’être dérangé sous aucun prétexte. Maman s’explique encore, insiste et finit par se mettre en colère face à l’inflexibilité de son interlocutrice. Les contractions la rappelant à l’ordre, Maman raccroche et appelle en urgence chez ses beaux-parents qui habitent à quelques vingt minutes de là. Elle espérait s’adresser à ma grand-mère mais seul mon grand-père est présent. Ni une ni deux, ce n’est pas le plus important, Grand-Père accepte de venir garder les grands pendant que maman fonce à la maternité. Elle laisse tout le monde devant la télévision avec un paquet de chocos et part, ne pouvant même pas laisser à mon grand-père le temps d’arriver. Ce branle-bas de combat n’est en rien atténué par l’inquiétude et la colère de Maman de ne pas avoir pu prévenir son mari. Je pointe le bout de mon petit nez autour de vingt heures, bien agitée par l’ambiance électrique que l’absence de Papa provoque, et peut-être par autre chose… J’ai des tremblements sur tout un côté du corps. Peut-être est-ce la péridurale ? Nous ne sommes à l’époque qu’au début de cette procédure. L’équipe médicale m’envoie tout de suite dans un autre service de la clinique pour me faire des analyses plus complètes et comprendre ce qui m’arrive. Papa est arrivé après la bataille, comme on dit, mais a quand même tout juste le temps de voir ma frimousse avant mon périple. Me voilà donc toute seule dans les services, entourée d’étrangers. N’étant toujours qu’un nouveau-né, certaines réalités sont profondément inconscientes et celle d’avoir le sentiment d’avoir été arrachée à ma mère est l’une des plus flagrantes de ce moment-là. Ce sentiment d’abandon viscéral autant qu’inconscient va ancrer en moi l’idée que vivre c’est être seul et que je ne peux compter que sur moi.
Cette première expérience, racontée par Maman bien des années plus tard nous a profondément marquées toutes les deux. Maman avait à peine eu le temps de me prendre dans ses bras mais le lendemain matin, nouvelles émotions. Le médecin et la sage-femme arrivent tout sourire dans la chambre de maman pour savoir comment s’était passée la nuit pour les deux occupantes de la chambre… Mais je ne suis pas revenue après mes examens de la veille et maman ne m’a donc toujours pas revue. Autant dire que la situation a provoqué une vraie tempête. Maman s’est mise très en colère contre toute personne du corps médical qui passait le pas de sa porte sans sa fille. Personne ne savait où j’étais : on m’avait perdue dans la maternité ! Et on ne me retrouvera qu’en fin de journée. Maman a culpabilisé parce qu’elle a eu le sentiment de m’abandonner, d’être une mauvaise mère, de ne pas avoir su s’occuper de sa propre fille alors qu’elle venait tout juste de naître. L’épuisement et les émotions fortes avaient ébranlé son instinct maternel. Venait s’ajouter à tout cela que Maman n’a jamais pu nous allaiter et cela a toujours été pour elle une grande source de frustration et de souffrance.
J’ai donc fini par la retrouver après toutes ses émotions mais je ressentais les angoisses, les colères et les frustrations vécues durant les heures précédentes. Face à tant de péripéties, je n’arrangeais rien en refusant de m’alimenter. Les moments de repas étaient très éprouvants. De mon côté, l’absence de mon jumeau ne me donne pas très envie de vivre, semble-t-il, et, encore une chose que j’apprendrais bien des années plus tard, Maman n’aime pas donner le biberon aux nouveau-nés de peur qu’ils ne s’étouffent. Pour elle, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase : elle refuse de continuer à s’occuper de moi car elle n’est pas en état physiquement et psychologiquement. Papa me prend sous le bras et me confie à ma marraine le temps que Maman remonte la pente. De mon côté, ma naissance introduit en moi l’idée que je ne mérite pas de vivre puisqu’il y a tellement de difficultés. Peut-être ne suis-je pas appelée à vivre, Maman a peut-être raison de m’abandonner à ma marraine. Une fois sans moi, elle se réfugie à Brest chez ses parents pour pouvoir se reposer, prendre soin d’elle et nous revenir quelques semaines plus tard une fois qu’elle sera à nouveau sur pieds.
Je continue à marcher sur le chemin des histoires de famille et des anecdotes qui font le ciment de ses membres. Je suis donc retirée à Maman pour ces semaines pendant lesquelles je grandis et me fortifie en me raccrochant tant que je peux à celle qui deviendra officiellement ma marraine le 6 février 1982. Mais les blessures de mes débuts sont toujours vives. Le lien avec Maman ne peut pas se tisser par la force des choses. Cette meurtrissure est autant pour moi que pour elle qui m’en reparlera à plusieurs reprises avec émotion malgré les années qui passent. De mon côté, la question reste entière bien qu’inconsciente du haut de mes deux petits mois de vie : ma mère ne veut-elle pas ou ne peut-elle pas s’occuper de moi ? Même si je comprends complètement l’épuisement de maman, je suis quand même la cinquième en sept ans, mon instinct de bébé ne réfléchit pas aussi loin et le sentiment d’abandon demeure.
Maman étant revenue de Brest et selon leur désir, les parents me font baptiser dans l’église paroissiale du quartier sous la protection de Sainte Bernadette. Nous sommes donc le 6 février, jour de la Sainte Dorothée. Même si je suis trop petite pour réaliser ce qui se passe, les parents me font un des plus beaux cadeaux du monde : je deviens enfant de Dieu. Je suis désormais sous protection divine. Ma marraine est la meilleure et la plus ancienne amie de Maman et mon parrain, oncle Henri, est le mari de la jumelle de Maman. Je ne peux qu’imaginer l’occasion que cela a été de réunir la famille d’une façon simple et joyeuse.
Je grandis au milieu de la fratrie mais avec encore des difficultés, Maman me comparant pendant toute ma petite enfance à « un petit rat crevé » qu’elle tentait tant bien que mal de faire grandir. L’histoire raconte qu’à cinq mois et demi, dans notre nouvel appartement versaillais, au premier étage d’un immeuble de famille, j’ai eu de gros soucis de santé à cause d’un dysfonctionnement de la régulation de la température corporelle. Le thermomètre faisait dangereusement le yoyo entre les deux extrêmes. Maman a mis tout en œuvre pour tenter de me soigner, du bain chaud à la couverture, du simple body au câlin, mais rien n’y faisait. À bout d’idées et de forces, devant l’urgence de la situation, elle s’est tournée vers tante Françoise, sœur de ma grand-mère paternelle, qui habitait au quatrième étage et qui était infirmière militaire entre deux missions. Par son savoir-faire, tante Françoise m’a sauvé la vie mais personne n’a exactement compris ce qui s’était passé et le quotidien a repris sans d’autres alertes. Maman ne s’ennuie pas avec les cinq enfants et Papa travaille pour subvenir au besoin de tout ce petit monde.
Vers mes deux ans, les parents partent pour un week-end en laissant chaque enfant à des amis ou de la famille pour ne pas trop surcharger l’un ou l’autre. Je me retrouve chez Grand-Père et Mamie. À la fin du week-end, les parents commencent par me récupérer en espérant commencer par la situation la plus facile. Il faut dire que les jumeaux étaient particulièrement bêtisiers, nécessitant parfois même l’intervention d’un médecin, et les parents s’accordent encore quelques minutes de calme avant la double tornade. Quelle ne fut pas leur surprise d’apercevoir au pied de l’immeuble des grands-parents une ambulance ! Mais l’immeuble est grand, il ne s’agissait pas forcément de leur famille… Ils avaient tort. J’avais pris les médicaments de mon grand-père pour des bonbons ou en tout cas quelque chose qui semblait pouvoir se manger. Évidemment, j’ai fait une overdose qui m’a valu un aller-retour à l’hôpital avec un lavage d’estomac. Une fois de plus, je n’étais pas passée loin de la mort. Les parents me diront plus tard que mon ange gardien s’est très bien occupé de moi et que j’avais une folle envie de vivre ce qui a permis aux médecins de faire leur travail et que cela se termine bien. Tout le monde a bien culpabilisé, et après une belle frayeur, les parents ont pu rassembler tous leurs petits poussins et reprendre le train-train quotidien entre l’école, les bains, les jeux et les repas. Pas vraiment le temps de s’arrêter et de reprendre son souffle. La vie de famille reprend ses droits avec les disputes, les pleurs, les fous rires, les joies et toutes ces petites choses du quotidien qui font grandir autant les enfants que les parents.
Chapitre 3
Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas.
Sachez que le Royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.
Marc 10, 14
En septembre 1984, je fais ma première rentrée scolaire. Je n’ai pas encore 3 ans mais je veux faire comme les grands. Rester à la maison toute seule avec maman a l’air beaucoup moins amusant que d’aller à l’école avec les frères et sœur puisque nous sommes tous les cinq inscrits dans le même établissement.
Je découvre ce nouveau monde qui s’ouvre à moi, je m’y amuse en profitant de la présence des autres enfants. En plus, j’ai vraiment l’impression d’être grande. L’institutrice apprend à me connaître autant que je me familiarise avec les règles de l’école. Elle estime, à en croire les bulletins scolaires que je suis une petite fille épanouie, qui parle très bien pour son âge et qui a un penchant non dissimulé pour les travaux manuels et la peinture en particulier. Apparemment, les murs de la classe aussi s’en souviennent !
J’apprends beaucoup de choses dans ce nouvel environnement mais il semblerait que je ne m’exprime pas forcément quand il le faudrait. Un après-midi, en rentrant dans la classe, étant d’un naturel joyeux et bavard, au lieu d’aller à ma place comme tous les autres enfants, je reste avec des amies. Je me souviens m’être appuyée contre une des petites tables pour chanter un tube de l’époque Mes chaussettes rouge et jaune à petits pois, victime de mon prénom… Il m’avait valu d’avoir à la maison des cassettes de la chanteuse Dorothée et, ne pensant pas à mal, j’avais poussé la chansonnette en plein milieu de la classe. L’institutrice, devant cette désobéissance flagrante, a jugé bon et utile en punition de me faire asseoir en tailleur au milieu de la table pendant toute l’après-midi. Pour renforcer encore plus le message, elle m’a mis du scotch renforcé posé en étoile sur la bouche pour que je me taise.
Du haut de mes 3 ans à peine passés, je n’ai pas compris ce qui l’avait mise autant en colère et devant ce que je ressentais comme une profonde injustice, je suis restée interdite et obéissante. Il ne me semblait pas que chanter soit une bêtise mais cette punition m’a profondément marquée au point d’avoir une phobie du scotch pendant plusieurs années. J’ai compris au plus profond de moi que j’avais l’interdiction absolue de parler ou de bouger sans une autorisation formelle de l’adulte qui me prenait en charge. La peur de l’adulte qui est née dans mon cœur à ce moment-là ne pouvait être que de ma faute puisque c’est moi qui avais été punie. Au-delà de cette peur s’est instillée en moi l’idée que je n’avais pas le droit d’être moi-même, de m’exprimer. La sentence était sans appel : je devais me taire purement et simplement. L’institutrice a signalé à ma mère que j’avais été punie pour désobéissance mais sans entrer dans les détails de la mise en pratique. Maman n’a pas pu réagir, ne connaissant pas les faits et j’étais trop petite et trop effrayée pour lui expliquer ce qu’il s’était réellement passé dans la classe. Le seul commentaire de l’événement s’est retrouvé sur mon bulletin où après avoir expliqué mon épanouissement, il était précisé que je devais maintenant apprendre à m’affirmer parce que je subissais… et pour cause, je n’osais plus rien faire de peur d’être à nouveau punie.
Ce n’est que quelques semaines plus tard, lorsque ma sœur a également été victime d’une punition abusive que Maman a réagi. Comme une louve qui protège ses petits et étant d’un caractère entier, du jour au lendemain, elle a pris ses cinq petits louveteaux et nous a changés d’école vers la fin du deuxième trimestre. Pour mes yeux de petite fille, c’était la punition de Marie-Astrid qui avait déclenché la protection de Maman et non la mienne. Cette impression a renforcé en moi le sentiment d’injustice et d’incompréhension qui m’habitaient depuis l’épisode de la table et du scotch. J’avais donc, dans ma logique d’enfant, moins d’importance que ma sœur, allant même jusqu’à croire que ce que je vivais n’avait pas d’intérêt aux yeux des autres.
Ceci étant, le changement d’école a été bénéfique et j’ai retrouvé ma joie de vivre. Je me suis épanouie comme une fleur au soleil. La nouvelle institutrice me trouvait très attentive aux autres avec une très bonne mémoire mais également impatiente et tête en l’air, trait de caractère qui s’est confirmé au fil des années au grand damne de Maman et de Bonne-Maman notamment. J’ai un goût prononcé pour les farces, les puzzles, le chant, les perles et la peinture. Je me sens heureuse et en confiance au point même de croire ce qui est écrit sur le mur de ma classe pour me présenter : « Dorothée est toujours bien coiffée ». Cette affirmation m’a toujours marquée car il est vrai que Maman se donnait beaucoup de mal le matin pour que nous sortions de la maison aussi bien habillés et coiffés que possible. À la fin de la journée, ma sœur revenait aussi propre sur elle et bien coiffée alors que je revenais avec la barrette de travers, la mèche de cheveux dans les yeux, le nœud de la robe mal refait dans le meilleur des cas et plus d’une fois avec une chaussette en tire-bouchon. Et chaque matin, le manège recommençait. Toute cette attention, cette affection, ces habitudes m’ont permis de retrouver confiance dans le monde adulte qui m’entourait. Je continuais de grandir dans un climat joyeux et ordonné autant que peut le permettre le quotidien d’une famille nombreuse.
Ma dernière année de maternelle a débuté comme s’était déroulée la précédente. J’aimais toujours autant les travaux manuels, étais toujours autant tête en l’air mais avec une vraie joie d’aller à l’école et d’apprendre sans cesse de nouvelles choses, sans oublier de bavarder tout mon saoul avec mes camarades de classe. À la maison, tout se passe pour le mieux et je grandis au milieu des grands tout à fait normalement avec une grande préférence pour les fraises. Au moment du dessert, il était de tradition dans la famille que le ou la plus jeune choisisse son dessert en premier. Mon choix se portait invariablement sur le yaourt à la fraise ce qui avait le don d’énerver prodigieusement les plus grands. À ce rythme, les paquets de yaourts ne comptaient rapidement plus la moindre trace de fraise. Ne sachant pas encore lire à cette époque, me voilà devant mon choix :
Mais ce jour-là, plus de fraises. Maman tente de me faire changer d’avis et je n’en démords pas. Agacée, elle finit par poser un autre yaourt devant moi. : « Tiens, c’est de la fraise, mange maintenant ! » Il était hors de question de refuser d’obéir à un ordre aussi direct et il n’était pas non plus envisageable d’exprimer ma désapprobation lorsque, plongeant la cuillère dans le pot et goûtant le fameux yaourt, je réalisais évidemment qu’il ne s’agissait pas de fraises. Je me retrouve à devoir finir mon yaourt mais chaque bouchée était accompagnée du même commentaire à voix basse de ma part : « Ce n’est pas de la fraise. ». Je me répétais tout en n’osant pas dire tout haut ce que je pensais tout bas : je me faisais rouler dans la farine mais il ne fallait pas me prendre pour une imbécile, je savais très bien ce que je mangeais, et ce n’était pas de la fraise. Le yaourt a quand même été fini sans plus d’histoire. Aujourd’hui, la famille raconte cette anecdote en souriant au souvenir de mon attitude qui les avait beaucoup fait rire. Mais j’ai compris dans cette petite histoire qu’à la maison, on ne plaisantait pas avec l’obéissance et les enfants n’avaient pas voix au chapitre même quand on leur mentait ouvertement.
La maîtresse perçoit un changement significatif en cours d’année. Elle signale sur le bulletin un trimestre mouvementé mais où je finis par retrouver ma forme et mon rythme selon ses propres mots. Apparemment, rien dans la vie de famille ne permet de comprendre cette baisse de régime… Pourtant la réponse n’est pas loin, là où personne ne pense à la chercher…
Chapitre 4
L’homme qui convoite sa propre chair : il n’aura de cesse que le feu le consume ; à l’homme impudique, toute nourriture est douce, il ne se calmera qu’à sa mort. L’homme infidèle à sa propre couche qui dit en son cœur : « qui me voit ? L’ombre m’environne, les murs me protègent, personne ne me voit, que craindrais-je ? Le Très-Haut ne se souviendra pas de mes fautes. » Ce qu’il craint ce sont les yeux des hommes, il ne sait pas que les yeux du Seigneur sont dix mille fois plus lumineux que le soleil, qu’ils observent toutes les actions des hommes et pénètrent dans les recoins les plus secrets.
L’Ecclésiastique 23, 16-21
À la maison, le rythme de Maman est soutenu. Les jumeaux, Thibault et Clément ont onze ans à cette époque et découvrent le collège. Ce sont des garçons de leur âge qui ont besoin de se défouler, de profiter de leurs amis… et deux cerveaux pour une seule activité, les débordements sont réguliers même si maman nous dira plus tard qu’ils s’assagissaient avec le temps. Il n’en demeure pas moins que leur quotidien est de l’énergie en tube. Paul, de trois ans leur cadet, était plus pondéré et plus cérébral, ce qui ne l’empêchait pas d’être plein de vie. Marie-Astrid, quant à elle, remplissait, aux yeux de la famille, le rôle de la petite fille modèle : bien habillée, bien coiffée, réservée, serviable mais il ne fallait pas trop la pousser quand même car elle avait aussi son petit caractère, comme on dit.
Tous les cinq très différents demandions beaucoup d’attention de la part des parents et principalement de Maman qui devait nous gérer jour après jour pendant que Papa travaillait. Devant le tourbillon familial, tante Henriette et oncle Marcel, frère de ma grand-mère paternelle, habitaient l’appartement du dessus et s’étaient proposés pour aider Maman. Une à deux fois par semaine, ils se chargeaient tantôt des garçons tantôt des filles le temps d’un dîner. Maman avait ainsi l’occasion de ne pas considérer ses enfants comme un seul et même paquet mais pouvait souffler un peu, si l’on considère le rythme d’une mère de famille nombreuse, et passer un temps privilégié avec ceux qui restaient.
Au début de cet arrangement, je montais donc avec ma sœur, après avoir pris notre bain. C’était pour nous une fête car il y avait là-haut de grands cousins et toute une famille pour s’occuper juste de nous. Ces moments cassaient un peu la routine. À cette même période, Marie-Astrid est tombée gravement malade pendant plusieurs mois. Je continuais quand même à monter chez mon grand-oncle et ma grand-tante avec d’autant plus de joie que le faire toute seule était une véritable aventure du haut de mes quatre ans. Je n’étais plus la petite dernière, je faisais la même chose que les grands. Même si notre quotidien était réglé comme du papier à musique, les horaires étaient un tantinet fluctuant et je pouvais monter avant que le repas soit prêt. Peu importait, il y avait toujours quelqu’un pour s’occuper de moi puisque tante Henriette et oncle Marcel avaient quatre enfants adolescents ou grands adolescents.
Et un jour de cette époque que ma mémoire ne peut définir précisément, ma tante, n’ayant pas fini de préparer le dîner me confie à son fils Pierre-Yves juste quelques minutes, elle appellerait à table dès que tout serait prêt. Elle ne veut pas que je lui traîne dans les pattes. Nous allons donc tous les deux jouer dans la chambre du fond du couloir à droite. Il ferme la porte et me sourit. C’est le premier jour du reste de ma vie. Il me propose de jouer à Jacques-a-dit. J’y ai déjà joué à l’école et ça m’amuse beaucoup. Comme on me l’a appris, je ne triche pas, je ne désobéis pas. Selon les demandes, je lève un bras, je lève un pied, je les repose. Je ne le comprends pas mais ses yeux changent, son regard. « Jacques a dit retire tes pantoufles… Très bien ! Jacques a dit : retire ta chemise de nuit… » Ce n’était qu’un jeu, je me déshabille. Mais finalement, ce n’est pas aussi amusant qu’à l’école. Il me rassure, tout va bien, c’est normal, ça fait partie du jeu et puis je ne suis pas une tricheuse. Je suis tétanisée au fur et à mesure qu’il s’approche. Il m’invite à ne pas faire de bruit en posant son index sur ma bouche et se met à chuchoter : je dois jouer jusqu’à la fin sinon c’est de la triche et tous les jeux ont des règles. Personne ne doit savoir, je ne dois rien raconter, à personne, c’est un secret. J’ai essayé de parler mais il a plaqué sa main sur ma bouche. J’ai froid, toute seule dans cette chambre. J’ai peur, toute seule dans cette chambre. Il lèche ma joue pour essuyer une larme. C’est une nouvelle règle : je n’ai pas le droit de pleurer. Et sa main commence à se promener partout sur moi. Je suis perdue, je ne comprends rien, je ne sais plus quoi faire. Je ne veux plus jouer mais je dois attendre la fin du jeu, attendre qu’il finisse de s’amuser. Pourquoi est-ce que je me sens si mal ? Et puis il pose ses lèvres sur ma bouche. Je ne réagis pas, je suis tétanisée : ce sont les papas et les mamans qui s’embrassent comme ça. Sa main descend sur mon corps nu, jusqu’en bas, il me caresse juste là, là où je ne veux pas qu’il vienne. Il entre un doigt à l’intérieur. Ça me brûle. Quelque chose se brise en moi à un endroit que je ne me connaissais pas. Il me viole pour la première fois, je meurs pour la première fois… je n’ai que quatre ans et demi… Il finit par se reculer avec un grand sourire. J’ai envie de vomir. Il est fier de moi mais je dois absolument me taire, et puis qui me croirait, ce n’était qu’un jeu, je pouvais refuser me dit-il avec un regard qui me vrille le cœur. Je remets ma chemise de nuit et mes pantoufles en même temps que je verrouille mon visage.
Tante Geneviève appelle à table. Pierre-Yves rouvre la porte avec ce même sourire sale, s’arrête devant moi, se met à ma hauteur : « si tu en parles, je vais te punir très fort. » Il avait dix-sept ans… De ce moment, j’ai joué le plus grand rôle de ma vie : la petite fille parfaite, toujours heureuse. Ce soir-là et tous ceux qui ont suivi, nous nous sommes retrouvés autour de la table de salle à manger, regardant les nouvelles de vingt heures à la télévision tout en plaisantant et en parlant de tout et de rien mais surtout pas de ce qui s’était passé dans la chambre quelques minutes plus tôt. Devant l’incompréhension et une terreur instinctive face à ce que je venais de vivre, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour oublier et survivre. C’était le seul moyen que j’avais pour me protéger et pour que Pierre-Yves ne mette pas ses menaces à exécution. À mon retour à la maison, personne n’a rien vu et rien compris. Pour mes parents, c’était un soir comme un autre. Je me suis couchée sans faire d’histoire, gardant mon secret tellement fort à l’intérieur que je me donnais l’impression qu’il ne s’était rien passé… et je repris le chemin de l’école le lendemain tout naturellement, comme si je n’avais pas été détruite à l’intérieur, comme si tout ce que j’avais vécu était normal… Mais une seule fois ne lui a pas suffi…
Les premières fois, il utilisait des jeux comme Jacques-a-dit pour obtenir de moi ce qu’il voulait. J’étais tellement petite que je ne comprenais pas ce qui se passait. Tout ce que je savais à ces moments-là, c’est que je me sentais mal, tout ce qui se passait ne me plaisait pas malgré ce qu’il pouvait dire. Il me faisait jouer tantôt à la poupée de chiffon, à la statue et d’autres jeux où il pouvait à son aise jouer avec mon corps sans que je me méfie dans les premières minutes. À chaque fois, j’espérais vraiment jouer comme à l’école mais dès que je comprenais que j’allais encore avoir mal, il s’assurait de mon silence. De peur que les menaces verbales ne suffisent plus, il me faisait mal exprès pour que j’obéisse.
Autant que je me souvienne aujourd’hui, chaque fois que je montais dîner était une occasion pour Pierre-Yves de s’amuser. Les menaces n’ont pas tardé à s’intensifier, tant par leur fréquence que par leur portée terrifiante. La punition n’était pas le seul moyen de pression. Rapidement, il a menacé de faire les mêmes choses à ma sœur. J’avais trop peur pour elle. Lorsque je montrais un tant soit peu de résistance au début, pour me faire définitivement rentrer dans le rang, il menaçait d’en parler lui-même à mes parents, qui m’abandonneraient parce que je n’étais pas assez gentille et obéissante. J’ai appris à ne plus opposer le moindre refus pour survivre. Je le laissais utiliser mon corps à sa guise, attendant désespérément que quelqu’un vienne l’arrêter, que quelqu’un comprenne, que tout s’arrête enfin.
Un autre soir, très peu de temps après, montant à nouveau au second, Pierre-Yves me propose de lire une histoire en attendant que le dîner soit prêt. Dans ma tête de petite fille, ce n’était pas un de ses jeux que je n’aimais pas, je ne risquais rien, je l’ai donc suivi. Nous nous retrouvons à nouveau dans cette chambre dont les murs sont de couleur pêche avec de grandes étagères remplies de livres et de BD, la chambre de la première fois. Il se met sur le lit, m’assied sur ses genoux et commence l’histoire. Je baisse la garde un instant mais aussitôt sa main caresse ma cuisse pendant qu’il continue l’histoire, l’air de rien. Il remonte ma chemise de nuit et touche ma peau. J’ai l’impression d’avoir la peau qui brûle. Il lâche le livre… ça recommence. Cette fois, il va plus loin, il est plus brusque dans ses gestes, il n’y a plus seulement sa main qui me caresse mais aussi ses lèvres qui m’embrassent où elles peuvent. Je me sens sale, gluante. Après avoir fait entrer un doigt en moi, après en avoir fait un crochet, il m’oblige à le sucer. J’ai envie de hurler mais aucun son ne sort, je veux bouger mais mon corps ne m’obéit plus. Je me dégoûte, tout est de ma faute puisque je le laisse faire. Je dois sans doute avoir mérité tout ça.
Malgré ma voix qui refusait de sortir et mon corps qui refusait de bouger pour fuir, j’arrivais parfois à opposer une petite résistance avec toute la force que je pouvais dans ces moments-là. Mes cinq ans terrorisés ne pouvaient que tenir ma bouche fermée quelques secondes de plus et mes jambes refusaient de s’écarter pas tellement plus longtemps. Pour obtenir de moi ce qu’il voulait, il posait une main sur ma gorge dès que je refusais d’obéir immédiatement : il serrait et enfonçait ses ongles me promettant de me faire mourir si je n’étais pas assez gentille avec lui. Tout cela se passait dans un silence de mort, avec seulement ses chuchotements à mes oreilles pour satisfaire ses moindres désirs et fantasmes. J’étais tantôt écrasée, tantôt écartelée selon ses ordres que j’avais appris petit à petit à suivre sans opposer de résistance. Il me le disait, c’était de ma faute, il ne fallait pas que je sois si belle, que je sois une fille, il ne pouvait pas résister.
Plus ces moments se multipliaient plus il prenait de l’assurance autant dans ses paroles que dans ses gestes, aidé par la présence ponctuelle d’oncle Marcel qui se permettait de regarder et de donner des conseils le cas échéant. J’aurais voulu lui faire aussi mal que ce que je ressentais à l’intérieur. Je n’étais plus rien, brisée en mille morceaux et il n’y avait personne vers qui se tourner tellement la terreur étreignait mon cœur.
À la maison, rien ne changeait. Nous allions à la messe le dimanche en famille, les parents, responsables d’un groupe scout, organisaient régulièrement des réunions à la maison. C’était pour moi de belles occasions de ne pas dormir et de passer de genoux en bras, autant de prétexte pour rester le plus proche possible des parents. Comme la messe, les bains et les repas en famille, Pierre-Yves était entré dans ma routine.
Je connaissais les règles en montant au second : j’allais avoir mal, mourir encore un peu plus et personne ne serait là pour m’aider. J’étais toute seule, trop seule. Mais chaque fois, ses mains trop pressantes, trop curieuses, ses doigts comme des crochets, sa langue trop gluante et ses mots me déchiraient toujours plus. Il me persuade que personne ne viendra à mon aide parce que je n’intéresse personne, en réalité, je mérite ce qu’il me fait. Il veut m’apprendre à aimer ça pour quand je serai plus grande, pour quand je serai une maman. Il me répète que je vais finir par aimer ce qu’il me fait. Tout ça est trop pour ma petite tête, pour mon corps : je m’en vais loin à l’intérieur de moi, ailleurs, là où les grands ne pourront jamais me trouver. J’ai envie de mourir à chaque fellation, à chaque fois que sa langue ou ses doigts entrent, à chaque fois qu’il se frotte à moi et que je deviens gluante, chaque seconde passée dans cette chambre. Et pourtant, j’oublie et je reprends ma vie où elle s’était arrêtée quelques minutes auparavant. Dans notre routine, et pour que personne ne soupçonne quoi que ce soit, je devais m’essuyer avec une serviette râpeuse qu’il avait pensé à prendre avec lui avant d’entrer dans cette chambre avec moi. Sur les conseils de son père, Pierre-Yves prenait soin de ne laisser aucune trace et de ne pas me blesser à l’intérieur comme à l’extérieur pour que ce secret reste bien caché. Quand on s’est fait mal, on désinfecte, on met un pansement et Maman fait un bisou magique. Mais je me retrouve avec des blessures bien plus profondes et invisibles qui font encore plus mal que celles que l’on peut voir. On ne peut rien soigner quand on ne sait pas que la blessure existe. J’ai le cœur qui saigne, j’ai l’âme qui pleure. Je ne suis plus rien.
Mon comportement a fini par changer et s’est déréglé à la mesure et au rythme de ce que Pierre-Yves me faisait vivre. J’ai commencé à faire des cauchemars, à refuser de m’éloigner de Maman, de m’endormir, j’avais drastiquement régressé concernant la propreté. Dans ma tête, je ressentais un profond malaise d’accepter ce qu’il me faisait sans oser en parler. J’étais tellement petite que je ne pouvais pas vraiment mettre des mots sur ce que je subissais puisque cela m’était inconnu jusque-là. Comment aurais-je pu parler à maman ou papa de caresses, de fellations, de douleurs à l’intérieur, de viols, de sodomie, de dissociations, système de défense… sur lequel je mettrai des mots plus de vingt ans après ? J’avais plusieurs certitudes qui m’empêchaient de parler. D’abord et avant toute chose, je pensais mériter ce qui m’arrivait puisque j’étais méchante, jolie et qu’en plus j’étais une fille. Il me l’a tellement répété que j’ai fini par m’en convaincre. Ma deuxième certitude, conséquence directe de mon éducation, était que les enfants doivent obéissance absolue aux adultes. Bien sûr, cette certitude ne m’a pas empêchée de me chamailler, de ne pas ranger ma chambre, de ne pas mettre les mains sur la table au moment des repas, bref, d’être un enfant qui grandit. Mais je croyais au plus profond de mon cœur, dans cette chambre, quand la porte était fermée, que ma vie était en jeu et que ma survie ne dépendait que de mon obéissance. Il n’y avait plus rien d’autre qui comptait : je devais me taire et obéir si je voulais sortir vivante. Il y avait quand même des choses que je ne comprenais pas même si j’avais appris à suivre les règles édictées. Pierre-Yves, au début, prétextait ma désobéissance pour justifier ce qu’il me faisait subir soir après soir. J’espérais donc en étant le plus sage possible à l’école et à la maison qu’il n’aurait plus de raison de me faire mal. Mes jeunes années se trompaient lourdement sur ce point.