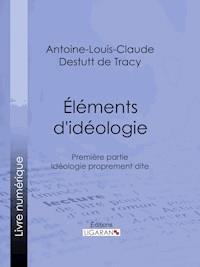
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Vous pensez tous : vous le dites souvent : aucun de vous n'en doute; c'est pour vous une vérité d'expérience, de sentiment, de conviction intime, et je suis bien loin de la nier. Mais vous êtes-vous jamais rendu un compte un peu précis de ce que c'est que penser, de ce que vous éprouvez quand vous pensez, n'importe à quoi ? Je suis bien tenté de croire que non. Et bien des hommes meurent sans l'avoir fait, sans y avoir seulement songé."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PROPREMENT DITE.
Jeunes gens, c’est à vous que je m’adresse ; c’est pour vous seuls que j’écris. Je ne prétends point donner des leçons à ceux qui savent déjà beaucoup de choses, et les savent bien : je leur demanderais des lumières au lieu de leur en offrir. Et quant à ceux qui savent mal, c’est-à-dire, qui ayant un très grand nombre de connaissances, en ont tiré de faux résultats dont ils se croient très sûrs, et auxquels ils sont attachés par une longue habitude, je suis encore plus éloigné de leur présenter mes idées : car, comme l’a dit un des plus grands philosophes modernes,
« Quand les hommes ont une fois acquiescé à des opinions fausses, et qu’ils les ont authentiquement enregistrées dans leurs esprits, il est tout aussi impossible de leur parler intelligiblement que d’écrire lisiblement sur un papier déjà brouillé d’écriture ».
Rien n’est plus juste que cette observation de Hobbes. Peut-être verrons-nous bientôt ensemble la raison de ce fait ; mais, en attendant, vous pouvez le tenir pour très certain. Je serais même fort surpris si votre petite expérience personnelle, quelque peu étendue qu’elle soit, ne vous en avait pas déjà offert la preuve. En tout cas, la première fois qu’il arrivera à un de vos camarades de s’attacher obstinément à une idée quelconque qui paraîtra évidemment absurde à tous les autres, observez-le avec soin, et vous verrez qu’il est dans une disposition d’esprit telle qu’il lui est impossible de comprendre les raisons qui vous semblent les plus claires : c’est que les mêmes idées se sont arrangées d’avance dans sa tête dans un tout autre ordre que dans la vôtre, et qu’elles tiennent à une infinité d’autres idées qu’il faudrait déranger avant de rectifier celles-là. Dans une autre occasion vous lui donnerez peut-être sa revanche. Eh bien, mes amis, c’est de la même manière et par les mêmes causes que l’on s’attache à un faux système de philosophie et à une fausse combinaison dans un jeu d’enfants.
C’est pour vous préserver de l’un et de l’autre que je veux dans cet écrit, non pas vous enseigner, mais vous faire remarquer tout ce qui se passe en vous quand vous pensez, parlez, et raisonnez. Avoir des idées, les exprimer, les combiner, sont trois choses différentes, mais étroitement liées entre elles. Dans la moindre phrase ces trois opérations se trouvent : elles sont si mêlées, elles s’exécutent si rapidement, elles se renouvellent tant de fois dans un jour, dans une heure, dans un moment, qu’il paraît d’abord fort difficile de débrouiller comment cela se passe en nous. Cependant vous verrez bientôt que ce mécanisme n’est point si compliqué que vous le croyez peut-être. Pour y voir clair, il suffit de l’examiner en détail ; et déjà vous sentez qu’il est nécessaire de le connaître pour être sûr de se faire des idées vraies, de les exprimer avec exactitude, et de les combiner avec justesse ; trois conditions sans lesquelles on ne raisonne pourtant qu’au hasard. Étudions donc ensemble notre intelligence ; et que je sois seulement votre guide, non parce que j’ai déjà pensé plus que vous, car cela pourrait bien ne m’avoir servi de rien, mais parce que j’ai beaucoup observé comment l’on pense, et que c’est cela qu’il s’agit de vous faire voir
On donne différents noms à la science dont nous allons parler : mais quand nous serons un peu plus avancés et que vous aurez une idée nette du sujet, vous verrez bien clairement quel nom on doit lui donner. Jusque-là tous ceux que je vous suggérerais ne vous apprendraient rien ; ou peut-être même vous égareraient, en vous indiquant des choses dont il ne sera point question ici. Étudions donc, et nous trouverons ensuite comment s’appelle ce que nous aurons appris.
Bien des gens croient qu’à votre âge on n’est pas capable de l’étude à laquelle je veux vous, engager. C’est une erreur ; et, pour le prouver, je pourrais me contenter de vous citer mon expérience personnelle, et de vous dire que j’ai souvent exposé à des enfants aussi jeunes qu’aucun de vous et qui n’avaient rien de remarquable pour l’intelligence, toutes les idées dont je vais vous entretenir, et qu’ils les ont saisies avec facilité et avec plaisir ; mais je vous dois quelques explications de plus ; elles ne seront pas inutiles par la suite.
Premièrement, il n’est pas douteux que nos forces intellectuelles, comme nos forces physiques, s’accroissent et augmentent avec le développement de nos organes : ainsi dans quelques années vous serez certainement susceptibles d’une attention plus forte et plus longue qu’aujourd’hui, comme vous serez capables de remuer et de soutenir des fardeaux plus lourds.
Secondement, il est tout aussi sûr que certaines facultés se développent avant d’autres, et que, comme la souplesse du corps précède sa plus grande vigueur, de même la faculté de recevoir des impressions et celle de se les rappeler se manifestent avant la force nécessaire pour bien juger et combiner ces sensations et ces souvenirs ; c’est-à-dire que la sensibilité et la mémoire précèdent l’action énergique du jugement.
Une autre vérité d’observation constante, c’est que toutes ces facultés physiques ou intellectuelles languissent dans l’inaction, se fortifient par l’exercice, et s’énervent quand on en abuse.
Voilà les faits : c’est toujours d’eux que nous devons partir ; car ce sont eux seuls, qui nous instruisent de ce qui est ; les vérités les plus abstraites ne sont que des conséquences de l’observation des faits. Mais que conclure de ceux-ci ? rien autre chose, si ce n’est que dans tous les genres il faut exercer vos forces et ne pas les excéder ; qu’actuellement vos leçons doivent être courtes et répétées, et que dans quelque temps vous ferez en un mois ce que vous ne faites à cette heure qu’en deux. Mais cela s’applique-t-il plus particulièrement à l’étude qui nous occupe qu’à une autre ? cela doit-il la faire écarter plus que toute autre ? non assurément.
En effet, tout jeunes que vous êtes, on vous a déjà donné des notions élémentaires de physique et d’histoire naturelle ; on vous a fait connaître les principales espèces de corps qui composent cet univers ; on vous a donné une idée de leurs combinaisons, de leur arrangement, des mouvements des corps célestes, de la végétation, de l’organisation des animaux : et on a bien fait de vous mettre tant d’objets divers sous les yeux, quoique vous ne soyez, pas en état de les approfondir cela vous a toujours fourni des idées préliminaires et des sujets de réflexion. Dans tout cela, il est vrai, beaucoup de choses ont frappé vos sens et réveillé votre attention : votre mémoire surtout a été exercée ; cependant votre jugement n’est pas demeuré inactif, car, sans son secours, vous seriez restés dans un véritable état d’idiotisme ; vous n’auriez rien compris à tout ce qu’on vous a dit.
Ce n’est pas tout ; on vous a aussi donné quelques leçons de calcul ; vous savez les principes fondamentaux de la numération : là cependant il n’y a presque rien à voir, très peu à retenir de mémoire, presque tout est raisonnement ; vous l’avez compris pourtant : ce que nous avons à dire n’est pas plus difficile.
Il y a plus ; vous avez déjà commencé l’étude du latin ; on vous a enseigné quelques éléments de grammaire ; on vous a expliqué la valeur des mots, leurs relations, le rôle qu’ils jouent dans le discours ; on vous a parlé de substantifs, d’adjectifs, du verbe simple et des verbes composés : vous n’avez pas pu apprendre l’emploi de ces signes sans connaître l’usage des idées qu’ils représentent ; ou vous n’avez rien compris du tout à tout cela, ou vous savez déjà au moins confusément une grande partie de tout ce qui va nous occuper ; et, si je ne me trompe beaucoup, la manière dont nous allons reprendre toutes ces matières vous les fera paraître beaucoup plus claires, d’autant que ce que nous en dirons ne sera pas embrouillé par les mots d’une langue qui ne vous est pas encore familière.
Enfin, quand vous n’auriez jamais entendu parler ni de physique, ni de calcul, ni de latin ; quand de votre vie vous n’auriez reçu aucune leçon expresse ; quand vous ne sauriez pas lire ; quand vous n’auriez appris qu’à parler, croyez-vous que vous y fussiez parvenu sans faire un grand usage de votre jugement ? Vous n’avez peut-être jamais pris garde à la multitude de choses qu’il faut qu’un enfant étudie pour apprendre à parler ; combien il faut qu’il fasse d’observations et de réflexions pour connaître et démêler tous les objets qui l’environnent ; pour remarquer et distinguer les sons et les articulations que prononcent ceux qui l’entourent ; pour s’apercevoir que de ces paroles les unes s’appliquent aux objets et les désignent, les autres expriment ce qu’on en pense et ce qu’on en veut faire ; pour parvenir lui-même à répéter ces paroles et à en faire une application juste ; et enfin pour reconnaître la manière de les varier et de les lier entre elles de façon qu’elles deviennent le tableau fidèle de sa pensée. Pesez un peu toutes ces difficultés, et vous verrez que ce n’est pas sans beaucoup de méditations et de raisonnements qu’on parvient à surmonter tant d’obstacles. Aussi observez un enfant quand il vient de réussir à distinguer les parties d’un objet qu’il ne connaissait pas, à entendre quelque chose qu’on lui dit et qu’il ne comprenait pas, à faire comprendre son idée qu’on ne saisissait pas, voyez comme il rit de bon cœur, quelle joie vive il manifeste : celle d’un savant qui vient de faire une découverte n’est ni plus grande ni mieux fondée ; elle est absolument du même genre, elle naît des mêmes motifs, son succès est dû à des efforts tout pareils. Je vous disais tout à l’heure que c’est par les mêmes causes que l’on se trompe dans les jeux et dans les sciences ; eh bien ! c’est par les mêmes procédés qu’on apprend à parler, et qu’on découvre ou les lois du système du monde, ou celles des opérations de l’esprit humain, c’est-à-dire tout ce qu’il y a de plus sublime dans nos connaissances.
Mes amis, plus vous aurez d’expérience, plus vous aurez réfléchi, et plus vous serez convaincus qu’en aucun temps de votre vie vous n’avez acquis autant de connaissances réelles, vous n’avez fait des progrès aussi rapides que dans les trois ou quatre premières années de votre existence. Ce n’est pas que, comme je l’ai dit, vous ne soyez devenus dans la suite capables d’un jugement plus ferme, d’une attention plus soutenue ; mais c’est que jamais vous n’aurez été aussi constamment occupés d’apprendre. Le plaisir presque unique de la première enfance est de faire des découvertes ; et, dans le reste de la vie, on ne se borne que trop souvent à jouir, tant bien que mal, des choses que l’on connaît à-peu-près. Ce qui met le plus de différence entre les degrés de lumières et de talents auxquels parviennent les hommes, c’est de conserver plus ou moins longtemps, plus ou moins vivement ce premier penchant à l’investigation, à la recherche des vérités quelles qu’elles soient.
En voulez-vous un exemple ? les exemples rendent les vérités plus sensibles. Vous aimez sûrement bien les chevaux : qu’on vous en donne un, et qu’on vous laisse libres ; vous courrez dessus des journées entières sans vous embarrasser de savoir ni comment il vit, ni comment il meurt, ni comment il broie ses aliments, ni ce qu’ils deviennent, ni quelle est sa structure interne ; sans peut-être seulement remarquer en quoi consiste la différence de ses mouvements au pas, au trot, et au galop. Ce que vous ferez, emportés par l’attrait du plaisir, un homme plus âgé le fera dominé par ses affaires, ou par l’appât du gain. Combien de gens mènent des chevaux toute leur vie sans faire autant de réflexions peut-être pour les conduire que le cheval pour leur obéir ! Au contraire, donnez un cheval de carton à un enfant : soyez assuré qu’à l’instant même il le tourne et retourne de tous les sens ; il l’examine autant qu’il est en lui ; bientôt il va l’éventrer pour voir ce qu’il y a dedans : s’il le traîne, il le regarde à chaque instant ; il veut deviner comment cela se fait : vous voyez souvent à son petit air pensif qu’il est bien moins occupé de l’effet, que de la manière dont il se produit ; son plaisir est de chercher ; sa vraie passion est la curiosité ; et cet utile sentiment serait encore bien plus permanent en lui si souvent on ne l’en distrayait pas très maladroitement, et bien plus fructueux si de bonne heure on ne lui faisait pas abandonner sa logique naturelle pour de faux principes. Mais revenons.
Vous voyez donc que vous êtes très capables de réflexion et de jugement, pourvu que la recherche vous plaise, et ne dure pas trop longtemps. Si vous avez cru le contraire, c’est une erreur dont il faut vous désabuser.
Il est encore une chose qu’il faut que vous sachiez, et dont vous verrez bien des preuves par la suite : c’est que l’esprit humain marche toujours pas-à-pas ; ses progrès sont graduels, en sorte que nulle vérité n’est plus difficile à comprendre qu’une autre, quand on sait bien tout ce qui est avant. Il n’y a d’inintelligible pour nous que ce qui est trop loin de ce que nous savons déjà ; mais il n’y a pas plus de distance entre la vérité la plus sublime des sciences et celle qui la précède immédiatement, qu’entre l’idée la plus simple et celle qui la suit ; comme dans les nombres il n’y a pas plus loin de 99 à 100 que de 1 à 2. La série de nos jugements est une longue chaîne dont tous les anneaux sont égaux. Il n’y a donc pas de science qui soit par elle-même plus obscure qu’aucune autre : tout dépend de l’ordre que l’on sait y mettre pour éviter les trop grandes enjambées, si je puis m’exprimer ainsi : trouver cet ordre, quand il n’est pas encore connu, c’est là le propre du talent ; et ce talent est le même qui fait trouver des vérités nouvelles. Nous verrons quelque jour en quoi il consiste ; car le bien connaître est le moyen de l’acquérir, et de se préserver de croire que le génie qui invente marche au hasard.
Pour ne pas outrer ce que je viens de dire sur l’enchaînement des vérités, il faut cependant observer qu’il y a tel raisonnement où la série de nos jugements est si longue, qu’il faut une attention peu commune pour la suivre toute entière ; et qu’il y en a tel autre formé de vérités qui tiennent à tant d’autres, que même en les connaissant bien il faut une force de tête au-dessus de l’ordinaire pour ne perdre de vue aucun des éléments qui les composent ; ce qui est cependant nécessaire pour n’en pas tirer de fausses conséquences : mais vous ne trouverez rien de tel dans tout ce que nous avons à dire. Nous ne nous proposons que d’examiner avec soin ce que nous faisons quand nous pensons, et d’en conclure ce que nous devons faire pour penser avec justesse. Là, les faits sont en nous, les résultats tout près de nous ; et le tout est si clair, que nous aurons peine à comprendre comment tant de gens l’ont si fort embrouillé en y supposant ce qui n’y est pas, et y cherchant ce que nous n’y pouvons trouver. Ne vous effrayez donc point de cette entreprise, aussi utile que facile, et qui, j’en suis sûr, vous causera plus de plaisir que de fatigue.
Mais, en terminant ces réflexions préliminaires, je dois encore vous rappeler que celui d’entre vous qui a l’esprit le moins exercé, a pourtant déjà une foule immense d’idées, qu’il en a porté des millions de jugements, et qu’il en est résulté une quantité prodigieuse de connaissances : tout cela est tellement innombrable dans toute la force du terme, qu’assurément il n’y a aucun de vous qui pût faire l’énumération complète de toutes les idées qu’il a conçues, de tous les jugements qu’il a portés, et de toutes les combinaisons qu’il en a faites ; et dans tout cela vous sentez bien qu’il doit s’être glissé déjà un grand nombre d’erreurs : à la vérité elles ont du moins un avantage, c’est qu’elles n’ont pas encore ce caractère de fixité qu’elles acquièrent avec le temps. Néanmoins vous êtes bien loin, pour me servir de l’expression de Hobbes, d’être semblables à des feuilles de papier blanc sur lesquelles on puisse écrire commodément et sans précaution. Il faut partir de l’état où vous êtes, il faut profiter du chemin que vous avez déjà parcouru ; il faut vous mettre en garde contre les fausses routes dans lesquelles vous pouvez être entrés : c’est ce que je crois avoir fait dans ce préambule.
En le lisant, bien des gens penseront peut-être que moi, qui vous promettais tout à l’heure de vous enseigner par la suite l’art que l’on nomme méthode, c’est-à-dire, l’art de disposer ses idées dans l’ordre le plus propre à trouver la vérité et à l’enseigner, j’ai commencé par manquer moi-même aux règles de cet art, en vous parlant de beaucoup de choses dont je ne vous ai point encore donné de notions exactes, en me servant, pour vous en parler, de beaucoup de termes, dont la signification précise n’est pas encore convenue entre nous. Ils croiront que j’aurais dû débuter par vous expliquer magistralement ce que c’est que faculté, pensée, intelligence, sensation, souvenir, idée, attention, réflexion, jugement, raisonnement, combinaison, etc. ; et par vous donner des définitions positives de tous les termes scientifiques que j’ai déjà employés et que j’emploierai à l’avenir ; et ils seront persuadés que de cette manière j’aurais été beaucoup plus clair.
Effectivement, si je m’y étais pris ainsi, peut-être y auriez-vous été trompés vous-mêmes ; peut-être auriez-vous cru dès l’abord me comprendre parfaitement, quoique dans le vrai il n’en fût rien. Vous n’êtes pas encore assez avancés pour que je puisse vous faire bien voir d’où vous serait venue cette confiance trompeuse : mais une preuve qu’elle n’eût été qu’une illusion, c’est que quand vous saurez bien ce que c’est que toutes ces choses que nous venons de nommer, quand par conséquent vous aurez une idée bien nette et bien juste de la signification des mots qui les expriment, je n’aurai plus rien à vous dire, vous saurez la science qui nous occupe. Or il est bien évident que c’est ce que je ne pouvais pas opérer dans un petit nombre de paragraphes. Je n’aurais donc fait, avec toutes mes définitions, que prendre des mots qui n’ont encore pour vous qu’un sens assez vague, et, sans vous donner aucune nouvelle lumière, les remplacer par d’autres mots nécessairement tout aussi vagues que les premiers. C’est ainsi que l’on s’éblouit, mais ce n’est point ainsi que l’on s’éclaire.
Il n’y a peut-être pas un des termes que je viens de citer, dont vous ne vous soyez déjà servi mille et mille fois. Ils ont donc pour vous un sens quelconque ; j’ai donc pu m’en servir en vous parlant, tout comme j’ai fait de termes plus usuels, que vous employez encore plus souvent, quoique certainement vous n’en sentiez pas toujours toutes les nuances. J’ai dû seulement ne pas faire de ces mots un usage trop fin que vous n’auriez pas compris ; car ces termes scientifiques ne réveillent pas en vous à beaucoup près autant d’idées qu’en moi, et la signification que vous leur attachez est confuse et indéterminée. Mais à mesure que je vous expliquerai les choses qu’ils expriment, cette signification deviendra et plus claire, et plus précise, et plus complète ; et quand elle sera exactement la même que celle que je leur donne, nous serons au même point ; vous saurez la science que nous étudions, autant que moi, et comme moi ; nous aurons fini. Commençons donc par dégrossir, si je puis m’exprimer ainsi ; ensuite nous perfectionnerons successivement et graduellement.
En effet mon objet est de vous faire connaître en détail ce qui se passe en vous quand vous pensez, parlez, et raisonnez : il faut donc qu’auparavant vous ayez pensé, parlé, et raisonné, sans quoi il vous serait impossible de m’entendre. Je parlerais éternellement des couleurs à un aveugle-né, et des sons à un sourd-muet de naissance, qu’ils ne sauraient jamais comprendre de quoi il s’agit. Il faut avoir éprouvé une impression quelconque, il faut la connaître déjà un peu pour pouvoir en raisonner : c’est la marche constante de l’esprit humain. Il agit d’abord, puis il réfléchit sur ce qu’il a fait ; et il apprend par-là à le faire mieux encore. Il prend une première connaissance d’une chose, ensuite il la médite ; enfin il la rectifie et la perfectionne, et de là il va plus loin.
Il m’a donc fallu commencer par vous parler de ce que vous savez déjà, de ce que vous avez déjà fait ; vous inviter à y réfléchir, et vous faire entrevoir le parti que je prétends en tirer, et le but où je veux vous conduire, sans rechercher d’abord une précision et une clarté parfaites. Je n’ignore pas que la première fois que vous lirez ces premières pages, surtout si vous les lisez seuls et sans guides, vous y trouverez des choses que vous ne comprendrez pas parfaitement : mais ce que vous en aurez saisi suffira pour ce que nous allons dire, et aura excité votre réflexion. Quand nous aurons été plus loin, vous y reviendrez : ce que nous aurons vu aura jeté un nouveau jour sur ce commencement, qui à son tour éclaircira ce que nous verrons après ; et ainsi successivement, jusqu’à ce que vos idées soient parfaitement déterminées : alors nous pourrons faire des définitions rigoureuses, ou plutôt des descriptions complètes ; car ce sont-là les vraies définitions.
Entrons donc en matière, et commençons par examiner ce que c’est que penser.
Vous pensez tous : vous le dites souvent ; aucun de vous n’en doute ; c’est pour vous une vérité d’expérience, de sentiment, de conviction intime, et je suis bien loin de la nier. Mais vous êtes-vous jamais rendu un compte un peu précis de ce que c’est que penser, de ce que vous éprouvez quand vous pensez, n’importe à quoi ? Je suis bien tenté de croire que non ; et bien des hommes meurent sans l’avoir fait, sans y avoir seulement songé. Cette insouciance si commune devrait bien nous surprendre, s’il n’était pas vrai qu’il n’y a que les choses rares qui aient le pouvoir de nous étonner. Essayons de faire ensemble cet examen que je vous soupçonne de n’avoir jamais fait.
Vous dites tous ; je pense cela, quand vous avez une opinion, quand vous formez un jugement. Effectivement, porter un jugement vrai ou faux est un acte de la pensée ; et cet acte consiste à sentir qu’il existe un rapport, une relation quelconque, entre deux choses que l’on compare. Quand je pense qu’un homme est bon, je sens que la qualité de bon convient à cet homme. Il ne s’agit pas ici de rechercher si j’ai raison ou tort, ni d’où peut venir mon erreur ; nous verrons cela ailleurs… : penser, dans ce cas, c’est donc apercevoir un rapport de convenance ou de disconvenance entre deux idées, c’est sentir un rapport.
Vous dites encore ; je pense à notre promenade d’hier, quand le souvenir de cette promenade vient vous frapper, vous affecter : penser, dans ce cas, c’est donc éprouver une impression d’une chose passée ; c’est sentir un souvenir.
Quand vous désirez, quand vous voulez quelque chose, vous ne dites pas aussi communément, je pense que j’éprouve un désir, une volonté. Effectivement, ce serait un pléonasme, une expression inutile : mais il n’en est pas moins vrai que désirer et vouloir sont des actes de cette faculté intérieure que nous appelons en général la pensée ; et que quand nous désirons ou voulons quelque chose, nous éprouvons une impression interne, que nous appelons un désir ou une volonté : ainsi penser, dans ce cas, c’est sentir un désir.
Vous vous servez encore moins de l’expression, je pense, quand vous ne faites qu’éprouver une impression actuelle et présente, qui n’est ni un souvenir d’une chose passée, ni un rapport existant entre deux idées, ni un désir de posséder ou d’éviter un objet quelconque. Quand un corps chaud vous brûle la main, vous ne dites point, je pense que je me brûle, mais je sens que je me brûle, ou mieux, encore, tout simplement je me brûle. Si vous êtes affecté par quelques douleurs internes, celles de la colique, par exemple, vous ne dites point, je pense que je souffre, mais je souffre. Cependant le dérangement mécanique qui s’opère dans votre main ou dans vos entrailles est une chose distincte et différente de la douleur que vous en ressentez ; la preuve en est que si ces organes sont paralysés ou gangrenés, ils peuvent éprouver de bien plus fortes lésions sans que vous vous en aperceviez : or cette faculté d’être affecté de plaisir ou de peine à l’occasion de ce qui arrive à nos organes, fait encore partie de ce que nous nommons la pensée ou la faculté de penser. Penser, dans ce cas, c’est donc sentir une sensation, ou tout simplement sentir.
Penser, comme vous voyez, c’est toujours sentir, et ce n’est rien que sentir. Maintenant me demanderez-vous ce que c’est que sentir ? je vous répondrai. C’est ce que vous savez, ce que vous éprouvez. Si vous ne l’éprouviez pas, ce serait bien inutilement que je m’efforcerais de vous l’expliquer : vous ne m’entendriez ni ne me comprendriez. Mais puisque vous avez la conscience de cette manière d’être, vous n’avez besoin d’aucune explication pour la connaître ; il vous suffit de votre expérience. Sentir est un phénomène de notre existence, c’est notre existence elle-même : car un être qui ne sent rien peut bien exister pour les autres êtres, s’ils le sentent ; mais il n’existe pas pour lui-même, puisqu’il ne s’en aperçoit pas.
Vous pourriez avec plus de raison me demander pourquoi, penser étant la même chose que sentir, on a fait deux mots au lieu d’un ? Je vous dirais que c’est parce que l’on a plus spécialement destiné le mot sentir à exprimer l’action de sentir les premières impressions qui nous frappent, celles que l’on nomme sensations ; et le mot penser à exprimer l’action de sentir les impressions secondaires que celles-là occasionnent, les souvenirs, les rapports, les désirs, dont elles sont l’origine. Ce partage entre ces deux mots est mal vu, sans doute ; il n’est fondé que sur les idées fausses qu’on s’était faites de la faculté de penser avant de l’avoir bien observée, et il a ensuite causé d’autres erreurs. Mais, malgré l’obscurité que ce mauvais emploi des mots répand sur notre sujet, il est clair, quand on y réfléchit, que penser c’est avoir des perceptions ou des idées ; que nos perceptions ou nos idées (je ferai toujours ces deux mots absolument synonymes) sont des choses que nous sentons, et que par conséquent penser c’est sentir. Nous avons donc actuellement une connaissance générale de ce que c’est que penser. Il nous reste à entrer dans les détails.
Encore une fois, puisque penser c’est sentir, si les mots de notre langue étaient bien faits ou bien appliqués, nous devrions appeler cette faculté sensibilité, et ses produits sensations, ou sentiments ; l’expression rappellerait la chose même : mais ne pouvant changer l’usage, nous le suivrons, et nous nommerons cette faculté la pensée, et ses produits des perceptions, ou des idées. Nous conserverons de même tous les autres termes reçus ; nous nous contenterons de bien déterminer leur signification.
On vous dira, et peut-être on vous a déjà dit que le mot idée vient d’un mot grec qui signifie image, et qu’il a été adopté parce que nos idées sont les images des choses. Ce peut bien être effectivement là la raison qui a fait créer ce mot, et qui l’a fait recevoir dans beaucoup de langues : mais cette raison n’en est pas meilleure ; car nos idées sont ce que nous sentons ; et assurément le sentiment de douleur que je sens quand je me brûle, n’est pas du tout la représentation du changement de couleur ou de figure qui arrive à mon doigt. Nous verrons cela encore mieux par la suite : mais dès ce moment gardons-nous de l’erreur commune de croire que nos idées, soient la représentation des choses qui les causent.
Quoi qu’il en soit, nous avons déjà remarqué que nous avions des idées ou perceptions de quatre espèces différentes. Je sens que je me brûle actuellement ; c’est une sensation que je sens. Je me rappelle que je me suis brûlé hier ; c’est un souvenir que je sens. Je juge que c’est un tel corps qui est cause de ma brûlure ; c’est un rapport que je sens entre ce corps et ma douleur. Je veux éloigner ce corps ; c’est un désir que je sens. Voilà quatre sentiments, ou, pour parler le langage ordinaire, quatre idées qui ont des caractères bien distincts. On appelle sensibilité la faculté de sentir des sensations ; mémoire, celle de sentir des souvenirs ; jugement, celle de sentir des rapports ; volonté, celle de sentir des désirs. Ces quatre facultés font certainement partie de celle de penser ; mais la composent-elles toute entière ? la faculté de penser n’en renferme-t-elle aucune autre ? quoique j’en sois bien convaincu, je ne me permettrai pas de vous l’affirmer encore ; c’est une question que nous traiterons par la suite. Commençons par considérer ces quatre facultés l’une après l’autre : si de cet examen il résulte qu’elles suffisent à former toutes nos idées, il sera constant qu’il n’y a rien autre chose dans la faculté de penser ; qu’elles la composent toute entière.
La sensibilité est cette faculté, ce pouvoir, cet effet de notre organisation, ou, si vous voulez, cette propriété de notre être en vertu de laquelle nous recevons des impressions de beaucoup d’espèces, et nous en avons la conscience.
Chacun de nous ne la connaît par expérience qu’en lui-même. Il la reconnaît dans ses semblables à des signes non équivoques, mais sans pouvoir jamais s’assurer au juste du degré de son intensité dans chacun d’eux : il faudrait qu’il pût sentir par les organes d’un autre. Elle se montre à nous plus ou moins clairement dans les différentes espèces d’animaux, à proportion qu’ils ont plus ou moins de moyens de l’exprimer. Elle ne se manifeste pas de même dans les végétaux ; mais aucun de nous ne pourrait affirmer qu’elle n’y existe pas, ni même dans les minéraux : personne ne peut être certain qu’une plante n’éprouve pas une vraie douleur quand la nourriture lui manque, ou quand on l’ébranche ; ni que les particules d’un acide que nous voyons toujours disposées à s’unir à celles d’un alkali, n’éprouvent pas un sentiment agréable dans cette combinaison. Je ne veux point par cette observation vous induire à supposer la sensibilité partout où elle ne paraît pas, car, en bonne philosophie, il ne faut jamais rien supposer : mais je sais que nous sommes dans une ignorance complète à cet égard. Quant aux motifs que nous aurions de former une conjecture plutôt qu’une autre sur ce point, ils ne sont pas de mon sujet ; je les passe sous silence.
Si nous ignorons l’énergie et les limites de la sensibilité dans tout ce qui n’est pas nous, du moins nous savons un peu mieux par quels organes elle agit en nous. Je n’entrerai point ici dans des détails physiologiques ; on a dû déjà vous donner une idée générale de notre organisation, et vous en ferez quelque jour-une étude plus approfondie : il me suffira de vous dire aujourd’hui que mille expériences directes prouvent que c’est principalement par les nerfs que nous sentons. Ces nerfs, dans l’homme, sont des filets d’une substance molle, à-peu-près de même nature que la pulpe cérébrale : leurs principaux troncs partent du cerveau dans lequel ils se réunissent et se confondent ; de là, par une multitude de ramifications et de subdivisions qui s’étendent à l’infini, ils se répandent dans toutes les parties de notre corps, où ils vont porter la vie et le mouvement.
Nous recevons par les extrémités de ces nerfs, qui se terminent à la surface de notre corps, des impressions de différents genres, suivant les différents organes auxquels ils aboutissent.
Ceux qui tapissent les membranes de l’œil, sont susceptibles de certains ébranlements qui nous donnent les sensations de la clarté et de l’obscurité, et de leurs différents degrés, celles des couleurs et de toutes leurs nuances : ce qui constitue le sens de la vue.
Ceux qui garnissent l’intérieur de la bouche, la langue, le palais, éprouvent aussi certains mouvements particuliers qui nous occasionnent les sensations des saveurs : ce qui constitue le sens du goût.
Il en est de même de ceux des oreilles qui nous font sentir les sons, et de ceux du nez qui font sentir les odeurs : ce qui compose les sens de l’ouïe et de l’odorat.
Remarquez que ce n’est pas sans raison que je dis que ces quatre genres de nerfs éprouvent des mouvements quelconques qui leur sont propres ; car, de quelque manière que vous excitiez ceux de l’oreille, ils ne vous donneront jamais les sensations de la vue ; ni ceux de l’œil, celles du goût ; et ainsi de suite.
Il n’en est pas de même du cinquième sens, que nous appelons le tact. Il paraît être général et commun aux nerfs de toutes les parties de la surface de notre corps ; du moins il n’en est aucune qui dans l’occasion ne nous donne plus ou moins les sensations de piqûre, de brûlure, de chaud, de froid, celles qu’excite l’approche d’un corps raboteux, ou poli, ou gluant, ou mouillé, etc… Les organes mêmes par lesquels nous recevons des sensations particulières, telles que les goûts, les sons, les saveurs, et les couleurs, sont encore capables de nous donner ces sensations plus générales, qu’on peut appeler tactiles. Il est vrai que ces sensations générales varient non seulement d’intensité, mais même de nature dans les différentes parties de notre corps. La même blessure ne nous fait pas partout le même genre de douleur ; un léger frottement ne nous donne pas partout la sensation du frissonnement ou du chatouillement ; un léger tiraillement, placé ailleurs que dans le nez, ne nous procurerait pas ce léger spasme qui précède et excite l’éternuement. On pourrait donc, si on les observait avec soin, établir des distinctions entre les sensations tactiles des diverses parties du corps, les localiser jusqu’à un certain point, et partager le sens du tact en plusieurs sens différents. Mais cela serait peu utile, et d’une exécution assez difficile, parce que ces nuances ne sont pas très tranchées, et pas exactement les mêmes dans les divers individus. Cependant cela était bon à observer pour vous faire remarquer, ce dont vous verrez de fréquentes preuves dans toutes vos études, que toutes ces classifications que font les hommes pour mettre de l’ordre dans leurs idées, sont très imparfaites ; et qu’il faut s’en servir parce qu’elles sont commodes, mais ne jamais oublier que toujours elles confondent des choses très distinctes, ou en séparent qui sont très analogues entre elles.
Quoi qu’il en soit, voilà le tableau assez complet de celles de nos sensations qu’on peut appeler externes, parce que nous les recevons des extrémités de nos nerfs qui sont à la surface de notre corps. Vous remarquerez que je n’y ai point compris les perceptions de grandeur, de distance, de figure, de forme, de résistance, de dureté, de mollesse, parce que ce ne sont pas des sensations simples, de purs effets de notre sensibilité ; ce sont des idées composées dans lesquelles il entre des jugements : c’est ce que je vous ferai reconnaître quand je vous expliquerai la génération de nos idées composées. Continuons.
Assez ordinairement, quand on rend compte des effets de la sensibilité, on se borne aux sensations externes que nous venons d’examiner ; souvent même on leur donne exclusivement le nom de sensation. Cependant la colique, la nausée, la faim, la soif, le mal d’estomac, le mal de tête, les étourdissements, les plaisirs que causent toutes les secrétions naturelles, les douleurs que produisent leurs dérangements ou leur suppression, sont bien aussi des sensations, quoiqu’elles nous viennent de l’intérieur de notre corps ; et par cette raison on peut les appeler des sensations internes. Mais à quel sens les rapporterons-nous ? Osera-t-on bien dire qu’un éblouissement appartient au sens de la vue, le mal de cœur au sens du goût, ou le mal de reins au sens du toucher ? non, sans doute. Nous en parlerons donc sans les rapporter à aucun sens, et il n’y aura pas grand mal. Que cela vous prouve seulement l’insuffisance de nos classifications. Toutefois vous voyez que tout ébranlement d’un de nos nerfs, soit qu’il soit l’effet du mouvement vital, soit qu’il soit produit par une cause étrangère, est l’occasion d’une sensation, et met en jeu notre sensibilité.
C’est pour cela que toutes les fois que nous faisons un mouvement quelconque d’un de nos membres, nous en sommes avertis, nous le sentons. C’est bien là encore une sensation. Elle n’a point de nom ; mais elle était bien essentielle à remarquer. Nous l’appellerons la sensation de mouvement.
Enfin il y a encore d’autres effets de la sensibilité, auxquels on donne communément plutôt le nom de sentiment que celui de sensation, et qui pourtant sont bien des résultats de l’état de nos nerfs, fort analogues à tous ceux dont nous venons de faire mention ; telles sont les impressions que nous éprouvons quand nous nous sentons fatigués ou dispos, engourdis ou agités, tristes ou gais. Je sais que l’on sera surpris de me voir ranger de pareils états de l’homme parmi les sensations simples, surtout les trois dernières, que l’on sera tenté de regarder plutôt comme des effets très compliqués des différentes idées qui nous occupent, et par conséquent comme des pensées, des sentiments très composés. Cependant, de même que souvent l’on se sent dans un état d’accablement et de fatigue sans avoir auparavant exécuté de grands travaux, ou que l’on éprouve un sentiment d’hilarité et de bien-être, sans un grand repos préalable ; on ne peut nier qu’il arrive aussi que très souvent nous ressentons de l’agitation, de la gaîté, ou de la tristesse, sans motif. J’en appelle à l’expérience de tous les hommes, et surtout de ceux qui sont délicats et mobiles. L’état joyeux causé par une bonne nouvelle, ou par quelques verres de vin, n’est-il pas le même ? y a-t-il de la différence entre l’agitation de la fièvre et celle de l’inquiétude ? ne confond-on pas aisément la langueur du mal d’estomac et celle de l’affliction ? Pour moi, je sais qu’il m’est arrivé souvent de ne pouvoir discerner si le sentiment pénible que j’éprouvais était l’effet des circonstances tristes dans lesquelles j’étais, ou du dérangement actuel de ma digestion. D’ailleurs, lors même que ces sentiments sont l’effet de nos pensées, ils n’en sont pas moins des affections simples, qui ne sont ni des souvenirs, ni des jugements, ni des désirs proprement dits. Ce sont donc des produits réels de la pure sensibilité, et j’ai dû en faire mention ici : en un mot, ce sont de vraies sensations internes comme les précédentes.
Il en est de même de toutes les passions, à la différence que les passions proprement dites renferment toujours un désir. Dans la haine, est le désir de faire de la peine ; dans l’amitié, le désir de faire plaisir : et ces désirs dépendent de la faculté que nous nommons volonté. Mais l’état doux ou pénible qu’éprouve l’homme qui aime ou hait un autre homme, est une véritable sensation interne. Je crois que tout ceci est entendu.
Voilà donc que nous avons passé en revue tous les effets que l’on doit attribuer à la pure sensibilité. Je crois bien que vous n’en aviez jamais fait un examen si complet et si scrupuleux ; et peut-être n’en sentez-vous pas encore beaucoup l’utilité : cependant cela doit commencer à vous faire un peu mieux démêler ce qui se passe en vous. À mesure que nous avancerons, vous verrez tout se débrouiller successivement sous vos yeux, et l’ordre succéder au chaos ; et vous y trouverez toujours plus de plaisir. Mais c’est assez parler de la sensibilité ; passons à la mémoire.





























