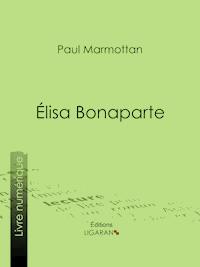
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Extrait : "D'où lui vient le prénom d'Elisa qui ne figure pas sur son acte de naissance ni sur les pièces officielles relatives à son entrée à Saint-Cyr ? — C'est un point très difficile à établir, sinon même insoluble. On a prétendu, et assez récemment encore, le baron Larrey, auteur d'un ouvrage très consciencieux sur Mme Laetitia, que Marie-Anne reçut ce nom d'Elisa « en mémoire d'une sœur décédée, baptisée avec Napoléon et morte peu de jours après »."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ce livre a trait tout entier à la jeunesse d’Élisa Bonaparte. Il raconte sa naissance et son éducation, puis (quand l’astre de son frère Napoléon commence à briller), son mariage, l’origine des Baciocchi et leurs titres de famille. Il suit aussi pas à pas la vie singulièrement mouvementée d’Élisa dans les quatre années du Consulat.
Nous étudierons un peu plus tard le rôled’Élise sous l’Empire, l’histoire de ses principautés de Lucques et de Piombino, enfin sa demi-souveraineté à Florence quand elle reçut le titre et les prérogatives de grande-duchesse de Toscane.
(1777 À JUIN 1798)
Marie-Anne Bonaparte, fille aînée de Charles de Buonaparte, née le 3 janvier 1777, est admise à Saint-Cyr en 1782. – Elle y reste de 1784 jusqu’à la suppression de cette maison royale (août 1792). – Élisa ramenée à Ajaccio par son frère Napoléon (septembre 1792). – La Corse aux Anglais. – Fuite des Bonaparte d’Ajaccio. – Leur arrivée et leur séjour à Marseille (1794 à 1796). – Lettre d’Élisa au représentant Chiappe en faveur de son frère Lucien incarcéré (1795). – Retour de la famille en Corse (1796).
Les Bonaparte appartiennent à une famille patricienne, d’origine italique, fixée en Corse depuis la première moitié du XVIe siècle. Leur noblesse indiscutable, attestée par des parchemins de sources diverses, fut reconnue par le Conseil supérieur siégeant à Bastia au nom du roi, lors de la conquête française. C’est ainsi que Charles Bonaparte, père de Napoléon, admis en 1781, au nombre des douze gentilshommes de son pays, représenta plus d’une fois la nation entière. Il avait été, notamment en janvier 1777, élu premier député de l’assemblée générale de la noblesse auprès de S.M. Louis XVI. En 1779, il reçut des lettres confirmant ses titres, ce qui permit à Napoléon d’obtenir une bourse d’élève à l’École royale et militaire de Brienne, d’où il passa dans celle de Paris, avant d’en sortir lieutenant d’artillerie en 1786.
Depuis la réunion de l’île de Corse à la France (1768) le gouvernement s’était efforcé d’attacher ces nouveaux compatriotes à la métropole et Louis XVI, dès son avènement, avait renouvelé une ordonnance de son aïeul pour l’admission dans les collèges Mazarin et de la Flèche, au séminaire d’Aix et à la maison de Saint-Cyr « des enfants des familles nobles de Corse tombées dans le besoin ». De ce nombre étaient les Bonaparte « réduits à l’indigence, dit une pétition du chef de cette famille, Charles de Buonaparte, par l’entreprise du dessèchement de salines et l’injustice des Jésuites qui lui enlevaient une succession à lui dévolue ».
Avant cette double catastrophe, il faut dire que la fortune patrimoniale des Bonaparte, si même on peut lui donner ce nom, ne comptait guère : 1 000 à 1 500 francs de revenu tout au plus, provenant d’un petit domaine que Charles faisait valoir, maigre ressource, – il est vrai un peu augmentée à défaut de numéraire suffisant, par le produit des biens en nature, fruits, victuailles et moutons, – mais que l’amélioration de la position de Charles par le mariage et la dot de sa femme, ne purent relativement pas modifier, car de nombreux enfants amenèrent de nouveaux besoins. En effet, les quelques biens que Charles tenait de son père étaient hypothéqués ; en outre, il avait été frustré des autres – ceux de son oncle maternel mort sans enfants – par les Jésuites, comme il vient d’être dit, malgré les clauses contraires formellement édictées et acceptées, au su de son père, par son oncle et ses héritiers. Les frais qu’entraînèrent le procès et les démarches qu’il dut faire à Rome, à Paris et auprès du Conseil de Corse, pour essayer de rentrer dans ses droits contre ces religieux indûment bénéficiaires, avaient augmenté sa gêne. Dès juin 1776, cette gêne est officiellement constatée, et il vit principalement de ses maigres appointements d’assesseur.
Par bonheur M. de Marbeuf, gouverneur général pour le roi de l’île de Corse, prit en affection Charles Bonaparte, et pour ses dons personnels et parce qu’il était un des premiers notables qui s’étaient déclarés partisans de la France contre Paoli. Il devint son protecteur. Grâce à ses conseils et à son appui, les demandes que Charles adressa au roi, accompagnées des pièces nécessaires, c’est-à-dire d’un certificat de l’évêque attestant l’état de pauvreté de la famille et des actes témoignant de cent quarante années de noblesse, furent agréées.
En vertu donc de la qualité reconnue aux siens, Marie-Anne Bonaparte, née à Ajaccio le 3 janvier 1777, quatrième enfant de Charles et de Lætitia, eut l’honneur d’être nommée par le roi de France élève au couvent de Saint-Cyr, fondé par Louis XIV, pour l’éducation des demoiselles. Faveur très regardée alors et accessible à celles-là seules dont l’Armorial enregistrait quatre quartiers authentiques du côté paternel. Plusieurs jeunes filles corses, de haute naissance, une Casabianca, une Varèze (de Bastia), une Cattaneo, une de Morlax, arrivaient à Saint-Cyr dans le même temps, et y furent camarades de Marie-Anne.
Ainsi entrèrent à Brienne, puis à Paris, puis à Saint-Cyr, à côté des rejetons de la plus ancienne noblesse de France, le fils et la fille de cet humble gentilhomme corse, ruiné, chargé d’enfants, réduit aux suppliques et aux démarches. Qui se fût douté alors que Napoleone ce cadet, pâle, hâve, mal vêtu, méditatif, commençait la plus étonnante carrière de l’Histoire, et qu’il serait appelé un jour à supplanter sur le trône, à force de génie et d’audace, la famille de l’infortuné et débonnaire Louis XVI, qui faisait à son père (depuis bien peu de temps Français) l’aumône de deux bourses dans ses maisons royales ! Qui eût pu prévoir, sans passer pour fou, que cet écolier à peine regardé devait, quelques années plus tard, ravir le sceptre à l’antique et illustre race de Bourbon, en France, en Italie et en Espagne, et que sa sœur, la chétive jeune fille à peine parlant français au sortir de l’île natale, occuperait à son tour, et en vertu toujours de ses succès inouïs, les palais et le rang d’une princesse du même sang royal ! – Ceci n’est pourtant pas un songe des Mille et une Nuits, mais la réalité.
Les premières années de Marie-Anne s’étaient écoulées à Ajaccio, dans la maison paternelle. Elles ressemblent à celles de tous les enfants et n’offrent rien de particulier. Avant son départ pour la France, elle était trop peu formée pour qu’on pût remarquer encore ses qualités naissantes ; elle se montrait seulement vive et enjouée et partageait les récréations de ses frères.
À son retour, au contraire, alors âgée de quinze ans révolus, elle apparut sérieuse et appliquée au travail, d’une intelligence assez éveillée vers les sujets nouveaux, et stylée avec quelque affectation, début d’habitudes de fierté, voire même d’aigreur qu’elle venait de contracter à Saint-Cyr, au milieu d’un personnel et de compagnes imbues de la morgue de l’ancienne noblesse. Les orages de la Révolution ayant atteint particulièrement sa famille et elle-même, corrigèrent bientôt cette grave imperfection, mais elle ne put jamais s’en détacher complètement, surtout avec la prospérité qui, il est vrai, dépassera pour tous les siens la mesure ordinaire. Quoi qu’il en soit, dès cette époque, octobre 1792, commença entre Lucien et elle l’étroite amitié dont témoigne une correspondance de toute la vie.
Leurs idées sociales d’alors sont, il est vrai, différentes : Lucien affiche de ce côté un tempérament singulièrement précoce et émancipé avec l’amour des libertaires à outrance. Par contre, Marie-Anne, plus guindée, plus ancien régime, a les manières et les goûts d’une aristocrate ; mais à ce frère, qui déjà a tant de ressemblance physique avec elle, elle est reconnaissante pour maints soins attentifs auxquels ni Joseph, ni Napoléon, ou généralement absents, ou plus tournés vers des frivolités enfantines qu’elle ne goûte pas, ne l’ont point habituée. Et puis, comme elle est déjà une intellectuelle en herbe, elle s’éprend des effets de rhétorique auxquels Lucien s’exerce, à ses côtés, dans la maison, en attendant de monter à la tribune des clubs. De cette époque datent leurs juvéniles sympathies et leurs affinités.
D’où lui vient le prénom d’Élisa qui ne figure pas sur son acte de naissance ni sur les pièces officielles relatives à son entrée à Saint-Cyr ? – C’est un point très difficile à établir, sinon même insoluble. On a prétendu, et assez récemment encore, le baron Larrey, auteur d’un ouvrage très consciencieux sur Mme Lætitia, que Marie-Anne reçut ce nom d’Élisa « en mémoire d’une sœur décédée, baptisée avec Napoléon et morte peu de jours après ». L’explication nous semble erronée, car l’acte de naissance de cette sœur, née en 1770 et décédée à l’âge de six mois en 1771, atteste qu’elle portait rigoureusement les mêmes prénoms que la future princesse de Lucques : « ceux de Marie-Anne ». Nous préférons adopter, en thèse générale, l’opinion suivante : en 1789, comme nous l’apprend le baron Larrey, les registres de l’état civil d’Ajaccio, qui étaient déjà mal tenus avant cette époque, furent détruits par un incendie « et rétablis ensuite sans garantie ».
Il y a dans ceux-ci, pour la seule famille Bonaparte, nombre d’autres erreurs du même genre, et souvent elles ne laissent pas d’embarrasser. Paola Maria, à sa naissance, est devenue Pauline plus tard ; Maria Nunziata s’est transformée en Caroline ; quant aux erreurs de date, elles existent aussi, notamment pour la fixation de la naissance de Mme Lætitia. Ajoutons que les trois filles de Mme Lætitia avaient toutes reçu de leur mère pour premier prénom celui de Marie, en conformité du vœu de reconnaissance envers la Vierge, qu’avait formé Mme Bonaparte, à la suite de l’heureux accouchement du 15 août 1769, jour de l’Assomption ; que les deux aînées s’appelaient ensuite Anne et Annonciade, appellations peu agréables ou démodées à tort ou à raison, et qu’en conséquence l’usage s’établit au sein de la famille – sur l’initiative présumée de Lucien « qui avait la manie de baptiser les femmes à sa guise » – de désigner l’une sous le vocable d’Élisa, l’autre sous celui de Caroline, vocables conservés par la suite et définitifs. Quoi qu’il en soit de cette induction, Marie-Anne prendra désormais le nom d’Élisa dès son départ de Saint-Cyr.
Bien que son brevet de nomination remontât au 24 novembre 1782, Marie-Anne de Buonaparte n’était entrée comme élève dans ladite maison de Saint-Louis que deux ans plus tard. Ce délai vient fort à propos : il donne le temps à son père, toujours très nécessiteux et gêné, de faire les fonds pour le voyage, ce qui ne laisse pas d’être commode. Enfin, peut-être grâce à son crédit auprès du gouverneur ou à l’offre comme garantie de l’argenterie de sa femme, il trouve 25 louis, du commandant d’Ajaccio. Ainsi muni, Charles Bonaparte et sa fille aînée, accompagnés de deux demoiselles, dont l’une était Mlle Cattaneo, également future pensionnaire de Saint-Cyr, s’embarquent en juin 1784 pour Marseille. Ils arrivent le 21 à Autun ; Lucien étudiait au petit séminaire de cette ville, et son père le retirant de cet établissement se rendit à Brienne, où il le laissa près de Napoléon, puis à Paris avec sa fille. On était à la fin de juin 1784 ; Marianne entra donc à Saint-Cyr à cette époque ; elle s’y trouvait encore le 1er septembre 1792 (an IV de la Liberté et Ier de l’Égalité). Son frère Napoléon, officier capitaine, lui servit de tuteur après la mort de son père, Charles Bonaparte, survenue à Montpellier en 1785. On avait bien désigné pour le remplacer cette même année Luciano de Bonaparte, écuyer, oncle paternel, mais outre qu’il décéda peu après, il ne put remplir sa mission par suite de l’éloignement et des difficultés de communication.
Ainsi Marie-Anne Élisa placée à Saint-Cyr dès l’âge de sept ans et demi, y demeura huit années et en sortit à l’âge de quinze ans révolus. Il fallait, d’après les règlements, avoir au moins sept ans pour être admise. Outre les premiers éléments de la grammaire, le catéchisme et les notions d’histoire sainte, les jeunes filles, entre onze et quatorze ans, étudiaient aussi la musique, l’histoire, la géographie et la mythologie.
Du temps de son séjour à Saint-Cyr, on a de Marianna, la lettre suivante à Mme Lætitia, écrite en 1786 – elle avait alors à peine dix ans. – Son ton un peu guindé montrera quel exercice les maîtresses tiraient pour leurs élèves de la correspondance avec les parents. C’est d’ailleurs la première lettre connue d’Élisa.
« MA CHÈRE MAMAN,
Je suis très inquiète de votre santé, car il y a bien longtemps que je n’ai reçu de vos nouvelles. J’ai eu cependant l’honneur de vous écrire, mais je n’ai pas eu la satisfaction de recevoir une réponse. Vous savez que je vous aime de tout mon cœur. Je vous supplie donc d’avoir la bonté de me donner bientôt de vos nouvelles. Il ne manque que cela à mon bonheur. Je me plais toujours bien à Saint-Cyr et me porte à merveille. Mes maîtresses ont mille bontés pour moi. Je tâcherai d’y répondre par ma bonne conduite. Oserais-je vous supplier de présenter mes respects à mes oncles et tantes ? Ma cousine de Casabianca serait bien fâchée que je finisse ma lettre sans la renouveler dans votre souvenir. Je l’aime de tout mon cœur. Soyez persuadée des tendres sentiments avec lesquels j’ai l’honneur d’être, ma chère maman, votre très humble et très obéissante fille et servante.
BUONAPARTE. »
« Je viens de recevoir votre lettre qui m’a fait un grand plaisir. J’ai eu l’honneur de vous écrire plusieurs fois. Je suis bien (fâchée) que mes lettres ne vous soient point parvenues.
Je vous supplie de vouloir bien me marquer, dans votre réponse, si j’ai reçu le sacrement de confirmation. »
Au nom de sa mère, Joseph, l’aîné de la jeune famille, répondait le 29 mai 1786 :
« Je profite de l’occasion que m’offre Mme de Petity, veuve de M. de Petity, lieutenant du roi et commandant de la place d’Ajaccio, pour vous donner des nouvelles de la famille, lesquelles sont aussi bonnes que vous pouvez le désirer. Nous avons reçu votre lettre et nous avons appris avec beaucoup de plaisir que vous continuez à vous plaire à Saint-Cyr.
Portez-vous toujours bien et surtout faites vos efforts pour contenter les dames qui ont tant de bontés pour vous. Ce n’est que par votre attention à remplir tous vos devoirs que vous pouvez en mériter la continuation. Soyez toujours bonne amie avec vos cousines, Mlles Colonna et de Casabianca, dont les parents sont en bonne santé. Votre oncle l’archidiacre, toujours tourmenté de sa goutte, se recommande à vos prières et maman ne cesse de mettre devant vos yeux vos devoirs de religion et l’exactitude que vous devez montrer à remplir les obligations de votre état.
Je suis avec tout l’attachement possible, ma chère sœur, votre frère aîné.
DE BUONAPARTE.
Ajaccio, 29 mai 1786. »
Dans ses années d’internat, Élise ne vit presque jamais de parents la visiter, car ceux-ci vivaient tous éloignés et les règlements de Saint-Cyr, très rigoureux, ne permettaient pas de venir voir les enfants hormis dans la huitaine des quatre fêtes du calendrier grégorien : Noël, Pâques, la Pentecôte et la Toussaint. Si son frère Napoléon put en profiter, comme on l’a dit, ce ne fut en tout cas que dans l’intervalle entre l’entrée d’Élise à Saint-Cyr (juin 1784) et sa sortie de l’École militaire de Paris (30 octobre 1785), aux jours de congé du pensionnat coïncidant avec les fêtes de ce laps de temps. Encore l’unique lettre qu’on a lue d’Élisa datée de Saint-Cyr, n’y fait-elle aucune allusion. Depuis, pendant la durée des études de Marie-Anne, Napoléon séjourne à Paris, une première fois en octobre-décembre 1787 et une seconde de mai à septembre 1792, époque où sa sœur quitta le couvent royal ; il se peut donc que l’une ou l’autre de ses visites ait eu lieu alors. Sous ces réserves, on peut accepter le dire de Mme la duchesse d’Abrantès ; mais les rares détails recueillis et publiés sur l’une de ces visites par un auteur aussi sujet à caution, intéressent plutôt le futur empereur qu’Élisa. On y relève qu’Élisa éprouvait vis-à-vis de ses compagnes, souvent mieux partagées, certaines mortifications d’amour-propre, à cause des faibles ressources dont elle disposait, conséquence de la fortune médiocre des siens. Toutefois Napoléon parut à Saint-Cyr, peut-être le 31 mai 1792, mais à coup sûr le 16 juin, accompagné probablement de son camarade de Brienne, Fauvelet de Bourrienne.
Il mandait, en effet, à Joseph, de Paris, le 18 juin 1792 : « … J’ai vu avant-hier Marianna qui se porte bien. Elle m’a prié de la faire sortir, si jamais l’on changeait leurs institutions.
Il paraît clair qu’elle n’aura pas de dot, soit qu’elle sorte actuellement, soit qu’elle reste encore quatre ans. Il en est sorti sept à huit qui avaient vingt ans et n’ont pas eu de dot.
Il paraît clair que cette maison va être ou détruite ou changera tellement de face qu’elle n’aura plus aucune similitude avec ce qu’elle est. Marianna est neuve, s’accoutumera très facilement au nouveau train de la maison. Elle n’a point de malice. Sur ce point là, elle est moins avancée que Paoletta. L’on ne pourrait pas la marier avant de la tenir six ou sept mois à la maison. Ainsi, mon cher, si actuellement que je te suppose à Ajaccio, tu crois que son mariage peut s’effectuer, tu me l’écriras et je l’amènerai. Si tu penses que cela soit plus qu’incertain, alors l’on pourrait courir le risque de la laisser, parce qu’on ne peut pas s’imaginer comment les choses tourneront. Une raison qui influe beaucoup sur moi, c’est que je sens qu’elle serait malheureuse en Corse, si elle restait dans son couvent jusqu’à vingt ans, au lieu qu’aujourd’hui elle y passerait sans s’en apercevoir. Ne perds pas un moment à m’écrire, là-dessus ce que tu en penses… ».
Il retourna à Saint-Cyr, au commencement d’août, et lia quelques relations avec les dames de la communauté, surtout avec Mme de Crécy, qui l’apprécia à cause de l’affection profonde qu’il témoignait à sa sœur. Cependant, dans une autre lettre dont on n’a pas la date, mais que Lucien vise dans sa missive à Joseph, du 24 juin, écrite d’Ucciani, cette mauvaise tête de Lucien dit : la lettre de Napoléon m’a fait beaucoup de plaisir pour Marianna « elle est, dit-il, aristocrate et j’ai dissimulé avec ces dames ». Lucien n’approuve pas cette attitude de Napoléon et part en guerre contre son caractère.
Quant à Mme de Permon (mère de Mme Junot et amie d’enfance de ses parents), qui avait épousé un futur agent de finances aux armées d’Italie, assez intrigant, comme on sait, ses visites à Saint-Cyr paraissent vraisemblables, puisqu’elle habitait Paris et aimait beaucoup les Bonaparte.
La fermeture forcée de l’établissement, que prévoyait Napoléon, interrompit, en effet, les études de Marie-Anne. En temps ordinaire, les jeunes élèves demeuraient au couvent jusqu’à vingt ans, sous la surveillance des religieuses de Saint-Augustin, ordre régulier.
À vingt ans, toute élève quittait la maison, munie d’une éducation très soignée (s’étant graduellement développée dans quatre périodes déterminées) et elle avait droit, en sortant, à une dot de 3 000 livres, avec un trousseau de 300, et à des frais de voyage. Mais la jeune pensionnaire ne put obtenir en tout que ces derniers de Saint-Cyr à Ajaccio.
Le 7 août 1792, l’Assemblée nationale avait supprimé l’aristocratique couvent. Une addition à la loi fut décrétée, le 16 du même mois. Aux termes de cette addition, le pensionnat serait évacué le 1er octobre, et les élèves recevraient 20 sous par lieue jusqu’à leur municipalité respective.
Après le 10 août, le parti girondin, qui représentait l’ordre, reprit ses positions au ministère et à la Législative. La cour tomba pourtant, mais la Montagne n’osait encore faire l’essai de ses forces. Napoléon profita du triomphe momentané de la Gironde, pour renouveler sa demande d’avancement. Il fut nommé capitaine d’artillerie à l’armée des Ardennes, dont le commandement venait d’être confié à Dumouriez (20 août). Le désir de se trouver en présence de l’ennemi lui aurait fait aisément oublier qu’il devait ramener sa sœur en Corse ; mais celle-ci, qui s’en aperçut, le lui rappelait tous les jours, le conjurait de ne pas la laisser partir seule, et en fait c’eût été bien risquer, à cette époque, de confier sans protecteur, aux voitures publiques, une jeune fille de quinze ans et demi. Les grandes routes n’étaient rien moins que sûres.
Il délibéra longtemps s’il devait accéder à ses prières ou bien suivre son penchant personnel. « J’attendrai ta réponse pour Marianne, mandait-il encore à Joseph, le 22 juin, je suis plus indécis que jamais, voilà un mois que je suis à Paris. » Enfin, les ordres de sa mère, les pleurs de sa sœur, l’emportèrent : il fit connaître sa position au ministre, qui lui permit de rentrer en Corse et d’y attendre des ordres ultérieurs.
Bonaparte, lieutenant au 4e régiment d’artillerie, mais destitué de son emploi pour avoir manqué à la revue de rigueur du mois de décembre, était alors à Paris. Il venait de se justifier d’avoir fait tirer sur le peuple le lundi de Pâques et se disposait donc à profiter de son récent congé. Il avait été réintégré et avait même reçu un grade supérieur.
Le jeune capitaine (il le fut en effet rétroactivement par faveur le 6 février), délivré de ces contretemps et l’esprit désormais libre, s’occupe alors de Marianna assez inquiète et dont il apprécie déjà les agréments et la distinction. Il écrit sa pétition le 1er septembre, veille de son départ ; sa sœur y ajoute quelques lignes ; le jour même, le maire et les officiers municipaux de Saint-Cyr vérifient les droits des réclamants, et le Directoire du district de Versailles accorde les 20 sous par lieue, soit 352 livres, pour les 352 lieues séparant Versailles d’Ajaccio. Sa démarche terminée, et sans perdre de temps, Napoléon revint dans la soirée à Saint-Cyr avec une carriole de louage. Une heure après, on le vit avec sa sœur, portant l’un et l’autre un paquet de hardes, sortir de cette maison fameuse, où il ne devait plus se montrer qu’Empereur des Français, en 1805. Le frère et la sœur, dans leur passage à Paris, habitèrent quelques jours à l’hôtel de Metz, rue du Mail, où était descendu Bonaparte dès le 20 mai précédent. Leur départ de la capitale était fixé au 9 septembre ; ils se rendirent d’abord à Lyon, d’où ils s’embarquèrent sur le Rhône. Des amies de Valence, Mlle Bon et Mme Mésangère, leur apportèrent sur le quai, pendant l’arrêt du bateau, un panier de raisins.
En passant à Marseille, où il arriva vers la mi-septembre et où il dut attendre une partance pour Ajaccio, Napoléon courut un grave danger, dont il se tira avec esprit : « Sa sœur avait un chapeau garni de plumes ; à la porte de l’auberge, elle fut remarquée par une foule de démagogues qui aussitôt se mirent à crier : "Aux aristocrates ! mort aux aristocrates ! – Pas plus aristocrates que vous, leur répondit Bonaparte avec fierté", et prenant le chapeau qui avait soulevé cette tempête, il le jeta au milieu de la foule ébahie qui changea ses vociférations en applaudissements. »
Le 24 septembre 1792, pendant qu’il était encore en Provence à attendre le moment de s’embarquer avec sa sœur, un courrier extraordinaire apporta la nouvelle que la Convention, par son décret du 21, avait aboli la royauté en France. Le lendemain, il mouillait dans le port d’Ajaccio. Paoli, à Corte, en fut aussitôt prévenu.
Quant à sa mère et aux autres enfants, ils furent au comble de la joie en voyant la jeune fille qui déjà venait d’échapper à plus d’un péril, et Mme Lætitia eût pu alors s’écrier comme Esther, dans une tragédie justement composée pour les pensionnaires de Mme de Maintenon :
Ce premier moment d’expansion passé, la triste réalité des circonstances apparut à la famille, car la gêne y était profonde. Les ressources diminuaient de jour en jour et les recouvrements se faisaient de plus en plus difficiles au milieu des discordes civiles. La seule ressource sur laquelle on pût compter paraît avoir été la solde de Bonaparte, qui reprit la direction de son bataillon de volontaires nationaux.
Le soir, alors que les plus jeunes enfants sont couchés, Lætitia se lamente sur l’avenir déplorable réservé à ses filles. Napoléon cherche à la rassurer, en lui disant qu’il ira aux Indes : « J’en reviendrai, ajoute-t-il, dans quelques années un riche nabab, et vous apporterai de bonnes dots pour mes trois sœurs. »
En tout cas, peu s’en fallut que pour Marianna le sort se décidât promptement en sa faveur, car on prétend que le contre-amiral Truguet, commandant les forces navales de la Méditerranée, ayant relâché alors à Ajaccio en décembre 1792, attendant des renforts du continent pour entreprendre une expédition en Sardaigne, frappé des moyens de la jeune fille et de son éducation, remarqua Marie-Anne et conçut pour elle quelque inclination.
Il est étonnant, si le fait est exact, que Marie-Anne ne l’ait point partagée. Un officier général, dans la passe difficile que traversait sa famille, – pouvait-elle désirer mieux ? Sans doute il y avait une grande différence d’âge (25 ans), mais Truguet était, paraît-il, beau garçon et aimable. Et il conserva longtemps encore ces qualités, car dans une lettre datée de Pontivy le 6 prairial an IX, huit ans plus tard, Bernadotte écrivait de lui à Désirée Clary sa femme, ceci : « Je dois de la reconnaissance à Truguet. Il se conduit en collègue obligeant. Général, beau garçon, aimable et célibataire, voilà bien des titres pour capter la bienveillance d’une jeune femme. »
Quelques mois après les évènements qui dans l’intérieur de l’île amenèrent le triomphe momentané de Paoli et du parti anti-français, la famille Bonaparte, compromise pour avoir pris la tête du mouvement en faveur de la République, fut déclarée suspecte et obligée de quitter le pays. Son bannissement fut prononcé par une délibération della consulta de Corté du 27 mai 1793.
Mme Bonaparte voulait résister à Ajaccio avec des partisans, mais les dangers que coururent ses enfants la forcent à s’évader. Elle sortit d’Ajaccio avec Fesch, Louis, Marie-Anne et Pauline pour se rendre à sa terre de Milleli. Ses autres enfants étaient en lieu sûr. Bientôt Mme Bonaparte dut abandonner Milleli pour le maquis afin de protéger sa vie et celle des siens menacés. Elle tenait par la main sa petite Pauline, tandis que Marie-Anne et Louis ne s’éloignaient pas de l’abbé Fesch, leur oncle. Des amis dévoués les accompagnaient. Errante plusieurs nuits, la famille arrive sur les bords du torrent le Capitello, qu’on passe à cheval ; des privations de toutes sortes rendent cette fuite fort pénible. Pendant ce temps, la maison Bonaparte, à Ajaccio, était livrée au pillage. Napoléon, de Provenzale où il était, va à la rencontre de sa mère et de ses sœurs, et les fait embarquer pour Calvi, d’où, montés sur un frêle esquif dit « chasse-marée », ils gagneront bientôt le continent.
La famille, après un arrêt à La Valette, près Toulon (juin 1793), se retrouva à Marseille dès la fin de juillet. On sait quelle vie de privations elle y mena durant plusieurs années, à peine coupées par de courts séjours à Château-Sallé, près d’Antibes, et à Nice en 1794, auprès de Napoléon, général commandant l’artillerie de l’armée d’Italie. Un document authentique connu, de la main d’Élisa, date précisément de l’une d’elles (1795). Il est très précieux par sa rareté, étant donné ce temps terrible de représailles, où elle était d’ailleurs encore si jeune, et il se rapporte à la situation malheureuse de son frère aîné Lucien. On le lira un peu plus loin.
Lucien s’était toujours montré jacobin et ami de Robespierre. Après la prise de Toulon, il fut incarcéré, car la réaction triomphait. Il venait de se marier le 4 mai 1794 à Marathon, avec Catherine Boyer, sœur de l’aubergiste du lieu.
La série des jours néfastes continuait pour la famille. Depuis juillet 1793, Mme Bonaparte et ses enfants habitaient Marseille. Joseph vivait chez les Clary. Lucien, quelques jours après l’accouchement de sa femme, avait dû quitter Saint-Maximin au plus vite. Sa position n’y était plus tenable. Grâce à Saliceti et à Turreau, on lui avait donné un petit emploi, celui d’inspecteur des charrois à Saint-Chamans, près de Cette.
Il croyait, dit Iung, trouver la tranquillité ; il devait se tromper. À la suite du licenciement de l’armée de Toulon et des évènements de floréal et de prairial, la réaction avait pris dans le Midi un caractère excessif de violence.
Dénoncé à son tour par le fils de ce Roy, qu’il avait autrefois livré, il fut arrêté, garrotté et conduit dans les prisons d’Aix, où il resta six semaines. Atterré, Lucien s’adresse à sa mère, à ses frères, à ses protecteurs, notamment au représentant Chiappe, le 3 thermidor an III (21 juillet 1795).





























