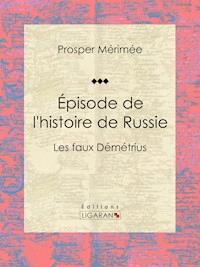
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Ivan IV, tsar et grand-duc de Russie, mourut en 1584, après un long règne. Les étrangers, ses contemporains, l'ont surnommé le Bourreau ; les Russes l'appellent encore Ivan le Terrible. Pour ses sujets seulement, il fut terrible, car ni les Polonais ni les Tartares ne le virent sur un champ de bataille. Ce n'était qu'un tyran grossier et cruel, qui se plaisait à répandre le sang de ses propres mains."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335076615
©Ligaran 2015
Ivan IV, tsar et grand-duc de Russie, mourut en 1584, après un long règne. Les étrangers, ses contemporains, l’ont surnommé le Bourreau ; les Russes l’appellent encore Ivan le Terrible. Pour ses sujets seulement, il fut terrible, car ni les Polonais ni les Tartares ne le virent sur un champ de bataille. Ce n’était qu’un tyran grossier et cruel, qui se plaisait à répandre le sang de ses propres mains. Pourtant un certain respect populaire demeure attaché à sa mémoire : sous son règne, souillé de tant de crimes, les Russes commencèrent à entrevoir leurs hautes destinées, et mesurèrent leurs forces naissantes, rassemblées et déjà organisées par son despotisme. Les peuples, comme les individus, ne conservent pas un souvenir amer des jours d’épreuve qui ont développé leur énergie et mûri leur courage.
Ivan laissait deux fils, Fëdor et Démétrius, dont le premier, âgé de vingt-deux ans, lui succéda. Le second, né en 1581, était issu d’un septième mariage d’Ivan, contracté au mépris des canons de l’église grecque, qui ne reconnaît pas d’union légitime après le quatrième veuvage. Malgré cette circonstance, le titre de tsarévitch ne fut pas contesté à Démétrius, et déjà même on le considérait comme l’héritier présomptif de la couronne, la santé débile de Fëdor faisant craindre qu’il ne mourût sans postérité.
Le caractère du nouveau tsar contrastait singulièrement avec celui de son père. Doux et timide comme un enfant, dévot jusqu’à la superstition, Fëdor passait ses journées en prières, ou bien à se faire lire et commenter de pieuses légendes. On le voyait sans cesse dans les églises, et souvent il se plaisait à sonner lui-même les cloches pour appeler les fidèles aux offices. – « C’est un sacristain, disait Ivan le Terrible, non pas un tsarévitch. » Lorsqu’il faisait trêve à ses exercices de piété, Fëdor s’enfermait avec ses bouffons, ou bien, du haut d’un balcon, il regardait ses chasseurs combattre contre des ours. Pour un esprit si faible, les soins du gouvernement étaient insupportables ; aussi s’empressât-il de les remettre à un de ses favoris, le boyard Boris Godounof, son beau-frère. D’abord il lui donna la charge de Grand Écuyer, attachant à ce titre des attributions considérables et un pouvoir immense. Bientôt après, par un aveu public de sa propre incapacité, il le nomma Régent de l’empire. Personne n’était plus propre que Boris à devenir le maire du palais de ce roi fainéant. Actif, infatigable, plus éclairé qu’aucun de ses compatriotes ; rompu aux affaires et connaissant les hommes, on lui accordait toutes les qualités d’un grand ministre. Bien qu’il fût d’une naissance médiocre, car il descendait d’un mourza tartare, il prit placé de bonne heure aux conseils de l’empire, où il gagna la faveur d’Ivan, sans l’acheter pourtant par des bassesses. On dit que lorsque, dans un accès de frénésie, Ivan frappa le tsarévitch, son fils aîné, d’un coup mortel, Boris seul osa tenter de retenir son bras et de sauver le jeune prince. Il cachait son ambition sous les dehors de la piété et d’un attachement sans bornes à la patrie et à son souverain. Naturellement grave et austère, d’une figure noble et d’une taille avantageuse, il imposait le respect aux boyards jaloux de son autorité, et lorsque le tsar se montrait au peuple accompagné de son ministre, chacun sentait que ce n’était pas sur le trône qu’il fallait chercher le maître de l’empire.
Le règne d’Ivan n’avait pu lasser la patience des Russes ni ébranler leur fidélité. Boris les soumit à une nouvelle épreuve. À la domination brutale et capricieuse d’Ivan il fit succéder un despotisme intelligent mais tracassier, qui prétendait régler l’intérieur de chaque famille aussi bien que les affaires de l’État. Rudes et grossiers encore, les Moscovites ne pouvaient sentir les avantages de l’exacte police que Boris voulait fonder dans tout l’empire. Pour eux, le désordre était comme une preuve d’indépendance qu’ils chérissaient, et dont Ivan ne les avait pas dépouillés malgré sa tyrannie. Maintenant cette licence invétérée allait être réprimée avec une rigueur inexorable. Sans doute les peuples n’eurent plus à craindre ces accès de fureur sanguinaire qui valurent à Ivan son surnom de Terrible, mais une surveillance soupçonneuse, assidue, pesa lourdement sur chaque famille. Le dernier tsar était une bête féroce, redoutable à rencontrer, mais dont on pouvait éviter l’approche, peut-être même désarmer la colère ; tandis que ni un acte, ni une pensée de désobéissance n’échappaient au Régent servi par d’innombrables espions. Grands et petits sentirent également sa main de fer. Dans son impassible sévérité, il châtiait l’ignorance comme un crime, et, pour réformer un ancien abus, il inventait cent contraintes nouvelles. Plein de confiance dans la supériorité de ses lumières, et peut-être confondant de bonne foi la grandeur de sa maison avec celle de son pays, Boris pliait tout sous sa volonté, et n’acceptait ni conseils ni remontrances. Les Russes se sentirent plus esclaves que jamais sous ce nouveau despotisme, régulier et minutieux, et parfois ils se prirent à regretter les fureurs intermittentes d’Ivan le Terrible.
Les efforts des ennemis de Boris, pour détruire son ascendant, n’aboutirent qu’à le fortifier. On voulut obliger Fëdor à répudier sa femme Irène, sœur du Régent, pour cause de stérilité, et déjà même, pour lui succéder, on désignait la sœur du prince Mstislavski, le premier boyard du conseil. Boris para le coup. Il fit intervenir l’autorité ecclésiastique toute puissante sur l’esprit de Fëdor, et lui persuada qu’il serait dangereux pour la Russie de priver Démétrius d’une couronne à laquelle il semblait prédestiné. Il lui montra dans l’avenir la guerre civile s’allumant entre ce prince et ses neveux, et les barbares profitant de l’anarchie pour dévaster l’empire. Il semble qu’à cette époque le droit de succession au trône ne fût pas encore bien nettement réglé en Russie, et l’on peut croire que l’usage musulman, qui attribue la couronne au plus proche descendant du fondateur de la dynastie, conservait de nombreux partisans dans un pays où les Tartares avaient implanté tant de traditions orientales. Quoi qu’il en soit, Fëdor ne répudia pas son épouse, et la sœur du prince Mstislavski fut contrainte de prendre le voile.
Boris voulait être craint avant tout, mais il ne dédaignait pas une certaine popularité pour sa maison, et s’appliquait avec soin à rendre sa sœur Irène chère au peuple russe. Les rigueurs s’exerçaient au nom du tsar, et par l’ordre du Régent ; les actes de clémence ; les grâces de toutes sortes étaient attribuées à l’intercession de la tsarine Irène, qui d’ailleurs fut toujours un docile instrument entré les mains de son frère. Elle n’agissait, ne pensait que d’après ses inspirations, confondant avec une grande simplicité de cœur son respect et son admiration pour Boris avec l’amour passionné qu’elle portait à Fëdor.
Les boyards intimidés étaient réduits au silence ; Démétrius, encore enfant, ne pouvait porter ombrage, mais sa mère, la tsarine douairière, Marie Fëdorovna, et ses trois oncles Michel, Grégoire et André Nagoï auraient pu chercher à se prévaloir de leur alliance avec la maison régnante. Boris les relégua dans la ville d’Ouglitch, assignée pour apanage au jeune Démétrius par le testament d’Ivan ; et sous couleur de leur confier l’éducation du tsarévitch, on les y tenait dans une espèce d’exil.
À Ouglitch, en 1591, Démétrius âgé de dix ans avait sa petite cour, ses menins et ses grands officiers, parmi lesquels le Régent entretenait sans doute plus d’un espion. Les pensions du jeune prince et celles de sa famille étaient payées et contrôlées par un secrétaire de chancellerie (diak), nommé Michel Bitiagofski, créature de Boris, et, tout naturellement, entre ce fonctionnaire et les Nagoï s’élevèrent de fréquentes discussions qui s’envenimaient de jour en jour. Fort de l’autorité dont le Régent l’avait investi, le secrétaire se plaisait à chicaner la famille du tsarévitch dans toutes ses prétentions. On eût dit qu’il prenait à tâche de lui faire sentir par de petites avanies sans cesse renouvelées l’abaissement de sa fortune depuis la mort d’Ivan le Terrible. Aux réclamations qu’on adressait au tsar, Bitiagofski répondait en dénonçant des propos imprudents échappés aux Nagoï dans leur exil. S’il fallait ajouter foi au rapport du secrétaire de chancellerie, le tsarévitch annonçait déjà les instincts féroces et les goûts cruels de son père. Il ne se plaisait, disait-on, qu’à voir battre des animaux, ou bien à les mutiler avec des raffinements de barbarie. On racontait qu’un jour d’hiver, jouant avec des enfants de son âge, il avait fait des figures d’hommes avec de la neige, dans la cour de son palais. À chacune il avait donné le nom d’un des hauts fonctionnaires de l’empire, et la plus grande, il l’avait appelée Boris. Armé d’un sabre de bois, il leur abattait les bras ou la tête. – « Quand je serai grand, disait l’enfant, voilà comme je les traiterai. » Ces anecdotes et d’autres semblables étaient recueillies avec soin et commentées à Moscou. Peut-être étaient-elles inventées par les agents de Boris, pour rendre les Nagoï odieux à la noblesse russe ; ou bien, élevé par des valets et des courtisans disgraciés, le jeune prince répétait-il trop fidèlement les leçons qu’on lui apprenait.
Les espérances et les craintes que faisait concevoir cette éducation furent promptement dissipées par la mort soudaine de Démétrius. Sa fin fut étrange, et il est difficile de savoir si elle fut le résultat d’un accident ou d’un crime. Le 15 mai 1591 (v s.), dans l’après-midi, le tsarévitch que sa mère venait de quitter pour un moment s’amusait avec quatre enfants, ses pages ou ses menins, dans la cour de son palais, vaste enclos qui renfermait plusieurs habitations séparées, bâties çà et là irrégulièrement. Auprès de lui se trouvaient encore Vassilissa Volokhof sa gouvernante, sa nourrice, et une fille de chambre. Il est vraisemblable qu’on le perdit de vue un instant. Selon le témoignage unanime des trois femmes et des pages, il tenait un couteau, qu’il s’amusait à ficher en terre, ou avec lequel il taillait un morceau de bois. Tout à coup la nourrice l’aperçut qui se débattait baigné dans son sang. Il avait une large plaie à la gorge, et il expira sans proférer une parole. Aux cris de la nourrice, la tsarine accourt, et, dans la première furie de son désespoir, s’écrie qu’on vient d’assassiner son fils. Elle se jette sur la gouvernante qui devait le surveiller, et, armée d’une bûche, la frappe à coups redoublés, l’accusant d’avoir introduit des meurtriers qui viennent d’égorger son enfant. En même temps, préoccupée sans doute de ses récents démêlés avec Bitiagofski, elle invoque contre cet homme la vengeance de ses frères et des serviteurs de sa maison. Survient Michel Nagoï, sortant de table, et dans un état d’ivresse, au dire de plusieurs témoins. À son tour, il frappe la gouvernante ; et ordonne de sonner la cloche d’alarme à l’église du Sauveur voisine du palais. En un instant l’enclos se remplit d’habitants d’Ouglitch et de domestiques, qui accourent avec des fourches et des haches, croyant que le feu est au palais du tsarévitch. Avec eux arrive Bitiagofski, accompagné de son fils et de gentilshommes attachés à la chancellerie. Il essaie de parler pour apaiser le tumulte, et d’abord s’écrie que l’enfant s’est tué lui-même en tombant sur son couteau, dans une attaque d’épilepsie, maladie dont il était notoirement atteint. – « Voilà le meurtrier ! » s’écrie la tsarine. Aussitôt cent bras se lèvent pour le frapper. Il s’enfuit dans une des maisons de l’enclos, et s’y barricade pour un moment, mais on enfonce la porte, et on le massacre. Son fils est égorgé auprès de lui. Quiconque élève la voix pour le défendre, quiconque est reconnu pour lui appartenir, est aussitôt chargé de coups et mis en pièces. La gouvernante Vassilissa, couverte de sang, à demi morte auprès de la tsarine, gisait à terre, tête nue et les cheveux épars, car les serviteurs des Nagoï lui avaient arraché son bonnet, outrage plus indigne que les coups de bâton dans les idées des Russes, à cette époque. Un serf de cette femme, touché de sa honte, ramasse le bonnet et le lui remet sur la tête ; on le massacre à l’instant. Cette foule furieuse, toujours poursuivant et frappant ceux qu’on lui désigne, porte à l’église le corps sanglant du tsarévitch. Là, on traîne Daniel Volokhof, le fils de la gouvernante, qu’on savait lié avec Bitiagofski. Il n’en fallait pas davantage pour qu’il fût déclaré son complice, et aussitôt égorgé aux yeux de sa mère, devant le corps du jeune prince. Ce fut à grand-peine que les prêtres de l’église du Sauveur arrachèrent des mains de la multitude Vassilissa et les filles de Bitiagofski. Toutes ces femmes cependant furent enfermées dans un des bâtiments dépendant de la cathédrale, et des gardes furent placés à toutes les avenues.
Une douzaine d’employés de la chancellerie du tsar, et quelques habitants d’Ouglitch, soupçonnés de connivence avec les assassins, périrent ainsi dans cette émeute soudaine, où les massacreurs tuaient au hasard tout ce qui s’offrait à leur rage. On les pourchassait comme des lièvres, dit un des témoins dans son interrogatoire. Deux jours après, la tsarine, qui venait de dénoncer les assassins prétendus, changea d’idée et s’avisa qu’une naine, qui venait quelquefois l’amuser par ses bouffonneries, avait jeté un sort au tsarévitch. Elle fit tuer cette malheureuse à coups d’arquebuse, et le corps fut jeté à l’eau sans autre forme de procès.
De leur côté, les Nagoï avaient cuvé leur vin et réfléchi, non sans terreur, aux conséquences de cette affreuse boucherie. Massacrer des secrétaires et des officiers du tsar n’était pas une action qui pût demeurer impunie sous un ministre aussi jaloux de son autorité que l’était Boris. Les cadavres des victimes de l’échauffourée avaient été jetés çà et là, sans sépulture. Michel et Grégoire Nagoï, à défaut de preuves qui constatassent le meurtre du tsarévitch, résolurent d’en inventer. Ils produisirent des couteaux, des sabres, et d’autres armes, trempés dans le sang d’une poule, qu’ils prétendirent avoir trouvés entre les mains des officiers tués par la populace d’Ouglitch, et ces armes, disaient-ils, avaient servi à frapper le jeune Démétrius. Il fut prouvé qu’un des Nagoï avait donné au bailli d’Ouglitch un poignard tartare, pour le mettre sur le cadavre de Bitiagofski ou de quelqu’un de ses compagnons, et l’on constata que ce poignard appartenait en effet à Grégoire Nagoï. Tous ces faits furent établis dans une enquête ordonnée par Boris au nom du tsar, immédiatement après l’évènement. Il avait nommé trois commissaires, dont le principal fut le prince Basile Chouiski, personnage dont le rang, la naissance, la fortune, le caractère indépendant et même un peu frondeur, garantissaient sinon un examen impartial, du moins la libre défense des accusés. Enfin, il faut ajouter que Basile Chouiski appartenait à une maison hostile à la politique de Boris, et que, soit avant, soit après l’enquête, loin d’obtenir la moindre faveur, il fut sans cesse, ainsi que toute sa famille, en butte aux soupçons du Régent, à ses persécutions même. C’est ainsi qu’il fut exilé plusieurs fois, et qu’on lui refusa toujours la permission de se marier.
Les Nagoï se défendirent fort mal. C’étaient des hommes sans énergie et sans intelligence. Aucun d’eux n’avait vu frapper le tsarévitch. Grégoire nia faiblement la tentative de corruption contre le bailli d’Ouglitch ; Michel en convint, et aucun des deux frères ne put produire un indice matériel du crime supposé de Bitiagofski. En ameutant la populace contre lui, ils avaient saisi l’occasion de se venger d’un homme avec lequel ils étaient sans cesse en discussion pour des affaires d’intérêt personnel. Il est vrai que la tsarine avait d’abord désigné Bitiagofski comme l’assassin, mais il était en ce moment loin du palais, et il n’est pas surprenant qu’une mère, dans l’emportement de sa douleur, ait prononcé son nom au hasard. En effet, bientôt après, oubliant ses soupçons contre le malheureux secrétaire de la chancellerie, elle avait tourné sa fureur contre une autre victime. Deux jours plus tard, elle ne croyait déjà plus elle-même à un assassinat, car elle accusait une pauvre femme d’avoir ensorcelé son fils. La tsarine ne fut pas interrogée par les commissaires, sans doute par respect pour la mémoire d’Ivan le Terrible, mais elle confessa spontanément son repentir. Ayant mandé auprès d’elle le métropolitain Gélase, elle avoua que la mort de Bitiagofski était un crime et un péché, et supplia le prélat d’intercéder auprès du tsar pour obtenir son pardon et celui du misérable ver de terre, son frère Michel.
À ces aveux accablants se joignirent d’autres dépositions qui semblent ridicules aujourd’hui, mais qui à cette époque devaient produire une profonde impression à la cour de Moscou. On accusa Michel Nagoï d’entretenir des sorciers pour faire des maléfices contre le tsar. Toute l’Europe était encore entichée de la croyance aux sciences occultes, et, peu d’années auparavant, les ligueurs de Paris préludaient à l’assassinat de Henri III par des conjurations magiques. En effet, un astrologue vivait dans la maison de Michel, et quel que fût l’usage qu’il fit du savoir de ce misérable, c’en était assez pour attirer l’indignation de Fëdor et celle de son ministre tout puissant.
Un jugement ne se fit pas attendre, rendu, comme il semble, avec quelque solennité, et sanctionné par l’avis d’une assemblée nombreuse de dignitaires ecclésiastiques. La tsarine douairière, obligée de prendre le voile sous le nom de Marfa, fut reléguée dans le monastère de Saint-Nicolas, près de Tcherepovets, et ses deux frères, Michel et Grégoire, furent exilés loin de la capitale. En même temps on faisait des funérailles magnifiques à Bitiagofski et à ses compagnons, et un service solennel était célébré en leur honneur. Quant aux habitants d’Ouglitch, qualifiés de rebelles, on sévit contre eux avec une rigueur approchant de la cruauté. Plus de deux cents périrent dans les supplices ; d’autres eurent la langue coupée ou furent jetés dans des cachots. Déjà la terreur en avait dispersé le plus grand nombre, et une cité autrefois florissante était devenue un désert. Le reste des malheureux habitants fut envoyé en Sibérie, province conquise et, pour ainsi parler, découverte sous le règne d’Ivan, mais encore presque inhabitée. Ils y fondèrent la ville de Pelim, une des premières colonies russes dans ces contrées sauvages. La colère du Régent s’attacha jusqu’aux objets inanimés, aux souvenirs matériels de ce forfait mystérieux. Le palais du tsarévitch fut rasé, et la cloche de l’église d’Ouglitch, qui avait ameuté ses habitants, fut exilée avec eux. Selon Karamzine, on la montrait encore, à la fin du siècle dernier, dans la capitale de la Sibérie.
Un seul homme avait un intérêt évident à la mort du tsarévitch, et cet homme était Boris. Pourtant, telle était la terreur qu’il inspirait, que son nom ne fut pas prononcé une seule fois dans l’enquête. Mais malgré sa profonde hypocrisie ; son ambition n’était depuis longtemps un secret pour personne, et peu de gens doutèrent qu’il n’eût commandé et payé l’assassinat de Démétrius. La rigueur inouïe déployée contre les habitants d’Ouglitch acheva de convaincre les plus incrédules. On se disait tout bas qu’il avait fait disparaître des témoins qu’il n’avait pu suborner, et qu’il avait détruit une ville tout entière afin d’effacer jusqu’à la trace de son forfait. Désormais le peuple moscovite ne voulut plus voir en lui qu’un meurtrier, et dans toutes les actions de sa vie qu’une suite de crimes atroces.
Malheureux celui que poursuit la haine de l’aveugle multitude ! Spécieuse ou absurde, il n’y a point d’accusation qui ne trouve créance auprès d’elle. Ingénieuse à calomnier, elle attribue aux actions les plus innocentes un but criminel ; elle transforme les accidents fortuits en combinaisons perfides ; souvent même les services rendus à la patrie passent pour des trahisons aux yeux du vulgaire. Boris en fit la triste expérience. Peu après l’horrible tragédie d’Ouglitch, un incendie dévasta plusieurs quartiers de Moscou, et réduisit à la misère un grand nombre de ses habitants. Boris fit reconstruire à ses frais des rues entières, distribua des secours aux victimes du désastre, et leur accorda des dispenses d’impôt. On accepta ses bienfaits, mais on l’accusait tout bas d’avoir allumé l’incendie pour l’attribuer aux partisans des Nagoï, et confirmer par une calomnie nouvelle le crime qu’il venait de leur imputer faussement.
La même année, Kassim Ghereï, khan de Crimée, pénétra tout à coup en Russie à la tête d’une armée formidable, et parut inopinément aux portes de Moscou. Les généraux perdaient la tête, l’armée était sans organisation, le peuple s’abandonnait à un désespoir stupide. Apathique à son ordinaire, Fëdor répondait à ceux qui venaient lui demander des ordres, « que les saints, protecteurs de la Russie, combattraient pour elle. » Dans cette extrémité, Boris seul conserva sa présence d’esprit. Quelques jours lui suffirent pour élever devant Moscou des palissades et des redoutes, derrière lesquelles il réunit des milices nombreuses et une artillerie formidable. Il ranima le courage des troupes, et par sa prodigieuse activité suppléa à toutes les ressources qui manquaient en ce moment suprême. Repoussés d’abord dans leur attaque contre ce camp improvisé, les Tartares voulurent regagner leur pays au bout de quelques jours ; mais vivement poursuivis par les Russes, leur retraite se changea bientôt en une déroute affreuse, et un tiers à peine de leur immense armée parvint à regagner la Tauride. Le pays était sauvé par Boris, mais Fëdor seul se montra reconnaissant. Le peuple accusa le Régent d’avoir appelé les Tartares, « afin, disait-il, que le danger de la patrie fit oublier la mort de Démétrius. »
L’année suivante, 1592, on annonça la grossesse inespérée de la tsarine Irène. Elle accoucha d’une fille. Aussitôt le peuple murmura que Boris avait substitué un enfant à celui que sa sœur venait de mettre au monde. Cette fille mourut au bout de quelques jours ; on dit qu’il l’avait empoisonnée. Enfin, en 1598, Fëdor, miné depuis longtemps par une maladie de langueur, s’éteignit dans les bras de sa femme et du Régent. La mort du tsar était depuis longtemps prédite par ceux qui dénonçaient Boris comme l’assassin de Démétrius. Après avoir écarté les obstacles qui l’éloignaient du trône, après avoir exterminé tous les rejetons de la famille impériale, il couronnait son œuvre en ôtant la vie au faible prince dont il avait depuis longtemps usurpé toute l’autorité. Il voulait régner. Les annalistes russes, qui sans doute ne connaissaient pas les légendes écossaises, représentent Boris comme un nouveau Macbeth poussé au crime par les prédictions de ses devins. – « Tu régneras ! » lui avaient-ils dit ; puis ils s’arrêtèrent effrayés de ce qu’ils lisaient encore dans l’avenir. Pressés de continuer, ils ajoutèrent d’une voix timide : – « Tu régneras, mais sept années seulement ! » – « Ne fût-ce que sept jours, s’écria Boris, qu’importe, pourvu que je règne ! » Les traditions populaires dans tous les pays ont la même forme poétique.
Cette légende, évidemment inventée après l’évènement, ne rend pas justice au caractère de Boris. Son ambition était démesurée, mais patiente : Son habitude était de temporiser, et les négociations de la Russie avec la Suède, la Turquie et la Pologne, sous son administration, en fournissent la preuve. Toujours il s’avançait vers son but d’un pas ferme, mais lent, attentif à ne jamais hasarder une fausse démarche. Ce but d’ailleurs, comme il est probable, ne fut pas d’abord bien distinct à ses yeux. S’il est vrai qu’il fit assassiner le jeune Démétrius, il n’en faut pas conclure que dès ce moment il prétendait au trône ; mais l’héritier présomptif, élevé par ses ennemis, sous un prince aussi faible que Fëdor, aurait pu traverser un jour ses desseins et ruiner son autorité. Maître absolu de l’esprit du tsar, à l’abri derrière ce fantôme de souverain, Boris avait trop de sens pour hâter le moment où le dernier tsar de la dynastie Varegue descendrait au tombeau. Au reste, l’évènement était prévu à l’avance, et l’on pouvait s’étonner que Fëdor, malade dès le berceau, eût vécu si longtemps. Boris s’était préparé de longue main à l’extinction de la dynastie. Tous les fonctionnaires publics étaient ses créatures ; les Strélitz, le clergé étaient pour ainsi dire dans sa main, et s’étaient habitués à le considérer comme le seul chef de l’État. Le peuple, tout en le haïssant, croyait à son habileté et à sa fortune ; et c’était une opinion établie, que l’empire ne pouvait se passer d’un génie si fécond en ressources. Enfin Fëdor lui-même le regardait comme son successeur, pour ainsi dire inévitable, et sembla le désigner comme tel à la nation. Peu de jours avant sa mort, lui présentant un coffret rempli de reliques : – « Mets tes mains sur ces saintes reliques, Régent du Peuple Orthodoxe, lui dit-il. Gouverne-le avec prudence. Tu parviendras à ce que tu désires, mais tu éprouveras que sur cette terre tout est vanité et déception. »
De même que Richard III et d’autres ambitieux, Boris fit mine de refuser la couronne lorsque déjà elle ne pouvait plus lui échapper. Dès que Fëdor eut rendu le dernier soupir, le Régent obligea les boyards du conseil et les grands officiers de l’empire à prêter le serment de fidélité à Irène, la tsarine veuve. Mais, soit par dégoût du monde, soit par un ordre secret de son mari mourant, soit enfin à l’instigation de son frère, elle annonça l’intention de se renfermer dans un cloître. Quant à Boris, il déclara hautement qu’il voulait quitter les affaires et vivre dans la retraite, bien convaincu qu’on viendrait l’en arracher. À plusieurs reprises, les grands, les députés des provinces, et le clergé, le patriarche en tête, se jetèrent à ses pieds et le supplièrent avec larmes de régner sur la Russie. C’était à qui aurait l’honneur de le persuader, ou plutôt chacun sentait déjà la nécessité de prouver son dévouement, et selon un annaliste russe, « ceux qui ne pouvaient pleurer se mouillaient les yeux de leur salive. » Le peuple même, effrayé à propos par le bruit répandu d’une invasion tartare, joignit ses instances à celles des grands pour fléchir le favori du destin. Devant lui, les mères jetaient à terre leurs enfants à la mamelle sans écouter leurs cris. Une multitude innombrable entourait le couvent où Boris s’était retiré, et répondait à chacun de ses refus par un long hurlement de désespoir. « Par « pitié, disait Boris en pleurant, » car il avait aussi ses larmes de commande ; « par pitié, ne faites pas de moi une victime du trône ! » Mais cette feinte résistance eut son terme. Il céda dès qu’il fut bien constaté qu’il était élu par le vœu de la nation. Au milieu de l’enthousiasme général, les princes Chouiski seuls avaient montré de la tiédeur, ou même quelque velléité d’opposition ; Boris ne l’oublia jamais.
Rien n’était changé en Russie que le nom du tsar. Pendant les premières années de son règne, Boris Godounof s’appliqua ; comme il l’avait fait sous Fëdor, à étendre sur toutes les provinces de son empire la vigilance d’une administration éclairée sans doute, mais dominatrice. J’aurai bientôt occasion d’examiner le caractère de son gouvernement, mais avant d’exposer quelle était à la fin du XVIe siècle la situation intérieure de la Russie, il convient, je crois, d’indiquer en peu de mots ses rapports avec les peuples ses voisins, peu avant les évènements qui font le sujet principal de mon récit. Au midi les Tartares et les Turcs, à l’occident les Polonais, au nord les Suédois, tels étaient les peuples en relations avec les Moscovites, et qu’ils pouvaient nommer leurs ennemis naturels, car, à cette époque, la guerre était l’état normal et ordinaire entre voisins. On ne faisait pas de paix, mais seulement des trêves. Ce dernier mot suffit pour marquer toute la différence entre ce temps et le nôtre.
Depuis la vigoureuse répression de l’incursion du khan de Crimée, en 1591, la puissance des Tartares était sur son déclin. Maintenant encore on pouvait appréhender de leur part des courses et des pillages désastreux, mais non plus une invasion. Ils commençaient à être tenus en bride par les colonies militaires, ou, comme on les appelait alors, les armées des Cosaques établies sur la frontière méridionale. Trop souvent ces colonies usaient de représailles contre les infidèles, et c’était pour le tsar une préoccupation constante que de contenir des milices indisciplinées, accoutumées à vivre de pillage et à ne respecter aucune autorité. Les envoyés russes auprès de la Porte Ottomane avaient d’ordinaire pour mission de désavouer les déprédations des Cosaques sur les rives de la mer Noire, d’arrêter par des menaces ou des promesses les velléités belliqueuses du khan, au besoin, de détourner ses irruptions sur les provinces polonaises. D’autres émissaires du tsar intriguaient à la cour de Perse et auprès des princes géorgiens, pour occuper le sultan et le distraire des projets de conquête qu’il pouvait entretenir.
Depuis des siècles, entre la Pologne et la Russie régnait la guerre, interrompue à peine par des trêves rares et mal observées. On se transmettait de génération en génération le souvenir de combats héroïques, de revers lamentables, de pillages continuels. C’était une lutte sans cesse renouvelée, et qui, longtemps encore, devait demeurer indécise. Au commencement du XVIIe siècle, un observateur peu attentif aurait pu facilement méconnaître les forces respectives des deux nations. La Pologne, par l’étendue de ses provinces, le développement relatif de sa civilisation et les habitudes belliqueuses de ses peuples, semblait avoir une supériorité décidée sur la Russie. Ses invasions étaient irrésistibles, ses victoires éclatantes, mais l’instabilité de son gouvernement, et surtout, il faut le dire, le caractère inconstant de la nation, lui faisaient perdre le fruit de ses exploits et rétablissaient la balance entre les deux peuples au moment où on l’aurait pu croire à jamais détruite. D’un côté, ardeur irréfléchie, de l’autre indomptable patience. Ici, le désordre institué par les lois, enraciné par la coutume ; perpétué par des mœurs guerrières ; là, l’obéissance et le respect pour l’autorité devenus un devoir religieux. Les Polonais prenaient pour roi un étranger qu’ils adoptaient, pour ainsi dire ; les Russes appelaient leur souverain leur père, et se glorifiaient d’être des fils soumis. Les deux peuples ont eu les mêmes ancêtres, mais les Polonais, en conservant leur indépendance nationale, avaient gardé la licence effrénée des anciens Slaves, tandis que les Russes, conquis par les Tartares, avaient profité des sévères leçons de l’adversité. Les hordes qui envahirent la Moscovie, avaient plié toute la nation sous un joug de fer, mais elles dédaignèrent d’exterminer ses chefs, qui leur parurent des instruments commodes pour leur empire. La servitude donna aux princes russes tous les instincts de l’esclave, la souplesse, la ruse, la patience qui ne se lasse point. Ils apprirent encore de leurs maîtres l’art de commander. Bientôt, ils chassèrent les barbares dont l’autorité tout entière passa entre leurs mains. Sous la domination musulmane, l’attachement des Russes à leur religion avait pris une force nouvelle ; c’était le lien qui avait conservé leur nationalité, et qui devait encore la défendre parmi des épreuves non moins redoutables. Dans la république de Pologne, au contraire, il n’y avait ni unité de croyance, ni même unité nationale. Dans quelques-unes de ses provinces allemandes, la religion luthérienne commençait à prévaloir. Presque toute la Lithuanie et l’Ukraine professaient la religion grecque, qui, dans le reste de la république, avait encore de nombreux adhérents. Tout au contraire, chez les Moscovites, sauf quelques peuplades sauvages, tous avaient un même culte comme ils parlaient une même langue.
Au point de vue politique, la religion des Russes leur prêtait encore une force considérable, et l’on peut reconnaître, en effet, dans l’église grecque une partie des avantages temporels et pratiques que Montesquieu a signalés dans les institutions religieuses des Romains. Importée de Constantinople en Russie, elle y conservait le caractère de son origine, et se montra toujours soumise au pouvoir séculier. Dès l’introduction du christianisme, chaque prince russe sur les domaines duquel était une éparchie, possédait ou avait assumé le droit de nommer et de destituer son évêque. Le métropolitain lui-même, bien que présenté par le patriarche de Constantinople, pouvait être refusé, ou même remplacé, par le grand-duc de Kïef. Jamais on ne vit en Russie cet antagonisme de l’église et du trône qui désola si souvent l’Europe occidentale. Il n’en fut pas de même dans la Pologne catholique. Ses rois, dans leurs démêlés avec la Russie, étaient animés autant par la ferveur religieuse que par l’ambition d’augmenter leur empire. Souvent ils proclamèrent le projet d’extirper le schisme d’Orient, et, sacrifiant leurs intérêts politiques à leur zèle de conversion, ils obligèrent les chrétiens du rite grec à se jeter dans les bras de la Russie. C’est de la sorte qu’ils s’aliénèrent les Lithuaniens et les peuples guerriers de l’Ukraine.
Presque seul parmi les rois de Pologne, Étienne Batthori ne paraît pas avoir partagé ces idées enthousiastes et chevaleresques. Son but était grand aussi, mais uniquement politique. Le premier il conçut le projet de rallier tous les peuples slaves dans une ligue commune et sous un même chef. Après d’éclatantes victoires sur les Russes, après avoir arraché la Livonie à Ivan IV et l’avoir obligé à demander une paix honteuse, il faisait dire aux ambassadeurs moscovites : « Abandonnons de vaines querelles ; nous sommes tous Slaves ; Polonais ou Russes, ne sommes-nous pas frères ? Qu’importent quelques légères différences de culte ? Pourquoi n’aurions-nous pas le même drapeau, le même chef ? Que Dieu accorde une longue vie aux deux souverains ! mais ils sont mortels… Si le roi de Pologne meurt le premier, que ses États soient réunis à ceux du tsar ; que Cracovie soit l’égale de Moscou, Vilna de Novgorod. En revanche, en cas de prédécès du tsar, engagez-vous à reconnaître Étienne pour souverain de toute la Russie. » Cette proposition singulière était présentée aux plénipotentiaires russes par un ambassadeur lithuanien, peu après la mort d’Ivan le Terrible, à une époque où Fëdor semblait pouvoir se promettre de plus longues années que Batthori, atteint déjà de la maladie à laquelle il devait succomber. Peut-être Batthori ne pensait-il pas à lui-même ; son génie était vaste, et, bien qu’il n’appartînt pas à la race slave, il avait compris ses hautes destinées. L’alliance fut rejetée par les Russes qui soupçonnèrent un piège, ou qui pensèrent que les Polonais, par la supériorité de leur civilisation, domineraient dans la fusion des deux peuples.
Cependant, après la mort d’Étienne Batthori, son plan reparut, et cette fois produit par les Russes. Fëdor fut un des candidats au trône de Pologne, lors de l’élection de 1587, et selon toute apparence il aurait été désigné par la diète, si des préoccupations religieuses ne fussent intervenues, qui dominèrent la question politique. Blessé dans sa croyance et dans son orgueil national, Fëdor rompit brusquement les négociations. Bien qu’avortées, ces tentatives prouvaient qu’en dépit de leurs vieilles querelles, les deux grands peuples slaves avaient conscience de leur commune origine. Entre eux il existait plutôt une rivalité qu’une haine nationale ; mais ils étaient trop proches voisins, et, si l’on peut ainsi parler, trop proches parents, pour que toute révolution intérieure de l’un des deux peuples n’attirât pas l’intervention de l’autre.
C’était déjà un grand succès pour Boris que d’avoir été reconnu sans contestation par le prince qui régnait alors en Pologne. Sigismond III, qui succéda à Batthori, avait été élu en 1587. Il était fils de Jean III, roi de Suède, et de Catherine Jagellon. En 1591, il hérita de la couronne de Suède. Bien que petit-fils de Gustave Wasa, qui introduisit dans ce pays la réforme de Luther, Sigismond tenait de sa mère un zèle ardent pour la religion catholique. Un historien polonais en cite cette preuve, qu’à son avènement au trône, son conseil était presque entièrement composé d’hérétiques, et qu’à sa mort il n’y en restait plus que deux seulement. Alarmés de sa ferveur convertissante, les Suédois, ses nouveaux sujets, excités d’ailleurs par Charles, duc de Sudermanie, son oncle, lui imputèrent des projets menaçants pour leur croyance. Sigismond, fier de sa double couronne, et fort de la cause qu’il défendait, ne ménagea pas les susceptibilités des Suédois, dont bientôt le mécontentement éclata en révolte ouverte. Il essaya de les réduire, mais la diète polonaise refusa assez durement de se mêler d’une querelle qui n’intéressait que son roi. Battu par le duc de Sudermanie, chef des rebelles, en 1598, il fut contraint de signer à Stonegebro une capitulation honteuse. L’année suivante, les États de Suède prononcèrent sa déchéance, offrant la couronne à son fils Vladislas, à la condition que le jeune prince serait élevé à, Stockholm et dans la religion luthérienne. Sigismond résista avec opiniâtreté à tout accommodement, et à l’aide de quelques secours qu’il obtint de la Pologne, il s’obstina à continuer la guerre.
La défaite de Sigismond en Suède coïncida avec l’extinction de la dynastie Varègue en Russie, et, bien que le prince polonais fût ambitieux, et qu’il crût avoir hérité du génie de Batthori pour la guerre en même temps que de sa couronne, il ne se sentit pas en mesure de troubler l’élection de Boris. Ce dernier profita avec habileté des fautes ou des malheurs de son voisin. Dans ses relations avec la Pologne il prit un ton plus fier, et d’abord refusa de reconnaître les droits de Sigismond au trône de Suède, mais en même temps il repoussa avec hauteur les avances du duc de Sudermanie, qui venait d’être nommé régent par les États. Fidèle à sa politique de temporisation, il évitait de rompre ouvertement avec les deux princes rivaux, mais il suivait avec joie les progrès d’une lutte qui les épuisait l’un et l’autre. Une trêve de quinze ans avait été jurée entre la Pologne et la Russie ; elle n’empêcha pas Boris de reprendre ses prétentions sur la Livonie, que le sabre de Batthori avait récemment arrachée à Ivan. Des émissaires russes inondaient cette province, en attendant que l’occasion se présentât de la reconquérir à main armée. Le tsar prodiguait l’or pour s’y faire des partisans ; il accordait des privilèges aux marchands livoniens ; il accueillait avec faveur les exilés ; en un mot, il ne négligeait rien pour accroître son autorité et se présenter comme un arbitre irrécusable entre les puissances du Nord.
Parmi les moyens qu’il employa pour atteindre ce but, il en est un qui, à mon avis, eut une influence fatale sur le sort de la Russie, mais dont il était impossible alors de prévoir les conséquences.
Outre les deux princes qui se disputaient la couronne de Suède, Sigismond et Charles, duc de Sudermanie, il y en avait un troisième, qui avait aussi des prétentions à faire valoir, plus légitimes peut-être que les deux premiers : c’était Gustave Éricsen, fils de Éric XIV, roi de Suède, et de Catherine Mansdotter, femme d’une basse naissance, mais qui pourtant avait été reconnue pour reine par la nation. Il avait un an à peine, lorsque son père, atteint d’une démence furieuse, fut déposé et enfermé dans une forteresse, où il mourut en 1577, empoisonné publiquement, et en quelque sorte avec l’autorisation solennelle des États. Cependant la couronne fut remise au frère d’Éric, Jean III, le chef principal des rebelles, qui à sa mort la transmit à son fils Sigismond, déjà roi de Pologne. Gustave partagea quelque temps la captivité de son père, après avoir été déclaré indigne du trône à cause de son origine ignoble. Échappé à la prison et probablement à la mort que lui préparait son oncle, l’usurpateur Jean III, il mena longtemps une vie errante, promenant sa misère de pays en pays, excitant partout la curiosité, plutôt que la pitié des princes du Nord, par ses infortunes et son savoir, qui passait alors pour extraordinaire. Il parlait, dit-on, avec facilité toutes les langues de l’Europe, et on le tenait pour un grand alchimiste. Tout jeune encore, on l’avait surnommé le nouveau Paracelse. Comme la plupart des adeptes des sciences occultes, il était réduit à mendier son pain auprès des rois et des grands seigneurs qu’il amusait de ses expériences, n’ayant d’ailleurs d’autre ambition que de s’illustrer par des découvertes scientifiques, et plus fier de sa renommée d’alchimiste que de son origine royale. Un agent de Boris le découvrit à Thorn en 1599, d’où il le conduisit à Moscou avec de grands honneurs. On lui fit des présents magnifiques, on lui assigna un état de maison considérable ; bref, il fut traité en prince et en prince légitime. S’il faut en croire quelques historiens, Boris lui offrit même la main de sa fille Xénia, s’il consentait à entrer dans la communion grecque. Mais il est peu vraisemblable que, voulant en faire un prétendant au trône de Suède, il lui créât un obstacle formidable par un changement de religion. Au reste, le tsar ne tarda pas à reconnaître à quel homme il avait affaire. Gustave se souciait peu d’une couronne, il était attaché à sa religion, plus encore peut-être à une maîtresse qu’il avait amenée en Russie. Cultiver les sciences en repos était son seul bonheur, son unique ambition. Les auteurs contemporains le représentent comme un homme bizarre, moitié fou, moitié philosophe, quelque chose comme le Jacques de Shakespeare. Il était impossible de le tirer de son apathie et d’en faire un prétendant. Bientôt Boris s’en dégoûta, et l’ayant relégué à Ouglitch, il cessa de s’en occuper.
J’ai cité cette anecdote, non seulement parce qu’elle montre l’ambition de Boris toujours active, bien que timide, mais encore parce que le séjour de Gustave en Russie dut frapper les imaginations et les préparer aux aventures romanesques de princes persécutés par des tyrans et miraculeusement sauvés par la Providence. Je ne sais si le nom du roi Sébastien de Portugal était alors connu en Russie, mais à la fin du XVIe siècle il y en avait en Europe plusieurs imposteurs qui prétendaient être ce prince échappé au désastre d’Alcazar-Kebir. Gustave était un prince bien légitime, et son histoire l’emportait, pour le merveilleux, sur celle des faux don Sébastien. Il parlait le russe avec facilité, et se plaisait au récit des dangers qui avaient environné son enfance. Il contait qu’on l’avait enlevé de son berceau pour le mettre dans un sac et le noyer par l’ordre de l’usurpateur ; qu’après la mort de son père Éric, des assassins, payés par son persécuteur, avaient à plusieurs reprises essayé de le faire périr. En vain l’on avait employé contre lui le fer et le poison. Dieu, disait-il, l’avait vingt fois arraché à une mort inévitable en apparence. Il racontait ses cruelles épreuves, les fortunes abjectes qui avaient été son partage, les travaux grossiers auxquels il s’était soumis pour gagner son pain et s’instruire dans les sciences. Tous ces récits, commentés et embellis en passant de bouche en bouche, parvinrent sans doute enfin à un homme dont l’audace et l’ambition n’attendaient qu’une forme pour se manifester. Le merveilleux est de tous les temps, mais chaque époque a son goût particulier : en le flattant à propos on frappe et l’on gagne la multitude. Un prince passait alors pour un être privilégié dont la destinée était régie par d’autres lois que le reste des mortels.
Les révolutions, comme les maladies, s’annoncent par un malaise vague dont on ne comprend rarement l’importance que lorsqu’on en a vu les suites. Jamais le gouvernement de Boris n’avait rencontré moins d’obstacles ; jamais l’autorité d’un tsar ne sembla plus sûrement affermie. En paix au dehors, spectateur tranquille des luttes de ses voisins, il s’appliquait à civiliser son peuple, à faire fleurir le commerce, à établir dans toutes ses provinces une police exacte. Chacun de ses actes était reçu avec soumission, exécuté avec empressement, et néanmoins une inquiétude secrète agitait tous les esprits. Le tsar ne pouvait se dissimuler l’aversion qu’il inspirait aux Russes : nobles ou serfs le détestaient également. Il voyait toutes ses intentions, tous ses décrets travestis en attentats contre les lois du pays. À cette époque d’ignorance, les Russes, même d’une classe élevée avaient pour les étrangers une espèce d’horreur superstitieuse. Ils ne faisaient aucune différence entre un étranger et un infidèle, appliquant le même nom de païen au Tchérémisse idolâtre, au Tartare musulman, à l’Allemand luthérien ou catholique. L’amour de la patrie, ou, plus exactement, du sol natal, se confondait pour eux avec leur attachement à la religion nationale. Ils disaient le peuple orthodoxe, la sainte Russie. Ailleurs que sur cette terre privilégiée on ne pouvait, croyaient-ils, faire son salut. Les premiers troubles de la Réforme en Allemagne avaient attiré en Russie un grand nombre d’aventuriers pauvres et cherchant à tirer parti de leurs connaissances. Le peuple s’apercevait bien de la supériorité de ces étrangers dans les arts et l’industrie, mais ne les en détestait que davantage. Corrompre la foi nationale et s’approprier les richesses du pays, tels étaient les reproches continuels que le vulgaire adressait aux Allemands. Boris les flattait et les attirait dans ses États, sentant qu’il avait besoin d’eux pour guider ses sujets vers une civilisation nouvelle. Les privilèges et les facilités pour le commerce qu’il accordait aux marchands livoniens et allemands servirent de prétexte à la plus terrible accusation qui puisse être portée contre un souverain, celle de trahir son pays et sa religion. Il envoya dix-huit jeunes gentilshommes étudier en Allemagne, en France et en Angleterre ; leurs familles les pleurèrent comme des victimes dévouées. En deçà, au-delà de la frontière, tout contact avec l’étranger semblait une souillure.
Des mesures fiscales, qui accompagnaient les tentatives de réforme, les rendaient encore plus odieuses. L’ivrognerie, ce vice endémique des climats rigoureux, avait été souvent combattue, et toujours sans succès, par les instructions du clergé et les décrets des tsars. Boris voulut renchérir sur les règlements de ses prédécesseurs ; mais il manqua le but, en attribuant à son gouvernement le monopole de l’eau-de-vie. On continua de s’enivrer, mais ce fut désormais dans des cabarets privilégiés. Il poursuivait la contrebande à outrance, et disait publiquement « qu’il pouvait pardonner à un voleur de grands chemins, mais jamais à un cabaretier fraudeur. » Cependant leur nombre était considérable, et quelques seigneurs n’avaient pas honte de favoriser le honteux trafic des liqueurs fortes. S’ils voyaient avec dépit tarir cette source de leurs revenus, le bas peuple maudissait le prince qui prétendait restreindre ou même lui interdire une jouissance chérie.
Je ne dois point oublier un grief bien plus considérable des Moscovites contre leur souverain. Avant le règne de Fëdor, le paysan russe ne pouvait posséder un immeuble, mais il était maître de sa personne, et lorsqu’il se mettait au service d’un gentilhomme ou d’un marchand, il ne s’engageait que pour un temps limité, libre à certaines époques fixes de rompre ce contrat et de chercher un nouveau maître. Fëdor, ou plutôt Boris, sous son nom, avait attaché les paysans à la glèbe, en leur ôtant le droit de changer de domicile. Cette grande mesure, qui d’abord passa presque inaperçue, date de 1593, et n’est aujourd’hui qu’assez imparfaitement connue dans ses détails. Il semble qu’on n’en prévît guère les conséquences, et qu’alors on ne songeât qu’à arrêter l’émigration générale vers les fertiles provinces du sud, qui menaçait de dépeupler celles du nord. Il fallait, d’ailleurs, dit-on, mettre un frein au goût du paysan russe pour la vie nomade, afin de donner aux villages une population fixe, intéressée à cultiver un territoire qu’elle ne pourrait plus quitter selon son caprice. L’évènement trompa ces calculs. Au mépris de la loi nouvelle, quantité de paysans s’enfuirent pour échapper au servage, et trouvèrent facilement un asile auprès de gentilshommes propriétaires qui manquaient de bras pour cultiver leurs domaines.





























