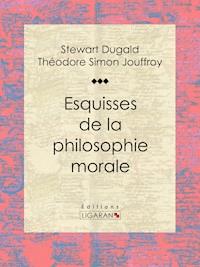
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Toutes les recherches philosophiques, quelle que soit leur nature, et toute cette connaissance pratique qui dirige notre conduite dans la vie, supposent un ordre établi dans la succession des événements. Autrement, l'observation du passé serait stérile, et nous ne pourrions rien en conclure pour l'avenir."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335038385
©Ligaran 2015
du traducteur.
L’étude exclusivement heureuse des sciences naturelles dans ces cinquante dernières années, a accrédité parmi nous l’opinion qu’il n’y a de faits réels, ou du moins qui soient susceptibles d’être constatés avec certitude, que ceux qui tombent sous les sens.
En rapprochant cette opinion du principe de Bacon, que tout ce que nous pouvons savoir de la réalité se borne à la connaissance des phénomènes par lesquels elle se manifeste à nous et aux inductions qu’il est possible d’en tirer, on arrive à cette première conséquence que la science de la réalité se réduit aux faits sensibles et aux inductions qui en dérivent, et à cette autre, que les sciences naturelles sont les seules possibles, ou du moins les seules qui soient susceptibles de certitude.
À quelques dissidences près, et qui ne sont pas de vieille date, cette doctrine est aujourd’hui universellement admise parmi ceux qui cultivent les sciences naturelles.
Ils en ont déduit deux opinions distinctes, mais également fausses sur les sciences philosophiques.
Les uns, prenant pour accordé que les questions philosophiques ne sont pas de nature à trouver leur solution dans des faits sensibles, en ont conclu, sans hésiter, quelles étaient insolubles, et, par la sublimité même de leur objet, éternellement livrées aux caprices de l’opinion. En conséquence ils ont rayé les sciences philosophiques du catalogue des sciences, et les ont méprisées et rejetées.
Les autres tirant une conséquence différente de la doctrine commune, ont essayé de résoudre les questions philosophiques par les données de l’observation sensible, ou, en d’autres termes, de construire les sciences philosophiques sur les mêmes bases que les sciences naturelles. C’est ainsi qu’entre les mains de certains hommes, les phénomènes physiologiques sont devenus le point de départ de l’idéologie, de la morale, du droit politique, de la science religieuse, et de la philosophie du beau.
Les uns et les autres ont trouvé dans leur opinion sur les sciences philosophiques, une explication du peu de progrès de ces sciences : ceux-là en niant qu’elles pussent devenir des sciences, ceux-ci en affirmant qu’on ne s’y était pas encore pris de la bonne manière pour les élever à cette dignité.
Les sciences naturelles ayant prouvé leur certitude par des résultats aussi magnifiques qu’incontestables, les savants qui les cultivent sont aujourd’hui les arbitres de l’opinion. Leurs sentiments sur les sciences philosophiques sont donc devenus populaires : en sorte que le public de notre époque pense avec eux qu’il n’y a de certain que les faits qui tombent sous les sens, et qu’il faut de deux choses l’une, ou que les questions philosophiques soient résolues par des faits de cette nature, ou qu’elles demeurent éternellement indécises.
Voilà on en est parmi nous l’opinion publique sur les sciences philosophiques. Voici maintenant ce que nous pensons.
Nous admettons pleinement avec Bacon que tout ce que nous pouvons connaître de la réalité se réduit à des faits que nous observons, et à des inductions tirées de ces faits sur la partie de la réalité qui échappe à notre observation. Nous ajouterons même, pour être plus complets, que nous tirons ces inductions au moyen d’un certain nombre de vérités ou axiomes primitifs qui nous révèlent ce que nous ne voyons pas, dans ce que nous voyons, et sans lesquels nous n’irions jamais au-delà des faits observés. Nous sommes si convaincus de la vérité de cette doctrine, que nous ne l’admettons pas parce qu’elle est de Bacon, mais uniquement parce qu’elle représente elle-même un fait incontestable de l’intelligence humaine.
Nous sommes donc d’accord sur ce premier point avec les naturalistes ; mais nous ne croyons pas, avec eux, qu’il n’y ait de faits que ceux qui tombent sous les sens. Nous croyons qu’il y a des faits d’une autre nature, qui ne sont point visibles à l’œil, point tangibles à la main, que le microscope ni le scalpel ne peuvent atteindre, si parfaits qu’on les suppose, qui échappent également au goût, à l’odorat et à l’ouïe, et qui cependant sont très observables et très susceptibles d’être constatés avec une absolue certitude.
Admettant des faits d’une autre nature que les faits sensibles, nous sommes forcés d’admettre aussi une autre observation que celle qui s’opère par les sens. Nous reconnaissons donc deux espèces d’observations comme nous reconnaissons deux espèces de faits.
Dès-lors nous ne sommes point réduits à accepter la maxime des naturalistes, qu’il n’y a de certain que les faits sensibles et les inductions qu’on en peut tirer, ni sa traduction immédiate que toute la science humaine se réduit aux faits sensibles et aux inductions qu’on en peut tirer, ni enfin sa traduction plus éloignée que les sciences naturelles sont les seules sciences possibles.
Nous ne sommes point forcés non plus de croire, avec eux, ou que les sciences philosophiques ne sont point des sciences, si elles ne peuvent avoir pour point de départ des faits sensibles, ou qu’elles ne peuvent devenir des sciences qu’en résolvant, par des faits sensibles, les questions qu’elles embrassent, c’est-à-dire en devenant aussi des sciences naturelles.
Nous croyons, il est vrai, que les sciences philosophiques ne méritent point encore le titre de sciences, parce qu’elles sont encore livrées à cet esprit de système auquel échappent à peine la plupart des sciences naturelles ; mais nous croyons qu’elles sont susceptibles de devenir des sciences, et des sciences aussi certaines que les sciences naturelles.
Nous ne pensons pas, néanmoins, que pour devenir de véritables sciences, elles doivent chercher leurs bases dans les faits sensibles ; car leurs bases ne sont pas plus dans les faits sensibles, que les bases de la chimie ne sont dans les faits astronomiques.
Les questions philosophiques ne se rapportant pas à la réalité sensible, elles ne peuvent être résolues par des faits sensibles ; mais la réalité qui tombe sous nos sens n’est pas, comme le pensent les naturalistes, toute la réalité ; il en est une autre qu’ils oublient, et à laquelle, précisément, se rapportent les questions philosophiques. Cette autre réalité n’est pas moins observable que la réalité sensible, quoiqu’elle le soit d’une autre manière ; on y découvre des faits d’une autre espèce que les faits sensibles, et dans lesquels les questions philosophiques trouvent leur solution naturelle ; et comme ces faits sont aussi certains que les faits sensibles, et que rien n’empêche d’en tirer des inductions aussi rigoureuses, les sciences philosophiques sont susceptibles d’une aussi grande certitude que les sciences naturelles.
L’erreur des naturalistes est de méconnaître cette autre réalité et cette autre série de faits, que les mains ni les yeux ne rencontrent point et ne peuvent atteindre : c’est là ce qui les rend injustes et faux, quand ils raisonnent des sciences philosophiques. L’erreur des philosophes est d’avoir négligé l’observation de ces faits, et de n’avoir pas suffisamment compris que tout ce qu’on peut apprendre de certain sur les questions philosophiques s’y trouve, et ne se trouve point ailleurs : c’est là ce qui a retenu dans le berceau et discrédité les sciences philosophiques.
Il serait donc important, pour détruire les préjugés des naturalistes et du public, contre les sciences philosophiques, de montrer qu’il y a une autre réalité et d’autres faits que la réalité et les faits sensibles ; et pour mettre enfin la philosophie et les philosophes dans les voies de la certitude et de la science, de faire voir que toutes les questions philosophiques dont la solution est possible, sont, en dernière analyse, des questions de faits comme les questions naturelles, et qui sont exclusivement, comme elles, de la compétence de l’observation et de l’induction. Le plus grand service que l’on pût rendre en France aux sciences philosophiques consisterait, selon nous, à mettre en lumière ces deux vérités.
Nous nous étions d’abord proposé de l’essayer dans cette préface. Un tel travail nous avait semblé l’introduction nécessaire de l’excellent livre dont nous offrons au public la traduction ; mais nous n’avons pas tardé à nous convaincre que le sujet était trop vaste pour un cadre si étroit. Il ne faudrait rien moins qu’un ouvrage spécial pour le traiter dans toute son étendue, et avec les développements qu’il comporte. Nous nous sommes donc décidés, quoique avec regret, à laisser entièrement de côté la seconde partie de la tâche, nous bornant, dans les observations qu’on va lire, à mettre en évidence cette vérité, méconnue par les naturalistes, qu’il y a pour l’intelligence humaine un ordre de phénomènes dont la conscience est le théâtre, qui sont tout aussi réels, tout aussi incontestables à ses yeux que les phénomènes sensibles, quoique d’une autre nature, et dont les lois peuvent être déterminées de la même manière et constatées avec la même certitude. Si ce point était une fois établi dans les esprits, on ne tarderait pas à tomber d’accord sur deux autres vérités dont nous avons été forcés de nous interdire le développement ; la première, que toutes les questions philosophiques viennent se résoudre dans l’observation de ces phénomènes méconnus, comme toutes les questions naturelles dans celle des phénomènes sensibles ; la seconde, que si depuis trois mille ans que les questions philosophiques sont débattues, il n’en est pas une encore qui soit définitivement, ou ce qui revient au même, scientifiquement résolue, c’est que les philosophes ont négligé jusqu’ici de faire des phénomènes de conscience l’objet d’une science régulière, et ne les ont guère étudiés que pour y chercher des inspirations systématiques et des fondements à leurs conceptions aventureuses.
Il est un fait peu remarqué, attendu qu’il se répète en nous continuellement, et que nous finissons par devenir insensibles aux phénomènes qui nous sont familiers, mais que personne cependant ne peut refuser de reconnaître et d’accepter, c’est que nous sommes incessamment informés de ce qui se passe au-dedans de nous, dans le sanctuaire impénétrable de nos pensées, de nos sensations, et de nos déterminations. Quoi que fasse notre intelligence, quoi qu’éprouve notre sensibilité, quoi qu’agite et résolve notre volonté, nous en sommes instruits à l’instant même, nous en avons conscience. Rien, dans l’état de veille, ne paraît pouvoir suspendre ni interrompre cette conscience de ce qui se passe en nous. Ainsi, au moment même où mon attention paraît le plus complètement plongée dans la contemplation d’une chose extérieure, au moment où mon intelligence, frappée du souvenir de quelque aventure passée, paraît le plus exclusivement occupée à faire revivre en elle les circonstances effacées de cet évènement, dans ces instants de préoccupation profonde où l’esprit, absorbé par un seul objet, devient étranger et comme insensible à tout le reste, encore garde-t-il assez de liberté pour s’apercevoir de ce qu’il fait, pour remarquer ce qu’il éprouve. Ce qui nous entoure, ce qui assiège nos sens, il ne le voit plus, il ne l’entend plus, il a perdu le sentiment de toutes choses ; mais il a conservé la conscience de ce qui se passe en lui ; la preuve en est que si vous me demandez brusquement de quoi je m’occupe et ce que j’éprouve, je vous le dirai, je pourrai vous le décrire. Faites la même question à qui vous voudrez dans un moment quelconque, vous obtiendrez toujours et sur-le-champ une réponse précise. Cette vue de ce qui arrive en nous est donc continuelle. Il est douteux que le sommeil le plus profond la suspende ; car toutes les fois que l’on nous éveille subitement nous sentons qu’on vient d’interrompre en nous une suite de pensées. Il n’est pas même prouvé qu’elle périsse dans l’évanouissement. Les cas nombreux où il est démontré que nous avons rêvé, bien que nous n’en gardions aucun souvenir, font assez voir que nous pouvons penser, sentir, désirer, vouloir, et en avoir conscience dans le moment, sans qu’il en reste aucune trace dans la mémoire.
Il est presque inutile de faire observer que cette perception continue de notre état intérieur n’est point l’œuvre des sens ; c’est une chose assez évidente d’elle-même, et que tout le monde reconnaît aisément Mais ce qu’il est important de remarquer, c’est que de toutes les convictions possibles, il n’en est point de plus forte, de plus complète que celle qui s’attache à cette information. Ce qu’il y aurait de plus absurde au monde ce serait de contester à un homme qu’il souffre quand il sent qu’il souffre, qu’il désire telle chose quand il sent qu’il la désire, qu’il est occupé de telle pensée, qu’il se souvient de telle personne, qu’il prend telle résolution, quand il a conscience en lui de tous ces faits. Tout ce que nous témoigne cette vue intérieure nous paraît d’une incontestable certitude. Les choses que voient nos yeux, que touchent nos mains, ne nous semblent pas d’une réalité plus assurée que les faits dont nous avons conscience. Nous ne chercherons pas, comme on l’a tenté plusieurs fois, à élever l’autorité du sens intime au-dessus de celle des sens ; mais nous poserons au moins comme un fait hors de doute et que personne ne contestera, l’égale autorité de ces deux perceptions.
Il y a, du reste, une raison bien simple à cette égalité. Quelque idée qu’on se forme du principe intelligent dans la constitution humaine, nul ne peut disconvenir qu’il ne soit un de sa nature ; car, par quelque voie que lui viennent les idées et de quelque espèce qu’elles soient, il les compare, il les distingue, il les associe, il les classe ; en un mot, il les travaille de manière à prouver qu’elles sont réunies, embrassées, possédées par un même pouvoir. Nous sentons d’ailleurs très distinctement en nous qu’il n’y a pas une intelligence pour percevoir les choses extérieures, une autre pour sentir les phénomènes intérieurs, une autre pour rappeler les choses passées, une autre pour réfléchir, comparer et raisonner. Nous sentons, au contraire, que c’est le même principe qui réunit toutes ces attributions ; c’est une des données les plus distinctes de notre conscience. Si donc c’est le même principe intelligent qui voit par les yeux, qui perçoit par le tact et les autres sens, ce qui se passe hors de nous, et qui sent par la conscience ce qui se passe au-dedans de nous, il n’est pas étonnant que nous ayons au témoignage de notre conscience et à celui de nos sens une confiance égale ; car, si notre intelligence se fie à elle-même quand elle regarde au dehors, pourquoi ne s’y fierait-elle pas quand elle regarde au-dedans, et comment, restant la même et voyant également dans les deux cas, pourrait-elle inégalement croire à la réalité des phénomènes qu’elle découvre ? Elle peut remarquer que les organes des sens l’induisent quelquefois en erreur, et que les yeux, par exemple, soumis à certaines lois physiques, lui font voir rond, dans quelques cas, ce qui est réellement carré. Mais une fois prévenue de ces causes d’erreur qui ne viennent pas d’elle, mais de son instrument, et ses précautions prises contre leur influence, il n’y a plus de raisons pour quelle croie moins à ce qu’elle voit qu’à ce qu’elle sent, ni moins à ce qu’elle sent qu’à ce qu’elle voit. Ce n’est donc pas seulement un fait, mais une nécessité très facile à comprendre, que les informations des sens et celles de la conscience aient, à nos yeux, la même certitude.
Le fait que nous venons de constater nous révèle une vérité importante, c’est que notre intelligence a deux vues distinctes ; lune sur le dehors par l’intermédiaire des sens, l’autre sur elle-même et les faits qui se passent dans le for intérieur, sans aucun intermédiaire. La première de ces deux vues est l’observation sensible ; la seconde est l’observation interne, qu’on appelle aussi conscience ou sens intime. Il y a donc deux observations bien distinctes, également réelles, et d’une égale autorité. Ce que nous affirmons ici n’est pas un système, ce sont des faits aussi certains, aussi palpables qu’il y en ait ; et parce que les naturalistes n’ont aperçu que l’observation sensible et n’ont pas remarqué l’autre, celle-ci n’en existe pas moins, n’en agit pas moins en eux comme dans le reste des hommes, et n’en doit pas moins être reconnue comme un fait incontestable de la nature humaine.
Ces deux vues ou ces deux observations ont chacune leur sphère spéciale et distincte ; en sorte que les sens ne peuvent pénétrer dans la sphère de la conscience ni la conscience dans la sphère des sens. Ce fait est remarquable, et mérite qu’on s’y arrête. Rien de ce que nous sentons au-dedans de nous n’est perceptible pour les sens ; rien de ce que les sens peuvent saisir n’est perceptible à la conscience. Le phénomène de la sensation en offre un exemple bien frappant. Il se compose de deux parties distinctes : une impression matérielle est produite sur l’un de nos organes par une cause quelconque ; cette impression est transmise au cerveau par le moyen des nerfs, et il en résulte en nous tantôt un sentiment douloureux ou agréable, tantôt un sentiment et une idée. La nécessité de l’action d’une cause extérieure sur l’organe, et de la transmission de cette action au cerveau, par l’intermédiaire des nerfs, pour que le sentiment et l’idée soient produits en nous, est une donnée de l’observation sensible ; mais toute l’attention possible, aidée des meilleurs instruments, ne pourrait lui révéler ni le sentiment, ni l’idée ; ces faits échappent aux sens. D’un autre côté la conscience sent parfaitement le plaisir ou la douleur, perçoit très bien l’idée, mais elle ne reçoit aucune notion ni de l’organe, ni du nerf, ni de l’impression faite sur l’un, ni de la transmission opérée par l’autre. Jamais, sans les informations de l’observation sensible, nous n’aurions appris que la sensation et l’idée ont précédées, dans le corps, de pareilles circonstances. Il en est de même du phénomène du mouvement volontaire ; nous avons conscience de notre détermination, mais nous n’avons pas conscience de la contraction musculaire qui opère ce mouvement ni du mouvement lui-même. Car ce qu’on appelle le sentiment de l’effort n’est autre chose que la conscience de la sensation plus ou moins douloureuse que la contraction musculaire nous cause, et point du tout la perception de cette contraction. Tout ce qu’il y a de physique dans la production du mouvement et le mouvement lui-même, ne nous est révélé que par l’observation sensible qui, son tour, ne peut en aucune façon percevoir le phénomène de la détermination volontaire. Ainsi, pour connaître complètement le phénomène de la sensation ou celui du mouvement volontaire, il faut consulter et l’observation interne et l’observation sensible : une seule n’y suffit pas. C’est cette impuissance qui a forcé les physiologistes, comme nous le verrons bientôt, à reconnaître des faits de conscience. On voit par là combien il est impossible et par conséquent absurde, de prétendre faire la science de l’homme, soit comme les philosophes le veulent avec la seule conscience, soit comme les naturalistes le prétendent avec la seule observation sensible. Mais revenons à notre sujet.
Cette incapacité de la conscience à percevoir les phénomènes sensibles, et de l’observation sensible à percevoir les phénomènes de conscience, est un fait trop remarquable pour qu’on n’en cherche pas la raison. D’abord on conçoit très bien pourquoi les sens ne perçoivent pas les phénomènes intérieurs, et pourquoi la conscience ne perçoit pas les phénomènes du monde extérieur. Le monde extérieur n’étant pas en nous, il est impossible que nous l’y sentions ; et les faits intérieurs n’étant pas placés en dehors de nos sens, il est impossible que nous les voyons et les touchions. Mais cette explication n’atteint pas le fond de la difficulté ; car d’où vient d’une part que nous avons le sentiment de la détermination volontaire, et que nous n’avons pas celui de la contraction musculaire ; et d’où vient de l’autre que le physiologiste avec son microscope et son scalpel découvre la contraction musculaire, et ne saurait par aucun moyen apercevoir la détermination volontaire ? Pour résoudre cette double question, il faut en premier lieu se faire une idée juste de la conscience. Qu’est-ce que la conscience ? C’est le sentiment que le principe intelligent a de lui-même. Ce principe se sent, et parce qu’il se sent, il a conscience de tous les changements de toutes les modifications qu’il subit. Les seuls phénomènes dont il puisse avoir conscience sont donc ceux qui se produisent en lui. Ceux qui se produisent hors de lui, il peut les voir, il ne saurait les sentir, il ne saurait en avoir conscience. Il peut donc avoir conscience de ses sensations, parce que c’est lui qui jouit et qui souffre ; de ses pensées, de ses déterminations, parce que c’est lui qui pense et qui veut ; mais il ne peut avoir conscience de la contraction musculaire, de la digestion, de la circulation du sang, parce que c’est le muscle qui se contracte, l’estomac qui digère, le sang qui circule et non pas lui. Ces phénomènes sont donc exactement pour lui dans la même condition que les phénomènes de la nature extérieure ; ils se produisent hors de lui, il ne saurait en avoir conscience. Telle est la vraie raison de l’incapacité de la conscience à saisir une foule de phénomènes qui se passent dans le corps, mais qui pour cela n’en sont pas moins extérieurs au principe intelligent, au moi véritable. D’un autre côté, les phénomènes de conscience n’étant que les modifications intimes du principe intelligent, lui seul peut les percevoir parce que lui seul les éprouve, et que pour les percevoir il faut les sentir : à ce premier titre, les phénomènes de conscience échappent nécessairement à toute observation extérieure. Mais ils en ont encore un autre pour échapper à l’observation sensible. Si l’on veut y réfléchir, on s’apercevra qu’il y a une différence absolue de nature entre la volonté et tous les phénomènes de conscience d’une part, et la contraction musculaire et tous les phénomènes qui tombent sous les sens de l’autre. Les choses et les phénomènes sensibles se manifestent par des apparences qui offrent prise aux sens : ce sont des couleurs, des odeurs, des formes, des résistances, des mouvements ou déplacements dans l’espace, toutes choses que nos sens ont été organisés pour saisir. Les faits de conscience n’ont aucun de ces attributs. Ainsi, quand bien même ces phénomènes ne seraient pas des modifications si intimes que le sujet seul qui les subit peut en avoir connaissance ; quand bien même ils se produiraient au dehors et arriveraient à la portée des sens, ils échapperaient encore à l’observation sensible par leur nature. Il est donc doublement impossible que les physiologistes, dans leurs recherches sur les phénomènes de la vie, pénètrent jamais jusqu’aux faits de conscience. Les sens ne peuvent pas plus pénétrer dans la sphère de la conscience que la conscience dans celle des sens.
Les différences essentielles que nous venons de signaler entre les faits de conscience et les faits sensibles n’affectent nullement régale réalité et l’égale évidence de ces deux espèces de faits ; et quoique l’intelligence atteigne ceux-ci par l’intermédiaire des sens et ceux-là sans cet intermédiaire, on ne voit pas que l’observation des faits de conscience soit plus difficile ni soumise à d’autres lois que celles des faits sensibles.
Les choses extérieures frappent également les sens d’un paysan et ceux d’un naturaliste ; mais ce qui distingue le naturaliste du paysan, c’est que le premier fait attention aux choses, tandis que le second les voit sans les regarder, ou ne les regarde pas assez pour démêler tous leurs éléments. C’est donc par l’attention, et une attention persévérante et soutenue, que le naturaliste dépasse la connaissance vague et imparfaite que le commun des hommes a des choses extérieures, et parvient à une connaissance plus distincte et plus complète de leur nature. Il en est absolument de même des phénomènes intérieurs. Tout homme est perpétuellement informé de l’existence en lui d’une foule de sensations, de désirs, d’opérations intellectuelles, de déterminations volontaires qui s’y succèdent sans interruption. Aussi tout homme a une idée confuse de chacun de ces faits de conscience ; il n’ignore pas ce que c’est que sentir, désirer, délibérer, vouloir, aimer, haïr, admirer, mépriser, connaître, comprendre ; se souvenir, croire. Il a des mots pour désigner tous ces faits ; il les distingue, il en parle ; et même, quand l’occasion se présente, il en dispute. Et cependant il n’a pas plus une idée précise et complète de ces phénomènes, quoiqu’il les ait mille fois éprouvés, que le bourgeois de Paris du phénomène de la combustion, quoiqu’il ait mille fois vu s’enflammer la mèche de sa bougie, et se réduire en cendre le bois de son foyer. Et pourquoi ? c’est qu’il n’a pas fait attention à ces phénomènes intérieurs. Pour arriver à une connaissance nette et étendue de ces phénomènes, il ne faut donc pas se contenter du sentiment involontaire que nous en avons lorsqu’ils se passent en nous ; il faut, lorsqu’ils se produisent, y attacher notre attention, ou en d’autres termes les observer. On voit donc qu’il en est des faits de conscience comme des faits sensibles. Ils se manifestent d’eux-mêmes, et également à l’intelligence de tous les hommes, qui en acquièrent ainsi involontairement une idée confuse ; mais cette notion il est point scientifique parce qu’elle n’est ni précise ni complète ; c’est par la considération attentive et volontaire des phénomènes, que l’observateur peut élever cette idée vague et inachevée à la distinction et à l’exactitude d’une connaissance scientifique.
Or, il est un tait bien certain et dont il faut convenir parce qu’il est réel ; c’est que notre attention se dirige beaucoup plus volontiers sur les choses extérieures que sur les phénomènes qui se passent en nous. Est-ce tout simplement habitude, ou la nature s’en mêle-t-elle ? c’est une question sur laquelle nous concevons facilement qu’on puisse être d’opinions différentes. Car si l’on considère quelle multitude de besoins attirent au dehors l’attention de l’enfant, et y retiennent celle de l’homme ; quelle variété d’objets les relations sociales et l’inépuisable étendue de la nature y présentent à sa curiosité et à ses passions, on sera forcé de convenir que quand bien même nous n’aurions point de penchant naturel à porter notre attention au dehors plutôt qu’au-dedans, les circonstances de notre condition auraient suffi pour imprimer cette direction et donner ce pli à notre intelligence. Et d’un autre côté cependant, soit que la puissance de l’habitude nous fasse illusion, soit que réellement l’instinct de notre intelligence la porte plus naturellement à regarder au dehors qu’à se replier sur elle-même, il serait difficile à un homme de bonne foi de rejeter absolument la possibilité d’une inclination primitive. Quoi qu’il en soit, le fait du penchant actuel de l’attention vers les choses extérieures est incontestable ; et certainement, c’est à ce penchant et à la nécessité de pourvoir avant tout à la conservation de notre vie, et aux besoins nombreux de notre corps, qu’on doit attribuer l’avance que les sciences naturelles ont prise sur les sciences philosophiques dans la carrière du développement intellectuel de l’humanité.
Mais cette habitude ou ce penchant qui porte notre attention au dehors, s’il explique l’espèce d’oubli dans lequel on a laissé jusqu’ici les faits de conscience, ne prouve rien contre la possibilité de les observer. Bien que dans l’état actuel notre attention se dirige habituellement vers les choses extérieures, une foule de faits concourent à démontrer qu’elle conserve la faculté de se replier sur les phénomènes intérieurs, et que sa direction habituelle n’est point une direction nécessaire. Sans parler des hommes célèbres qui, dans tous les temps, ont possédé à un degré éminent la faculté de considérer et de discerner les phénomènes intérieurs, l’expérience démontre que toutes les circonstances qui peuvent diminuer l’attraction qu’exercent sur notre intelligence les choses extérieures, et toutes celles qui peuvent réveiller son intérêt ou sa curiosité pour les phénomènes intérieurs, la détournent plus ou moins, et sans effort, de ses voies accoutumées. C’est ainsi, d’une part, que le silence qui laisse en repos notre oreille, que l’obscurité qui nous débarrasse des perceptions de la vue, que la solitude qui nous sépare du mouvement et des intérêts de la vie sociale, nous ramènent naturellement au sentiment de ce qui se passe en nous. Un tempérament froid, lourd, et peu sensible aux impressions extérieures, produit souvent le même effet chez les personnes qui en sont douées. Une nature triste et monotone, repoussant pour ainsi dire l’épanchement de l’intelligence au dehors, est une autre circonstance qui porte à la réflexion ; et, pour le dire en passant, si les peuples du Nord ont plus d’inclination et de capacité pour les études métaphysiques que ceux du Midi ; si dans la poésie des uns les phénomènes de l’âme jouent un plus grand rôle, et ceux de la nature dans celle de l’autre, c’est à ces deux dernières causes réunies qu’il faut l’attribuer. D’un autre côté, la pénétration qu’acquièrent tout à coup, en matière d’observation intérieure, les personnes les moins réfléchies quand les faits de conscience prennent accidentellement en elles une grande véhémence ou qu’un puissant intérêt les engage à les étudier ; la propriété qu’ont les amants, par exemple, d’analyser avec une subtilité profonde et de décrire à leurs maîtresses avec une fidélité prodigieuse les sentiments qui les agitent ; la perspicacité avec laquelle un homme, qui a peur de contracter une maladie, distingue dans certaines parties de son corps d’imperceptibles sensations qui s’y produisent habituellement, mais auxquelles jusque-là il n’avait jamais fait attention, et mille autres faits de cette nature, sont des preuves non moins convaincantes, que si la connaissance des faits internes est si peu avancée, c’est moins le pouvoir de les observer qui a manqué, que l’idée d’en faire l’objet d’une étude méthodique et le sujet d’une science régulière.
Tout homme est apte à vérifier sur lui-même la justesse de cette assertion. Il n’est personne, en effet, qui ne puisse, pour peu qu’il le veuille, remarquer ce qu’il sent en lui-même et acquérir une idée plus précise, qu’il ne l’avait auparavant, des différentes opérations de son intelligence, des différents mouvements de sa sensibilité et des autres phénomènes habituels de sa conscience. C’est là un commencement d’observation interne. Quand il arrivera à quelqu’un de faire de pareilles remarques sur soi-même, il s’apercevra qu’il ne fait plus attention aux choses extérieures, que ses sens deviennent muets et ne l’informent plus, que d’une manière très vague, des phénomènes qui les frappent. Bientôt, sans doute, l’intelligence encore rebelle à cet exercice nouveau, se fatiguera, se laissera distraire, et reprendra sa direction accoutumée. Mais de nouveaux essais la façonneront peu à peu à cette contemplation réfléchie ; la durée de ses observations se prolongera ; elle deviendra moins susceptible aux distractions extérieures ; les faits de conscience qu’elle n’avait d’abord qu’obscurément sentis dans leur passage rapide, se laisseront plus distinctement apprécier ; elle y discernera des circonstances qu’elle n’y avait d’abord pas aperçues ; ce qui lui avait paru simple se décomposera ; ce qui lui avait paru semblable se distinguera ; un grand nombre de faits qu’elle n’avait jamais soupçonnés se révéleront à elle ; en un mot, si la personne qui fera sur elle-même ces tentatives est douée de quelques dispositions naturelles pour l’observation et d’un peu de persévérance, elle acquerra, en moins de temps qu’on ne l’imagine, une puissance prodigieuse d’attention intérieure, et verra s’ouvrir dans ce monde ignoré, où la conscience du commun ne discerne que quelques masses de phénomènes indistincts, des perspectives immenses, peuplées de faits sans nombre, dans lesquels viennent naturellement se résoudre les plus hautes questions que l’esprit humain puisse agiter.
Mais il faut en convenir, bien que tous les hommes soient plus ou moins capables de cette investigation intérieure, et puissent y trouver de l’instruction et du plaisir, elle ne produira des résultats vraiment scientifiques qu’autant quelle sera maniée par des hommes familiarisés avec les procédés, les méthodes et la rigueur des sciences d’observation. Des observateurs comme Vauvenargue ou La Bruyère n’y suffiraient point. En effet, il ne s’agit pas de démêler comment la nature se comporte, et quelles formes elle, prend dans un cas particulier. Ce n’est là que son allure du moment, qui, étant variable selon les circonstances, n’est point du ressort de la science. Ce qu’il s’agit de découvrir, c’est ce qu’il y a de constant, de régulier, d’invariable dans ses opérations ; et, pour le découvrir, ce n’est point assez de la surprendre, il faut savoir l’interroger. Il faut, si l’on peut s’exprimer ainsi, la mettre à l’épreuve dans des cas différents, lui faire répéter une opération sous des influences diverses, afin de distinguer les circonstances variables qui appartiennent au lieu, au temps, à l’éducation, à mille causes accidentelles et qu’il faut abandonner au peintre de mœurs, et les circonstances constantes qui appartiennent à la nature humaine et qui doivent trouver place dans la science ; en un mot, pour faire la science des faits internes, il faut savoir d’abord expérimenter. Mais ce n’est point là tout : la plupart des philosophes savaient expérimenter, et ne cherchaient dans l’étude de l’homme que les formes immuables de sa nature ; Descartes, Leibnitz, Locke, ne considéraient point la scène intérieure sous le point de vue de La Bruyère ; et cependant ils n’ont point fondé la science des faits internes. C’est qu’il ne suffit pas de savoir observer, il faut encore avoir le courage de ne voir dans les faits constatés que ce qui y est, de n’en tirer que les inductions qui en sortent rigoureusement ; il ne faut pas avoir en tête une foule de questions qu’on ait hâte de moudre et qu’on désire résoudre d’une certaine manière ; il ne faut pas, pour satisfaire son impatience ou justifier son opinion, extorquer aux faits, à force de subtilité et d’imagination, les solutions que l’on veut, et qu’ils ne rendent pas ; il ne faut pas, en un mot, observer au profit de l’esprit de système et mêler la poésie à la science. Il faudrait être assez sage pour comprendre que le meilleur moyen de résoudre des questions de faits d’une manière solide, est d’oublier ces questions dans l’observation des faits, afin de pouvoir constater ceux-ci d’une manière impartiale, d’une manière complète ; il faudrait comprendre aussi que le champ des faits est immense, qu’il faut long temps pour l’explorer, et que néanmoins la plus petite circonstance négligée suffit pour fausser la solution d’une question. Peut-être alors consentirait-on à laisser de côté pour quelque temps les questions ; peut-être se résignerait-on à borner pendant longtemps des efforts à reconnaître les faits qui doivent un jour les résoudre ; peut-être, au moins, se contenterait-on de ne tirer des faits constatés que des solutions provisoires, qui seraient réformées à mesure que des faits nouveaux viendraient prouver leur insuffisance ou leur inexactitude. Voilà les principes qui ont manqué aux philosophes, et dont ceux qui voudront entreprendre la science toujours ajournée des faits internes, devront se pénétrer. Tant que ces maximes sévères, tant que ces habitudes circonspectes qui se sont enfin enracinées dans l’esprit des naturalistes, et qui ont conduit les sciences qu’ils cultivent à des résultats si positifs et si incontestables, n’auront point pénétré dans l’esprit des philosophes, la science des faits internes ne sortira point du berceau, et les questions qui s’y rattachent demeureront livrées aux caprices de l’opinion.
Mais en abordant avec cet esprit l’étude des faits internes, on se convaincra bientôt que tout ce qui a été tenté et consommé sur les faits sensibles peut également, et d’une manière aussi solide et non moins scientifique, être exécuté sur ces faits d’une autre nature. En effet, de quoi s’agit-il, si ces faits, comme l’expérience le prouve, sont observables ? De reconnaître leurs lois, et ces lois reconnues, d’en tirer des inductions pour toutes les questions qui s’y rapportent. À quel autre terme aboutissent les sciences naturelles ? Or, douterait-on, par hasard, que ces faits se produisent selon des lois régulières ? Ne serait-il pas bien singulier que tous les faits observés jusqu’ici dans toutes les parties de la nature, aient été trouvés soumis à des lois régulières ; qu’en un mot l’ordre ait été reconnu et dans l’ensemble et dans les moindres détails de ce vaste univers, et que les opérations de l’esprit humain qui constate cet ordre, et que les mouvements de la sensibilité humaine qui admire cet ordre, et que les mobiles de la conduite de l’homme, qui est la pièce la plus merveilleuse de ce vaste ensemble, eussent été seuls abandonnés au hasard, sans règle et sans lois certaines ? De toutes les suppositions imaginables ce serait la plus évidemment absurde quand bien même l’expérience ne la démentirait pas ; mais il suffit d’avoir observé, et de la manière la plus superficielle, un phénomène quelconque de conscience, pour n’avoir plus de doute à cet égard. Qui ne s’est pas aperçu, pour nous borner à des exemples bien simples, que jamais nous ne prenons une détermination sans un motif compris ou entrevu d’avance ; que jamais un souvenir ne s’éveille en nous qui n’ait été suscité par une idée antérieurement présente dans notre esprit, et qui avait quelque rapport avec l’idée rappelée ; que jamais notre attention ne s’applique à un objet à moins que nous n’en ayons déjà acquis quelque notion ? et si l’observation prouve que ces trois circonstances accompagnent constamment l’une le fait de volonté, l’autre celui de mémoire, la troisième celui d’attention, ne sont-ce pas là des loin de ces trois opérations ? Les sciences naturelles procèdent-elles d’une autre manière, et arrivent-elles à d’autres résultats ?
Et remarquons en faveur de cette science nouvelle dont on conteste la possibilité, que les expériences à faire sur les phénomènes internes offrent beaucoup plus de facilité dans l’exécution, et promettent beaucoup plus d’exactitude dans leurs résultats que celles par lesquelles sont obligées de passer la plupart des sciences naturelles. Car, à commencer par la physiologie, combien de phénomènes lui échappent, et se voit-elle réduite à présumer par l’impossibilité de pénétrer sans la détruire dans les mystères de la vie ? Et ceux qu’elle parvient à atteindre ne sont-ils pas le plus souvent altérés par les opérations douloureuses qu’il a fallu pratiquer pour les observer ? encore n’est-ce point sur l’homme dont il s’agit, mais sur les animaux qu’elle les observe. Qui ne connaît toutes les difficultés que présentent les expériences beaucoup plus faciles cependant de la physique et de la chimie ? soit à cause de la subtilité des phénomènes qui échappent aux sens, soit à cause des mille influences extérieures qui tantôt contrarient l’expérience au point de la rendre impossible, tantôt modifient et dénaturent ses résultats, au point de rendre nécessaires les contre-épreuves les plus multipliées ? On se figure à peine combien de temps, de sagacité, de patience et d’habilité à expérimenter, ont coûté dans ces deux sciences les moindres découvertes. Que dirons-nous maintenant de ces autres sciences qui sont obligées de parcourir la terre pour constater un fait, d’attendre les révolutions des astres pour faire une observation, de rapprocher une multitude d’êtres et d’objets différons, disséminés sur la surface du globe, ou enfouis çà et là dans ses entrailles, pour entrevoir une loi de la nature vivante ou inanimée ? Et, quand nous voyons la patience et le génie surmonter ces obstacles prodigieux dans les différentes branches des sciences naturelles, comment ne pas se rassurer sur l’avenir de la science des faits internes, qui ne présente ni ces difficultés à vaincre ni ces causes d’erreurs à éviter. En effet, comme le but dans cette science est de connaître l’homme et non pas les hommes, et que l’homme est tout entier dans chaque individu de l’espèce, dans quelque position sociale que se trouve l’observateur, il porte toujours en lui-même tout l’objet de ses études, tout le sujet de ses expériences. Il n’a pas besoin comme le physiologiste de mettre la vie en péril ou de troubler ses fonctions pour l’observer. Pour qu’il puisse sentir la vie intérieure, il faut, au contraire, qu’il la laisse aller ; et plus elle va et mieux il la saisit ; et il suffit qu’elle aille pour qu’il en ait le spectacle. Or, elle se développe continuellement avec le cortège des phénomènes qui la manifestent ; en sorte que l’observateur qui la porte partout avec lui, peut, à toute heure, en tout lieu, sans préparation comme sans dérangement, attacher sur elle ses regards et poursuivre te cours de ses recherches. Pour découvrir les lois de ces phénomènes, il n’est pas besoin qu’il se travaille et imagine des expériences ; il altérerait le naturel des phénomènes en les produisant ou en les faisant naître exprès en lui-même. Qu’il se contente d’acquérir l’habitude de les observer quand ils se produisent naturellement, et qu’il ne s’inquiète point du reste. Cette habitude acquise, que le philosophe vive comme le reste des hommes, qu’il coure le monde, qu’il cultive la société, qu’il vaque à ses affaires. La scène mobile de la vie, le jeu varié du commerce social exciteront cent fois le jour et sous l’influence de mille circonstances différentes, le développement des divers phénomènes dont il cherche les lois. Grâce à cette expérimentation naturelle et perpétuelle, le même fait vingt fois reproduit sous des conditions différentes, laissera bientôt paraître ce qu’il a d’invariable et de constant, s’abstraira bientôt des circonstances accidentelles qui le modifient dans les différents cas, et se livrera sans effort à l’observateur dans ses éléments constitutifs.





























