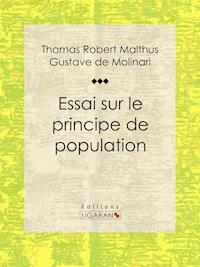
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
Extrait : "Si l'on cherchait à prévoir quels seront les progrès futurs de la société, il s'offrirait naturellement deux questions à examiner..."
Das E-Book Essai sur le principe de population wird angeboten von Ligaran und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335028973
©Ligaran 2015
« Il a été l’homme le plus funeste de son siècle. Bonaparte lui-même n’a pas été un plus grand ennemi de l’espèce humaine. C’était un homme qui défendait la petite vérole, l’esclavage et l’infanticide ; qui dénonçait les soupes économiques, les mariages précoces et les secours de la paroisse ; qui avait l’impudence de se marier après avoir prêché contre la famille ; qui pensait que le monde est organisé d’une manière tellement défectueuse que les meilleures actions y produisent les pires maux ; qui a enlevé toute poésie à l’existence et débité un dur sermon sur le vieux thème : Vanité des vanités, tout n’est que vanité ! » Tel est, au dire d’un récent biographe et commentateur de Malthus, le portrait de l’auteur de l’Essai sur le principe de population tracé par les adversaires le sa doctrine. Encore ce portrait n’est-il pas complet ; il y manque des traits essentiels, que les socialistes du continent se sont chargés d’y ajouter.
« La théorie de Malthus, disait Proudhon en 1848, dans un article demeuré célèbre, c’est la théorie de l’assassinat politique, de l’assassinat par philanthropie, par amour de Dieu. – Il y a trop de monde au monde ; voilà le premier article de foi de tous ceux qui, en ce moment, au nom du peuple, règnent et gouvernent. C’est pour cela qu’ils travaillent de leur mieux à diminuer le monde. Ceux qui s’acquittent le mieux de ce devoir, qui pratiquent avec piété, courage et fraternité les maximes de Malthus sont les bons citoyens, les hommes religieux ; ceux qui protestent sont des anarchistes, des socialistes, des athées… Qui viendra me dire que le droit de travailler et de vivre n’est pas toute la révolution ? Qui viendra me dire que le principe de Malthus n’est pas toute la contre-révolution ? » À un autre bout de l’horizon, la théorie de Malthus était condamnée comme immorale et abominable ; en 1856 la sacrée congrégation de l’index mettait en interdit le Dictionnaire de l’économie politique, infecté de malthusianisme, et un prédicateur du temps jetait l’anathème sur les époux malthusiens qui, « privant à la fois l’État de citoyens, l’Église d’enfants et le ciel d’élus, pèchent contre la société, contre la terre et contre le ciel, attaquant Dieu directement et lui disputant les créatures que sa puissance se préparait à produire et les âmes que sa miséricorde voulait sauver ».
C’est là ce qu’on pourrait appeler la légende du malthusianisme, et cette légende est précisément le contre-pied de l’histoire. Le plus grand ennemi de l’espèce humaine était un homme de mœurs douces, un excellent père de famille, un philanthrope non moins qu’un économiste, et sir James Mackintosh disait de lui, en associant sa mémoire vénérée à celle d’Adam Smith et de Ricardo : « J’ai connu un peu Adam Smith, beaucoup Ricardo, intimement Malthus et je puis dire, à l’éloge de la science économique, que ces trois grands maîtres ont été les hommes les meilleurs que j’aie connus ». La vie de Malthus et son œuvre, étudiées sans parti pris, témoignent en faveur de l’appréciation flatteuse de Mackintosh. C’est pourquoi, si général que soit encore le préjugé populaire à l’égard de l’auteur de l’Essai, on ne doit pas désespérer de le dissiper et de remplacer la légende par l’histoire.
I. Biographie. – Né dans le domaine de Rookery, sur la route de Dorking à Guildford, le 14 février 1766, Thomas-Robert Malthus était le second fils de Daniel Malthus, honnête propriétaire campagnard, d’une fortune modeste, qui avait étudié à Oxford sans y prendre ses grades et passait dans son voisinage pour un esprit excentrique ; il avait fait la connaissance de Rousseau et s’était enthousiasmé pour le système d’éducation de l’Émile. Il l’appliqua à ses enfants, et jusqu’à l’âge de neuf ou dix ans, Thomas Robert jouit du bénéfice d’une sorte de laissez faire que son premier biographe, l’évêque Olter, considère comme irrégulier, mais qui ne paraît avoir nui ni à la croissance vigoureuse de son corps ni au développement de son esprit. En 1776, on le confia à M. Richard Graves, recteur de Claverton près de Bath, qui lui apprit un peu de latin ; il passa ensuite aux mains d’un ministre dissident d’un haut mérite, George Wakefield, qui le fit entrer comme pensionnaire au collège de Jésus à Cambridge en 1784. Son éducation achevée, il entra dans les ordres et alla desservir une cure près d’Albury. Ses biographes ne nous disent pas comment il fut amené à s’occuper particulièrement d’économie politique. Nous savons seulement qu’il écrivit en 1196 un pamphlet intitulé la Crise que son père le dissuada de publier. Deux ans plus tard, en 1798, paraissait, sans nom d’auteur, son œuvre capitale, l’Essai sur le principe de population. Eu 1803, il en publiait la seconde édition, considérablement augmentée et, sur quelques points essentiels, sensiblement modifiée. Le retentissement de cet ouvrage et la protection de Pitt, avec qui il s’était rencontré au dîner de commémoration de Trinity college, lui valurent d’être nommé en 1805 professeur d’histoire et d’économie politique au collège d’Hayleibury près d’Hertford. Ce collège venait d’être fondé par les directeurs de la compagnie des Indes, à l’usage des cadets qui se destinaient au service civil de la compagnie. Ils y passaient deux ou trois ans. Le programme comprenait l’histoire générale, l’économie politique, les lois et la constitution britanniques, les relations politiques et commerciales de l’Angleterre avec l’Inde, les langues orientales, les mathématiques et la philosophie naturelle. Les cours étaient : de deux années. Les élèves, au nombre de quarante environ, étaient âgés de quatorze à vingt-deux ans. La classe de Malthus, appartenant à la seconde année du cours, n’en comprit jamais, plus de 12 à 14. Les professeurs étaient pour la plupart dans les ordres et ils remplissaient, à tour de rôle, leur office à la chapelle du collège. Leurs fonctions leur laissaient des loisirs qu’ils pouvaient consacrer à d’autres travaux, tout en les affranchissant des soucis matériels de la vie. Malthus n’eut guère d’autres revenus que ceux qu’elles lui procurèrent pendant trente ans, de 1805 à 1834. Malgré le succès de son Essai, il disait en 1820 à un publiciste français, Léonard Gallois, que ses ouvrages ne lui avaient pas rapporté 1 000 livres sterling ; conséquent avec ses principes, il s’était marié tard. Peu de temps avant sa nomination au collège d’Hayleibury, le 13 mars 1804, il épousait Harriet Eckerstall, à laquelle il était fiancé depuis plusieurs années. Il avait alors trente-huit ans. Il eut trois enfants, et non pas onze, comme le croyait M. Cherbuliez, en racontant dans le Journal des Économistes (1850) que Malthus avait été faire une visite à M. de Sismoudi à Genève, suivi de ses onze filles ! Deux de ses enfants, un fils entré dans les ordres, et une fille lui survécurent. Miss Harriet Martineau, qui alla passer quelques jours chez Malthus, en 1833, fait une aimable description de l’intérieur de l’illustre auteur de la théorie de la population et de sa vie paisible et studieuse. La réimpression de son Essai et la publication de ses autres ouvrages furent les seuls évènements de son existence, tout entière vouée à la science et aux devoirs de ses fonctions de professeur et de ministre du culte. En 1819, il devenait membre de la Société royale, et en 1821 il prenait part à la fondation du Club d’économie politique de Londres ; plus tard, en 1833, il était élu membre associé de l’Académie des sciences morales et politiques de Paris et membre de l’Académie royale de Berlin. Il comptait au nombre de ses amis James Mackintosh, Borner, Ricardo et J.-B. Say.
Une physionomie sereine, avec un caractère de fermeté, tempérée par la douceur, telle est l’impression que laisse un beau portrait de Malthus, à un âge déjà avancé, par Linnel (gravé par Fournier pour la Collection des principaux économistes). Il était grand et de tournure élégante. Sa parole était claire, quoique sa prononciation fût légèrement défectueuse. Sydney Smith disait à ce propos : Je consentirais volontiers articuler aussi mal si je pouvais penser et agir aussi bien.
Il était, dit Charles Comte, d’un caractère si calme et si doux, il avait sur ses passions un si grand empire, il était si indulgent pour les autres, que des personnes qui ont vécu près de lui pendant près de cinquante années, assurent qu’elles l’ont à peine vu troublé, jamais en colère, jamais exalté, jamais abattu ; aucun mot dur, aucune expression peu charitable ne s’échappèrent jamais de ses lèvres contre personne ; et quoiqu’il fût plus en butte aux injures et aux calomnies qu’aucun écrivain de son temps et peut-être d’aucun autre, on l’entendit rarement se plaindre de ce genre d’attaques, et jamais il n’usa de représailles. Il était très sensible à l’approbation des hommes éclairés et sages ; il mettait un grand prix à la considération publique ; mais les outrages non mérités le touchaient peu, tant il était convaincu de la vérité de ses principes et de la pureté de ses vues ; tant il était préparé aux contradictions et même à la répugnance que ses doctrines devaient inspirer dans un certain monde.
Sa conversation se portait naturellement sur les sujets qui touchent au bien-être de la société, et dont il avait fait l’objet d’une étude particulière. Il était alors attentif, sérieux, facile à émouvoir ; il énonçait son opinion d’une manière si claire, si intelligible, qu’on voyait aisément qu’elle était le résultat d’une réflexion profonde. Du reste, il était naturellement gai et enjoué, et aussi prêt à prendre part aux plaisirs innocents de la jeunesse qu’à l’encourager ou à la diriger dans ses études.
Il était au nombre des partisans les plus zélés de la réforme parlementaire et désirait de voir le gouvernement s’engager dans une voie de progrès ; mais il n’était pas moins attaché à la forme des institutions nationales, et il redoutait les innovations et les expériences inconsidérées. Il appartenait à cette fraction de la nation anglaise qu’on a désignée sous le nom de whigs, et qui possède aujourd’hui la direction des affaires de la Grande-Bretagne.
Fidèle à ses opinions politiques dans le temps où elles étaient loin de mener à la fortune, il ne s’en est pas fait un titre à la faveur lorsqu’elles ont triomphé ; il n’a pas eu la pensée de faire de la science le marchepied de l’ambition. Quand ses principes sont devenus le fondement de la loi qui réformait la législation sur les pauvres, les calomnies et les injures des ennemis de la réforme ne lui ont pas manqué. Ses adversaires ont tenté de faire tomber sur lui la responsabilité des vues qu’ils signalaient dans la mesure du gouvernement. De leur côté, les partisans de cette mesure lui ont prodigué les éloges dans les discussions auxquelles elle a donné lieu au sein du Parlement ; mais là se sont arrêtées la reconnaissance de ses amis politiques et la munificence nationale. Je dois ajouter qu’on ne l’a vu se plaindre ni des injures des premiers ni de la négligence des seconds.
Malthus était entré dans sa soixante-neuvième année avec toutes les apparences de la santé, lorsqu’il mourut subitement d’une maladie de cœur, chez son beau-père, M. Eckerstall, où il était allé passer en famille les fêtes de Noël. Il a été enterré dans l’église de l’abbaye à Bath. Voici son épitaphe, attribuée à son condisciple et son biographe, l’évêque Otter :
II. L’Essai sur le principe de population. – Si l’on veut apprécier exactement le caractère et l’influence de cet ouvrage célèbre, au moins lorsqu’il parut sous sa première forme, qui était celle d’un pamphlet anti-socialiste, comme on dirait aujourd’hui, et s’expliquer à la fois les colères violentes qu’il a excitées et la faveur non moins passionnée qu’il a rencontrée, il faut avoir présent à la pensée l’état matériel et moral de l’Angleterre, à l’époque de sa publication. La grande industrie venait de naître ; les inventions de Watt, d’Arkwright, de Hargraves, de Crompton, remplaçaient le travail à la main par le travail mécanique, bien autrement productif ; des mines de fer et de charbon, d’une richesse extraordinaire, étaient découvertes dans le nord de l’Angleterre et leur mise en exploitation favorisait le développement des manufactures ; l’ingénieur Brindley préludait à la création du réseau des voies de communication intérieure, en creusant le canal de Liverpool à Manchester ; le commerce britannique, sous l’influence de la transformation de l’industrie, s’élevait de 13 millions de livres sterling en 1720 à 42 300 000 en 1790 par une progression qui devait s’accroître encore plus tard. Malheureusement, cette brillante médaille avait un sombre revers. Comme tout changement soudain, la révolution industrielle bouleversait une multitude d’existences et réduisait aux plus dures extrémités de la misère les ouvriers adaptés à l’ancien outillage et trop vieux ou trop routiniers pour s’adapter au nouveau ; en même temps, le système prohibitif, appliqué avec une rigueur particulière aux articles de première nécessité, renchérissait la vie, tandis que le droit à l’assistance, consacré par le statut d’Élisabeth, encourageait la multiplication des pauvres, en infligeant un fardeau de plus en plus lourd aux contribuables : de 1 720 316 livres sterling, en 1776, la taxe des pauvres s’éleva à 2 167 749 liv., en 1783 pour atteindre le chiffre énorme de 5 348 205 liv. en 1803. Le paupérisme croissait, pour ainsi dire, dans la même progression que la richesse. Cet état de choses ne pouvait manquer de provoquer un sentiment général de malaise et d’irritation dans les classes ouvrières et de faire éclore toute sorte de projets, destinés à porter remède à des maux dont le spectacle émouvait les cœurs si les causes en échappaient encore aux intelligences. À défaut de la science trop lente, l’imagination se donna carrière et l’on vit apparaître des plans variés de réformes qui devaient avoir pour effet immédiat et infaillible de guérir tous les maux de la société et de réaliser le millenium.
La Révolution française qui éclata sur ces entrefaites apporta d’abord aux mécontents et aux réformateurs un puissant concours ; on crut, un moment, en Angleterre et dans le reste de l’Europe, que l’abolition de l’ancien régime allait inaugurer une ère nouvelle de liberté, de paix et de bonheur ; aussi éveilla-t-elle à ses débuts une ardente et presque universelle, sympathie. C’était aux vices des gouvernements qu’à l’exemple des apôtres de la Révolution, on s’accordait à attribuer tous les maux de la société. Il ne s’agissait donc pour y mettre fin que de réformer les gouvernements ou, mieux encore, de les supprimer. Cette dernière thèse fut développée avec une entraînante éloquence par l’auteur de la Justice politique, William Godwin. Dans ce livre écrit à l’aurore de la Révolution et publié en 1793, Godwin, qu’on peut considérer comme un des pères de « l’anarchisme », paraphrasant cet aphorisme de Thomas Payne : « que la société est produite par nos besoins et le gouvernement par notre méchanceté », soutenait que l’homme était naturellement bon et que tous les maux qui l’accablaient provenaient des institutions auxquelles on l’avait assujetti ; que le jour où il n’existerait plus de gouvernements on verrait disparaître, avec la misère et le crime, les inégalités sociales ; enfin, qu’il suffirait alors d’une demi-heure de travail par jour pour permettre à chacun de satisfaire amplement à ses besoins. Remarquons à cette occasion que le sage Franklin, sans aller si loin, prétendait que quatre heures pourraient suffire, sous un régime de gouvernement sobre et économique. Godwin, toutefois, était moins avancé que les anarchistes d’aujourd’hui, en ce qu’il repoussait l’emploi de la force pour réaliser sa théorie et n’en demandait l’avènement qu’aux progrès de la raison.
Mais bientôt les excès de la démagogie révolutionnaire et les sanglants holocaustes de la Terreur soulevèrent partout un sentiment d’horreur et de dégoût, que les classes intéressées au maintien de l’ancien régime s’empressèrent d’exploiter contre les réformes, comme les réformateurs avaient naguère exploité contre les conservateurs l’enthousiasme communicatif des premiers beaux jours de 89. Les Réflexions sur la Révolution de France, d’Edmond Burke, répondaient à ce courant nouveau de l’opinion ; mais cette protestation indignée et brûlante contre les excès de la Révolution n’atteignait pas à fond l’esprit de réforme ; elle laissait aux réformateurs le bénéfice des espérances et des illusions qu’ils avaient éveillées en déroulant leurs plans prestigieux de régénération politique et sociale. Elle ne condamnait que le procédé révolutionnaire, et ce procédé, les réformateurs, Godwin en tête, ne l’avaient-ils pas répudié ? Ce qu’il fallait, ce que demandait l’esprit de réaction, c’était une démonstration de l’impuissance et de l’inanité des réformes politiques et sociales pour remédier aux maux de la société. Cette démonstration, il la trouva aussi complète et aussi saisissante qu’il pouvait la souhaiter dans l’Essai sur le principe de population.
L’auteur inconnu de ce livre ne songeait certainement pas à servir des intérêts de classe ou des passions de parti. C’était un jeune savant, probablement assez naïf, qui avait étudié l’économie politique dans la Richesse des nations d’Adam Smith et les Essais de David Hume, et dont l’attention s’était particulièrement dirigée sur la question de la population. Cette question avait été fort discutée dans la seconde moitié du dix-huitième siècle. On s’était demandé si la population s’était accrue depuis l’antiquité. Montesquieu, Wallace et le docteur Price avaient prétendu que le nombre des hommes avait diminué, tandis que Hume soutenait la thèse opposée. D’un autre côté, quoique la statistique fût encore dans l’enfance, les dénombrements de la Suède, les tables de Wargentin, les recherches de Süssmilch, les calculs d’Euler avaient commencé à jeter quelque lumière sur le taux d’accroissement de la population, et la multiplication extraordinaire des colons récemment émancipés des États-Unis attestait la puissance prolifique de l’espèce humaine. On remettait en question l’utilité des encouragements que les gouvernements avaient l’habitude d’accorder à la population et, en 1786, le révérend Joseph Townsend dénonçait à cet égard les funestes effets de la taxe des pauvres.
Des faits que les statistiques de la population de la Suède et des États-Unis mettaient au jour, Malthus tira la conclusion que l’espèce humaine a une tendance naturelle à s’accroître plus rapidement que les subsistances, et que cette tendance a pour effet de créer incessamment un excès de population, auquel les fléaux : destructeurs de la vie, la misère et le vice, opposent seuls une limite répressive. Cette conception imparfaite de la théorie de la population, l’auteur devait la compléter et la rectifier lui-même plus tard ; mais, en attendant, elle s’était emparée de son esprit et elle y avait créé la conviction de l’impuissance des réformes préconisées par les novateurs. Une nouvelle publication de Godwin, l’Enquirer (l’investigateur) contenant un essai sur l’avarice et la prodigalité, dans lequel se trouvait reproduite la théorie favorite des réformateurs, savoir que tous les maux de l’humanité proviennent des vices des gouvernements, parut dans le moment même où le jeune disciple d’Adam Smith et de Wallace croyait avoir découvert la vraie et abondante source du mal. Il ne put se retenir d’opposer la vérité qui venait de lui apparaître aux utopies de Godwin, et il publia l’Essai sur le principe de population (1798). Dans ce livre, écrit avec une emphase juvénile, plutôt dans le style d’un article de polémique que d’une œuvre de science, l’esprit de réaction trouva ce qu’il cherchait : une théorie qui semblait ruiner à jamais les espérances et les illusions des fauteurs de révolutions et même des paisibles amis du progrès, en montrant combien il était chimérique de demander à la réforme du gouvernement l’amélioration du sort de la multitude souffrante, puisque la source de ses maux était ailleurs. Sur ce point, l’auteur ne laissait aucune prise au doute. Dans l’ivresse de sa découverte, il exagérait encore la formidable puissance qu’il attribuait au principe de la population et la nécessité de sacrifier les misérables dont la naissance était le produit d’une infraction à ce principe.
Un homme qui est né dans un monde déjà possédé, disait-il, s’il ne peut obtenir de ses parents la subsistance qu’il peut justement leur demander, et si la société n’a pas besoin de son travail, n’a aucun droit de réclamer la plus petite portion de nourriture et, en fait, il est de trop. Au grand banquet de la nature, il n’y a pas de couvert vacant pour lui. Elle lui commande de s’en aller, et elle mettra elle-même promptement ses ordres à exécution s’il ne peut recourir à la compassion de quelques-uns des convives du banquet. Si ces convives se serrent et lui font place, d’autres intrus se présentent immédiatement, demandant la même faveur. Le bruit qu’il existe des aliments pour tous ceux qui arrivent remplit la salle de nombreux réclamants. L’ordre et l’harmonie du festin sont troublés, l’abondance qui régnait auparavant se change en disette, et le bonheur des convives est détruit par le spectacle de la misère et de la gêne qui règnent dans toutes les parties de la salle, et par la clameur importune de ceux qui sont justement furieux de ne pas trouver les aliments sur lesquels on leur avait appris à compter. Les convives reconnaissent trop tard l’erreur qu’ils ont commise en contrecarrant les ordres stricts à l’égard des intrus, donnés par la grande maîtresse du banquet, laquelle désirant que tous ses hôtes fussent abondamment pourvus et sachant qu’elle ne pouvait pourvoir un nombre illimité de convives, refusait humainement d’admettre de nouveaux venus quand la table était déjà remplie.
L’auteur de l’Essai ne se bornait pas à prononcer cette dure sentence d’exclusion des convives surabondants. À ceux qui s’imaginaient qu’on pourrait, par une réforme des abus du gouvernement de la production et de la distribution des subsistances, nourrir un plus grand nombre d’invités, il opposait cette image décourageante :
Les institutions humaines, quoiqu’elles puissent occasionner de grands maux à la société, ne sont réellement que des causes légères et superficielles, semblables à des plumes qui flottent sur l’eau, en comparaison des sources bien plus profondes du mal qui découlent des lois de la nature et des passions des hommes.
En même temps, il insistait sur la nécessité d’expliquer aux pauvres que le gouvernement auquel les réformateurs se plaisaient à attribuer la responsabilité de leurs souffrances n’y avait que la plus petite part :
Il ne faut pas croire que les pauvres soient des visionnaires. Leurs maux sont toujours réels, bien qu’ils se trompent sur la cause qui les produit. Si donc on leur expliquait nettement quelle est cette, cause sur laquelle ils s’abusent ; si on leur faisait sentir combien est petite la part que le gouvernement a dans leurs souffrances ; combien est grande, au contraire, l’influence des causes qui lui sont tout à fait étrangères, le mécontentement et l’irritation se manifesteraient moins souvent dans les classes inférieures du peuple ; et lorsque ces sentiments se manifesteraient, ils éclateraient avec moins de violence.
Enfin, il adressait aux orateurs et aux écrivains populaires de son temps ces reproches sévères qui devaient les irriter d’autant plus qu’ils les méritaient davantage et qui n’ont rien perdu, hélas ! de leur opportunité :
Que les classes ouvrières ne voient pas distinctement les causes principales de leur détresse ; qu’elles ne sentent pas à un certain point et pour un certain temps, que leurs maux sont sans remède, c’est ce qui est assez naturel. Qu’elles écoutent avec faveur ceux qui leur promettent avec confiance un soulagement immédiat, plutôt que ceux qui n’ont à leur offrir que des vérités peu agréables, c’est ce dont on n’a pas droit de s’étonner. Mais il faut convenir que les orateurs et les écrivains populaires ont profité sans aucune retenue de la crise qui leur a mis le pouvoir en main. En partie par ignorance et en partie à dessein, tout ce qui aurait pu tendre à éclairer les classes ouvrières sur leur vraie situation, tout ce qui aurait pu les engager à supporter avec patience des maux inévitables, a été soigneusement écarté de leur vue ou hautement réprouvé ; et tout ce qui pouvait tendre à les décevoir, à aggraver, à fomenter leur mécontentement, à exciter une folle attente de soulagement à l’aide de simples réformes, a été mis en avant et soigneusement exposé à leurs regards. Si, dans de telles circonstances, les réformes proposées avaient été exécutées, il en serait évidemment résulté que le peuple aurait été cruellement frustré dans ses espérances. Sous un système de suffrage universel et de parlements annuels, le sentiment général d’un peuple trompé dans son attente l’aurait probablement conduit à tenter, en fait de gouvernement, toute sorte d’expériences, jusqu’à ce qu’enfin, après avoir parcouru toute la carrière des révolutions, il eut été contenu par le despotisme militaire. Les plus chauds amis de la véritable liberté ont pu avec raison être alarmés d’une telle perspective.
On s’explique aisément qu’un tel livre, tombant au milieu du conflit des passions surexcitées par les prodigieux évènements qui venaient de bouleverser le monde et de mettre tous les gouvernements en péril, ait été accueilli avec enthousiasme par les conservateurs et qu’il ait excité au plus haut point la colère des réformateurs, dont il achevait de ruiner le crédit. Les conservateurs y voyaient la justification de la résistance qu’ils opposaient à toute réforme, et la théorie de Malthus leur agréait précisément par ce qu’elle avait d’insuffisant et de contestable. Des « Malthusiens » exagérant, comme d’habitude, la théorie du maître ou, pour mieux dire, ce qu’il y avait de faux dans cette théorie, imaginèrent toute sorte de moyens révoltants ou bizarres pour empêcher le débordement, toujours imminent, de la population. Un philanthrope anglais, d’une haute célébrité, au dire de P. Rossi, proposait, dans une publication signée du pseudonyme de Marcus, de soumettre les nouveaux-nés à une asphyxie sans douleur (painless extinction) ; un écrivain allemand, M. Weinhold, conseiller de régence en Saxe, donnait la préférence au procédé employé pour obtenir les chanteurs de la chapelle Sixtine. Les « antimalthusiens » ne se firent pas faute d’exploiter les erreurs du maître et les aberrations de quelques-uns de ses disciples. Ils représentèrent l’auteur de l’Essai comme un ennemi de la population, de la charité et du mariage, ils l’accusèrent de réhabiliter les fléaux destructeurs de la vie-humaine, et c’est ainsi que se créa la légende du malthusianisme.
Mais, cette légende, l’auteur de l’Essai ne pouvait consentir à l’accepter. Il n’avait pas voulu écrire un pamphlet politique pour servir des passions éphémères, il avait voulu faire une œuvre de science et servir la cause durable de la vérité. Il était, par tempérament, un whig modéré et non un tory furieux. Les éloges des uns aussi bien que les injures des autres lui firent voir ce qu’il y avait d’insuffisant et d’excessif dans l’exposé de sa théorie et il se remit à l’œuvre pour la compléter et la tempérer. Il alla étudier la question de la population dans les parties de l’Europe qui étaient encore accessibles aux voyageurs anglais, en Danemark, en Norvège, en Suède et en Russie ; un peu plus tard, il visita la Suisse et la Savoie. Au retour de ses pérégrinations, il refondit entièrement son ouvrage ; il ne se contenta pas d’y ajouter les résultats de ses recherches, il introduisit dans sa théorie de la population un élément nouveau, d’une importance capitale : l’obstacle privatif ou la contrainte morale. C’était plus qu’une addition, c’était une transformation.
Sous sa forme primitive, la théorie de Malthus avait, en effet, un caractère fataliste et pessimiste qu’il était difficile de contester. Si la population, obéissant à une impulsion, développée en raison géométrique, tendait incessamment à dépasser les moyens de subsistance, réduits à croître seulement en raison arithmétique, et si cette différence de progression ne pouvait être comblée que par l’action des fléaux destructeurs de la vie humaine, n’était-il pas clair que toutes les tentatives d’amélioration du sort de la multitude demeureraient vaines, que l’action du principe de la population finirait toujours par les déjouer, en multipliant le nombre des convives du banquet plus vite que le nombre des places et la quantité des provisions ? Si, au contraire, il dépend de l’homme d’opposer un frein à la passion qui le pousse à se multiplier, la situation change. Sa destinée est désormais entre ses mains. L’obstacle privatif ou préventif de la contrainte morale peut faire la besogne nécessaire de l’obstacle répressif et le remplacer, en épargnant à l’espèce humaine les maux et les souffrances qu’implique la mise en œuvre de ce dernier obstacle auquel l’auteur avait donné la qualification significative de vice et de malheur. Le progrès devient possible ; il suffit de contenir et de régler la puissance formidable du principe de population, puissance d’ailleurs indispensable, dans son exubérance, pour assurer le peuplement de notre globe.
Dans l’état actuel des choses, disait l’auteur de l’Essai dans cette nouvelle édition, nous avons à diriger une force immense capable de peupler en peu d’années une région déserte, mais susceptible en même temps d’être contenue par la force supérieure de la vertu dans des limites aussi étroites que nous le voudrons, au prix d’un mal léger en comparaison des avantages qui doivent résulter de cette sage économie… Ainsi, c’est à diriger et à régler le principe de population que nous devons nous appliquer et non à l’affaiblir ou à l’altérer. Et si la contrainte morale est le seul moyen légitime d’éviter les maux qu’il entraîne, nous ne serons pas moins tenus à la pratique de cette vertu que nous ne le sommes à celle de toutes les autres, dont l’utilité générale nous prescrit l’observation.
À la vérité, l’auteur de l’Essai n’avait pas une confiance illimitée dans l’efficacité de l’obstacle préventif. « Je crains bien, disait-il, qu’on ne trouve que j’ai eu raison d’envisager l’action de cette cause comme étant aussi peu active que je l’ai représentée… Il y a très peu de pays, ajoutait-il, où l’on n’observe pas un constant effort de la population pour croître au-delà des moyens de subsistance. Cet effort, constant dans son action, tend non moins constamment h plonger dans la détresse les classes inférieures de la société, et s’oppose à toute espèce d’amélioration dans leur état ».
Néanmoins, il ne désespérait pas de l’avenir ; il avait confiance dans les progrès de l’éducation et, en particulier, dans la propagation des principes de l’économie politique pour substituer dans la pratique l’obstacle préventif à l’obstacle répressif. Enfin, dans la conclusion de son ouvrage, il faisait à ses adversaires une concession importante en convenant « qu’il était probable qu’ayant trouvé l’arc trop courbé en un sens, il l’avait trop courbé de l’autre, en vue de le redresser », et en ajoutant, avec une modestie assez rare, que l’objet pratique qu’il avait eu en vue, quelque erreur de jugement qu’il eût pu commettre d’ailleurs, était d’améliorer le sort et d’augmenter le bonheur des classes inférieures de la société.
Mais cette concession et cette déclaration n’eurent pas la vertu de désarmer les antimalthusiens. Dans ses Recherches sur la population contenant une réfutation des doctrines de M. Malthus sur cette matière, publiées en 1820, Grodwin persistait à ne tenir compte que de l’obstacle répressif ; il qualifiait Malthus de « noir et terrible génie prêt à étouffer tout espoir de l’espèce humaine » et prétendait que « s’il avait ajouté aux deux obstacles à l’accroissement de la population, énoncés dans la première édition, un troisième obstacle désigné sous le nom de contrainte morale, c’était seulement pour ménager la sensibilité de certains lecteurs » Il faisait ensuite une peinture lamentable des ravages moraux qu’avait commis la théorie de « l’ennemi de la population ».
Depuis vingt ans, disait-il, le cœur des habitants de notre île s’endurcit par suite des théories de M. Malthus. Il m’est impossible de prévoir quel effet permanent cela pourra avoir sur le caractère des Anglais, mais je suis sûr qu’il faut se hâter d’y opposer une barrière. Depuis quelque temps on tâche de persuader à la nation, ou tout au moins à toutes les personnes qui s’occupent d’économie politique et qui certes ne sont pas les membres les plus méprisables de la communauté, qu’il faut regarder de mauvais œil toute créature humaine, et surtout les petits enfants. Une femme enceinte se promenant dans les rues est, d’après cette doctrine, une chose vraiment alarmante. Le père d’une famille nombreuse, s’il appartient aux classes inférieures de la société, est devenu à nos yeux un objet odieux.





























