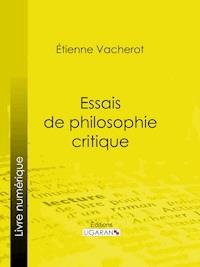
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Pour tout esprit qui s'intéresse à l'avenir des études philosophiques, il est manifeste qu'elles traversent en ce moment une crise redoutable. Depuis le début de ce siècle, la philosophie n'en avait pas connu d'aussi grave, d'aussi difficile, et qui mît à ce point son existence en péril."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le jour où nous rendions les derniers devoirs à notre ami, j’entendais le duc de Broglie dire avec une profonde tristesse : Nous perdons un sage. Ce mot, dans la bouche d’un tel homme, résumait tout ce que notre imparfaite humanité contient de plus noble et de meilleur. Tel est bien l’homme que l’Université, que l’Académie, que le public savant, que le monde a connu. Et pourtant, aucun de ceux qui ont vécu dans l’intimité de M. Damiron, ne trouveront dans le mot de son illustre confrère la complète définition de l’homme excellent qui vient de nous être si brusquement enlevé. Oui, M. Damiron avait les pensées, les mœurs, les affections, les vertus d’un sage. Jamais un paradoxe n’a séduit sa sévère raison ; jamais une épreuve n’a fait fléchir sa ferme volonté ; jamais un devoir n’a échappé à l’œil toujours ouvert de sa conscience. Mais, s’il fut sage, c’est d’une manière qui n’est qu’à lui. Chez la plupart des hommes qui méritent ce beau titre, la sagesse est le fruit de l’expérience et de l’épreuve ; la vertu est le prix de l’effort. En un mot, ils sont devenus sages. Il semble que M. Damiron soit né tel, comme il est né doux, bon, affectueux, sympathique. Sans aller jusqu’à dire que la nature, et pour me servir d’un synonyme qu’il se plaisait à employer, la grâce avait tout fait en lui, je ne serai pas contredit de ceux qui l’ont le mieux connu, en affirmant que sa sagesse et sa vertu avaient quelque chose de si naturel qu’il était difficile d’y apercevoir la lutte et l’effort. C’est que la pratique du bien ne rencontrait jamais chez lui ces passions violentes ou haineuses qui, même domptées chez les plus nobles caractères, laissent une certaine amertume dans la victoire qui a été le fruit du combat.
Tout sentiment, dans cette douce et noble nature, tournait à l’affection, aucun à la passion. Voilà le secret de la paix profonde dont il jouissait au milieu des mille contrariétés de la vie, de la charmante gaieté qui étonnait jusqu’à ses amis, au sein de sa famille et dans son petit cercle d’intimes, du bonheur enfin qu’il répandait autour de lui en l’éprouvant lui-même. Nul sentiment amer, nul mouvement violent n’eût osé se produire devant tant de bienveillance et de modération. L’indignation, la colère, la haine du mal et des méchants, le mépris de tout ce qui est bas et vil ne sont pas des passions étrangères aux plus honnêtes gens ; et il est des temps où de tristes spectacles les portent à un degré d’amertume et de violence que condamne la sagesse. L’affection était si bien le fond de l’être, chez M. Damiron, que les bassesses et les iniquités éveillaient rarement autre chose qu’un sentiment de profonde tristesse. Il en souffrait bien plus qu’il ne s’en indignait. Et c’est à peine si parfois un sourire de pitié venait trahir l’énergique répulsion que lui causait le récit d’une méchante action ou d’une basse intrigue. Aussi, pour calmer ou modérer ceux d’entre nous qu’une passion, même généreuse, entraînait au-delà des bornes de la vérité ou de la justice, n’avait-il besoin ni de leçons ni de conseils. Nos colères tombaient devant sa judicieuse bonté, et notre âme se mettait bien vite au ton de sa douce sagesse. C’est que, sans le vouloir, sans le savoir, car il n’aimait guère accepter ce qu’on appelle un rôle en quoi que ce soit, il faisait sentir sa pacifique influence à tous ses amis, se trouvant tout naturellement le mentor des jeunes, l’arbitre des vieux, le médiateur des intérêts, le modérateur des passions, le vrai juge de paix d’une petite société où tous les sentiments trop vifs, toutes les prétentions excessives, toutes les petites querelles d’ambition ou de vanité, venaient expirer devant son tribunal.
Voilà quel sage était M. Damiron. Chose singulière ! cet esprit si modeste, cette âme si douce, ce caractère réservé jusqu’à la timidité portait le cachet d’une exquise originalité ! Ses doctrines avaient une onction, ses vertus avaient un parfum qui ne semblaient pas de son temps, bien qu’il en fût, dans la bonne acception du mot. Il est bien des côtés, les plus intimes et les meilleurs, de cette rare nature que n’ont connus ni l’Université, ni l’école Normale, ni l’Académie, ni le monde savant, où il a laissé de profonds et unanimes regrets. Je suis de ceux qui ont eu le bonheur de vivre tout près de lui. J’aurais voulu pouvoir dire sur sa tombe tout ce qu’ont perdu ses amis dans cette douloureuse séparation. Je n’en ai pas trouvé la force.
M. Damiron n’a été mon maître que par ses livres. Quand j’ai pu l’entendre, j’étais déjà vers la fin de ma carrière de professeur. Mais le premier de ses livres, l’Essai sur la philosophie du XIXesiècle, publié d’abord en une série d’articles dans le Globe, a été pour moi une révélation. Lorsqu’il parut, nous n’avions aucune idée de la philosophie nouvelle. Voltaire ou de Maistre, Descartes (non le vrai, mais le Descartes de la philosophie de Lyon) ou Condillac, les idées innées ou la table rase, telle était l’alternative à laquelle semblait condamnée la jeunesse philosophique du temps. Le seul enseignement qui eût eu une certaine popularité, en dehors de ces noms et de ces écoles, était les leçons de M. Laromiguière, où s’annonçait déjà la réaction contre la philosophie de la sensation. Grâce à l’habile et libérale direction de mon premier maître, M. Patrice Larroque, j’étais de ceux qui avaient été initiés, dès le collège, à cette timide réforme de la philosophie dominante. Il faut avoir passé par cette disette d’idées et ce luxe de scolastique pour comprendre la révolution qui se fit tout à coup dans nos jeunes intelligences, à la lecture d’un livre où les doctrines analysées n’étaient guère moins nouvelles pour nous que la critique qui en suivait l’exposition. Rien, aujourd’hui, ne peut donner à la jeunesse qui arrive des provinces une idée du mouvement au milieu duquel nous tombâmes, en 1827, au sortir du collège. C’était le moment où l’esprit nouveau, le véritable esprit du XIXe siècle, faisait explosion dans tous les genres et sous toutes les formes, science et littérature, livres, journaux et cours publics. C’était le moment où M. Royer-Collard était l’oracle de la tribune, où MM. Villemain, Cousin, Guizot étaient les maîtres de la jeunesse française, où le Globe, sous M. Dubois, où le National, sous MM. Thiers, Mignet et Carrel, répandaient à flots la lumière et la flamme sur tous les sujets actuels de politique, de philosophie, d’histoire, de littérature, d’art. Le livre de M. Damiron, tout en nous laissant ignorer l’origine et la tradition de la plupart des doctrines dont il nous présentait le tableau fidèle et animé, nous transportait tout à coup au plus vif de la mêlée des écoles contemporaines, et nous faisait entrer dans la vivante pensée du siècle. Des maîtres illustres avaient déjà écrit et parlé ; mais leurs oracles n’étaient point encore sortis du cercle de quelques initiés. Maine de Biran, dont les traités les plus importants n’avaient pas vu le jour, restait parfaitement ignoré. Royer-Collard n’était connu que de quelques esprits d’élite réunis autour de sa chaire. M. Cousin, déjà populaire par son éloquence plutôt que par ses idées, n’avait encore publié de son enseignement que quelques fragments plus à la portée des initiés que du public. Jouffroy ne s’était fait connaître que par ses mémorables articles du Globe. Par l’étendue et la variété des matières, par la parfaite netteté des analyses, par l’esprit libéral et toujours sympathique des critiques, par ce style déjà plein de charme et d’onction qui excellait à montrer la pensée d’autrui sous son meilleur jour, le livre de M. Damiron nous inspira le goût et nous ouvrit les horizons de la philosophie contemporaine. La pensée française du XIXe siècle, dispersée jusque-là en écoles exclusives, en œuvres personnelles ; s’était reconnue, concentrée, sinon réconciliée avec elle-même, dans ce livre où toutes les écoles avaient comparu ; elle y avait pris conscience de sa force et de sa vraie direction.
M. Damiron est déjà tout entier dans ce livre. Sa science assurément gagnera en étendue, en profondeur, en exactitude ; sa critique deviendra plus sûre et plus précise. Mais sa doctrine est déjà faite, et son style également. C’est qu’il tient sa doctrine et son style de sa nature avant tout. La science développera l’une, l’art perfectionnera l’autre. Mais ni la science ni l’art n’ont rien créé. M. Damiron est de la famille de ces écrivains que j’appelle naturels, sans la moindre intention de critique pour des écrivains d’un tout autre caractère, que je définis par le mot d’artistes. Il n’a jamais eu, pas plus que Jouffroy par parenthèse, cette souplesse d’allures, cette variété de ton, cette merveilleuse propriété de se teindre-de la couleur de tous les sujets, toutes qualités qui font le génie des écrivains artistes. Chez lui, ce sont toujours les mêmes cordes qui vibrent, le même ton, la même harmonie, avec des degrés divers de force et d’intensité. Il savait, comme d’autres, les secrets de l’art d’écrire ; son goût délicat, sa science de la langue se montraient dans ses conseils à ses élèves. Il n’y a qu’une voix là-dessus parmi tous ceux qui l’ont eu pour maître. Mais, quand il écrivait, il était tout à sa pensée et à son sentiment. Son âme passait dans son style, et c’est ce qui en fait le prix. Dans ce style, nul éclat emprunté à l’art des métaphores, nulle couleur poétique, nul mouvement cherché. La pure lumière de son esprit, la douce flamme de son cœur, la discrète émotion d’une sensibilité tout intérieure, voilà ce qui en fait le caractère original. Viennent les accidents, les influences du dehors ; elles n’auront jamais le pouvoir de le transformer, ni même de l’altérer.
Tous les livres publiés successivement pendant sa laborieuse et féconde carrière : ces cours de psychologie, de logique, de morale, où il a embrassé tout le cercle des grandes questions de philosophie, répandant sur toutes, les clartés de sa fine analyse et l’onction de sa douce éloquence ; ces mémoires, si savants et si précis, sur les grands et les petits philosophes du XVIIe et du XVIIIe siècle, qu’il lisait à l’Institut, offrent les mêmes qualités de pensée et de style que ses premiers essais, avec plus de science et de maturité. Quand le moment sera venu d’apprécier tous ces importants travaux, la critique en fera ressortir les solides mérites et les aimables qualités, l’exactitude de l’érudition, la précision des détails, la rectitude de jugement, la sévère impartialité des conclusions, un sentiment exquis des convenances, une finesse d’observation, une délicatesse dans le discernement des nuances, un tact supérieur pour découvrir, un rare talent pour exprimer les choses qui se sentent plus qu’elles ne se pensent. C’est par ces dernières qualités que se distinguent surtout ses analyses et ses descriptions des phénomènes de conscience. En les lisant, on sent qu’il a regardé dans le cœur humain, à travers le miroir de sa propre nature, et que c’est ainsi qu’il en a si bien vu les parties délicates et les nobles côtés. Mais nulle part l’homme que j’essaye de faire connaître ne s’est montré aussi nettement, aussi pleinement que dans ces leçons générales qu’il nous lisait, à chaque ouverture de son cours, sur quelques-uns de ces grands problèmes de philosophie morale ou religieuse qui ont toujours occupé les esprits élevés, et que la science abandonne aujourd’hui à l’éloquence des théologiens. Ces sortes de discours, qui semblent sinon d’un autre temps, du moins d’un autre pays, ne font-ils pas penser à la prédication de l’illustre Channing, tout en rappelant la manière de Fénelon et de Malebranche ? Et ces touchantes allocutions qu’il adressait, dans sa Sorbonne des champs, à ces pauvres enfants d’ouvriers qui venaient recevoir, sous les yeux de leurs familles, le prix du travail des mains de notre cher philosophe, est-il possible de les lire sans sentir palpiter, sous ces paroles émues, un cœur vraiment aimé du peuple, plein de sympathie pour ses naïves vertus et de pitié pour ses misères. Le langage qu’il parlait à ces âmes simples ne flattait pas leurs passions. Je ne lui ai jamais entendu dire qu’il n’en ait pas été compris.
J’étais un fervent adepte de M. Damiron longtemps avant de le connaître. Je l’ai entendu plus tard à la Sorbonne. Là, sa parole montrait ce que son style laissait apercevoir, une foi intime, profonde, très vive, sous les formes les plus sévères et les moins oratoires. Quand je dis : montrait, je me trompe encore, je devrais dire : trahissait. Car il fallait le bien connaître, l’avoir vu de près, toucher sa personne en quelque sorte, pour bien juger des tourments de cet esprit, qui craignait toujours de ne pas rencontrer la juste expression de sa pensée, et pour entendre les battements de ce cœur toujours ému par le sentiment intime des vérités dont il donnait la démonstration. J’ai entendu à peu près tous les maîtres de la parole de notre temps, et dans tous les genres ; j’ai assisté avec ravissement, dans mes jeunes années surtout, à ces grandes fêtes de l’éloquence, où se pressait l’élite de la société et de la jeunesse française, aux jours de notre liberté. Je me garderai bien de dire que l’âge, l’expérience, les habitudes méditatives m’en ont fait perdre le goût. Mais ces grands artistes, dont la parole va si bien aux foules, peuple ou assemblée, me font penser au forum et au théâtre, où les orateurs et les acteurs produisent d’autant plus d’effet qu’ils sont plus maîtres d’eux-mêmes. J’ai toujours trouvé un charme particulier à ces enseignements intimes, je dirais presque à ces entretiens à demi-voix où l’âme du professeur se communique avec ses idées au petit nombre d’auditeurs, d’amis qui recueillent sa parole. Tels étaient Jouffroy et Damiron. Ils ne cherchaient jamais l’éloquence. Quand au fort d’une analyse, d’une déduction, d’une description, il leur arrivait de rencontrer une de ces vérités qui saisissent l’âme tout à coup en même temps que l’esprit, et l’exaltent malgré elle ; quand le sentiment longtemps contenu de cette vérité montait enfin du cœur aux lèvres et s’échappait en paroles émues, il se produisait alors, au sein de l’auditoire, un mouvement qui n’était pas l’effet ordinaire de l’éloquence, n’ayant rien des gestes de l’admiration et n’éclatant point en applaudissements. Il se faisait un profond silence, comme pour mieux jouir des hautes pensées qui passaient dans l’âme des auditeurs. J’ai goûté souvent ces joies de l’esprit, en entendant la voix de ces deux maîtres.
Je n’apprendrai rien au public en disant que, chez M. Damiron, la doctrine était une foi, et que cette foi était sa vie. Il suffit de l’avoir lu et entendu pour le deviner. Et qui ne sait d’ailleurs comment il a vécu ? C’est que cette foi était non seulement établie dans les habitudes de son esprit, mais tenait aux plus profondes racines de sa nature. Aussi n’avait-elle ni doute, ni obscurité, ni défaillance. C’était la foi d’un croyant. Il avait la même fermeté de pensée contre tous les adversaires de sa foi, qu’ils fussent théologiens ou encyclopédistes, qu’ils s’appelassent de Maistre, Spinosa ou d’Holbach. M. Damiron n’a pas dévié un seul instant de la ligne que son esprit s’était tracée de bonne heure. Philosophe spiritualiste et religieux, mais toujours libre penseur, il n’a jamais rien fait ni pour échapper à la congrégation de l’Index, ni pour en faire révoquer les arrêts. Sa fermeté, en cela, n’avait d’égale que sa douceur.
Que cette foi fût libérale et tolérante, rien de plus simple. Autrement elle n’eût pas été la foi d’un philosophe. Mais ceux qui ne le connaissaient point à fond admiraient toujours comment, prenant au sérieux ses idées au point de souffrir de la contradiction, M. Damiron traitait, je ne dis pas avec convenance, mais avec sympathie les plus décidés adversaires de ses croyances ; comment les Helvétius, les d’Holbach, les Diderot d’une part, les de Bonald, les Lamennais, les de Maistre de l’autre, le trouvaient toujours plein d’égards et d’aménité. Était-ce simple politesse académique ? nullement. Il suffit de lire sa polémique pour voir que la politesse n’a ni ce ton ni cet accent. C’est qu’il en est de la tolérance de M. Damiron comme de ses autres vertus. Il était tolérant à sa manière et selon sa nature, c’est-à-dire qu’il l’était encore plus par le cœur que par l’esprit. Dans sa critique, il lui était impossible de séparer entièrement l’homme du philosophe. Quand donc ces philosophes de l’encyclopédie ou de l’Église se trouvaient être d’excellents ou de nobles caractères, M. Damiron ne pouvait s’empêcher de se prendre d’amitié pour eux. Et alors il lui arrivait ce qui arrive à tous ceux qui aiment. Il cherchait, et combien il était heureux de découvrir, à côté des erreurs qu’il lui fallait signaler et condamner, des vérités, des aperçus, des observations, des sentiments, des mouvements qu’il notait avec bonheur, sans triompher de la contradiction qui semblait en résulter. C’est là ce qui fait, non pas seulement l’intérêt (tous les mémoires publiés par lui ont ce caractère à un haut degré), mais le charme particulier, mais l’originalité des études sur Spinosa, sur Helvétius, sur d’Holbach, sur Diderot. D’autres critiques, à l’esprit sinon plus large, du moins plus souple, ont pu traiter avec plus de complaisance ces philosophes du XVIIIe siècle. Nul n’a aussi bien vu, aussi bien montré la bonté, la générosité, la foi ardente, l’abnégation personnelle de ces singuliers apôtres, sous la pauvreté, la légèreté, et parfois l’immoralité des doctrines. Aujourd’hui, on parle d’or sur toutes choses ; le plus pur spiritualisme coule de toutes les lèvres. J’aime à croire qu’il est aussi au fond des cœurs ; mais j’en voudrais voir les effets dans les œuvres. Nous pensons d’une façon bien plus correcte que nos pères. On n’entendrait plus dire sans scandale parmi nous que l’homme n’est qu’une machine ou un animal, que le bien et le mal se réduisent à l’intérêt bien ou mal entendu, que le sentiment de notre liberté et de notre responsabilité personnelle n’est qu’une illusion, que tout n’est que matière, le mouvement, la vie, l’âme, l’intelligence. Et tous les esprits élevés, toutes les âmes généreuses, doivent applaudir à ce progrès de la philosophie française. Mais en voyant l’étrange contraste des faits et des doctrines, n’est-il pas permis d’avoir un peu d’indulgence, et avec notre cher Damiron, même un certain degré de sympathie pour ces pauvres philosophes qui pensaient parfois si mal et agissaient souvent si bien ? Pour moi, j’avoue que je n’ai pu lire sans être ému à en verser des larmes le touchant mémoire sur mon compatriote Diderot. La pensée de cet homme excellent, si vive d’ailleurs, si-féconde, si étincelante d’aperçus et d’idées, n’a pas toujours été aussi noble, aussi pure que ses sentiments. Ceux qui liront M. Damiron verront comment un sage, mais un sage qui est bon, traite une de ces bonnes, loyales, et soudaines natures égarées, à la suite de leur siècle, dans les basses régions de la pensée.
Toute foi est communicative. Celle de M. Damiron s’épanchait dans ses livres, dans ses cours, parfois dans de rares conversations avec de jeunes amis, où son âme s’échappait avec sa pensée, sans controverse ni discussion. Il se gardait de produire ses idées à tout propos et à tout venant. Non qu’il eût peur que la contradiction ne vînt éveiller chez lui des doutes et provoquer des défaillances. Sa foi n’était pas une de ces plantes délicates que le vent de la critique dessèche ou déracine. Mais d’abord il n’aimait pas jeter les choses saintes, comme il disait, les graves questions de la métaphysique en pâture aux railleries ou aux légèretés d’une conversation mondaine. Ensuite la contradiction lui était doublement désagréable. Il en souffrait pour lui-même et dans sa foi qui était sa vie ; et il en souffrait aussi pour autrui, par un sentiment d’irrésistible sympathie. Car il était de ces âmes dont l’extrême délicatesse s’étudie à écarter les occasions de froissement, encore plus pour les autres que pour soi-même.
Ses amis le savaient, et se seraient trouvés mal à l’aise de penser autrement que lui. Assurément la vérité a ses droits, et la mission de l’écrivain a ses devoirs qui priment tout. Mais il est des hommes en compagnie desquels on est tout heureux de poursuivre cette vérité. Le digne philosophe, l’ami vénéré que nous venons de perdre ne s’est jamais douté, dans sa candide modestie, de l’empire qu’il exerçait autour de lui, par l’attrait de sa douceur et le respect de sa foi. L’empire, l’autorité, l’ascendant ! les caractères violents, les âmes serviles en cherchent le principe dans la force qui contraint, qui insulte et qui écrase. Pour moi, dont le caractère n’est ni de fer ni de roc, j’ai toujours eu un superbe mépris pour la force orgueilleuse et insolente ; mais aussi, je l’avoue, j’ai peine à tenir devant la force de la douceur et de la bonté. Quand, pour continuer à suivre la voie que je croyais celle de la vérité, j’ai dû m’écarter des rangs où j’avais combattu sous le même drapeau que M. Damiron, mon grand souci, dirai-je mon trouble, a été celui-ci : que pensera notre cher philosophe ? Et ici encore je ne craignais pas pour son estime, pour son amitié. Je savais que toute pensée sincère et sans nulle prétention personnelle, quelque hardie qu’elle lui parût, pourvu qu’elle fût toujours haute et sévère, sur de si difficiles problèmes, obtiendrait sinon l’assentiment, du moins le respect de cet esprit si dévoué à la recherche du vrai. Mais je prévoyais que ce sentiment serait mêlé d’un regret et, pour dire le mot, d’un véritable chagrin.
Je l’ai vu, je l’ai senti, ce sentiment dans les lettres animées, éloquentes, presque vives, mais toujours si affectueuses qu’il m’écrivait en réponse à l’envoi de mon livre sur la métaphysique et la science. Ce livre lui était tombé des nues au milieu d’une terrible épreuve. Il s’agissait de la vie de l’être qui lui était le plus cher au monde, de la vie d’une sœur dont je ne veux rien dire ici, sinon qu’elle fut digne de lui. Elle était au plus mal. Il ne quittait guère le chevet de son lit. C’est dans ces cruels moments qu’il prenait la plume pour défendre la foi de toute sa vie. « Plus j’avance dans votre livre, plus je tremble pour le dénouement. Votre critique ressemble à ces chars armés de faux qui ne laissent rien debout sur leur passage. Que restera-t-il à notre philosophie, après cette guerre acharnée à tout ce que vous appelez les abstractions, les entités et les idoles de la vieille métaphysique ? » Il lui restait, il le savait bien et m’en a toujours félicité, toutes ces grandes et immortelles vérités morales sur lesquelles il n’est pas permis à tout homme qui a une conscience d’hésiter, aujourd’hui moins que jamais. Je pouvais me séparer de mon cher maître, sur les hauts sommets de la métaphysique, concevoir autrement que lui le Monde et Dieu, la Nature et la Providence, la vie individuelle au sein de l’Être universel. Ce sont des points sur lesquels d’honnêtes gens peuvent ne pas tomber d’accord. Mais la nature, la fin et la loi de notre être, le bien, le beau, le devoir et le droit, la liberté et la dignité de la personne humaine ; mais la morale tout entière, telle que l’ont enseignée et écrite partout et toujours les philosophes et les sages de la grande école à laquelle se rattachait M. Damiron, j’aurais perdu l’estime et le respect de moi-même le jour où j’eusse cessé d’y croire et de la professer en compagnie de cet ami vénéré.
Tout entier au culte de sa religion (il prenait ainsi la philosophie), M. Damiron s’est toujours tenu en dehors de la vie politique. Je veux dire par là qu’en pratiquant, avec courage au besoin, tous les devoirs qu’elle impose au citoyen, il a toujours refusé d’y prendre un rôle. Mais nul n’est resté plus fidèle à ses principes et à ses amis. Il était de cette génération libérale qui, née parmi les orages-de la Révolution, avait grandi au milieu des pompes de l’Empire. Les souvenirs de l’une, les spectacles de l’autre, avaient inspiré aux hommes de son âge, avec quelques préjugés et quelques illusions, deux grands sentiments : le goût de l’ordre et l’amour de la liberté. Le despotisme, qui achève d’abaisser le commun des âmes, a cela de bon qu’il est singulièrement propre à relever, à exalter les âmes d’élite.
Je voudrais pouvoir dire en terminant : Voilà le sage que nous avons perdu. Mais tous ceux qui ont connu M. Damiron trouveront qu’il manque bien des traits à la faible esquisse que j’essaye de tracer. C’est bien ce qui m’a fait hésiter à prendre la plume sur un tel sujet. Je sens que je n’ai pas retrouvé notre ami tout entier. « Cher maître, que votre modestie ne s’offense pas de mon indiscrète témérit. La plume a pu faire défaut, non le cœur. Votre digne sœur, et l’ami de quarante ans qui seul pouvait parler de vous, si une douleur comme la sienne n’était pas muette, en lisant ces faibles lignes, me pardonneront tout ce qui manque à votre image, en faveur de ce qu’une main trop émue a pu y mettre de vrai. Votre mort si brusque n’a pas laissé à ceux qui vous ont le mieux connu et le plus aimé la liberté de vous dire l’éternel adieu. J’ai voulu suppléer à ce silence. »
Il est mort comme il a vécu, le livre à la main, la parole de vérité sur les lèvres, au sortir d’une séance de l’Institut, où il couronnait par une dernière étude sur Condillac la série de ses beaux mémoires sur toute la philosophie moderne. Mort bien douce pour lui, comme devait être celle d’un juste et d’un sage dont le cœur, riche de toutes les nobles et saintes affections, n’a pas connu une seule des passions qui dévorent ou empoisonnent la vie ! Mort cruelle pour celles qui le perdent au plus vif de leur bonheur, au plus profond de leur sécurité ! Mort bien triste pour une société d’amis dont il était le centre et le lien ! Il n’eût pas voulu mourir si vite, nous le savons. Pourquoi ? Y eut-il un sage plus prêt que lui à paraître à toute heure devant le grand Juge ? Si sévère qu’elle fût, sa conscience ne pouvait manquer d’être en paix. Hélas ! ce n’était pas sa conscience qui demandait du temps, c’était son cœur-qui pressentait tout ce qu’une brusque séparation aurait de déchirant pour celles dont la vie semblait inséparable de la sienne !
E. VACHEROT.
Ce n’est pas le sujet qui fait l’unité de ce livre. Nous y traitons une série de questions psychologiques, logiques, métaphysiques, morales, historiques dont la succession ne forme point un ordre systématique. C’est à propos de certaines publications qui intéressent la critique que nous avons repris les questions indiquées ou développées par les auteurs des livres cités, en leur donnant une solution tantôt conforme, tantôt contraire à celle des auteurs eux-mêmes ; en sorte qu’envisagé à ce point de vue, ce livre ne saurait avoir d’autre titre que celui de Mélanges.
Mais l’unité d’un livre peut tenir à autre chose que le sujet. Si un même esprit anime les matières les plus diverses, si une seule méthode préside au développement et à la solution des questions de tout ordre, le livre prend un certain caractère d’unité, parce qu’on peut voir dans ses différentes parties, sinon les développements d’une même pensée, du moins les applications d’une même méthode. Telle est l’œuvre que nous offrons au public. Pour l’éclaircissement ou la solution des problèmes posés, nous avons écarté toute conception à priori, toute considération abstraite, toute hypothèse, en nous renfermant strictement dans les limites de la science pure, quel que soit l’objet de notre étude, matière, force, âme, esprit, sensation, idée, certitude, devoir, progrès. Notre but n’est pas de donner une solution nouvelle à tous ces problèmes, mais de montrer comment la solution en devient plus précise et plus solide, quand la science positive leur prête ses lumières. Nous ne prétendons pas que la science ait prise sur toutes les questions qui sont du domaine de la philosophie, de manière à les ramener à des problèmes purement scientifiques. L’esprit humain serait trop heureux qu’il en fût ainsi. Nous avons fait voir ailleurs que la métaphysique proprement dite ne peut se passer de certaines conceptions à priori ; et dans ce livre encore, on pourra remarquer que certaines questions relatives à l’infinité du Monde, dans le temps et dans l’espace, se dérobent à la compétence des sciences positives. Mais s’il y a des questions qui s’y prêtent, n’est-ce pas une bonne fortune à saisir, dans un temps surtout où l’on ne croit guère qu’à la science, à ses procédés et à ses résultats ?
Voilà la pensée de ce livre. Psychologie, logique, métaphysique, morale, tout y est traité par l’observation et par l’analyse. Avec une pareille méthode, on ne pénètre pas, nous le savons, tous les mystères de l’ontologie ; mais on avance sûrement dans la solution des problèmes réservés à la connaissance humaine. Peut-être même, si l’on ne se payait plus de mots, trouverait-on que ces mystères tiennent plus aux termes qu’aux objets métaphysiques, et que les mots de matière, de force, d’âme, d’esprit, etc., etc., deviendraient clairs et intelligibles, du moment où l’on s’habituerait à n’y voir que la simple expression des propriétés et des lois de la réalité. Quoi qu’il en soit, la philosophie n’est pas de ces études spéciales auxquelles les autres sciences soient inutiles ; elle comprend nombre de questions qui trouvent dans les sciences positives la matière même de leur solution, et elle en compte peu qui n’empruntent à ces sciences quelques-unes des données dont elle a besoin pour les résoudre.
L’application persévérante de cette méthode aux problèmes les plus divers de psychologie, de logique, de métaphysique, de morale et de philosophie historique, justifie, ce semble, le titre donné à la série d’analyses et de critiques que comprend ce livre.
Parmi les diverses parties dont il est composé, il en est de tout à fait neuves : ainsi la première, consacrée à la question des rapports de la philosophie et des sciences, et la deuxième, qui a pour objet la défense des études psychologiques contre l’école historique et l’école positive. Quelques pages publiées, il y a treize ans, sur un livre de M. Cournot, ne donnent aucune idée du travail d’analyse et de critique qui remplit plus du tiers du volume. La troisième et la quatrième partie se composent d’études qui ont déjà paru dans divers recueils, mais qui, pour l’analyse et la critique, n’avaient ni l’étendue ni la portée suffisantes pour un livre. C’étaient de simples articles de revues qu’il nous a fallu développer pour leur donner les proportions de véritables chapitres philosophiques. Nous espérons qu’avec les modifications et les accroissements qu’ils ont reçus, ils ne paraîtront pas trop au-dessous des justes exigences de la philosophie contemporaine.
E. VACHEROT.
19 juillet 1864.
(Essai sur les fondements de nos connaissances, 2 vol., 1851. – Traité de l’enchaînement des idées fondamentales, 2 vol., 1861 ; par A.A. Cournot, ancien inspecteur général de l’instruction publique.)
Pour tout esprit qui s’intéresse à l’avenir des études philosophiques, il est manifeste qu’elles traversent en ce moment une crise redoutable. Depuis le début de ce siècle, la philosophie n’en avait pas connu d’aussi grave, d’aussi difficile, et qui mît à ce point son existence en péril. Les symptômes de cette crise éclatent à tous les yeux ; et la lutte renaissante entre le matérialisme et le spiritualisme, dans les grands pays philosophiques de l’Europe, n’en est pas peut-être le plus menaçant, malgré le bruit qui se fait autour des adversaires, et les grands intérêts engagés dans le combat.
Il semblait que la mission de la philosophie du XIXe siècle fût de terminer le débat entre les deux doctrines ; une devant les larges méthodes, les profondes analyses, les grands principes de cette philosophie, soit en Allemagne, soit en France, les écoles rivales allaient abdiquer leurs prétentions exclusives ; que les deux doctrines enfin pouvaient être réduites à deux points de vue faciles à concilier et à fondre dans une synthèse supérieure. Tout pacifier, tout expliquer, tout accepter dans une certaine mesure était la devise et la constante aspiration des écoles nouvelles, en deçà comme au-delà du Rhin. Si l’on conservait plus d’estime et de goût pour la philosophie des idées que pour la philosophie de la sensation ; si Descartes, Malebranche, Leibnitz, paraissaient fort supérieurs à Locke et à Condillac, on n’en croyait pas moins à la nécessité d’une transformation de toutes les doctrines du passé dans le sein d’une philosophie plus compréhensive, et l’on n’exceptait pas de cette nécessité le spiritualisme de Platon et de Descartes.
Cette illusion de paix définitive et perpétuelle a disparu avec les grandes écoles qui, en Allemagne et en France, en avaient fait leur drapeau. La lutte reprend partout, disons mieux, la guerre, avec une force, une ardeur, une passion que nous ne regretterions pas trop, malgré les malentendus qui recommencent, si la philosophie seule se déployait dans ce débat. Car toute passion est un signe de vie ; et quand nous voyons la lutte s’animer, les adversaires s’enflammer, le public qui fait cercle s’intéresser et s’émouvoir, nous ne craignons plus le mortel ennemi de la philosophie, l’indifférence. Seulement, nous voudrions que la philosophie se suffit à elle-même, dans ce grand conflit, et qu’elle n’acceptât d’auxiliaires d’aucune espèce ni d’aucun côté, quelque grands et légitimes que puissent être d’ailleurs, au point de vue social, les intérêts représentés par les hautes puissances qui tendent à intervenir dans le débat.
Quoi qu’il en soit, voici la situation des deux partis. D’un côté, le matérialisme reparaît sur la scène, après le discrédit des grands systèmes de l’idéalisme allemand, et malgré les habiles méthodes de l’éclectisme français ; il n’a changé ni de principe, ni de méthode ; il s’est si peu transformé au contact de la nouvelle philosophie, qu’on le prendrait volontiers pour une reproduction des idées d’Holbach et de Diderot, si l’appel aux faits révélés par le progrès des sciences positives n’en venait manifester l’origine tout à fait contemporaine. Telle est la seule originalité de ce nouveau matérialisme. C’est toujours cette philosophie de l’imagination qui se croit en pleine lumière, quand elle s’est établie dans une pure représentation sensible, et qui continue à expliquer l’être complexe par l’être simple, la vie par la force, l’âme et l’esprit par la vie, parce que l’être complexe a pour base l’être simple ; et que la vie organique repose sur la force purement physique ou chimique, de même que la sensibilité et l’intelligence ont pour base la vie organique elle-même. Ce matérialisme n’a pas précisément la science positive pour lui, mais il prétend l’avoir ; et comme il n’invoque qu’elle, il passe, aux yeux du vulgaire, pour la vraie philosophie du monde savant.
D’un autre côté, se présente un spiritualisme aussi peu nouveau que le matérialisme dont nous venons de parler, continuant à invoquer les grandes autorités de l’histoire, le sens commun, le salut des âmes et des sociétés, comprenant toutefois que la grande autorité de ce temps-ci est celle des sciences positives, et cherchant habilement à la mettre de son côté, mais n’osant pas se confier entièrement à ses fécondes révélations, et conservant trop religieusement toute une tradition d’idées et d’arguments vieillis qui ne peuvent que nuire à sa thèse, parce qu’ils ne sont plus en harmonie avec les notions nouvelles de la science sur les propriétés de la matière. Toujours fort et victorieux contre les conclusions grossières de ses adversaires, le spiritualisme ne réussit pas également à faire comprendre son principe, et à le concilier avec les faits de l’histoire naturelle. Toutes les intelligences élevées, toutes les âmes d’élite sont pour ce principe, sans lequel la volonté, la liberté, la conscience, la vie morale enfin devient inexplicable. Mais si les savants proprement dits ne sont pas tous pour le principe contraire, grâce à Dieu ; il serait difficile de nier que l’hypothèse matérialiste, plus simple, plus claire en apparence, plus à la portée des esprits dont l’imagination est la faculté dominante, ne gagne du terrain dans ce monde plutôt industriel que savant, pour lequel tout ce qui ne se voit ou ne se touche pas est pure abstraction.
Certes, on ne nous fera pas l’injure de nous croire du nombre de ceux qui assistent à cet intéressant débat en curieux indifférents, et simplement pour compter les coups, noter les bons mots et les traits heureux, admirer les mouvements de véritable éloquence, ou les passes habiles d’une dialectique consommée. Nous prenons nettement parti pour le spiritualisme contre le matérialisme. Si les sciences de la Nature nous charment et nous subjuguent par leur solidité, leur exactitude, leurs merveilleux effets sur la civilisation générale, elles ne nous font pas oublier les sciences et les vérités de l’esprit qui sont la substance la plus pure, le sel conservateur de cette civilisation. Nous ne croyons pas que le matérialisme tienne plus devant la science de notre temps que devant la conscience du siècle ; nous voulons donc le triomphe définitif du spiritualisme. Mais nous le voulons par d’autres méthodes et avec les transformations que réclame le progrès des sciences. Nous le voulons surtout, sans qu’il soit fait appel à d’autres considérations que les raisons tirées de l’observation et de l’analyse scientifique. Les plus nobles, les plus respectables auxiliaires ont leur inconvénient, nous dirons même leur danger, du moment qu’on va les chercher en dehors de la science elle-même. Ainsi nous comprenons bien qu’au point de vue social, des puissances d’un ordre différent, comme la morale et la religion, unissent leurs efforts pour combattre tel ou tel ennemi commun, tantôt le matérialisme instinctif des masses, tantôt l’industrialisme d’une époque, tantôt l’immoralité générale d’une société en décadence. Mais cette alliance, que le moraliste peut désirer, que le politique doit rechercher, devient impossible dans une œuvre philosophique, si le philosophe tient à conserver toute son indépendance. Il en est, sous ce rapport, de la religion comme de la politique. Ces deux institutions ont un but éminemment social, tandis que la philosophie a pour but immédiat, sinon unique, la recherche de la vérité, en dehors de toutes considérations politiques, religieuses et même morales. La science pour la science, la vérité pour la vérité, telle doit être sa devise, dans la question du matérialisme et du spiritualisme, comme dans toutes les autres.
Pour dire toute notre pensée, en ce moment la querelle du matérialisme et du spiritualisme, malgré le profond intérêt moral qui s’y attache, n’est pas encore ce qui nous touche le plus. Nous trouvons la situation plus grave pour la philosophie, en ce que ce n’est pas seulement telle de ses grandes doctrines qui est en péril, mais sa propre existence. Pendant que les écoles philosophiques s’attaquent avec plus ou moins de justice et de mesure, il y a une école de savants qui les regarde, les juge, et se propose de les congédier dos à dos. L’école positive, c’est son nom, ne veut plus entendre parler des questions qui ont donné lieu aux doctrines et aux débats nés de la contradiction des doctrines. Matière, force, vie, âme, esprit, cause, substance, Infini, Universel, Dieu, sont des mots qu’elle se résigne à conserver dans le dictionnaire de la langue usuelle, mais à condition qu’on renoncera à la recherche de leur objet. Comme elle ramène avec Bacon, son premier père, toute la science et toute la philosophie à la connaissance des faits, des lois et des rapports, pour elle, toutes les questions proprement métaphysiques sur les principes des choses, ou sont sans objet réel, ou ont un objet qui dépasse la portée de la science. Elle tend donc à supprimer tout à la fois les débats, les doctrines, les questions, et la science elle-même qui agite les unes et engendre les autres, c’est-à-dire la métaphysique. Si elle conserve la philosophie, c’est à la condition d’en faire simplement le système des rapports qui unissent toutes les sciences spéciales entre elles.
Cette école a de nombreux adeptes en France, en Allemagne, en Angleterre surtout, dans tous les grands foyers de la science moderne ; elle fait de rapides progrès dans le monde savant ; elle compte parmi ses disciples des hommes comme MM. Comte, Littré et Stuart Mill. Mais ce ne sont ni ces noms ni ces progrès qui nous inquiètent le plus pour l’avenir de la métaphysique, quelles que soient la vigueur de leur esprit et l’étendue de leurs connaissances. L’école positive est surtout redoutable parce qu’elle répond tout à la fois à un instinct général et permanent de l’esprit humain, et à une disposition particulière et actuelle de l’esprit contemporain. Le véritable père du positivisme, ce n’est pas Auguste Comte, ce n’est même pas Bacon ; c’est plutôt l’empirisme, dont le génie anglais est le type le plus vigoureux, et dont le novum organum est le code le plus complet ; c’est l’empirisme, dans le sens le plus large et le plus élevé du mot, c’est-à-dire la méthode et la doctrine qui entend tirer toute la science humaine et la philosophie elle-même de l’expérience, et qui retranche du domaine de la connaissance positive tout objet qui n’est pas un fait, une loi, un rapport. Or, comme c’est avec cette méthode, enseignée avec tant de grandeur et d’éloquence par Bacon, appliquée avec tant de génie et de succès par Newton, que les sciences de la Nature ont fait la conquête de l’esprit moderne, et sont en train de faire celle du Monde ; on s’explique la puissance et la popularité de l’école qui est venue, de nos jours, en proposer la formule la plus absolue et la plus précise. Au fond, l’école positive doit sa force surtout à l’esprit positif du siècle, à cet esprit qui ne croit qu’aux méthodes, aux démonstrations, aux conclusions scientifiques.
Quand nous disons que notre siècle n’a foi qu’en la science, nous n’entendons pas le faire plus sage qu’il n’est réellement. On a beau être l’esprit du XIXe siècle ; on est toujours l’esprit humain. Toutes les synthèses de la spéculation, toutes les folies de l’imagination se retrouvent dans le tableau des œuvres intellectuelles de ce siècle. En fait de merveilles de la pensée, on y voit les grands systèmes de l’Allemagne idéaliste, et les belles doctrines de la France spiritualiste. En fait d’illusions et de superstitions, rien n’y manque non plus, pas même ce mysticisme grossier des tables tournantes et des esprits frappeurs, qui paraît avoir remplacé chez un assez grand nombre d’imaginations contemporaines la foi de nos pères au surnaturel. Mais si l’esprit du siècle a plus d’estime pour les choses qui sont au-dessus de la science positive que pour celles qui sont au-dessous, il faut avouer qu’il n’a guère plus de goût et de confiance pour les unes que pour les autres. D’abord tout ce qui est objet de pure spéculation n’éveille en lui qu’une médiocre curiosité ; il ne consent à entendre parler de matière, d’âme, d’esprit, de Dieu, qu’autant qu’on lui démontre l’importance morale et sociale de ces problèmes. C’est par le côté pratique seulement qu’ils le touchent et l’attachent. Or, un pareil intérêt n’a rien de philosophique.
Il y a pourtant un autre point par lequel l’esprit du siècle s’y sentirait attiré ; c’est le côté scientifique. Si l’esprit du siècle a plus d’affinité avec la philosophie positive qu’avec toute autre, il ne faut pas croire qu’il en soit le complice aveugle, dans la guerre ouverte déclarée par cette école à tout ce qui ressemble à de la métaphysique. Il n’est ni aussi étroit, ni aussi systématique à cet égard ; il a plutôt une défiance instinctive qu’un parti pris à l’endroit des questions de ce genre. Il y a plus : quand on les lui présente sous un jour scientifique, on voit qu’il s’y intéresse et s’y attache ; mais il est évident que c’est la condition de toute confiance et de toute foi en ces sortes de doctrines. Donc, la seule manière de ramener l’esprit du siècle au goût et à l’étude sérieuse de la métaphysique, est de les traiter par la méthode des sciences positives, et de les éclairer de leur lumière. Autrement, ni la politique, ni la morale, ni l’éloquence, ni le génie, ni l’autorité de l’histoire ne la sauveront des attaques de l’empirisme, ainsi que de l’indifférence du monde savant.
Mais, dira-t-on, est-ce que la métaphysique peut être traitée scientifiquement ? Est-ce que la nature des problèmes qu’elle comprend, et le nom même qu’elle porte, ne protestent pas contre une pareille prétention ? La métaphysique et la philosophie ayant eu de tout temps l’ambition de pénétrer l’essence et le fond des choses, et de s’élever aux premiers principes d’où les choses dérivent, il semble que la science positive n’ait rien à voir dans de pareilles spéculations, soit que de tels objets se trouvent réellement hors de la portée de l’esprit humain, soit que l’esprit humain puisse les atteindre par des procédés d’un autre ordre que les méthodes positives.
Nous ne savons pas ce qu’on entend par l’essence et le fond des choses, si cela ne signifie pas tout simplement certaines propriétés essentielles et permanentes des choses, dont les caractères, les lois et les rapports subsistent indépendamment des conditions de perception ou de représentation sensible. En ce sens, les sciences positives, aussi bien que la philosophie et la métaphysique, ont pour objet le fond et l’essence même des choses. C’est précisément ce qui distingue l’apparence de la réalité, et l’image de l’idée. La science peut se faire à l’aide d’images ; mais elle ne se compose que d’idées, c’est-à-dire de notions qui ont une véritable réalité objective. Le mot ontologie n’a pas d’autre sens, à notre avis. Donc, toute science véritable a un caractère ontologique, et nous pourrions dire que le savant fait de l’ontologie sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose. Sauf les mathématiques, qui ont pour objet des abstractions, toutes les sciences traitent de la réalité, et la métaphysique ne fait point exception sous ce rapport. Toute la différence entre elles est dans le degré de généralité, de profondeur, de grandeur, de précision de leur objet. Il est certain que les objets métaphysiques proprement dits, comme la substance, la cause, la matière, la vie, l’âme, l’esprit, sont des réalités plus difficiles à définir que les objets scientifiques, en raison de leur complexité, ou de leur abstraction, ou de leur étendue. Mais enfin ce sont des réalités, c’est-à-dire des choses qui ne peuvent être connues que par l’observation et l’analyse des propriétés qui en révèlent l’existence. Donc, ou la métaphysique est un pur jeu de dialectique, un tissu d’abstractions sans substance ; ou elle est une vue supérieure de la réalité fondée sur les résultats de l’observation et de l’expérience. Que l’abstraction, l’analyse des idées, la définition, et en général les procédés logiques aient une plus grande part que les méthodes expérimentales et descriptives dans le développement des questions métaphysiques, cela est incontestable et s’explique par la nature abstraite et générale des objets auxquels elles se rapportent. Mais, de même que les plus hauts problèmes de la géométrie et de l’astronomie, elles trouvent leurs données élémentaires dans l’observation des faits. Le métaphysicien a beau s’élever sur les ailes de l’abstraction ; si sa tête se perd dans le ciel, ses pieds ont touché à la réalité.
Et quand nous parlons de la métaphysique et de ses rapports avec la science positive, nous ne la confondons point avec cette science générale qui n’a pas de matière propre, et qui, sous le nom de philosophie, ne peut être considérée que comme une sorte de synthèse, dont la science proprement dite serait l’analyse. Il est trop clair qu’une pareille spéculation de l’esprit, consistant à saisir les rapports les plus étendus et les plus complexes des choses, et à s’élever, par l’intuition de ces rapports, à la plus haute unité possible, dans l’ordre de faits et de réalités auquel elle se rapporte, n’est possible qu’en prenant la science positive elle-même pour base et pour point de départ. L’école d’Auguste Comte, qui ne veut pas entendre parler de métaphysique, aime, estime et cultive ce genre de philosophie ; c’est même par là qu’elle s’est fait une place à part dans le monde savant. La philosophie des sciences n’est pas la métaphysique ; elle a son existence propre, et sa destinée qui n’est point inséparable de celle de la métaphysique ; en sorte que celle-ci pourrait disparaître du domaine des sciences humaines, sans que celle-là fût menacée d’en sortir.
Et telle serait, en effet, la destinée de la métaphysique, s’il était vrai, comme le prétend l’école positive, qu’elle n’a rien de commun avec la science. S’il est une vérité acceptée aujourd’hui par les philosophes, aussi bien que par les savants, c’est qu’il n’y a pas de connaissance à priori de la réalité. Qu’il s’agisse des corps ou des esprits, des individus ou des universaux, on ne peut en savoir que ce que l’observation ou l’expérience nous en apprennent ; et le travail d’abstraction et d’analyse qu’exigent les objets les plus généraux, les plus élevés, les plus métaphysiques de la science humaine, repose sur la même base que le travail de pure observation et de simple description que demande l’étude de la réalité la plus humble et la plus grossière. La seule réserve à faire à ce principe s’applique, non à la connaissance proprement dite, mais à la conception de certains objets métaphysiques, tels que l’infini, l’universel, l’absolu, dans les diverses catégories de l’être. Ici il est évident que les révélations de la science positive ne suffisent plus, et que l’esprit ne peut s’élever plus haut, dans la carrière ouverte à sa pensée, qu’en s’aidant de certains principes à priori, dont la nécessité logique n’est pas contestable. Que ces principes dits rationnels soient l’œuvre de l’abstraction et de l’analyse, comme il ne semble pas déraisonnable de le croire, ou qu’ils soient le fruit propre d’une faculté supérieure et originale de l’esprit, comme le pensent la plupart des métaphysiciens, c’est une question à décider. Toujours est-il que le caractère à priori de ces principes, ainsi que des conceptions qui en dérivent, est hors de doute, quelle qu’en soit l’origine. Si donc la métaphysique se réduisait à ce petit nombre d’axiomes et de principes qui en constituent la partie supérieure et vraiment transcendante, on ne voit pas quel rapport elle pourrait avoir avec les sciences positives, ni surtout comment elle en aurait besoin pour ses conceptions et ses déductions. Nous pensons que c’est là le véritable élément métaphysique de la connaissance humaine, parce que c’est le seul qui soit vraiment à priori, et qu’il se compose de conceptions proprement dites qui ont pour objet, non pas telle réalité déterminée, mais la Réalité universelle, dans toutes les catégories de la pensée. Mais tout ce que l’on comprend généralement sous ce mot un peu vague, en dehors de ces quelques conceptions, comme les idées de matière, de force, de substance, de cause, de vie, d’âme, d’esprit, rentre dans le domaine de l’expérience et de la science proprement dite. Ces questions-là nous paraissent de nature à être traitées scientifiquement, parce qu’elles ont pour objet, non des principes à priori, mais des réalités qu’il s’agit surtout d’analyser et de définir, et sur lesquelles la science positive peut et doit être interrogée.
Cette méthode, du reste, n’a pas le mérite de la nouveauté. L’histoire de la philosophie nous enseigne qu’elle est aussi ancienne que la métaphysique elle-même. De tout temps la métaphysique a emprunté à la science, et particulièrement aux sciences de la Nature, les éléments de ses systèmes et de ses doctrines. Seulement, tant que ces sciences elles-mêmes ont été livrées à la spéculation pure, à l’hypothèse, à la méthode des analogies douteuses ou superficielles, elles ne pouvaient fournir que des données fausses, vagues ou incomplètes pour la solution des questions métaphysiques. D’ailleurs, à vrai dire, au lieu de recevoir ses premiers enseignements des sciences positives, c’était la métaphysique qui leur imposait ses conceptions et ses principes à priori. Toutes les sciences subirent d’abord cette domination, depuis les premiers essais de physique, de cosmologie et d’histoire naturelle des écoles antésocratiques, jusqu’aux grands systèmes de philosophie naturelle qui ont paru aux XVIe et XVIIe siècles. C’est à tel point que les sciences de la Nature n’ont été véritablement constituées comme sciences, et n’ont commencé cette série de progrès qui fait la gloire de l’esprit moderne, qu’à partir du jour où elles ont été entièrement émancipées de la tutelle de la métaphysique, où elles ont eu leur but, leur objet et leur méthode propres. Cette séparation des sciences positives et de la métaphysique enseignée par Bacon, pratiquée par tous les savants, à partir du XVIIIe siècle, consacrée par les succès croissants des recherches scientifiques, était la condition de l’existence même et des progrès de la science positive.
Que les sciences donc poursuivent leur œuvre, avec les méthodes et les principes qui leur sont propres, sans s’inquiéter de l’avenir de la métaphysique, rien de plus simple et de plus nécessaire. Mais les métaphysiciens auraient grand tort de faire comme les savants. Si les sciences positives peuvent se passer de la métaphysique, celle-ci a besoin absolument des sciences positives ; c’est une vérité qui a été reconnue et pratiquée de tout temps par les grands esprits qui ont essayé d’embrasser dans leurs systèmes l’explication universelle des choses. Sans parler des écoles antésocratiques qui ont si bien mêlé et confondu les questions naturelles et les questions métaphysiques, qu’on ne sait parfois si leurs doctrines n’appartiennent pas plutôt à l’histoire des sciences qu’à celle de la philosophie, Platon n’a-t-il pas fondé sa philosophie de la Nature, et en particulier sa théorie des corps et de la matière, sur des conceptions mathématiques empruntées à l’école pythagoricienne ? D’où viennent la théorie des quatre principes et la grande formule de l’acte et de la puissance qui résument toute la métaphysique d’Aristote, sinon de l’expérience et de l’observation comparée ? Il n’y a pas, par parenthèse, de système dans l’antiquité et dans les temps modernes, où la spéculation soit plus en rapport avec l’expérience, où les formules correspondent mieux aux faits, où les sciences expérimentales et descriptives, comme l’histoire naturelle, la psychologie, la morale, la politique, l’esthétique, se relient plus intimement à cette philosophie première à laquelle on a donné le nom de métaphysique depuis Aristote, et à l’occasion du classement de ses divers traités. La preuve manifeste de l’étroite dépendance qui existe entre les parties expérimentales et la partie spéculative de la philosophie péripatéticienne, c’est la facilité avec laquelle les faits et les réalités trouvent leur explication dans les principes et les formules, et réciproquement les principes et les formules trouvent leur application dans les faits et les réalités. La parfaite unité de cette doctrine, l’étroit enchaînement de toutes ses parties, prouvent que le système est composé de pièces homogènes, qu’une même pensée, un même esprit, le remplit tout entier, et que le Principe qui le couronne n’est qu’une suprême généralisation de l’expérience. Pour qui ne se laisse point tromper par l’appareil abstrait et scolastique dont s’enveloppe la pensée intime de ce grand philosophe, s’il est une métaphysique positive, dans le vrai sens du mot, c’est la sienne. Quand Aristote veut définir ce qu’il faut entendre par la matière, la forme ou l’essence, la vie, l’âme, l’esprit, le bien, le parfait, il ne s’égare point dans des spéculations abstraites ; il procède toujours par observation, et prend des exemples dans la réalité la plus simple et la mieux connue. En lisant le XIIe livre de la Métaphysique, consacré surtout à la théologie, on admire comment ce grand et profond esprit s’élève jusqu’au sommet de la Nature sans perdre terre, et retrouve le type de la divine perfection dans la conscience humaine.
Il y a deux écoles qui ont, de tout temps, méconnu cette salutaire alliance de la métaphysique et des sciences ; mais elles ne l’ont jamais méconnue impunément. Nous voulons parler des mystiques et des scolastiques. L’école d’Alexandrie, bien qu’elle possédât toute la science de son temps, en a fait trop peu usage dans ses spéculations métaphysiques ; elle a mieux aimé demander ses notions sur Dieu, sur l’esprit, sur l’âme, sur la matière, sur l’être en général, soit à des abstractions logiques, soit à de vagues et ténébreuses méditations intérieures. A-t-elle réellement élevé l’horizon de la pensée métaphysique ? A-t-elle seulement atteint l’objet de ses mystiques aspirations ? Il faut bien convenir que tout ce qu’elle nous a laissé de plus net, de plus précis, de plus profond sur ces divers problèmes, n’est qu’un commentaire des doctrines de Platon et d’Aristote. Le seul principe qui lui semble propre, et par lequel elle puisse se croire supérieure à ses devanciers, c’est l’Unité de la vie universelle. Or, faute d’avoir cherché dans la science la démonstration et la définition de cette Unité, cette école en a fait quelque chose d’inintelligible et de vide, qui ne répond ni à un sentiment de l’âme, ni à une vue supérieure de l’esprit.
Quant à l’école scolastique qui a surtout fleuri au Moyen Âge, bien qu’elle soit de tous les temps, on peut dire que ce n’est ni l’ardente recherche de la vérité, ni l’effort persévérant, ni la force d’abstraction et la subtilité d’analyse, ni même le génie de la pensée qui lui ont manqué pour la solution des problèmes métaphysiques. Plotin, Proclus, Albert le Grand, saint Thomas, Duns Scott ont fait, en ce genre, des prodiges que la philosophie moderne est plus tentée d’admirer que d’imiter. Et en effet, tout cela a plutôt fait reculer qu’avancer la métaphysique, en la faisant sortir des voies fécondes et vraiment scientifiques où Aristote l’avait engagée, et en l’enfonçant de plus en plus dans les distinctions verbales et les analyses purement logiques.
On ne fera point un pareil reproche à la métaphysique de Descartes, de Malebranche, de Spinosa, de Leibnitz. Outre que deux de ces philosophes sont des inventeurs de premier ordre dans les sciences mathématiques, et que les autres sont fort versés dans ces matières, il est impossible de ne pas reconnaître la trace des sciences exactes et positives dans leur philosophie de la Nature. Descartes et Spinosa empruntent évidemment à la géométrie et à la mécanique leur définition de la matière, ainsi que leurs idées générales sur la cosmologie et la biologie. Si leurs idées sont fausses sur la matière, sur la vie, sur l’âme, sur la nature et les rapports des substances corporelle et spirituelle, cela tient à leur manière toute géométrique et toute mécanique de comprendre, soit le monde de la matière, soit le monde de la vie. S’ils ont erré, ce n’est point pour avoir voulu construire la métaphysique à priori ; c’est pour avoir essayé de la construire avec des éléments scientifiques qui n’étaient pas les plus propres à ce genre de construction. Comme eux, Leibnitz s’est servi de la science positive ; mais plus heureux qu’eux, parce qu’il comprend mieux les propriétés et les lois de la Nature, et surtout de la Nature vivante, il fonde sa notion de la substance matérielle et de la substance en général sur l’expérience physique et psychologique. Et si l’on veut se rappeler les idées principales de cette belle doctrine, on trouvera qu’elles répondent toutes à quelque grand fait, ou à quelque grande loi de l’expérience ; ni l’harmonie préalable, ni l’emboîtement des germes, ni les monades, ni l’optimisme, ni la loi du progrès qui en semble dériver ne peuvent être considérées comme des conceptions à priori, sans rapport avec les données de la science positive.
La philosophie du XVIIIe





























