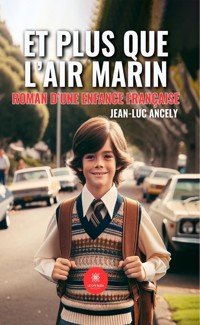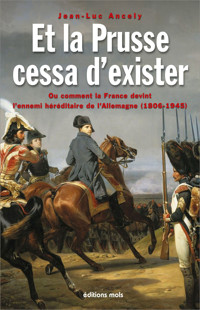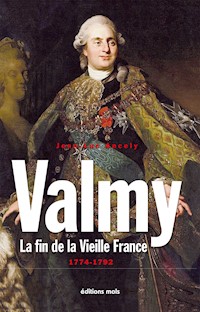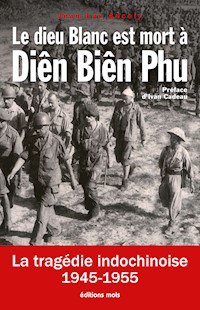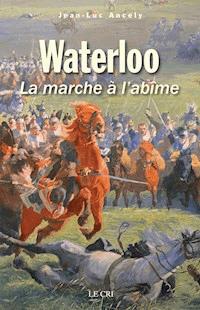Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La route de Zanzibar conte l’histoire d’un homme très ordinaire, médiocre, mal aimé, hypocondriaque, qui est habité par un rêve : partir ! Partir, seul, à la voile, faire le tour de l’Afrique jusqu’à Zanzibar. Parviendra-t-il à accomplir ce voyage ? À changer de vie ? Nous sommes tous, peu ou prou, dans l’espérance d’un départ. Pourtant, comme le dit W. Faulkner : « Cette espérance sans fondement qui est la nourriture des faibles » est-elle justifiée ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Parce qu’il a quelque chose à dire,
Jean-Luc Ancely écrit. Considérant la littérature comme un partage, il apprécie les moments d’échange avec les lecteurs. Il croit fermement, comme Alfred de Vigny, au « rôle social de l’écrivain ».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean-Luc Ancely
La route de Zanzibar
Roman
© Lys Bleu Éditions – Jean-Luc Ancely
ISBN :979-10-377-5571-1
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Du même auteur
Essais historiques
– Waterloo, la marche à l'abîme, Mols (Belgique) ;
– Napoléon aura-t-il lieu? Mols (Belgique) ;
– Le dieu Blanc est mort à Diên Biên Phu, Mols (Belgique) ;
– Valmy, la fin de la Vieille France, Mols (Belgique).
Conte et nouvelles
– Ainsi sont-ils, Mols (Belgique).
Roman
– Les remparts de Sodome, Maïa éditions.
Poésie
– Le feu et la cendre, Presses littéraires (prix Châteauneuf 1994 de la Société des Poètes Français).
1
Biip. Biip. Le thermomètre s’obstinait à afficher trente-sept deux. « 37,2°, ce n’est pas de la température », tenta de se convaincre Sidney. « Mais hier, je n’avais que trente-sept. Faudra suivre cela de près. Et puis, cette rougeur au pied droit, ce fourmillement dans les orteils, ne serait-ce pas du diabète ? Je vais consulter, faire contrôler ma glycémie. »
Sidney appréhendait la réaction fatiguée du praticien. Il préjugeait de son verdict : « Mais vous n’avez rien, monsieur Lerat. Vous n’avez jamais rien. Je me tue à vous le répéter, chaque semaine que vous me consultez. J’en vois passer des malades, des malportants. Vous, vous n’êtes qu’un inquiet, un angoissé. Comment dites-vous ? »
— Mais, docteur, ce ganglion, là, sous la mâchoire…
— Vos ganglions sous-maxillaires sont un peu durs, un peu enflés, c’est vrai mais c’est bénin. Allons, je vous ai ausculté ; vous avez fait des radios, un scanner, une IRM, des bilans de toute sorte, bref, tout ce qui est techniquement et médicalement possible. Vous êtes en bonne santé. Acceptez-le. Voudriez-vous que je vous trouvasse quelque affection pour être rassuré ? Ne voyez-vous pas là un paradoxe ? Que puis-je vous dire de plus ?
— Mais je me sens patraque, enchifrené, pas dans mon assiette. Cela ne cache-t-il rien d’inquiétant ?
— Ah ! je vous vois venir ; ne me parlez pas de cancer, monsieur Lerat. Le cancer, c’est dans votre tête qu’il prospère.
— Dans ma tête ? Tumeur au cerveau, docteur ?
Le docteur Malebranche tapotera son sous-main, cherchera le mot, sachant qu’il faut être prudent avec certains « malades » – et surtout avec ceux qui se croient malades –, les hypocondriaques, cette engeance des cabinets. On a beau leur affirmer, examens à l’appui, qu’ils ne souffrent de rien, cela ne fait que les conforter dans leur certitude qui, au fond, n’est que de l’angoisse : « S’il me dit que je n’ai rien, ce ne peut être que pour me faire oublier que c’est grave et qu’il est impuissant. Les médecins mentent, c’est connu. On leur apprend à mentir à leurs patients. Mon père me l’a seriné toute sa vie : « Méfie-toi des toubibs. Ils n’y connaissent rien. Ne les crois jamais ; moi je sais. » Il avait sans doute raison, papa, puisqu’il en est mort ». Et Sidney enfourchait de nouveau son cheval favori, vieille rosse jamais lasse :
— Enfin, docteur, ce ganglion…
Le médecin soupirera ; comment en sortir ?
— Tenez, je vous fais une ordonnance. Voyez un stomatologue. Il vous examinera, confirmera mon diagnostic – ce qu’il ne dit pas, c’est : « A lui la corvée, je serai débarrassé, ouf ! ». Ainsi, vous serez rassuré. Désolé, monsieur Lerat, la salle d’attente est pleine ; mes patients attendent. Je vous libère.
— Mais, docteur, moi aussi je suis un patient.
— Un patient fort impatient, si je puis me permettre…
— Oh, docteur, de l’humour avec un malade ?
— Sauf que vous n’êtes pas malade. Vous n’avez rien d’organique… Puis-je vous conseiller de consulter, après le stomato, bien sûr, un psychothérapeute ? J’en connais de fort compétents et…
— Mais je ne suis pas fou !
— Qui parle de folie ? De névrose, tout au plus. Tenez (il poussera un bout de papier vers Sidney), appelez-le de ma part. C’est vingt-cinq euros. Au revoir, monsieur Lerat.
Et Sidney s’en ira, ulcéré et toujours inquiet. Inquiet pour sa santé, ulcéré que le praticien l’ait affublé du substantif dégradant de « névrosé ». Être malade, soit, mais névrosé, c’est avilissant. « Encore un qui ne me prend pas au sérieux. Quand je serai crevé, il s’en mordra les doigts, ce jean-foutre ! Peut toujours courir que j’aille voir son exorciste ! Vais changer de médecin traitant, et voilà ! »
***
Il en était ainsi, grosso modo, deux fois la semaine. Entre eux, c’était comme un rituel éprouvé, une manière de duel, de joute oratoire. L’un, fort de ses diplômes et de son savoir, tentait de convaincre l’autre, fort de ses certitudes, de son erreur. L’un voulait à toute force que l’on acceptât sa maladie quand l’autre s’épuisait à prouver qu’il n’en était rien. N’allez cependant pas croire que Sidney voulait être reconnu comme malade ; sans qu’il se l’avouât, il attendait du médecin que celui-ci le convainquît de son bon état de santé en lui opposant les arguments cliniques les plus irréfutables. C’était la lutte du symptôme subjectif contre le savoir objectif. Pour être débarrassé de cette engeance, il eût suffi au docteur Malebranche de reconnaître : « Oui, monsieur Lerat, vous souffrez probablement de ceci ou de cela. » Mais la conscience professionnelle du médecin lui interdisait ce tour de passe-passe. Simplifions : Sidney insistait sur son mal-être afin de contraindre l’autre, le savant, à lui prouver scientifiquement qu’il était dans l’erreur. Mais, ne parlant pas la même langue tout en employant les mêmes mots, c’était une tentative vouée à l’échec. Il en résultait la lassitude de l’un et la grogne de l’autre ce qui n’empêchait nullement l’un de revenir et l’autre de le recevoir. La médecine générale est parfois un chemin de croix.
***
« N’empêche que le thermomètre, ce matin, affiche trente-sept deux et pas trente-sept comme il devrait. Début d’infection ? Ou pire encore ? »
— Sidney ! Café servi ! Tu vas être en retard.
— Oui, mon Adé ; je viens. J’accours. Je suis là.
Il rangea promptement le thermomètre coupable dans « son » tiroir, parmi « ses » vitamines, « ses » antioxydants, « ses » antibiotiques (périmés, certes mais on les garde toujours, au cas où), « ses » antistress, « ses » pansements hémostatiques (une hémorragie est toujours possible), « ses » straps, « ses » antimigraineux, le minimum, quoi. Ah ! vite, prendre son pouls avant qu’Adé s’impatiente. Soixante-deux. Correct ; sans plus. Il fut un temps, quand il faisait du sport, où son pouls, au réveil, se stabilisait à cinquante-quatre. Il avait décliné, c’était évident. Que lui fallait-il en conclure ? Faudrait songer à aller rendre visite à « son » cardiologue…
— Sidney !! Alors, quoi ! Café, bordel !
Il pouvait faire des reproches à Adélaïde mais il lui fallait reconnaître que son café était nickel. Elle cuisinait mal, vieillissait mal, l’aimait mal (en fait, elle ne l’aimait plus du tout, si tant était qu’elle l’eût jamais aimé, ce qui était d’ailleurs un mystère pour lui), mais son café était irréprochable.
De plus, oh chance ! Adé était infirmière diplômée et ça ! avoir sous la main une auxiliaire de santé quand on est, comme lui, toujours patraque et probablement gravement atteint, c’était un cadeau du destin. Même s’il ne se l’avouait pas, son attirance pour Adélaïde avait été nourrie de savoir qu’elle pourrait lui être d’un grand secours. Certains aiment un être pour sa beauté, son talent, son intelligence, son esprit et, pourquoi non ? Son argent. Lui, c’était pour sa qualification professionnelle. Si l’amour est un mystère, chez Sidney, on eût pu le réduire à une ordonnance. Hélas ! (nul n’est parfait), Adé n’était pas médecin, ce qui lui avait évité de sombrer dans une passion dévorante.
Couloir. Cuisine. Tabouret. Il s’assied, un rien préoccupé par ce 37,2° matinal. Dès neuf heures, il sonnera le docteur Malebranche afin qu’il le reçût en sortant du boulot. Il savait d’avance sa réponse et son air excédé. Sidney lui trouvait mauvaise mine, au docteur Malebranche. Fatigué ? Cela ne pouvait qu’altérer son jugement. Évidemment, à consulter des quarante patients chaque jour que Dieu fait ! À croire que le monde n’est peuplé que de malades. Sidney finissait par leur en vouloir à ces catarrheux, ces rhumatisants, ces fiévreux, ses cancéreux en sursis, ces encombrants qui dévoraient le temps de « son » médecin à lui, l’empêchant de consacrer plus d’attention à ceux qui, comme lui, sont d’authentiques malportants. Oui, vraiment, une petite mine, ce docteur Malebranche. Et s’il osait, lui, Sidney, lui conseiller de consulter un confrère ? C’est qu’il était inquiet. Que deviendrait-il sans lui ? Il fallait qu’il demeurât à son poste, c’est-à-dire à « sa » disposition, à lui, Sidney Lerat. Un médecin, c’est comme un prêtre, tout comme. Il n’y a que la mort pour les délivrer de leur sacerdoce. On n’aime guère changer de praticien, tout recommencer, répondre à cent questions, questions idiotes, niaises, d’un professionnel qui vous découvre et manifeste son scepticisme quand son prédécesseur, lui, savait de quoi il retourne. Cependant, à qui se confier si ce n’est à son médecin, à cet homme consacré qui ne se moquerait jamais de lui, le recevrait et l’écouterait toujours ? Mourir, le docteur Malebranche ? Ah non ! Cela lui était interdit, du moins tant que Sidney ne serait pas guéri, définitivement guéri. Il avait trouvé le mot : le toubib n’avait pas le droit de trépasser.
Le bol, trop chaud, lui échappe des mains et va s’éclater sur le carrelage. Penaud, Sidney contemple le résultat de sa maladresse : des dizaines d’éclats tout blancs dispersés dans une mare toute noire. En plus, il s’est peut-être brûlé ! Il examine sa main : non, rien de grave.
Encore un bol passé par pertes et profits…
Alertée par le bruit, Adélaïde se tient au seuil de la cuisine, mains aux hanches, le visage tartiné d’un fond de teint blafard, l’air peu amène :
— C’est pas Dieu possible d’être aussi gloton ! Toute ma vaisselle y passera, la vaisselle qui me vient de ma mère ! Un des derniers bols de quimper que je tenais de Mamie ! Allez, maladroit, pousse-toi donc que je répare le malheur. Mais qui est-ce qui m’a fichu un gloton pareil ? Il n’y en avait qu’un et, bien sûr, c’est moi qui l’ai eu.
— Mais, mon Adé-toute-en-sucre, le bol était brûlant…
— Brûlant ce matin, glacé hier, trop rond, trop lourd, trop lisse, toujours une raison. Et cesse de m’appeler « Adé-toute-en-sucre ». Passés vingt ans de mariage – et là, elle lève les yeux au ciel –, ces petits mots gnangnan deviennent parfaitement grotesques. On n’est plus des mômes. Tu me fais vieillir avant l’âge.
— Mais, pour moi, tu seras toujours mon Adé-d’amour.
— Encore une niaiserie et je te fous ma serpillière par le travers du museau ! Sidney Lerat !! Lerat ! A-t-on idée ? Quand je pense que, par ta faute, je suis devenue, officiellement Adélaïde Pujol épouse Lerat ! Ma mère avait bien raison, qui me dissuadait de t’épouser. Nous habitions Montauban ? On ne devrait jamais quitter Montauban ! Allez, file, tu vas être en retard. Mais dégage donc avec ta mine de chien battu.
— Mais, Adé, et mon café ? Tu sais bien que, sans mon café du matin…
— Les bistrots ne manquent pas d’ici le métro. Dégage, calte, fissa !
Et Sidney s’esquiva, dompté, l’oreille basse, le ventre vide, l’air contrit, poussé aux épaules par son Adé, houspillé tel un vieux chien qui se serait oublié sur le paillasson.
Sur le palier, face à la porte de l’ascenseur, il l’entendit ronchonner. Elle ronchonnait souvent, Adélaïde. Elle en avait pour une bonne heure, sûr. Par chance, elle avait devant elle un jour de RTT et son ménage. Elle aimait bien faire son ménage, briquer, astiquer, ranger, mettre de l’ordre. On dit que certaines femmes « rangeraient le Bon Dieu lui-même ». Elle était de ces femmes-là. Les tâches ménagères ne lui étaient jamais apparues sans noblesse, à son Adé. De ses borborygmes, il saisit plusieurs fois ce « gloton » qui résumait tout. « Gloton », cela ne figurait dans aucun dictionnaire ; c’était un néologisme créé par Adé, une invention, la seule invention dont elle fût capable. Un gloton est un être congénitalement maladroit, un incapable, un boulet, un laissé-pour-compte, un perdant, un niais, un neuneu, un pas fût-fût. Sidney Lerat, le gloton absolu. De lui, elle disait que, parmi les glotons, il était une synthèse à lui seul. Sidney, sa croix, son époux pour le pire et jamais le meilleur. Adélaïde Pujol, c’est pas une gracieuse.
Mais était-ce sa faute à lui s’il éprouvait une incapacité chronique à se positionner dans l’espace, à se latéraliser, si les objets alentour lui étaient toujours trop hauts, trop bas, trop proches ou trop éloignés (quand ils n’étaient pas, les coquins ! trop glissants ou trop rugueux, trop chauds ou trop froids, trop… enfin, trop.) Il était pourtant plein de bonne volonté, Sidney. Il voulait bien faire mais il faisait tout mal. Il se cognait partout, se blessait – encore heureux qu’il ne blessât pas les autres en sus ! – renversait tout ce qui n’était pas soigneusement arrimé, fixé, lesté. Il en arrivait à croire que les objets inanimés avaient bel et bien une âme, mais perverse, l’âme des objets, décidément acharnés à le persécuter. Ainsi, Sidney éprouvait une crainte diffuse à manipuler quoi que ce fût. Allons plus loin : tout système de propulsion recelait pour lui un danger mortel, ce pour quoi il ne conduisait pas (ses moniteurs d’auto-école, les pauvres, avaient fini, après moult tentatives, par le dissuader et le convaincre de se contenter des transports en commun). Le vélo, la moto, exclus. Ne parlons pas même d’activités ludiques – ou supposées telles – comme le parapente ou l’escalade ! Non, n’en parlons pas. La natation ? La piscine municipale lui refusait l’entrée depuis sa troisième noyade… Mais certains hommes goûtent fort la cuisine, pourquoi pas lui ? Parce que les pompiers étaient las d’éteindre ses feux de cuisine ou de le conduire aux urgences toutes sirènes hurlantes. Et le bricolage ? Voilà une activité très masculine, le bricolage. Passons pudiquement et n’accablons pas le pauvre Sidney.
Mais alors, me direz-vous, comment avait-il pu rencontrer Adélaïde ? Ah ! vous êtes intrigués. Vous n’allez pas le croire : au ski.
***
La « chance de la vie » d’Adélaïde avait commencé sur des lattes. C’était à Gérardmer, dans les Vosges, donc. Elle avait vingt-trois ans, venait fêter-là son diplôme en effectuant quelques glissades sans prétention avec ses copines de l’école d’infirmières. Le week-end s’annonçait bien. Il faisait beau. La rouge du Renard était large, bien damée. Elle riait à la vie. Mal lui en prit.
Elle cessa de rire quand une manière de missile hors contrôle vint à couper sa trajectoire. L’OGNI (objet glissant non identifié) la faucha à hauteur des chevilles et s’en alla mourir en embrassant un pauvre mélèze qui n’en pouvait mais. L’abruti se releva comme si de rien n’était, pas même contusionné. Le ciel a parfois de ces indulgences envers les dangers publics. Adélaïde se tordait, gémissait et se livrait là à l’exercice qu’elle maîtrisait le mieux : l’imprécation.
Quand le malotru, skis sur l’épaule, revint vers elle s’enquérir du tort à elle causé, ce furent ses oreilles qui souffrirent le plus. De mémoire de montagnard et de skieur, on n’entendit jamais autant de malédictions dévaler la rouge du Renard. Vous avez déjà deviné l’identité de l’agresseur, n’est-ce pas ? Tout ce qu’il retint du flot verbal alternant avec les hurlements de douleur, ce fut : « gloton ».
Et c’est ainsi que Sidney Lerat, skieur irresponsable mais souriant, entra dans la vie d’Adélaïde Pujol – enfin, « entra » si je puis me permettre ce raccourci hasardeux. Vu la gravité des blessures de la jeune femme, on l’évacua dare-dare sur l’hôpital d’Épinal où elle prit une pension dont elle se fut bien passée. Cassée, qu’elle était, Adélaïde : fracture de la malléole et du tibia ; opération, vis, plâtrage, la routine, quoi. Copines affectées, parents attendris, gentillesse des infirmières découvrant en elle une collègue, compétence distante du chirurgien, Adélaïde découvrit ainsi le monde hospitalier dans sa diversité. Un stage d’application, en quelque sorte.
Mais voilà-t-il pas que l’Abruti vient la visiter, penaud, mal fagoté et avec des fleurs en plus ! Il entre, zigzague entre le vase fleuri, le pichet en plastique, le tabouret, cherche un siège, se pose, se présente en s’excusant et subit sans mollir une engueulade carabinée. Sidney la trouve charmante dans sa colère et attribue aux circonstances la verdeur de son langage. Comment eut-il pu deviner que la blessée ne forçait nullement son talent, qu’Adélaïde Pujol, vraiment charmante, plâtrée sur son lit d’hôpital, avait un caractère de chiotte ? À force de patience, d’obséquiosité et d’aplatissement verbal, il attendit la fin de l’orage. Arriva le moment où, tout de même, la victime dut reprendre son souffle. Il en profita pour solliciter la permission de signer son plâtre, comme d’usage. « Il eût mieux fait de signer un chèque, ce sale type », se dit-elle. Non content de signer, il inscrivit son numéro de portable ! Elle en fut estomaquée. Le culot du « connard » lui coupa la chique, ce qui ne manqua pas de surprendre les parents présents qui vivaient depuis vingt ans avec la certitude que leur fifille chérie avait une sirène d’alarme tapie au fond du gosier. Silencieuse qu’elle était, Adélaïde. D’un coup, d’un seul.
Son forfait perpétré, l’aimable assassin s’en fut, se cognant dans la porte, culbutant la table basse et le vase qui… passons. Adélaïde comprit alors que le pauvret était excusable : un handicapé neuromoteur ? Il faut être gentil et patient avec les êtres diminués, on le lui serinait tous les jours à l’école d’infirmières de l’hôpital Lénine de Nuton la garenne. Un pauvre gloton, voilà ce qu’il était. Adieu et bon débarras.
Gloton, peut-être, mais obstiné ; une moule agrippée à son caillou, une tique enrostrée dans l’épiderme de sa victime, une plaie, une épidémie, un inéluctable. Un dicton prétend qu’il n’existe de sûr en ce monde que « la mort et les taxes ». Erreur ! Il existe aussi un troisième fléau : Sidney le gloton !
Car il revint, le lendemain et les jours d’après, avec des fleurs, une peluche, des friandises, des pralines. Il s’assied, tout de guingois, la questionne sur son bien-être, sur l’évolution de ses blessures, l’accompagne, prévenant, à la cafétéria et semble la trouver adorable avec son plâtre et ses cannes anglaises. Elle est tout d’abord surprise, sur la réserve, puis amusée du côté serviable, attentif et délicat du calamiteux. Les jours passants, elle ne lui en veut plus ou presque plus. Il l’aide à s’asseoir, va lui chercher un magazine au kiosque à journaux, un cappuccino, lui pose mille questions à propos de son avenir, de ses études, de sa famille, de son chien. Il confesse avoir prolongé son séjour afin de demeurer là, tout près, disponible. Il lui avoue se sentir ô combien responsable, voire coupable. Il veut réparer mais le peut-il ? Il l’étourdit. Aucune femme ne résiste à tant de persévérance, de gentillesse affichée, de dévouement inlassable. Elle, dont l’existence ne paraissait intéresser qu’assez peu de gens, se découvre – enfin ! – compter mais compter vraiment pour un être qui ne lui demande rien si ce n’est que la servir et la réconforter. Elle en est attendrie et finit par commettre, autant par faiblesse et lassitude que par bonté mais aussi par désir de mettre à l’épreuve ce soupirant imprévu, elle finit donc par commettre l’erreur de l’autoriser à la revoir à son retour chez elle. Cette erreur, somme toute bénigne chez quiconque, Adélaïde Pujol devait en payer les conséquences durant des années.
***
Toutes les bonnes choses ayant une fin, le chirurgien jugea qu’Adélaïde pouvait faire de la place et regagner les pénates de ses parents, à Villeneuve-le-Roi. Ils habitaient un de ces pavillons en meulière qui, dans ces banlieues, étaient le terrier habituel de la classe moyenne.
Les parents d’Adé étaient de braves gens moyens, en tout : taille moyenne, ambitions moyennes, opinions modérées, revenus moyens, bref, ils faisaient partie de ce peuple qui est la vache à lait de la nation, moutons moyens tondus quatre fois l’an afin de permettre à ceux qui ne paient jamais de vaquer à leurs occupations. Oh ! je ne veux pas désigner ici les pauvres, qui n’ont pas choisi de l’être ni les riches qui, eux, font tout pour demeurer tels, mais il faut bien admettre que, si certains touchent des aides, si d’autres ont un conseiller fiscal habile, ce sont toujours les mêmes qui raquent. La classe moyenne, donc. Les Pujol habitaient donc moyennement un pavillon moyen dans une banlieue raisonnablement éloignée de la capitale, occupaient des emplois moyens, vivaient avec modération, possédaient une voiture de gamme moyenne et passaient leurs congés estivaux dans une maison de Vendée qu’un grand-père avait acquise en d’autres temps pour y replier sa nichée en cas d’invasion prussienne. La Vendée étant à une distance moyenne de Villeneuve-le-Roi, en conduisant à allure moyenne, c’était l’affaire d’une petite journée de conduite (en prenant bien soin, cela va de soi, d’éviter les autoroutes où des fous furieux conduisent au-delà de toute convenance dans le but de maintenir leur moyenne). Des gens moyens, donc, mais fort sympathiques au demeurant. Le maître-mot de monsieur Pujol, s’il en avait eu un, ç’aurait été : « il faut toujours trouver moyen de moyenner » ce qui signifie : préservons-nous des passions extravagantes (le jeu, le sexe, l’alcool, la politique, l’argent) et nous vivrons moyennement heureux et mourrons de même. S’il existe des êtres qui font tout pour se mettre en avant, il en est d’autres – et les Pujol étaient de ceux-là – qui font tout pour demeurer moyennement en arrière. Ils y parvenaient parfaitement, respirant modérément une atmosphère convenant à leurs poumons moyens. Mais pas Adélaïde. Elle étouffait, Adé et n’attendait que l’occasion de larguer les amarres et de filer vent arrière. L’occasion… où celui qui lui permettrait de vivre et de jeter sa coiffe par-dessus les moulins (moyens, les moulins, évidemment).
Et la voici de retour à Villeneuve-le-Roi, claudiquant gracieusement, toutes cannes anglaises brandies comme un ancien combattant de retour du front. À peine franchi le seuil de ses parents, à peine ouvertes les valises et vidés les sacs, à peine bu le thé et grignoté les cookies maison (une délicatesse de madame Pujol qui connaît la gourmandise de sa fifille), on sonne.
On n’attend personne. Quel est cet importun ? Qui ose ?
Il me faut ici apporter une courte note : Maman Pujol avait pour principe de ne jamais décrocher le téléphone (« qui oserait déranger en appelant ? ») ni ne jamais ouvrir sa porte à un inconnu. L’inconnu, c’est le danger, le malheur peut-être, la perturbation sûrement. On n’ouvre qu’aux gens connus, reconnus, attendus. Les plis recommandés eux-mêmes sont source d’inquiétude, annonciateurs de soucis pécuniaires car officiels. Donc, méfiance.
On écarte prudemment le rideau du salon et l’on aperçoit, contre la grille, un gugusse précédé d’un énorme bouquet – mais de quoi ? Des œillets ? Adé déteste le parfum des œillets – et qui se dandine gauchement d’un pied sur l’autre en s’acharnant sur la pauvre sonnette. « Non ! se dit Adélaïde, pas lui ! Il n’oserait pas ! » Si, il a osé, il ose.
— Mais enfin, Adé, l’apostrophe maman Pujol, ne me dis pas que c’est… l’Autre ? Comment a-t-il su ? Qui lui a dit ?
Adélaïde ne répond pas, ne bouge ni pied ni patte (et pour cause !)
— Eh bien, mûm (elle a toujours, nul ne sait pourquoi, interpellé sa mère de cet angliciste « mûm »), il insistait, gentiment, alors, de guerre lasse, afin d’avoir la paix, je lui ai donné votre adresse, persuadée qu’il n’en ferait rien. Peut-être n’était-ce pas une bonne idée.
— Toi, ma fille (quand elle n’était plus Adé mais « ma fille », c’est que leurs rapports tournaient au vinaigre), je crains que tu aies commis la GROSSE bêtise, celle qu’on a du mal à rattraper. Tu n’es là que depuis dix minutes qu’il est déjà à escalader la grille, l’assassin des pistes bleues, l’Attila des remonte-pentes, le bousilleur de vacances ! Et maintenant que tout le voisinage est informé, que faire ? Lui jeter des pierres, appeler la police, lâcher le chien (un York, comme chien d’attaque défense, ça ne fait pas très crédible) ? Que vont penser les voisins ? Y songes-tu, inconsciente ?
— Fais-le entrer. Je vais mettre tout cela au net. Dans dix minutes, il repart, à jamais.
Madame Pujol débloqua la serrure électrique. L’intrus traversa le jardinet (moyen, le jardinet, fort moyen), heurta la poubelle, rata une des trois marches du perron et ne dut son salut qu’en s’agrippant au volet. Mais enfin, il était là. Les Pujol s’entre-regardèrent, muets, dubitatifs et vaguement inquiets quant aux intentions de l’olibrius. Était-il ivre ou malade ? Peut-on être aussi gauche, aussi maladroit ? On peut. La preuve. Et, de plus, on peut être collant.
… Six mois plus tard, on célébrait, comme à regret, le mariage de Sidney Lerat et Adélaïde Pujol. Et c’est ainsi que tout commence.
2
Un dicton préconise : « qui veut séduire la fille doit plaire à sa mère ». Sidney livra, avec succès, ce combat acharné. Il sut se montrer habile. Habile et convaincant. En dépit de sa maladresse qui ne pouvait que surprendre, il sut « se vendre » à sa future belle-mère et mettre en avant ses avantages. Il est vrai qu’étant d’une intelligence moyenne, d’un physique somme toute moyen, occupant un logement de taille moyenne, bénéficiant des revenus d’une situation moyenne, il avait tout pour ne pas déplaire aux Pujol. Et tout d’abord, il était orphelin (voiture, accident, exit père et mère). Un orphelin attendrit toujours. Les Pujol n’avaient qu’une fille et point de fils. Il était tout désigné pour devenir un fils adopté. Orphelin mais héritier, cela aide parfois. Curieux comme les héritiers sans partage se parent de mille vertus aux yeux de futurs beaux-parents : un appartement de trois pièces en banlieue, des liquidités (économe en plus, le Sidney), un travail honnête (il était chef de rayon au Brico-Confort du boulevard Général Turreau, près de la République), bref, de quoi rassurer et séduire. N’arborant pas un ego écrasant qui les eût mis mal à l’aise, il sut se couler dans le futur moule pujolesque.
D’avoir appris tout cela et le reste, les Pujol lui trouvaient, quoi qu’ils en eussent, de l’allure et, osons le mot, presque du charme. Oh ! il n’avait pas étalé son patrimoine comme cela, tout à trac. Ç’avait été par petits bouts, comme à regret, en fourbe, sans en avoir l’air, presque détaché des basses matérialités, entre la mirabelle de Pujol-père et les petits fours de Belle-maman : un coup l’immobilier, un autre l’assurance-vie, un coup les louis d’or dans la boîte à biscuits de feu-papa, jaunets prudemment accumulés (« on ne sait jamais, mon fils ; l’or c’est le secours intangiblement garanti »). Il savait enrober le tout avec délicatesse, comme d’une belle faveur toute rose il ornait le bouquet de fleurs qu’il ne manquait jamais d’offrir à sa promise. Si Adélaïde était assez peu fleurs, madame Pujol les aimait. Et donc le bouquet reçu négligemment par Adé finissait immanquablement dans un des vases de belle-maman. Car il n’avait pas tardé à se risquer à cette privauté : nommer Germaine Pujol « Belle-maman ». Hypocrite, disais-je, mais habile. Quant au futur beau-père, Sidney n’avait pas tardé à connaître sa vénération envers l’Homme du Dix-huit juin et il savait dénicher et offrir quelque souvenir, quelque livre relatant la vie et les exploits du Héros. Évidemment, l’objet de toute son attention demeurait son Adé-chérie ! Et que je te la couvre de cadeaux (pas toujours de très bon goût, mais c’est l’intention qui compte, si je puis oser ce lieu commun), et que je te la mignote, et que je te la câline ouvertement, et que je te l’embrasse dans les coins (derrière l’oreille, pourquoi pas ?). Alors, à force, habitués à la présence quasi hebdomadaire de l’ostrogoth, les Pujol avaient condescendu et Adé (tout de même la principale intéressée) tout autant car pas mécontente de quitter enfin, et honnêtement, l’étouffoir familial de Villeneuve-le-Roi. Elle avait dit « oui », du bout des lèvres, un rien méfiante, un peu comme le môme qui se tient au bord de la piscine mais hésite à se jeter à l’eau sous les quolibets des autres, toujours excités par une possible noyade. Car toutes ses « amies » (les garces !) lui avaient fait l’article : « il est gentil, il paraît t’aimer profondément, il a du bien, tu seras dans le confort, chez toi et puis, il est si poli, si délicat, si prévenant, etc., etc. Bon, il a deux mains gauches mais qui est sans nul défaut ? Vas-y, Adélaïde, plonge ! »
Elle avait donc plongé, la conne, et pas fini de patauger… Donc, mariage.
Le mariage. Parlons-en, mais vite.
Les Pujol, comme d’usage, avaient tout organisé, tout bien : traiteur, robe blanche et son inévitable couronne de fleurs d’oranger, musique, invités, parents proches ou éloignés. Du côté du marié, personne. Étrange. Juste un demi-cousin extrait de quelque province montagneuse et qui ne décrocha pas trois mots. Son témoin, il était allé le quérir parmi ses collègues du Brico-Confort et pas sans mal. Mais l’intéressé, tout en se faisant tirer l’oreille, n’avait pu couper à la corvée, Sidney ayant barre sur lui pour l’avoir surpris fauchant une perceuse à percussion et ne l’ayant pas dénoncé à la direction. Le malandrin, pris la main dans le sac et l’outil en pogne, n’avait pu qu’obtempérer. Sidney, plaisantin à certaines heures, lui avait même susurré : « Je vois que tu as déjà choisi mon cadeau de mariage. Bon choix, bonne marque. C’est allemand. »
Adélaïde avait choisi ses demoiselles d’honneur tout naturellement parmi ses copines de promotion de l’École. Vêtues de rose ou de bleu pastel, les pieds torturés par leurs chaussures neuves, elles tinrent dignement leur rôle, non sans manifester dans le creux de l’oreille de la mariée leur étonnement quant à son choix. Adélaïde n’avait pas même l’excuse d’une grossesse prématurée pour justifier la chose. Martine, la plus délurée et dont le franc-parler était redouté de toutes, n’hésita pas : « Dis donc, ma grande, es-tu bien sûre de ne pas faire une connerie ? Je le trouve… bizarre, ton amoureux ».
— Bizarre ? regimba Adé, un peu mais si gentil. Et puis cela fait plaisir aux parents et puis je vais pouvoir foutre le camp d’ici et vivre, m’entends-tu ? Vivre enfin !
— Vivre ? Vraiment ? On verra, on verra. Se marier avec le premier gugusse venu pour échapper au cocon familial, c’est risqué. Cela en vaut-il la peine ? La gentillesse, d’accord, mais est-ce suffisant pour faire un mariage heureux ? Pourtant, avec ton physique, tu avais le choix.
— Le choix, parlons-en, Martine : la glu des parents, le pavillon de meulière, les excités tout juste dépucelés qui te dévastent la toilette le samedi soir avec leurs mains fébriles et leur haleine de chacal, j’en avais marre. Faut bien se poser un jour. Mais le pire, c’était peut-être le veau Marengo.
— ?
— Oui, oui, le plat favori de ma mère, le terrible, l’inéluctable veau Marengo du dimanche. Ah, Martine, tu n’imagines pas combien j’ai pu en bouffer de ce veau ! Des troupeaux entiers ! Marre, marre et marre !
— D’accord, ma grande. Se poser. Mais sur quoi, sur qui ? Je suis perplexe. Évidemment, reprit la fouteuse de merde, l’avantage, c’est que personne ne cherchera à te le chiper, ton chéri.
— Que veux-tu dire ? Tu ne peux pas t’empêcher de faire ta garce, Martine. C’est trop fort, ça te démange.
— Je veux dire qu’il n’a pas l’air flambant. Je l’imagine mal te faisant grimper aux rideaux. Enfin, quoi, Adé, il n’a pas une tronche de sex-symbol, ton Sidney !
— Je verrai bien. C’est un doux. Attendons pour voir.
— Doux ? Comme ces vins trop sucrés, ces pinards pour fillettes ou mamies qui y trempent leur biscuit avec des petits airs de dentelle. Doux ? Ce n’est pas une assurance de bonheur, la douceur. On s’emmerde vite avec les doux… Non mais, ne me dis pas qu’il ne t’a pas encore… ?
— Il est bien élevé, délicat et a su respecter ma pudeur – comme dit maman. Voilà. Tu sais tout.
Martine bondissait comme un kangourou en chaleur : « C’est pas vrai ! J’y crois pas ! Un curé, tu épouses un curé ! Tu vas t’en mordre les doigts, ma chérie, et jusqu’à l’os ! »
— Dis, Martine, tu es venue pour être ma demoiselle d’honneur ou pour me dégoûter du mariage ?
— Un curé défroqué, un séminariste refoulé ! Oh, moi, ce que j’en dis, hein ?
— Eh bien, c’est encore de trop.
— Mais après tout, peut-être me trompé-je ? Oui, sans doute. Pardonne-moi, Adé, je me trompe.
— Qui parle de tromper par une si belle journée ?
Et Sidney – car c’est lui, bien évidemment – tombe dans l’aparté comme la misère sur le pauvre monde. De toutes ses maladresses, la verbale n’est pas la moindre. Il a l’art du contrepied involontaire. Toujours affable, il a le chic pour brûler la conversation en décochant, souvent même sans s’en apercevoir, quelque mot incongru, quelque contresens, quelque pavé dans la mare qui rend muets ses interlocuteurs. Il entre là-dedans avec ses gros sabots tout crottés et génère un malaise qui déclenche inévitablement une fuite générale. Mais son royaume, à Sidney, là où il règne sans partage, c’est celui du lieu commun. Il n’en omet aucun, à propos de n’importe quoi et en toutes circonstances. Pour le lieu commun, il est inégalable : « un rien vaut mieux que deux tu l’auras ; une hirondelle ne fait pas le printemps ; à chaque jour suffit sa peine ; après la pluie vient le beau temps ; la beauté ne se mange pas en salade ; l’argent ne fait pas le bonheur (va donc le dire aux pauvres, eh, banane !), etc., etc. On se gaussait de lui mais il ne se rebutait jamais, croyant n’émettre là que des expressions de la sagesse dite « populaire ». On eût pu rédiger un fort opuscule de ses lieux communs. Incollable, indépassable sur le sujet, Sidney. Même si certains avaient passé de mode (« charbonnier est maître chez lui », vous en connaissez, vous, des charbonniers ?), même si quelques-uns, attribués à d’infâmes tyrans (« il n’est de richesse que d’hommes » selon Joseph Staline), aucun ne le rebutait et il faisait son fiel de toutes fleurs même des moins avenantes. Nul n’est parfait (voyez comme on s’y met vite) et lui, moins que tout autre. S’il en était un qu’il eût dû garder à l’esprit, c’était bien : « le silence est d’or ». Hélas, non ».
Mais il est le premier étonné de l’attitude dérobée de ses interlocuteurs ; tel un poussin tombé du nid, il ouvre tous grands des yeux écarquillés : « C’est étrange. Dès que je veux causer, entrer dans le débat, ils ont toujours quelque urgence qui les appelle ailleurs. Les gens sont bizarres, non ? »
Adélaïde n’osait pas – pas encore – lui mettre les points sur les « i » mais belle-maman Pujol, elle, avait son franc-parler. À la hussarde qu’elle le sabrait, Sidney, direct :