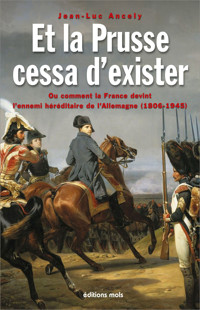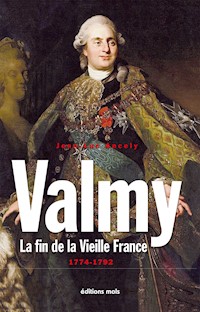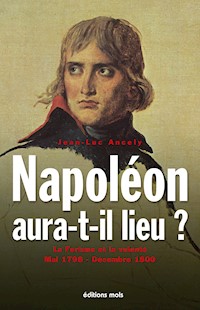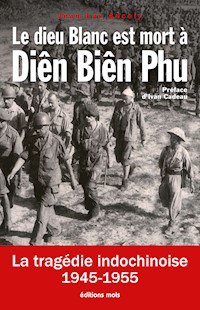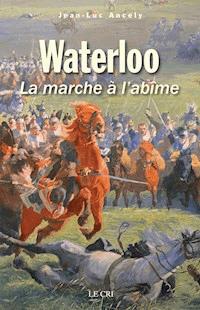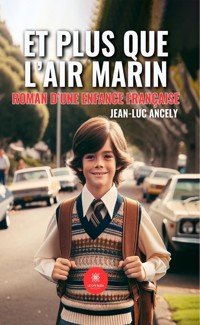
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
"Et plus que l’air marin – Roman d’une enfance française" est une œuvre poignante dans laquelle
Jean-Luc Ancely nous convie à un voyage autobiographique au cœur des années soixante, une époque dépassée, mais chargée d’émotions et de contrastes. En utilisant ses souvenirs, il dépeint avec finesse les luttes intérieures d’un jeune garçon de province, tiraillé entre ses rêves et les réalités souvent déconcertantes de ses parents, ancrés dans un passé révolu. Ce récit captivant révèle les déchirements et les dilemmes d’une époque en transition, où les aspirations individuelles se heurtent aux conventions familiales et sociales.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean-Luc Ancely croit en la force de l’écriture pour communiquer un message, surtout lorsqu’on ne possède pas d’autres talents artistiques comme la peinture ou la musique. Pour lui, la littérature est un acte de partage, et il trouve une grande satisfaction lorsque les lecteurs le contactent pour exprimer leur reconnaissance, ce qui souligne l’importance sociale de l’écrivain.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean-Luc Ancely
Et plus que l’air marin
Roman d’une enfance française
Roman
© Lys Bleu Éditions – Jean-Luc Ancely
ISBN :979-10-422-2314-4
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
La dix-huitième année est l’âge des espoirs, mais aussi des tourments et des fuites.
Robert Brasillach
La haine, beaucoup plus encore que l’amour, ça occupe.
Hervé Bazin
Un roman, c’est du mensonge bien écrit.
TLH
Les parents sont infaillibles pour faire le malheur de leurs enfants.
Jean Dutourd
Tes père et mère honoreras.
Le décalogue
On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans.
Arthur Rimbaud
On ne sort jamais vainqueur d’une dispute familiale. Quel que soit l’adversaire, on est mutuellement détruits.
Anonyme
Avant-propos
Toute ma vie, je me suis efforcé d’apprendre à mourir quand tant d’autres tentent de vivre. Y suis-je parvenu ? Je l’ignore. Je le saurai le moment venu. Entre ces deux évènements que sont la naissance et la mort, un spasme à l’échelle de l’univers, un hoquet. Entre les deux, des espoirs, des bonheurs, des déceptions, des trahisons parfois, des souffrances, souvent. Et cependant, il faudrait aimer, car, ne nous y trompons pas, aimer est un devoir d’état. Aimer, comme malgré soi. Aimer en dépit de tout.
L’enfance est toute peuplée de rêve et de merveilleux, d’espérance dans l’avenir. Mais l’enfant est un artiste qui s’ignore et dont l’orgueil créateur exclut les adultes plats. L’enfance est aussi, hélas, un marais biologique où les hormones putréfient l’innocence. La jeunesse, si souvent vantée et exaltée, est l’âge des certitudes et de la soif d’absolu. Je ne connais, hélas, rien de plus stupide et de plus ennuyeux dans ses certitudes qu’un jeune homme de vingt ans. Si ce n’est deux. D’ailleurs, ils vont souvent en bandes, en clans, en troupes, en compagnies, en cénacles, en cellules, pétris d’ardeur et de mépris envers tout ce qui n’est pas eux et qu’ils ne comprennent pas. En devenant de jeunes mâles fous de leur virilité – fous souvent au point de mal la vivre –, ils deviennent cons. Les pauvres jeunes ardents perdent de vue cette évidence : la jeunesse est déjà une agonie.
Introït
« Frangin, cher vieux,
Depuis des années que tu me tannais afin que j’écrivisse mon histoire – notre histoire ? – je me rends. Mon histoire ou bien raconter une histoire ? Mémoire ou mémoires ? Quelle importance dès lors que tout est mensonge ? La vérité – “qu’est-ce que la vérité, dit Ponce Pilate ?” – est un improbable gibier entr’aperçu dans le clair-obscur d’un taillis à la tombée du jour. Je serai donc l’interprète de cette “vérité”. Interprète donc, traducteur, donc traître. Il n’est de vérité que dans l’acte, évident, irréfutable. La parole est mensonge. Oser prétendre que, tel jour, à telle heure, j’ai dit ceci, fait cela, est déjà illusoire sans témoin. Ainsi, au bout du temps, la masse des souvenirs change de teinte, devient une relecture, un enjolivement ou une aggravation selon l’humeur, selon l’envie de plaire ou de choquer. Si, comme on le prétend, “le rire est le propre de l’homme”, j’en viens à penser que, bien davantage, c’est le mensonge qui est humain et voici pourquoi l’animal, si pur, n’est point homme. Je suis homme, donc je mens. “Le roman, c’est du mensonge bien écrit.” Ah, phrase lapidaire qui devrait faire naître un sourire sur toutes les lèvres de ceux qui écoutent un écrivain établi pérorer sur ce qu’il a vu, entendu, dit. Je me remémore cette parole du Maréchal Pétain que l’on pressait d’écrire ses mémoires et qui répondit, bien dans son style désabusé : “pourquoi écrire mes mémoires ? Je n’ai rien à cacher.”
Quand je dis, quand j’affirme : “notre père a fait ceci, a prétendu cela”, en suis-je bien sûr ? N’est-ce pas moi qui parle par sa bouche ? Ne lui imposé-je pas mes goûts, mes lubies, mes rancœurs ? Quand je deviens péremptoire, quand je force le trait, quand j’exagère, je mens. Je mens, non par vice, mais pour séduire ; je deviens le cuisinier de l’esbroufe, le mitonneur de ragougnasse, car vous, lecteurs, seriez bien emmerdés par le plat récit des travaux et des jours. Ce qui vous excite, c’est le “plus que”, l’improbable, l’inattendu, le truculent, l’obscène, pourquoi pas ? Tout est donc mensonge. Nous mentons pour plaire, pour éviter un embarras, une dispute, pour décrocher un job, obtenir un contrat, séduire une fille. En fait, nous mentons pour être aimés, pour ne plus être seuls. Et qui croit dire le vrai se ment à lui-même. Les enfants le savent d’instinct qui font du mensonge une arme et un passe-partout. Nous mentons pour sauver notre peau ou conquérir la vôtre. Les juges, dans les prétoires, le savent bien : en justice, tout le monde ment. La déesse justice n’est pas aveugle ; elle est sourde. Il nous arrive même de mentir à Dieu – un comble – tant nous avons peur de déplaire.
Quand le malade – le patient, substantif admirable ! – questionne le médecin, il espère une réponse apaisante, rassurante et, au fond, nullement la vérité. Mais cette vérité médicale est-elle autre chose qu’un pieux mensonge ? Que veut-il entendre sinon : “vous n’avez rien de grave” ?
Malheur à celui qui dit la vérité ! Comme Cassandre, il sera rejeté, empêcheur de mentir en rond. Sans le mensonge, la vie sociale est impossible. Confesser un mensonge peut détruire l’harmonie. La sagesse est là : “N’avouez jamais !” On peut tuer avec la vérité et sauver avec le mensonge. Les politiques le savent bien : le peuple redoute la vérité. Il attend d’eux la ronronnante musique de la tisane sédative du mensonge public. Les vociférateurs, les imprécateurs de la vérité finissent au mieux au placard, au pire au bûcher. On a reproché à Giono de mentir en écrivant. Mais qu’eût-il pu écrire de vrai ? L’indicateur des Chemins de fer ?
Sache-le, mon frère, dans ce que je vais dire, tout est faux : mensonges, demi-mensonges, quarts de mensonges puisque vérités revisitées, réinterprétées, régurgitées. Le miracle tient en ceci : mille mensonges mis bout à bout peuvent constituer une vraisemblable vérité, une bonne grosse vérité littéraire ; cela s’appelle un climat, une atmosphère. Je vais donc mentir, moi, Sébastien, ton frère, à propos de moi, de toi, de nos parents, truquer par-ci, biaiser par-là, ronger et rajouter, travestir, grossir, outrer le trait, le pastelliser parfois, le noircir sûrement. Mais je jure que je mens en toute sincérité, que cette vérité est la mienne et pas celle d’un autre, que je vous mens la main sur le cœur avec la plus grande franchise, la plus totale impudeur. Croix de bois, croix de fer… Mais l’enfer lui-même n’est-il pas un mensonge ? Quand la vérité n’est qu’une illusion, on devrait, avec Céline, se souvenir que “dans ce monde, la seule vérité, c’est la mort.”
Cher frangin, notre père-géniteur est mort depuis trente ans ; au fond, que savions-nous de lui ? Peu de choses de cet homme qui eût jugé peu digne de se confier à ses fils. Toi et moi n’avons pas les mêmes souvenirs – neuf années nous séparent –, ne sommes pas détenteurs des mêmes vérités bien qu’il fut le même père de ses deux fils. Pourquoi mentirais-je moins que lui ? Trente ans, cela donne assez de recul ; on peut causer. À qui ferais-je du tort ? Mère-Chérie – qui, à la maison de retraite, niait mon existence – ne lira jamais ce fatras de billevesées ; alors… Faisons-nous plaisir et tissons un joli beau mensonge bien dodu joufflu : “la vie de Sébastien de la naissance à sa fuite”. Oh ! attention ! Ce ne sera ni du Dickens ni du Jules Vallès. Ici, point d’enfant martyr, de pauvre persécuté. Nos parents n’étaient pas des monstres ni des Thénardier. Ils étaient pire…
Vivre une enfance banale, conne, somme toute et finir par haïr ces géniteurs-là est le paradoxe. Passe encore que Sébastien fût battu, affamé, violé et toute la sombre litanie des horreurs des Cours d’Assises. On pourrait comprendre. Le mépris, la haine et le dégoût, voilà bien de la matière fécale, j’en conviens. Hélas non. Ainsi donc, Sébastien a pu être nourri, éduqué, vêtu, logé, blanchi, etc, nullement maltraité (ce qui, je sais, n’a pas été ton cas) et n’en éprouver nulle reconnaissance, si ce n’est pire ? Sébastien est-il un fondamental salaud, doublé d’un ingrat, comme il en existe ? Je te laisse juge, cher frangin et, sur ce, je prie Dieu qu’Il t’ait en Sa sainte Garde. »
***
Philippe Portal reposa la lettre – jamais adressée à son destinataire – avec un soupir d’appréhension. « Mais quelle mouche a donc bien pu piquer ce vieil ours de Sébastien ? Ce vieux, tout cassé, tout bancal, misanthrope, asocial, atrabilaire et pour tout dire infréquentable, quel besoin éprouve-t-il, à l’automne de sa vie, de déballer toutes ces horreurs ? Croit-il appartenir à la seule famille qui aurait des cadavres dans ses placards ? À quoi bon cet exhibitionnisme facile ? À moins que… eh bien, lançons-nous. Qu’avons-nous à redouter, nous autres gens ordinaires ? »
Philippe aurait pu aussi écrire ceci : « nous sommes tous voyeurs des souffrances des autres ».
Première partie
Premiers pas
Où l’on fait la connaissance du « héros » : Sébastien
Sitôt la gare derrière lui, sitôt longés les bâtiments de la criée où se mêlent toutes les senteurs de la mer, sitôt contourné le bunker enfoncé devant la poste – un souvenir de 44 –, Sébastien reconnaît chaque pavé, chaque sente faufilée entre les garages et les hangars de guingois. Il marche, Sébastien, il marche. Quatre cents mètres, deux cents. Voici la rue, la rue banale, bête comme sont les rues et voici la maison, la porte du couloir d’entrée, béante. Il entre, Sébastien, le nœud dans sa gorge se resserre. Il tombe en arrêt sur une silhouette en prière. Ah ! que ne la connaît-il pas, cette silhouette lourde, sans grâce, sans pardon possible. C’est vendredi. Mère-Chérie, à genoux sur le ciment, lave à grande eau, la brosse ravageuse, la serpillière comme un cilice ; elle lave les trois étages d’escalier. On peut la voir de la rue, elle n’en a cure. Bien au contraire. Elle offre au passant sa peine, son courage de femme ô combien méritante afin que nul n’ignore ce que chacun doit savoir : sa vie est un calvaire sans fin. La preuve : elle lave et frotte, dans le froid et l’humidité, les trois volées de marches, à genoux, comme une suppliante de Fatima. Il est souhaitable et même vivement recommandé de s’extasier :
— Eh bien, madame Cruchon, toujours à laver et récurer, par ce temps ?
— Faut bien, sinon çà deviendrait vite une porcherie avec tout ce passage.
Je précise d’emblée que nul ne venant jamais chez les Cruchons, on est en droit de s’interroger.
Mère-Chérie offre son dévouement de ménagère héroïque sur l’autel sanglant du mariage. Elle s’expose, vaillante et résignée, à l’admiration des foules : « Pensez donc : tout l’escalier et à genoux ! » La manœuvre est à double détente : elle démontre – si besoin en était encore – les mérites de Madame Cruchon ; en outre, elle fait passer son époux pour un tyran domestique exigeant de son épouse accablée de labeur des travaux harassants indignes d’un mari moderne. La subtilité de la chose échappe souvent aux voisins. Sébastien, lui, sait. Ah ! Que Machiavel était un petit garçon !
Mais elle le voit, tout gauche, toute bête :
— Ah ! C’est toi. Fais attention où tu mets les pieds. Je n’ai pas fait ces trois étages (à genoux) pour que tu viennes tout saloper.
— Bonjour, maman.
L’escalier est un Niagara où la serpillière frappe sans merci. À moins de léviter, il est rigoureusement impossible d’éviter l’inondation. Mère-Chérie se redresse douloureusement, les mains aux reins, passe devant Sébastien et vide ses eaux sales dans le caniveau. Pourquoi ? me direz-vous puisqu’il lui est loisible de vider le seau dans le puisard de la cour, à deux pas. Naïfs que vous êtes ; dans la cour, nul ne la verrait. Nouvelle Cosette, Mère-Chérie atteint là son apothéose : les genoux rougis par le ciment, les mains crevassées par l’eau froide, les lombaires en compote, elle cueille avec délices la palme du martyre conjugal. Et ne vous avisez pas de lui demander bêtement pourquoi elle lave aussi souvent un escalier impeccable jamais emprunté ou pourquoi elle ne prend pas une femme de corvée. Elle vous foudroierait d’un définitif : « Sûrement pas ! Payer pour un travail bâclé ? C’est que je les connais, ces jeunes : toutes des feignantes. » Il va de soi qu’il lui serait difficile de dénicher une femme équilibrée acceptant d’œuvrer dans de telles conditions. En plus, il faudrait lui donner des sous, de « l’érgent » comme dit MC (mais çà, faut pas le dire).
Voici donc Sébastien rendu. Il est temps pour moi de lui laisser la parole. Après tout, c’est son histoire, pas la mienne.
— C’est à toi, Sébastien. Nous t’écoutons.
— Et par quoi commencerais-je ? Je ne suis guère au fait de ce genre d’exercice. J’ai peur de bafouiller, d’ennuyer, de faire des phrases, de jouer au poseur.
— C’est un risque, en effet. La vie aussi est un risque quotidien. Alors quoi ?
— Aidez-moi, narrateur. C’est la première fois que je suis amené à dérouler le fil de ma vie.
— Et probablement la dernière. Allons, un effort. Fais comme David Copperfield. L’entame est simple et toute trouvée : « Je nais. »
— Je n’ai ? Mais que n’ai-je ?
— Non pas. Je nais, du verbe naître. Il faut bien naître avant d’être, n’est-il pas ?
Chapitre I
Je nais1
Je nais comme tout un chacun : sans le vouloir et parfaitement inconscient de la chose. Je mourrai probablement de même. Il est cocasse de constater que les deux évènements fondamentaux de notre existence nous échappent totalement. De quoi faire preuve d’humilité. Je nais donc, un deux-août, date fort peu propice à la célébration d’un anniversaire : d’une part, c’est le deux août mil neuf cent quatorze que l’Europe décida de se suicider ; d’autre part, le deux août, tout le monde part ou revient de vacances. Donc, personne pour vous brailler aux oreilles : « Happy birthday to you. » J’aurai échappé à cela et à cette hypocrisie ; le monde se fout bien de savoir que ce jour-là, Mère-Chérie a pondu son gniard. Il me reste le choix entre me le fêter moi-même ou pleurer.
— Et pourquoi pleurer ?
— Parce que chaque anniversaire est un clou de plus enfoncé sur votre cercueil, une marche de plus descendue vers les ténèbres, un coup de canon d’alarme, un grand « dong » dans le compte à rebours. À chacun de nos anniversaires, nous sommes un peu moins vivants, un peu plus morts. Pas de quoi se réjouir.
Je tiens à préciser, avant toute chose, que je suis le « fruit » d’une erreur médicale et voici comment : Henri, mon aîné, eut les oreillons et les refila à Papa-François. Chez un mâle adulte, la conséquence est souvent la stérilité. Le médecin « de famille » comme on disait alors, affirma péremptoirement à Papa-François qu’il ne pourrait plus procréer. Ce dernier interpréta à sa manière, c’est-à-dire : « plus besoin de prendre de précautions quand j’exerce mon droit de cuissage patriarcal ». Conséquence : grossesse inattendue de Mère-Chérie.
Je nais donc. À mes débuts je ne suis qu’un paquet vagissant, une de ces larves de braillards, pissards, chiards hurlant à gorge déployée dans les pondoirs des maternités (avez-vous noté l’étonnante capacité de nuisance sonore des nouveau-nés ? À peine nés, déjà des reproches au monde entier). Mais comment peut-on trouver cela attendrissant ? À quoi songent les parents, tantes, cousins et autres grands-parents en glougloutant d’aussi ineptes propos que : « Oh ! il a tes yeux, pas de doute. »
— Moi, je lui trouve le front de son père (traduction : une tête de mule en devenir).
— Il est tout poutou-poutou. Hein, mon chéri, que tu es le gros poutou-poutou de tata ? Areu, areu, gouzi-gouzi… j’en passe et des pires.
Mais on atteint le sublime dans le genre : « Et qu’est-ce qu’on fera plus tard, mon chéri ? (Le chéri a deux jours et déjà on lui pompe l’air.)
— Tu seras fonctionnaire comme ton papa ? (ou aviateur ou archevêque, grosse truffe !)
— Toi, avec ta jolie bouche, tu feras enrager les filles ! (yeux écarquillés de la victime.)
— Mais c’est vrai qu’il a encore le temps, ce coquin (le coquin en question soupire et lâche un bon pet de soulagement).
— Ah ! je crois qu’il a fait la grosse commission, dit la tata en me palpant le cul (grand bien lui fasse). Où sont les couches ?
Car, remarquez-le, ces bonnes dames si soucieuses de leurs toilettes n’hésitent jamais à s’emmerder les doigts dès qu’il s’agit de tripoter un lardon. Si c’était un adulte, elles le traiteraient de vieux dégueulasse. Allez comprendre…
Le père, le géniteur, celui par qui le scandale est arrivé, est là qui se tait. On l’ignore. Il a rempli son rôle en procréant, parfois sans enthousiasme. On n’a plus besoin de lui… pour l’instant. Le chiard devient la proie des femelles, pour quelques années. Peut-être que c’est à cet instant que germe la minuscule, oh ! la si petite graine de haine que va bientôt lui inspirer ce concurrent inattendu. Il l’ignore encore, mais quelque chose vient de se briser dans sa vie de mâle. L’impétrant passe tout entier aux mains des gloutonnes. Le père se tait ; tout juste réfléchit-il : « Combien ça va coûter, ce cirque ? N’était pas prévu le lardon. Si on ne peut plus tirer son coup sans qu’elle se mette à pondre, alors… »
Mine sombre ; plus sombre encore : celle du frangin, l’aîné, l’unique : « Petit salaud, je te montrerai qui est le chef ici ! »
Remontons le temps de six mois : mère chérie est certaine d’être grosse et croit devoir en avertir l’aîné. Elle lui annonce donc « l’heureuse nouvelle ». À ces mots, cri du cœur : « Un petit frère, mais pourquoi ? Achetez un vélo, une moto (on a des goûts simples dans la famille), mais pas un petit frère ! Je n’ai rien fait pour mériter ça ! » Que c’est beau, l’amour fraternel ! Un vélo ! Je connais au moins ma valeur à ses yeux : un vélo.
— Avec ou sans les sacoches ?
— Avec, bien évidemment. Je suis un garçon.
Je nais donc et je vis. Mon frère a beau espérer de toutes ses forces une maladie infantile foudroyante, rien n’y fait. Je grossis, enfle, prospère et me voici, là, dans le berceau, centre géographique de la famille. Je vis, mais je l’ignore puisqu’il est bien évident que, la vie ne commençant qu’au premier souvenir, je ne serai conscient que, disons, vers trois ans. Si l’on y songe, la vie est une escroquerie ; si vivre c’est savoir que l’on vit, la vie nous vole un tiers de notre temps par le sommeil et plus ou moins les trois premières années au cours desquelles nous ne sommes qu’un bourgeon. Faites le compte. Et la « fin de vie ? » Alors, heureux ?
Je ne sais donc encore rien de ce qui m’entoure et bourdonne autour de moi. Je ne suis rien d’autre qu’un être « dépendant ». Mais ce « rien » est déjà un monceau de tracas, soucis, charges et problèmes.
Traduction : contente-toi de ce que l’on te donne, misérable ! Si tu savais combien tu coûtes ! Et surtout, ne viens pas te plaindre ; tu en auras toujours eu plus que nous, etc, car les parents, les miens, du moins, finiront, n’en doutez pas, par jalouser leur propre rejeton –, celui qui est un rejet, celui que l’on repousse d’être moins purotin qu’ils ne le furent, eux.
Sois reconnaissant, mange ta soupe, vénère-les et ferme ton clapet.
***
On me prénomme Sébastien ; jusqu’ici, rien de grave ; on a vu pire. Papa-François aurait bien vu Gérard, mais Mère-Chérie l’a rembarré aussi sec avec un argument définitif : « Gérard ? Tu n’y songes pas ? Les Gérard ne vivent pas vieux, c’est connu ! » Allez répliquer à cela. Donc, Sébastien.
Sébastien, mais Cruchon. Sébastien Cruchon. Je ne marche pas, je ne parle pas, je ne comprends rien et la vie se complique déjà. Le prénom, passe encore, mais le patronyme va peser, je le sens. Réponse du Père : « Je suis un Cruchon, mon père l’était et son père avant lui. Mon fils aîné en est un (œil sournois dudit aîné). Mon second fils sera Cruchon, et alors ? »
Alors ? Pain bénit pour les cours de récréation : « Sébastien, nez de chien, Cruchon, tête de c. J’en passe et des plus savoureuses. Ceci dit, même Bonaparte s’est fait foutre de sa gueule à Brienne et cela ne l’a pas trop gêné dans sa carrière.
Je nais donc par un beau jour d’été presque ensoleillé, ce qui est rare dans cette bonne ville de C. On prétend n’y connaître que deux saisons : l’automne et le quatorze juillet. Climat tempéré, donc. Très. Le ciel y pisse trois cents jours l’an. C’est l’Irlande sans moutons ni Guinness, la Bretagne sans pardons ni calvaires. C’est l’eau devant, dessous et dessus. Pays de vaches grosses, grasses, au cerveau lent et apathique (je parle des bovins, bien sûr). C’est, selon le mot d’un poète : « la grasse Normandie herbagère et mouillée ». Jolie côte, découpée, encore ornée de ces charmantes résidences secondaires de béton armé gris que nos amis allemands se faisaient ériger en quarante-trois : vues imprenables – meurtrières – sur la mer ; insensibles au vent ; ah ! savaient bâtir en ce temps, ma bonne dame ! ça peut souffler : deux mètres de béton ferraillé. Je connais quelques richesses locales qui seraient bien gênées de dire comment elles se sont faites ? « Ben oui, dame, j’étais dans le bâtiment à cette époque. Fallait bien faire bouillir la marmite de mes ouvriers. Collabo, moi ? Oui, bon, je coulais des bunkers à pleines bétonnières, mais, attention ! je donnais les plans à la Résistance. Je suis un bon Français. Et puis, ces Allemands si corrects de l’Organisation Todt payaient bien, rien à redire » (elle pouvait payer rubis sur l’ongle, l’O.T, les boches nous taxaient de quatre cents millions de francs par jour en frais d’occupation, ça laisse de quoi honorer les traites des fournisseurs). Bref, une bonne partie des familles de notables, respectables, honorables, de C. avait plus ou moins profité de la présence non souhaitée de ces visiteurs. Oui, certes, il fallait bien vivre – et certains ont fort bien vécu – si ce n’avait été moi, ç’aurait été un autre (traduisez : un concurrent). Et puis, difficile de refuser de travailler pour eux. Difficile, peut-être. D’ailleurs, qui êtes-vous pour me faire la morale ? À la Libération, j’ai fait mon devoir. Je n’ai pas été inquiété et même décoré ; c’est bien la preuve (la preuve que vous donniez autant à Pierre qu’à Paul). Comme le temps passe…2
Je serai donc le fils de Mère-Chérie et de Papa-François (« matelot » pour l’escadre et les bals du samedi soir). Il est temps que je vous présente un peu la tribu.
— Un instant. Vous naissez donc.
— Bien obligé même si je ne fais pas l’unanimité. Je m’impose. Puis c’est le trou noir. Jusqu’au jour de l’araignée.
— Quelle araignée ?
Chapitre II
La vie commence à trois ans
Philippe reposa le manuscrit : halte-là ! Il a dit qu’il présentait sa « tribu » ? Fort bien. Que ne le fait-il pas ? « La vie commence à trois ans » ? Agnagna, agnagna… Cette manie qu’ont certains écrivassiers de sauter des étapes, de survoler sans aller au fond des choses ! Il a dit : la tribu. Je veux en savoir plus. Ouvrons donc le couvercle du panier de crabes des Cruchons.
Et tout d’abord, puisqu’il y a des crustacés, disons en un mot dans quel lieu ils vivent. C, la ville de C, vue des collines abruptes qui la ferment au sud, est elle-même un énorme crabe : le corps en est la ville, tournée vers la mer, les deux longues jetées formant darse en sont les pinces. Cette ville n’a pas d’hinterland. On est soit les pieds dans l’eau soit, une fois franchie la barrière des hautes collines, dans un tout autre monde, essentiellement terrien, plus du tout maritime. C. est une fin, ou un début si l’on se projette vers l’océan. D’ailleurs, toute cette presqu’île, ce bras tendu, ce poing brandi vers l’Angleterre ne peut avoir d’autres buts que de la menacer. Elle est toute militaire, et ce, depuis des siècles. Ce crabe énorme sent la mer, pue la marée quand les chalutiers et les cordiers y viennent déverser leur moisson frétillante. À peine triés, pesés, jetés sur la glace, les sujets de la mer sont enfournés dans des wagons frigorifiques qui attendent là et, de sitôt, filent vers la capitale. Le paradoxe est que le poisson qu’on y consomme là-bas est parfois moins frais que celui qui jonche les étals des poissonniers parisiens, premiers servis. Ce n’est déjà plus la Normandie du lait, des vaches et des fromages. Ces richesses ne franchissent pas les collines. Ici, c’est tout pour la mer, le voyage, la pêche, la guerre. Le port militaire, clos dans l’arsenal, est tout et le fut longtemps. Ce n’étaient que longues coques grises des croiseurs et des contre-torpilleurs, cigares bas des sous-marins et, parfois, l’amoncellement de canons lourds d’un cuirassé en visite. Mais les grosses unités, c’est plutôt à Brest ou Toulon qu’il convient de les chercher. La ville ressemble parfois à un de ces parterres de fleurs dans lequel les cols bleus et les pompons rouges des matelots seraient les fleurs dansantes et innombrables. Des marins, des bistrots, des bordels, ainsi est C.
Mais C. c’est aussi et surtout l’Arsenal, cette ville militaire, toute de granite, au sein de laquelle on construit, en les cachant bien, les bateaux de guerre. L’arsenal de la Marine est le premier employeur de la ville. Ici, on n’a guère le choix : marin-pêcheur ou ouvrier de l’État.
Papa-François, commençons par lui, après avoir servi dans la Royale, après mille déconvenues dans l’industrie, a trouvé un emploi –, oh ! bien modeste – derrière les murailles grises.
Mère-Chérie ne travaille pas – « les femmes qui travaillent hors de leur foyer sont toutes des salopes », selon Papa-François » – du moins, se contente-t-elle de bricoler deux jours par semaine dans la boutique du grainetier dont j’aurai l’honneur de vous causer plus tard.
Henri, le frère aîné, est lycéen ; enfin, quand le lycée ne l’a pas renvoyé pour sa conduite très… turbulente. Finalement, il fera tous les établissements possibles et imaginables des alentours avant que de finir… mais, de cela aussi, je vous entretiendrai en temps utile. Pour l’heure, il cultive une dégaine savamment décontractée de poète maudit. À treize ans, il est très calé sur Rimbaud, Baudelaire et Lautréamont. Les parents, interloqués, en finissent par se demander si cet agité du bocal est bien leur fils. D’ailleurs, les mauvais jours – c’est-à-dire souvent-le un des deux ne rate pas l’occasion de déclarer à son conjoint : « TON fils a encore fait le con ! » Ô Joies familiales, ô bonheur accueillant du foyer, ô certitude éducative du coup de trique et de la baffe généreusement distribués !
Telle est la tribu au sein de laquelle Sébastien échouera – et ceci, dans toutes les acceptions du verbe « échouer ».
***
« N’ayant conservé aucun souvenir avant d’avoir eu mes trois ans, je ne me distingue guère des autres braillards de mon espèce. Il y a là un des mystères de notre condition. Les premières pages de notre livre personnel sont des pages blanches. Je nais au monde, je suis un organisme vivant, mais je l’ignore. Descartes a beau avoir raison avec son « cogito ergo sum », cela ne m’avance guère. Avant mes trois ans, je mange, je bois, je dors, je défèque, je me dresse sur mes deux pattes de derrière fort malhabiles, je saisis tout ce qui passe à portée de mes menottes avides, je tombe parfois (souvent), mais je l’ignore. Je ne vis pas ; je suis vécu. Je suis faible et maladroit. De tous les animaux terrestres, le petit d’homme est sans doute celui qui est le plus tardivement dépendant de ses géniteurs qui le protègent. Eh oui ! l’homme est inférieur à la bête qui, dès ses premiers jours, se dresse, se nourrit, s’abreuve, marche et suit la harde. De cette infériorité primale, l’homme se venge plus tard : il devient un tyran qui tue, détruit, torture avec allégresse comme s’il avait une terrible revanche à prendre, ce qui amènera Papa-François à formuler un de ces aphorismes péremptoires : « De tous les animaux, le seul nuisible, c’est l’homme. » Ces mots me hanteront longtemps. Faut-il voir dans notre incapacité originelle la cause de nos cruautés d’adulte ?
Donc, j’ai trois ans ; je suis au lit. Blancheur du drap jusqu’au menton. Sur cette vastitude immaculée, elle avance, craintive, précautionneuse, terrifiante, horrible. Sa lenteur, sa prudence, n’en sont que plus menaçantes. Je suis pétrifié : qui est-elle, que me veut-elle ? Pourquoi s’approche-t-elle de moi ?
Ô Araignée, ma sœur, puisqu’il faut t’appeler par ce nom, éloigne-toi. Toi, si prudente, si discrète, toi tant haïe et cependant si faible et si innocente, pourquoi es-tu la première créature dont je me souvienne ? Sais-tu combien je souffrirai d’écraser tant de tes sœurs et qu’il me faudra quarante années pour dominer ma phobie et me dire : « C’est toi qui me crains, mais c’est moi qui te tue, toi qui te terres derrière une poutre au premier bruit, toi si utile, toi, incomparable artiste dans tes œuvres. Tu ne me veux aucun mal –je ne suis pas une mouche ! – et la mémoire transmise par des milliers de générations d’araignées martyrisées par nous t’a enseigné que je suis ton pire ennemi, que je te tue sans raison précise, simplement parce que tu es toi, telle que tu es et que je ne supporte pas ton apparence. Cache-toi ; fais-toi petite et invisible, ou souffre et meurs. Je te tue, car tu suscites en moi la répulsion, et, dieu cruel, je tue ce qui me dégoûte. Gloire à l’homme !
Cependant, peut-être est-ce moi qui te fais horreur si tant est que tu puisses éprouver un tel sentiment. Ce géant bruyant, imprévisible, cette montagne en mouvement, sans doute est-ce pour toi une vision atroce. L’image que j’ai de toi, ce fantasme, en fait, n’est en rien comparable à la terreur que je répands parmi tes sœurs. Toi, tu tues pour te nourrir ou te défendre, mais moi je tue, car tel est mon bon plaisir. Et nous sommes fiers de ce que nous sommes ! Nous nous élevons des monuments ! Mais qui osera ériger le mémorial de la bête innombrable torturée par l’homme-dieu ? Qui ose glorifier l’arracheur de pattes de mouches, le tronçonneur de vers, le cloueur de chouettes aux portes des granges, l’énucléeur de chatons, le tortionnaire de chiens enchaînés à vie ? Qui tient encore à célébrer les bataillons des vaillants guerriers fusilleurs de lapins, ces héros du dimanche ? Ah, Poverello d’Assise ! Ils t’ont dit fou et avaient bien raison, car les fous nomment fou celui qui leur est différent.
Ainsi, Araignée, ma sœur, de t’avoir tant exterminée, je me repens et chacune d’entre tes semblables que j’épargne désormais est un petit pas sur le chemin de ma rédemption.
Codicille : qui écrase l’innocente araignée n’est guère différent de qui massacre le Juif parce qu’il est juif. Nous tuons celui que nous croyons autre. L’Autre, c’est le monstre ! Et pourtant, tous nous sommes, araignée, Juif, étranger, moi, créatures de Dieu. Amen.
***
À cet âge balbutiant, le poupon est passif. Si la vie humaine est synonyme d’action et d’action consciente, le petit enfant ne vit pas pleinement comme il vivra grandi. Il s’exerce à vivre, il apprend. La vie lui est comme l’acquisition d’une autre langue, pleine de déconvenues, de bégaiements, de ratages qu’il lui faut surmonter, encore et encore, maladroitement, avec pour seule arme sa seule volonté appuyée à une faiblesse physique pathétique. Mais il veut vivre, avec cette férocité qui étonne toujours. Il n’a guère de pouvoir sur l’univers qui l’entoure ; tout lui paraît immense, démesuré et hors de portée.
Les meubles sont des montagnes, les adultes des géants, les pièces exiguës du modeste logement familial des halls de gare, les escaliers de l’Himalaya. Tout est trop lourd, trop loin, trop haut. Il ne peut rien entreprendre par lui-même, ni se nourrir, ni se vêtir, ni satisfaire les fonctions organiques les plus élémentaires. Il est dépendant. Ce que ses parents croient être un élan d’amour n’est que l’attachement viscéral, primal, du faible au fort, du valet à son maître, l’expression de la nécessité. La femelle mammifère le sait bien qui repousse le petit à peine sevré. Il lui faut faire la preuve qu’il peut alors survivre. Elle n’attend de lui ni reconnaissance ni amour. Elle sait que, grandi, il sera un concurrent ou un danger. Son obscur instinct lui commande d’élever, de nourrir et de protéger. Ce n’est nullement de l’amour. C’est là le même devoir que celui de la sentinelle gardant son poste.
L’homme est tout autre. Il se sent contraint d’aimer (l’homme moderne, j’entends, car il en était tout autrement avant le Rousseau du dix-huitième). Il doit chérir ceux qu’il a engendrés quand bien même il ne recevrait d’eux qu’un monceau de déceptions et d’ennuis. Sans doute aime-t-il par devoir, voit-il en eux d’autres lui-même. Ou bien procrée-t-on juste pour se prolonger, pour ne pas mourir tout à fait ? En engendrant, on vainc un peu la camarde. La descendance est le fruit d’une double inquiétude : la volonté tenace de vivre, purement biologique et l’angoisse métaphysique de retourner au néant sans laisser de trace visible. Tout le reste n’est qu’attendrissement et niaiserie gagatisante. Avant, le nouveau-né, être fragile et périssable, passait vite et souvent. On ne s’endeuillait guère longtemps de la perte d’un petit. Il ne devenait intéressant que plus tard, quand sa vigueur laissait deviner un futur et une force productive. Osons le dire : l’homme qui aime ses enfants s’aime à travers eux. Ce que nous nommons amour paternel est un narcissisme allié à des devoirs sociaux.
C’est ainsi que Sébastien croît, végétatif et déjà encombrant. Il tient sa place, réclamant tout son dû. Il est au monde, mais pas encore « du » monde. J’y viens.
***
L’école maternelle ou la découverte de l’injustice
Il a bientôt cinq ans, ce grand niais. Mère-Chérie a commencé de travailler « au noir » chez un grainetier et il lui faut bien ne plus avoir le rejeton dans les jambes. Donc, incarcération du bambin dans ces garderies-débarras qu’on nomme pudiquement « écoles maternelles », mais qui ne sont ni des écoles – puisqu’on n’y apprend rien – ni maternelles puisque les mamans en sont exclues. C’est l’entrée dans le monde impitoyable des grandes personnes et les p’tits culs tout juste débarbouillés qui vont s’en rendre compte.
Je vous parle d’un temps révolu, d’une époque qui voyait les Français devenir des consommateurs. On les avait privés de tout ; ils voulaient prendre leur revanche sur cette chienne de vie : vélomoteurs, radios, bientôt téléviseurs, bagnoles pour les plus argentés et même, un truc tout nouveau. Mais ô combien alléchant : les Vacances ! La France se reconstruisait, entrait dans le monde moderne, avait abandonné le cul des vaches pour l’établi ou le comptoir. Et les femmes ! Ah ! les femmes ! Depuis qu’on leur avait octroyé le droit de vote (je te demande bien comme si elles comprenaient quoi que ce soit à la politique, ces innocentes), depuis qu’on en avait fait des citoyennes après avoir été des ventres passifs et des poules pondeuses, voilà-t’y pas qu’elles ambitionnaient de travailler ? De mères et épouses respectables, elles devenaient des prolétaires. Elles voulaient leurs sous à elles, sans avoir à quémander au mâle de quoi se vêtir, se pomponner, se maquiller. N’y avait plus de morale, voilà tout.
Conséquence : puisque ces garces allaient se pavaner au bureau ou à l’usine, qu’elles ne pouvaient plus torcher leurs moutards, il fallait que la République bienveillante créât des lieux où l’on garderait leurs rejetons jusqu’au soir. Encore heureux qu’elles eussent le temps de faire la soupe, car ça ! pas question de transiger. Papa-François était strict à ce sujet : le soir, il s’attablait, fourchette en l’air, couteau brandi et fallait que la gamelle se remplisse et pas avec des trucs « industriels ». Lui qui rapportait sa paye à la maison, il exigeait que ses droits de chef de famille (eh oui, cela existait en ce temps, les « chefs de famille »), fussent respectés, à savoir : que sa femme écartât les cuisses quand lui l’exigeait et que la soupe soit chaude et à l’heure. Enfin, c’était du moins sa Weltanschauung à lui.
Et voici pourquoi on avait érigé des écoles maternelles. Celle de Sébastien n’était guère éloignée. On traversait la rue, on enfilait une ruelle bordée de jardins et de garages et hop ! on était déjà face à une construction carrée, toute de briques et de vitres, où, chaque matin, des mères surmenées déposaient leur progéniture éplorée.