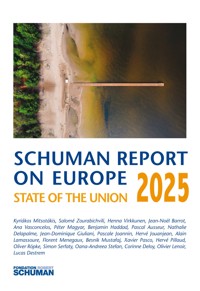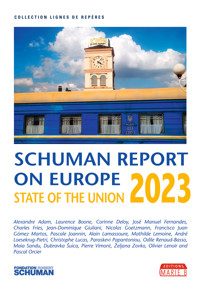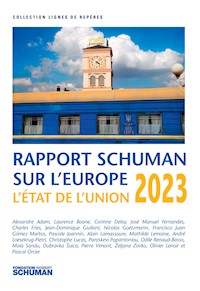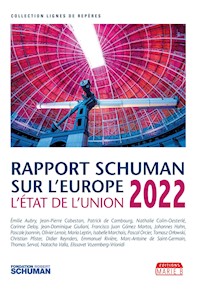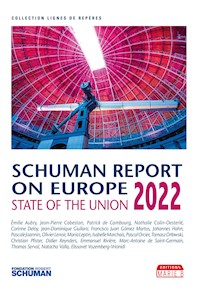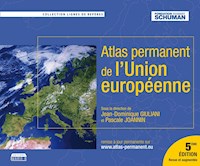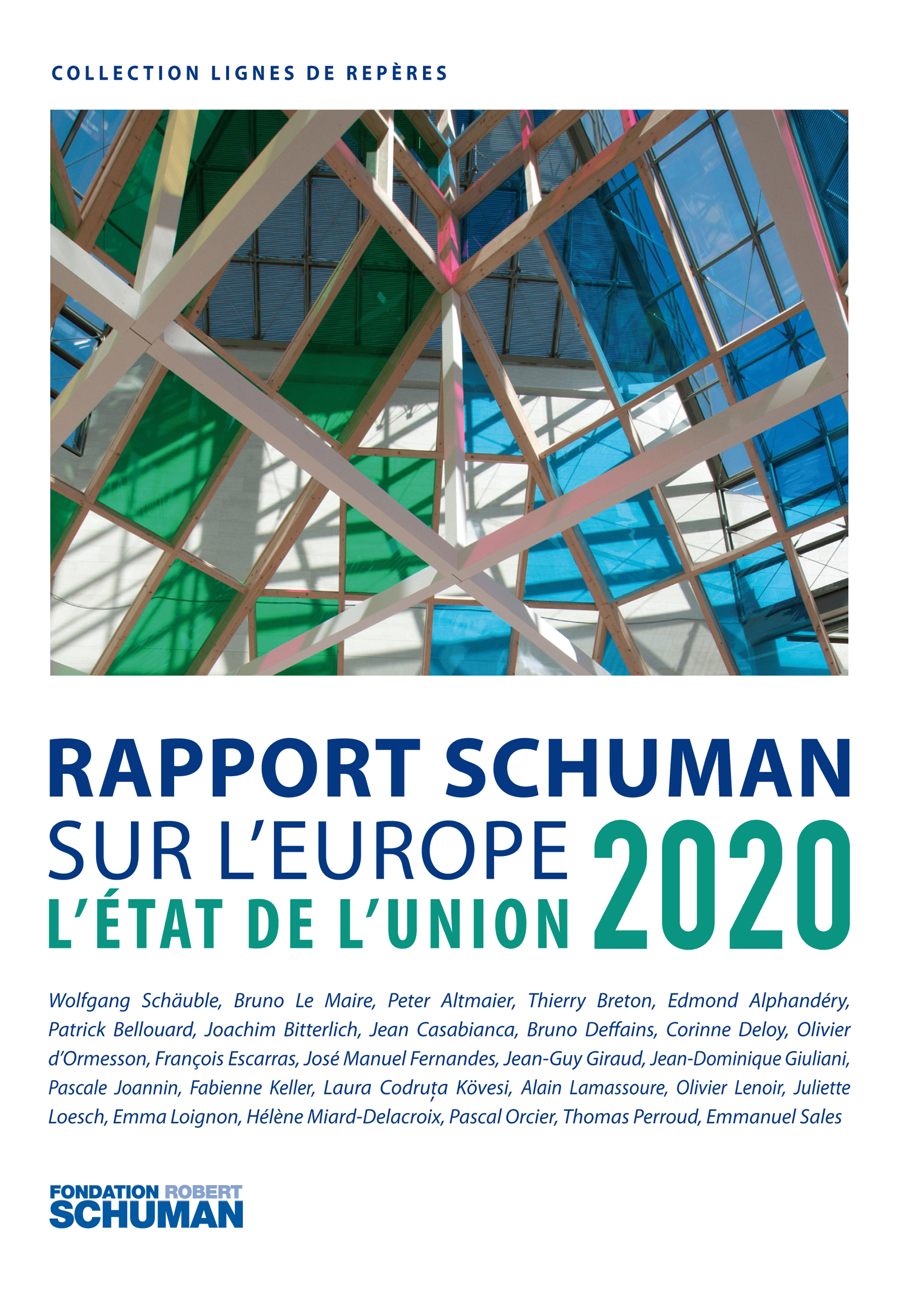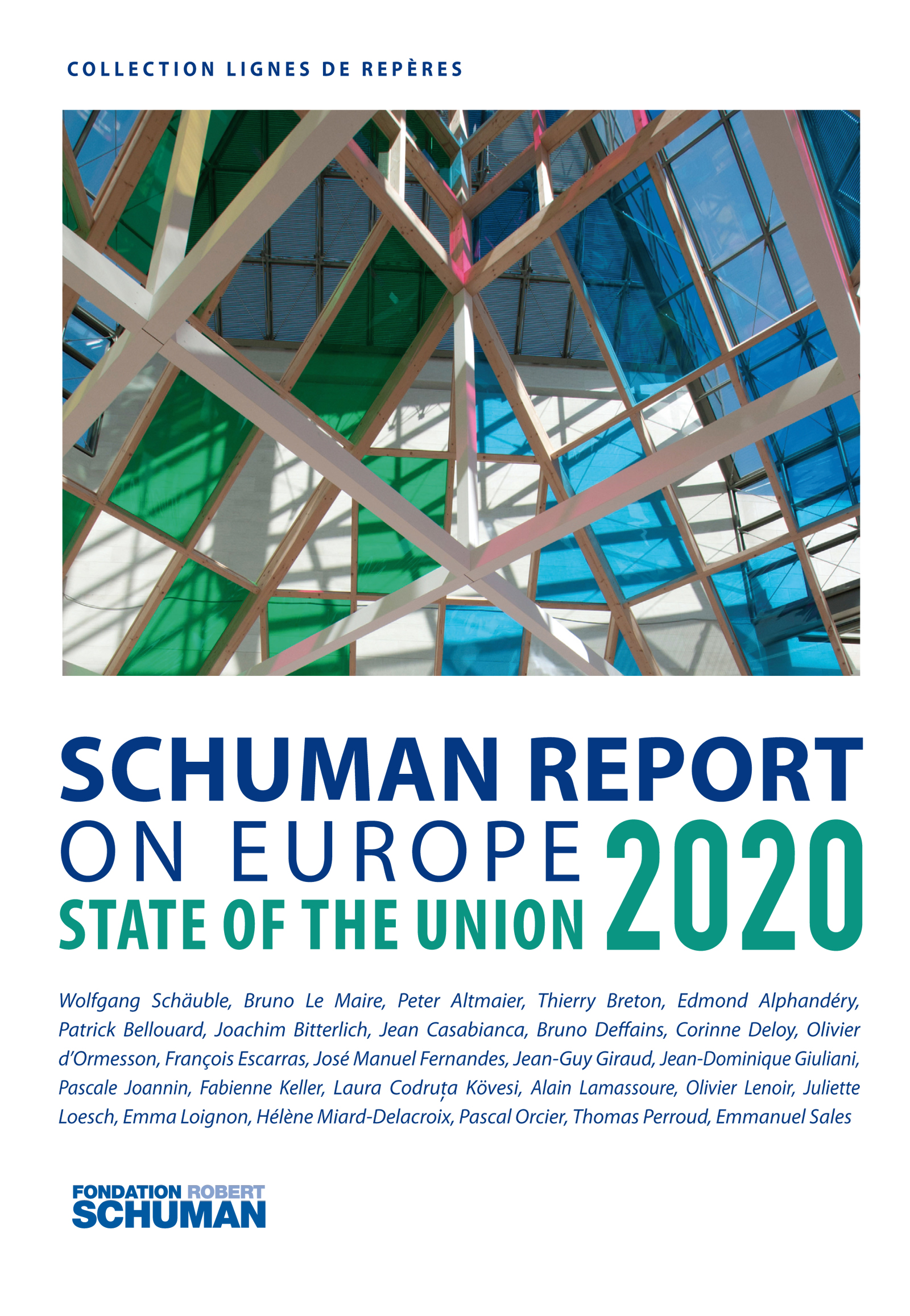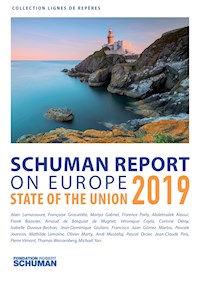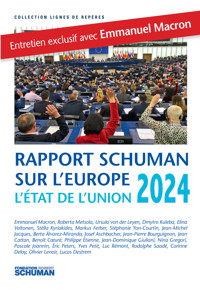
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Marie B
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Depuis 2007, la Fondation Robert Schuman réunit les meilleurs experts pour éclairer l'actualité européenne et en décrypter les enjeux et perspectives.
L'édition 2024 est particulièrement attendue- entretien exclusif avec Emmanuel Macron à la veille d' élections européennes à haut risque qui vont se dérouler en juin.
Comme pour les éditions précédentes, l'ouvrage est illustré par des cartes originales et est enrichi d'une partie statistiques commentées.
À PROPOS DES AUTEURS
Directrice générale de la Fondation Robert Schuman, ancienne auditrice de la 56e session nationale de l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN),
Pascale Joannin dirige le Rapport Schuman sur l’Europe, l’état de l’Union, éditions Marie B, et codirige l’Atlas permanent de l’Union européenne, éditions Marie B (5e édition), 2021. Elle est l’auteur de
L’Europe, une chance pour la femme, Note de la Fondation Robert Schuman, n° 22, 2004. Elle a publié de nombreuses études sur les questions européennes.
Président de la Fondation Robert Schuman,
Jean-Dominique Giuliani a été directeur de cabinet du Président du Sénat René Monory et directeur à la SOFRES. Ancien Conseiller spécial à la Commission européenne et membre du Conseil de Surveillance d’Arte, il codirige l’Atlas permanent de l’Union européenne, Éditions Marie B (5e édition), 2021. Il est l’auteur de
Européen, sans complexes, éditions Marie B, 2022 et de
La Grande bascule, éditions de l’école de Guerre, 2019.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’État de l’Union 2024 Rapport Schuman sur l’Europe est une œuvre collective créée à l’initiative de la Fondation Robert Schuman au sens de l’article 9 de la loi 57-298 du 11 mars 1957 et de l’article L.113-2 alinéa 3du code de la propriété intellectuelle.
Textes originaux en allemand traduits en français
par Mathilde Durand et Stefanie Buzmaniuk.
Les opinions exprimées dans cet ouvrage n’engagentque la seule responsabilité de leurs auteurs.
Mise en page : Nord Compo
Maquette de couverture : Nord Compo
Photographe : Philippe STIRNWEIS © European Union 2024 – Source : EP
Copyright : Éditions Marie B, collection Lignes de repères
ISBN : 978-2-4927-6343-4
Ce document numérique a été réalisé par Nord Compo.
Sommaire
Sommaire des cartes
1957-2024 : la construction européenne
Territoires de l’Europe
L’Europe au féminin
2. Et enfin vint la géopolitique
Le soutien à l’Ukraine
60 ans d’élargissement
Les dépenses militaires dans le monde
Sécurité dans le monde
La compétition sino-américaine
Investissements dans le secteur spatial
Le commerce maritime international
La mer en Europe : enjeux et stratégies
Les espaces ultra-marins de l’Union européenne
3. Espoirs et défis
Union européenne : attachement et confiance
La santé des Européens
Les dépenses en recherche et développement
Migrations internes
L’Union européenne et la gestion des migrations
Les principales routes migratoires vers l’Europe
4. Objectif croissance
Les préoccupations majeures des Européens en 2024
L’Europe dans le monde : accords commerciaux
Budget de l’Union européenne
Dette publique
Perspectives de croissance mondiale
Europe et compétitivité
L’énergie nucléaire : état des lieux et stratégies
L’origine de l’électricité en Europe
La politique agricole commune
Intelligence artificielle : moyens et dynamiques
Les start-up en Europe
Numérisation de l’Europe
5. Observatoire des élections
L’Europe politique en 2024 (gouvernements)
L’Europe politique en 2024 (chefs de gouvernement)
Les populismes en Europe
6. L’Union européenne par les statistiques
L’inflation
Géographie de la zone euro
La démographie
Le commerce extérieur
Commerce intra communautaire
Les matières premières critiques
La pression fiscale en Europe
Les retraites
Ont contribué à cet ouvrage
Textes
Berta Álvarez-Miranda
Professeure titulaire de sociologie à l’université Complutense de Madrid, Berta Álvarez-Miranda a été directrice de recherche de 2013 à 2017 du Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), département gouvernemental de sondages d’opinion en Espagne. Ses recherches dans le domaine de la migration comprennent à la fois des travaux quantitatifs et qualitatifs. Elle a sondé les attitudes des immigrants originaires de pays à majorité musulmane dans le cadre d’une étude comparative des villes européennes et a mené des analyses des politiques publiques et des relations internationales liées à la migration.
Josef Aschbacher
Depuis mars 2021, Josef Aschbacher est Directeur général de l’Agence spatiale européenne (ESA). Ce poste est l’aboutissement d’une longue carrière internationale au sein du secteur spatial, dont trente-cinq ans à l’ESA, où il a été Directeur des programmes d’observation de la Terre et coordonnateur du programme Copernicus. Auparavant, il a travaillé pour le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne, l’Agence spatiale autrichienne et l’Institut asiatique de technologie. Il est titulaire d’un doctorat en sciences naturelles de l’Université d’Innsbruck.
Jean-Pierre Bourguignon
Mathématicien de formation, Jean-Pierre Bourguignon a été chercheur au CNRS de 1969 à 2013, tout en étant professeur à l’École polytechnique de 1986 à 2012. Il a dirigé l’Institut des Hautes Études Scientifiques situé à Bures-sur-Yvette (France) de 1994 à 2013. Il a été le président du Conseil européen de la Recherche (ERC) de 2014 à 2019, puis ad interim de juillet 2020 à août 2021. Il préside actuellement le Conseil d’administration de l’Université Ludwig Maximilian à Munich.
Jean Cattan
Secrétaire général du Conseil national du numérique, Jean Cattan est docteur en droit public, diplômé du Collège d’Europe et chargé d’enseignements en droit et régulation du numérique à Sciences-Po Paris et à l’Université Panthéon-Assas. Il est l’auteur de nombreux articles portant sur la régulation du numérique, les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle. Il est le coauteur avec Serge Abiteboul de Nous sommes les réseaux sociaux (Odile Jacob, 2022).
Benoît Cœuré
Diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique (Ensae), Benoît Cœuré intègre la Direction du Trésor du ministère français de l’Économie est des Finances, puis le directoire de la Banque centrale européenne de 2012. À la tête du pôle innovation de la Banque des règlements internationaux jusqu’en mars 2020, il est nommé président de l’Autorité de la concurrence en janvier 2022. Il est aussi président du Centre pour la recherche économique et ses applications (Cepremap).
Corinne Deloy
Diplômée de Sciences Po et titulaire d’un DEA de sociologie politique de l’université de Paris I – Panthéon Sorbonne, Corinne Deloy a été journaliste au Nouvel Observateur et Secrétaire générale de la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol). Elle est chargée d’études au Centre de recherches internationales de Sciences Po (CERI) et rédactrice de l’Observatoire des élections en Europe (OEE) de la Fondation Robert Schuman.
Philippe Étienne
Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de mathématiques, Philippe Étienne devient diplomate à sa sortie de l’ENA en 1980. Il sert trois fois à la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne, notamment comme ambassadeur, (2009-2014). Il a été ambassadeur en Roumanie, en Allemagne et aux Etats-Unis (2019-2023). Appelé à plusieurs reprises à travailler dans des cabinets ministériels, dont la direction du cabinet du ministre (2007-2009), il rejoint l’Elysée en mai 2017 comme conseiller diplomatique du président de la République. Élevé à la dignité d’Ambassadeur de France en juin 2019, il remplit différentes missions de conseil et d’enseignement, dont un cours sur démocratie et géopolitique à l’ENS. Il préside la Mission pour le 80e anniversaire de la Libération de la France.
Markus Ferber
Ingénieur de formation, Markus Ferber est député européen (PPE, DE) depuis 1994. Membre de la commission des affaires économiques et monétaires, dont il est le coordonnateur du groupe PPE, il est aussi membre suppléant de la commission des transports et du tourisme et vice-président de la sous-commission des affaires fiscales. Porte-parole du cercle parlementaire des PME d’Europe du groupe CDU/CSU (PKM Europe), il a été président du groupe Europe de la CSU de 1999 à 2014 et président de la CSU du district de Souabe de 2005 à 2023. Depuis 2020, il préside la Fondation Hanns-Seidel. En juin 2021, il a été élu vice-président de l’Union des fédéralistes européens (UEF).
Jean-Dominique Giuliani
Président de la Fondation Robert Schuman, Jean-Dominique Giuliani a été directeur de cabinet du Président du Sénat René Monory et directeur à la SOFRES. Ancien Conseiller spécial à la Commission européenne, il est membre du Conseil de Surveillance d’Arte France et d’Arte GEIE, Il codirige l’Atlas permanent de l’Union européenne, Éditions Marie B (5e édition), 2021. Il est l’auteur de Européen, sans complexes, éditions Marie B, 2022 et de La grande bascule, éditions de l’école de Guerre, 2019.
Nina Gregori
Directrice exécutive de l’Agence de l’Union européenne de l’asile, basée à Malte, depuis juin 2019, Nina Gregori a été auparavant à la tête de la direction asile et migration du ministère slovène de l’Intérieur. Pendant la présidence slovène du Conseil en 2008, elle a présidé le Comité stratégique sur l’immigration, les frontières et l’asile (SCIFA), au sein duquel elle était déléguée nationale. Longtemps membre de la Commission interdépartementale slovène des droits de l’Homme, elle a été membre permanent de plusieurs délégations slovènes dans des procédures et instruments des Nations unies et du Conseil de l’Europe.
Jean-Michel Jacques
Après vingt-trois ans dans la Marine nationale, dont dix-sept dans les forces spéciales, Jean-Michel Jacques a été élu maire de Brandérion en 2014 et conseiller communautaire de l’agglomération de Lorient. En 2017, il est élu député du Morbihan et réélu en 2022. Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées, il a été élu rapporteur de la loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030. Il publie régulièrement des articles autour de la construction européenne et de la politique de défense, mettant en avant entre autres ses retombées positives en faveur du renforcement du lien Nation-Armées et ses atouts pour les territoires.
Pascale Joannin
Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Ancienne auditrice de la 56e session nationale de l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN), Pascale Joannin dirige le Rapport Schuman sur l’Europe, l’état de l’Union, éditions Marie B, et codirige l’Atlas permanent de l’Union européenne, éditions Marie B (5e édition), 2021. Elle est l’auteur de L’Europe, une chance pour la femme, Note de la Fondation Robert Schuman, no 22, 2004. Elle a publié de nombreuses études sur les questions européennes.
Dmytro Kuleba
Diplômé de l’Institut des relations internationales de l’université Taras-Chevtchenko de Kiev, Dmytro Kuleba abandonne en 2013 après dix ans le service diplomatique ukrainien en invoquant son désaccord avec l’ancien président Viktor Ianoukovitch, et prend une part active aux manifestations d’Euromaïdan puis crée la Fondation UART pour la diplomatie culturelle. En 2016, il est nommé Représentant permanent de l’Ukraine auprès du Conseil de l’Europe. D’août 2019 à mars 2020, il est vice-Premier ministre chargé de l’intégration européenne et euro-atlantique de l’Ukraine, avant d’être nommé ministre des Affaires étrangères le 4 mars 2020.
Stélla Kyriakídes
Psychologue clinicienne, après trente ans au ministère chypriote de la Santé au département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Stélla Kyriakídes est élue en 2006 à la Chambre des représentants à Chypre, où elle exerce sa fonction de députée pendant treize ans. Elle est élue en 2017 présidente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Particulièrement impliquée dans la lutte contre le cancer du sein au niveau européen (Europe’s Beating Cancer Plan) et connue pour son approche attentive au patient, elle est, depuis 2019, commissaire européenne en charge de la santé et de la sécurité alimentaire.
Emmanuel Macron
Président de la République française depuis mai 2017. Emmanuel Macron a étudié la philosophie avant d’intégrer l’École Nationale d’Administration (ENA), dont il a été diplômé en 2004. Il a alors intégré l’Inspection Générale des Finances (IGF) ou il a travaillé quatre ans avant de rejoindre le secteur bancaire. Il est devenu, en 2012, secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Il a quitté ses fonctions en juillet 2014 avant de devenir ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique (2014-2016).
Roberta Metsola
Élue présidente du Parlement européen en janvier 2022, Roberta Metsola y siège depuis 2013. Juriste de profession, elle est spécialisée dans la politique et le droit européens. Avant son élection au Parlement européen, elle a fait partie des services de la Représentation permanente de Malte auprès de l’Union européenne, puis elle a occupé la fonction de conseillère juridique auprès de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Au cours de ses études, elle a activement milité en faveur de l’adhésion de Malte à l’Union européenne. En 2002-2003, elle a été secrétaire générale des Étudiants démocrates européens. Elle est diplômée de l’Université de Malte et du Collège d’Europe.
Éric Peters
Ancien élève de l’École normale supérieure de Lyon et diplômé de l’École nationale du génie rural, des eaux et des forêts (ENGREF), Éric Peters est titulaire d’un master de biologie moléculaire et cellulaire. Depuis mars 2021, il est chef d’unité (ff) en charge de la stratégie européenne en matière de politique du numérique « la décennie numérique 2030 » à la Direction Générale CONNECT de la Commission européenne, où il a occupé différents postes. Il a également la charge de la coordination des aspects numériques de l’initiative « New European Bauhaus ».
Yves Petit
Professeur à l’Université de Lorraine (Faculté de droit de Nancy), Yves Petit dirige le Centre européen universitaire (CEU) de Nancy depuis 2016. Il est responsable du Master « Études européennes et internationales » et du parcours-type de Master 2 « Droit de l’Union européenne ». Il enseigne le droit européen. Ses travaux de recherche portent sur les institutions européennes, les politiques de l’Union (agriculture, environnement), et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Luc Rémont
Ingénieur de profession, diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale supérieure des techniques avancées (ENSTA Paris), et ingénieur militaire au début de sa carrière, Luc Rémont rejoint le ministère français de l’Économie et des Finances, comme chargé des relations avec les banques de développement, puis comme membre de cabinet. Après plusieurs expériences dans le secteur privé, il devient en 2022 le Président-Directeur général d’EDF.
Rodolphe Saadé
Président-Directeur général du groupe CMA CGM depuis 2017, Rodolphe Saadé pilote une flotte de plus de 600 navires et de terminaux. Il a procédé à l’acquisition de CEVA en 2019 et au lancement de CMA CGM Air Cargo en 2021. Il a aussi repris les journaux La Provence et La Tribune et acquis des participations dans l’audiovisuel (M6) et le numérique (Brut). En parallèle, il a fondé ZEBOX, un réseau d’accélérateurs de start-up, en 2018 et TANGRAM, un centre de formation et d’innovation, en 2024, deux initiatives visant à soutenir l’innovation et à façonner l’avenir du transport et de la logistique.
Elina Valtonen
Ancienne programmatrice informatique, Elina Valtonen a travaillé dans le secteur financier pendant une dizaine d’années avant d’embrasser une carrière politique. Elle devient députée au Parlement finlandais en 2014. Elle a été aussi présidente de la délégation finlandaise à l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, puis membre de la délégation finlandaise au Conseil de l’Europe. Elle est vice-présidente du parti de la coalition nationale (KOK). Elle est, depuis juin 2023, ministre des Affaires étrangères.
Ursula von der Leyen
Diplômée en sciences économiques des universités de Göttingen et de Münster, puis en médecine, Ursula von der Leyen est élue députée au Landtag de Basse-Saxe en 2003. La même année, elle est nommée ministre des Affaires sociales, des Femmes, de la Famille et de la Santé de ce Land. En 2005, elle est nommée ministre fédérale de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la Jeunesse en 2005 par la chancelière Angela Merkel. En 2009, elle est nommée ministre fédérale du Travail et, en 2013, ministre fédérale de la Défense. En juillet 2019, elle est élue Présidente de la Commission européenne et devient la première femme à occuper cette fonction.
Stéphanie Yon-Courtin
Diplômée en droit européen des affaires, Stéphanie Yon-Courtin a été juriste pour la Commission européenne, avocate et conseillère internationale au cabinet du président de l’Autorité de la concurrence. Elle devient maire de Saint-Contest, vice-présidente du département du Calvados, puis députée européenne (Renew, FR) en 2019 et Conseillère régionale de Normandie. Au Parlement européen, elle coordonne la commission des Affaires économiques et monétaires et est membre de celle du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Elle est, entre autres, rapporteure sur la politique de concurrence, la directive sur le crédit à la consommation et la stratégie d’investissement de détail.
Statistiques
Olivier Lenoir
Analyste stratégique dans le numérique, Olivier Lenoir collabore également à la revue Le Grand Continent. Son parcours européen l’a mené à travailler dans le numérique, les affaires publiques et la stratégie entre Paris et Varsovie. Il est diplômé de l’École normale supérieure en économie et relations internationales.
Cartes
Lucas Destrem
Géographe de formation, diplômé des universités de Limoges, de Genève et de Lille, Lucas Destrem est spécialisé sur les questions de toponymie critique et de patrimoine industriel. Cartographe, sa pratique mêle à la fois productions conventionnelles et créations originales. Il est aussi l’auteur d’ouvrages et de contributions variées, consacrés à la valorisation du patrimoine régional, à la dénomination politique des lieux ou aux héritages de l’industrie.
Quelques remarques liminaires
Quelle plus-value européenne ?Succès, défauts et perspectives
Jean-Dominique GIULIANI
Depuis la crise sanitaire, l’Union européenne s’est transformée. Depuis la guerre russe en Ukraine, ces changements se sont accélérés, au point que le visage qu’elle présente désormais a peu à voir avec ce qu’il était il y a cinq ans encore. Les institutions européennes ont dû s’adapter aux besoins exprimés par les États membres. Elles ont elles-mêmes tiré des conséquences propres de l’évolution de la situation géopolitique. Ces bouleversements ont entraîné des avancées spectaculaires, mais aussi quelques erreurs.
Pacte vert
Les Européens ont décidé d’être les mieux-disants dans la lutte contre le changement climatique. Ils ont utilisé la dimension et les institutions européennes pour se fixer ensemble des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre (–90 % par rapport à 1990 d’ici 2040) et parvenir à la « neutralité climatique » du continent en 2050. Cent soixante-neuf buts à atteindre en 2030, 3 milliards d’arbres à planter, 75 textes de lois européennes ont été décidés alors qu’un tiers des 1 800 milliards € des plans de relance et d’investissement est consacré à cette politique.
Dès son investiture en 2019, Ursula von der Leyen a fixé comme priorité de sa Commission la réalisation du « Pacte vert ». Celui-ci a fait l’objet d’un très fort lobbying des organisations non gouvernementales et d’un engouement spontané et vibrant de la part des gouvernements nationaux. L’ensemble des institutions européennes, y compris la Banque centrale et la Banque européenne d’investissement, se sont alignées sur ces orientations, considérées comme susceptibles de générer une nouvelle croissance et de conférer à l’Europe une avance dans les transformations des modes de production et de consommation. L’engagement écologique est devenu, sous cette législature, le principal credo des politiques européennes.
Régulation extraterritoriale numérique
L’absence de régulation des grands acteurs du numérique et leur influence sur le marché européen ont conduit l’Union européenne à adopter des règles inédites et sévères qui s’appliquent erga omnes. Après le Règlement général sur la protection des données (RGPD) adopté en 2016, la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act) depuis mai 2023 et la loi sur les services numériques (Digital Services Act) entrée en application le 17 février 2024 sont des innovations jamais et nulle part ailleurs tentées. Accompagnées d’autres textes législatifs imposant en 2022 de supprimer les contenus à caractère terroriste, de combattre les abus sexuels envers les enfants, de protéger le droit d’auteur ou l’intégrité du commerce en ligne, ces dispositions, et d’autres à venir, sont issues d’une « boussole numérique », véritable plan d’action destiné à faire des années 2020 la « décennie numérique » permettant à l’Europe un véritable tournant en la matière. Au-delà de leur application au sein de l’Union, ces textes s’appliquent aussi aux grands acteurs étrangers présents sur son territoire. Compte tenu de l’importance du marché intérieur européen, ils ont donc vocation à devenir la règle pour ces entreprises et donc, peu à peu, à s’appliquer partout dans le monde. Face à l’absence de volonté des autorités américaines de réguler et à l’explosion des usages numériques, l’Europe s’essaye à l’extraterritorialité avec un vrai succès.
Outre les financements normaux du budget européen, près de 150 milliards € du plan de relance européen seront consacrés à l’économie numérique en Europe. Les Européens ont conscience de leur retard et sont décidés à le combler. Un plan de soutien à la fabrication de semi-conducteurs et aux approvisionnements en matières premières critiques (terres rares), une numérisation accélérée des procédures et services aux citoyens (par exemple le système Entry-Exit dans l’espace Schengen), l’euro numérique sur lequel travaille la Banque centrale, constituent des avancées considérables destinées à rattraper un retard identifié dans ces domaines.
Géopolitique
Ursula von der Leyen avait plaidé d’entrée pour une « Commission géopolitique ».
Incontestablement, tout au long de son mandat, les politiques européennes se sont au fil du temps révélées influencées de plus en plus par les impératifs géopolitiques. Dans son domaine de compétences économiques, la Commission n’a pas cessé de proposer des mesures permettant d’assurer une plus grande autonomie de l’Union. Ce fut le cas pour les masques, les vaccins et les matériels sanitaires de lutte contre le Covid. Ce fut surtout le but d’une longue série de textes se préoccupant de réduire les dépendances européennes dans tous les domaines (batteries, composants industriels de toutes natures).
Parallèlement, l’impératif de réciprocité dans les échanges a gagné du terrain et plusieurs procédures ont été ouvertes, par exemple, contre les importations chinoises de véhicules électriques, de services ferroviaires ou de panneaux solaires.
Par ailleurs, en réponse à l’agression russe de l’Ukraine, les Européens ont immédiatement adopté des sanctions sévères contre la Russie et les ressortissants russes impliqués dans cette violation de la loi internationale. Le gel de 300 milliards d’avoirs de la Banque centrale russe par le G7, la décision de saisir les biens russes sur le territoire de l’Union ont conduit à l’immobilisation de nombreux yachts et de propriétés luxueuses, y compris appartenant au dirigeant russe ou à ses proches.
Treize trains de sanctions ont ainsi été adoptés et les intérêts des fonds russes gelés seront vraisemblablement transférés à l’Ukraine. Ces mesures ont eu un fort impact sur le commerce et l’économie russes. Elles ont permis aux Européens de se libérer spectaculairement en quelques mois, (à l’exception de quelques cas particuliers comme la Hongrie), de leur dépendance envers les fournitures d’énergie en provenance de Russie.
L’Union européenne a utilisé la Facilité européenne pour la paix pour rembourser aux États membres une part importante des équipements militaires qu’ils livraient à l’Ukraine. De 6 milliards €, elle est passée à 12 milliards et sera certainement abondée encore dans le futur. Elle a décidé de financer la fourniture d’un million de munitions à l’Ukraine à concurrence de 500 millions €. Elle a renforcé les programmes européens de coopération industrielle à des fins militaires dans le cadre du Fonds européen de défense et du programme européen d’investissement dans l’industrie de défense (EDIRPA).
À ce jour, l’aide européenne à l’Ukraine s’élève à plus de 88 milliards € dont 28 pour les équipements militaires. Nul n’aurait pu imaginer un tel engagement des États membres et des institutions communes pour faire face à un conflit. Et nul ne doute qu’en cas de défaillance américaine dans le soutien à l’Ukraine, l’Union européenne n’accroisse son aide. Un tournant majeur a été pris qui témoigne d’un réel changement dans la prise en compte de la situation géopolitique.
Quelques erreurs
Un tel bouleversement des politiques et pratiques européennes ne pouvait pas être totalement parfait. L’Union continue à décider selon les mêmes procédures, lentes, souvent bureaucratiques et toujours diplomatiques. Si la rapidité en souffre alors que la vitesse de décision est devenue indispensable, l’efficacité aussi en pâtit. L’accord de tous est nécessaire pour décider. Réfléchir à des délégations pourrait se révéler nécessaire pour l’avenir comme le permet déjà le Traité sur l’Union européenne en matière d’interventions civiles ou militaires (article 44). Pour autant, on sait désormais que l’Union est capable de réagir dans l’urgence.
Les difficultés viennent plutôt de son incarnation. La rivalité entre Charles Michel et Ursula von der Leyen, entre le président du Conseil européen et la présidente de la Commission s’est révélée préjudiciable à l’image de l’Union sur la scène internationale. Elle a exacerbé une imprécision des traités qui disposent que : « Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice des attributions du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité » (Article 15 du TUE), pendant que l’article 17 stipule que : « À l’exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, elle (La Commission) assure la représentation extérieure de l’Union ».
Quant à l’article 18, il indique que « le haut représentant conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union. Il contribue par ses propositions à l’élaboration de cette politique et l’exécute en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune ». (al. 2) « Le haut représentant est l’un des vice-présidents de la Commission. Il veille à la cohérence de l’action extérieure de l’Union. Il est chargé, au sein de la Commission, des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l’action extérieure de l’Union » (al. 4). On comprend alors que seule la bonne entente des différents protagonistes permet une représentation extérieure harmonieuse à défaut d’être unique.
La présidente de la Commission, dotée d’une forte personnalité, et désireuse de répondre aux demandes des États d’une meilleure prise en compte des impératifs géopolitiques, a occupé une place qui a pu froisser les États membres. Cela a été le cas pour la solidarité avec l’Ukraine comme dans l’expression européenne pour le conflit à Gaza.
Il s’agit d’un problème récurrent : quand l’Europe est incarnée, ce qui est positif – et Ursula von der Leyen l’a bien fait au-delà des usages habituels – on lui reproche sa précipitation ou ses prises de position. Quand elle est trop prudente, tout le monde regrette son absence !
Or une politique étrangère commune, recherche ancienne de l’Union, ne pourra vraiment se mettre en place qu’avec l’accord des États membres. Pour les convaincre de s’engager davantage vers une politique étrangère plus commune, il faut que l’Union européenne leur apporte quelque chose en plus et s’abstienne de donner le sentiment de vouloir d’abord prendre leur place. C’est à cette fin qu’avait été créée la fonction de haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, susceptible de devenir un vrai ministre des Affaires étrangères de l’Union. Or ce poste, malgré de louables efforts et une véritable présence sur la scène internationale de Josep Borrell, n’a pas toujours été utilisé comme il se devrait.
Vraisemblablement, « l’autonomisation » du Service européen d’action extérieure serait une solution à examiner dans l’avenir. Doté d’un vrai budget et d’un personnel ne dépendant pas de la Commission, ayant autorité sur tous les commissaires en charge de questions internationales, il y gagnerait plus facilement la confiance des États et de leurs appareils extérieurs, ainsi qu’une plus grande marge de manœuvre. C’est d’autant plus nécessaire que les questions de défense vont prendre une place de plus en plus importante dans les travaux des institutions. La présidente sortante de la Commission a déjà proposé la création d’un « commissaire à la défense », ce qui confirme un besoin ; cela ne saurait régler pour autant la problématique ici décrite, au contraire.
Verdir mais comment ?
L’urgence de lutter contre le dérèglement climatique a été endossée par l’Union avec enthousiasme et efficacité. L’Europe peut se targuer d’être en avance sur ses grands partenaires mondiaux. Mais dans sa hâte à agir, elle a peut-être sous-estimé l’ampleur de la tâche et certainement la réaction des acteurs économiques, mais aussi surestimé le rôle des ONG.
Ces dernières ont pignon sur rue à Bruxelles et Strasbourg, car les institutions européennes sont les plus ouvertes de toutes les institutions démocratiques. Les ONG disposent d’un vrai savoir-faire en lobbying et d’une stratégie de communication particulièrement efficace. Aussi apparaissent-elles trop souvent comme les interlocutrices privilégiées des décideurs européens et nationaux en matière de climat, ce qui n’est assurément pas le cas auprès des autres grands « pollueurs » de la planète. Les opinions publiques ont pu parfois estimer que les politiques européennes en la matière étaient trop brutales, ne ménageant pas les transitions ou ne prévoyant pas suffisamment les mesures d’accompagnement nécessaires. La crise agricole, en ce début d’année 2024, a ainsi conduit la Commission et les gouvernements à reculer sur plusieurs des dispositions contestées des nouvelles mesures de la politique agricole commune, par exemple cette injonction de mettre 4 % des terres en jachère ou celle de réduire de 20 % l’usage des produits phytosanitaires.
La question de la méthode retenue pour atteindre les objectifs environnementaux que l’Union européenne s’est fixés demeure posée : la contrainte ou l’incitation, la règle ou l’accompagnement.
L’exemple de l’Inflation Reduction Act américain s’inscrit à cet égard en contre-point de la politique européenne. Il privilégie les avantages fiscaux et la subvention et s’en remet aux acteurs économiques tandis que l’Union européenne, communauté de droit par excellence, préfère la règle. La « taxonomie », ce monstre d’absurdité technocratique, en est l’expression.
Les règles sont nécessaires, parfois même indispensables, mais les contraintes doivent être accompagnées de stimulants, d’aides à la transformation et toujours faire l’objet d’une étude approfondie quant à leurs conséquences économiques.
Certains des objectifs que s’est donnés l’Europe, comme l’interdiction de la commercialisation de moteurs thermiques pour les automobiles à partir de 2035 ou la réduction de 70 % des émissions de gaz à effet de serre dans l’aviation en 2050 et 80 % dans le transport maritime, risquent de ne pas être atteints. Les conséquences économiques et financières sur ces secteurs d’activité, pour lesquels l’Europe occupe le premier rang mondial, seront considérables et les acteurs, pourtant bienveillants, pourraient être conduits à remettre en question ces ambitieuses règles alors que beaucoup s’interrogent sur le décrochage de l’économie européenne par rapport aux États-Unis.
De surcroît, fort de son influence croissante, le Parlement européen est souvent celui des acteurs institutionnels qui tente de les durcir au point de donner le sentiment de privilégier systématiquement la contrainte sur le soutien aux mutations, sans toujours en estimer le coût.
La perspective et les résultats des élections européennes pourraient aussi conférer plus de poids aux mouvements désireux d’alléger les contraintes et les règles qui pèsent sur les citoyens et les entreprises, ce qui constituerait un recul, voire un échec pour la transition environnementale. Au lendemain de ce scrutin, des choix décisifs, engageant l’Union européenne pour longtemps, devront être faits. Certains, comme Mario Draghi, appellent à une mutualisation d’emprunts européens pour financer les importantes transformations environnementales et numériques nécessaires à une croissance retrouvée.
Quelques leçons pour l’avenir
L’Union européenne s’est imposée comme une dimension indispensable du règlement des crises affectant les nations européennes. Ce sont les gouvernements nationaux qui se sont tournés vers elle et ont réclamé son intervention pour affronter des problématiques de plus en plus difficiles à résoudre sur le seul plan national. La crise sanitaire et la relance économique via des emprunts communs ont démontré la pertinence du niveau européen. L’Europe est capable d’adaptation face aux périls ; elle est devenue indispensable aux États membres.
Les défis que les Européens doivent désormais affronter concernent l’économie mais aussi, et surtout, la politique étrangère et la défense. Il est clair qu’il va leur falloir être plus imaginatifs, revoir leurs politiques économiques, repenser leurs politiques monétaires et budgétaires et ne plus se satisfaire des discours figés sur la rigueur et la discipline. S’agissant de la politique de sécurité au sens le plus large du terme, ils devront aller plus loin et plus vite dans des mesures efficaces pour affronter les menaces russes sur le territoire européen et les grands défis mondiaux, dont ils sont parties et comptables, qu’ils le veuillent ou non. L’environnement, bien sûr, mais aussi l’avenir du multilatéralisme et du règlement pacifique des différends, la liberté du commerce et de la navigation, la protection des droits fondamentaux de la personne face à un « Sud global » dont ce n’est plus la priorité. L’Union européenne va s’engager sur de nouveaux terrains qui relèvent encore de la souveraineté des États.
Actualité de la « méthode Schuman »
Pour réussir et convaincre les États membres d’œuvrer davantage ensemble, notamment dans les domaines de la politique étrangère et de défense, pour faire progresser dans le long terme l’intégration européenne, il n’y a qu’une méthode vraiment efficace apprise de Robert Schuman et qui devrait s’imposer aux institutions européennes : apporter aux États une vraie plus-value.
En apportant aux autorités nationales, en mal d’efficacité dans les politiques publiques, des outils tangibles et des réalisations concrètes, la dimension européenne crée peu à peu une solidarité réelle, des réflexes qui vont au-delà de la coopération et constituent le cœur de politiques européennes communes en devenir. Offrir dans la durée une plus-value européenne plutôt que de vouloir remplacer tout de suite les politiques nationales est vraisemblablement la recette du succès.
La politique étrangère européenne a souffert de la concurrence entre les institutions communes alors qu’elle aurait pu bénéficier de son apport. Il en sera de même en matière de défense : si la Commission veut prendre la place des États, ceux-ci se fermeront à la coopération ; si elle leur apporte de nouveaux outils économiques, financiers pour plus d’efficacité, ce seront les États et les acteurs qui réclameront son intervention.
L’envol d’Europol, agence intergouvernementale qui a permis beaucoup de succès récents dans la lutte contre la grande criminalité, s’explique par la plus-value en assistance et outils qu’elle a offerte aux services de police nationaux. Le relatif échec de l’Agence européenne de défense s’explique par la réticence des complexes militaro-industriels nationaux envers une instance qui apparaît vouloir se substituer à eux.
Pour affronter de nouveaux défis dans un horizon assombri par l’agression russe qui s’étend désormais à l’Union et ses États membres, avec son cortège d’ingérences dans le débat démocratique, l’Union européenne doit procéder à une véritable introspection en prenant le temps de la réflexion et en modifiant certaines pratiques. Il va falloir accepter d’avoir des ennemis, de s’opposer à leurs menaces hostiles ; il faut aussi accepter de revoir les poncifs les mieux partagés sur un continent riche et prospère s’agissant de la dette, de la politique monétaire ou du soutien à l’investissement. Saurons-nous les remettre en cause ? L’Union européenne et ses États membres ont la force de réussir ces transformations. Les États membres en auront-ils la volonté ? Leurs institutions communes accepteront-elles aussi d’adapter leurs pratiques ? De ces réponses dépend le succès commun dans une période de troubles et d’incertitudes.
1Le grand entretien
« La souveraineté européenne est consubstantielle de notre identité européenne ».
Emmanuel MACRON, Président de la République
Vous avez le premier appelé à une « autonomie stratégique européenne » et à plus de souveraineté européenne. Ce concept vous paraît-il désormais partagé et suffisamment traduit dans les faits ?
Lorsque j’évoquais en 2017 l’idée de souveraineté européenne, tout restait à faire, à commencer par la forge d’un consensus. Depuis, les grandes tendances de fond qui sous-tendaient cette idée se sont accentuées, au point de la rendre incontournable et de l’ancrer dans toutes les politiques publiques européennes que nous mettons en place. Rivalités internationales, compétition industrielle et technologique, remise en cause de nos valeurs, du multilatéralisme et des règles sur lesquelles se fonde l’ordre international, mais aussi les grandes crises de ces dernières années, celle du Covid et la crise énergétique : tout a conduit à dessiller nos regards sur la nécessité pour nous, Européens, de regagner en souveraineté. Évidemment, la guerre d’agression russe contre l’Ukraine a cristallisé le concept d’autonomie stratégique. Nous n’avions encore jamais fait face à un tel danger : une guerre à nos frontières, retour tragique de l’Histoire sur un continent et un espace politique qui s’imaginait peut-être, à tort, en être sorti.
Six ans après mon discours à la Sorbonne, nous pouvons nous réjouir du chemin parcouru. Ce réveil stratégique est venu de la prise de conscience de l’impérieuse nécessité de réduire nos dépendances vis-à-vis des pays tiers, avant toute chose sur les biens les plus stratégiques ; il découle également de la réalisation que l’Union européenne doit être en capacité, toujours, de décider pour elle-même. Il en va de la protection du modèle européen de société, qui nous est propre, et de nos valeurs. La souveraineté européenne est consubstantielle de notre identité européenne.
C’est cette nécessité de garantir notre souveraineté européenne qui a guidé l’agenda défini à Versailles par les chefs d’État ou de gouvernement en mars 2022, dès les premiers jours de la guerre en Ukraine. Nous y avons alors acté le renforcement de nos capacités de défense, de notre indépendance en matière d’énergie et de la construction d’une base économique plus solide, par des actions fortes sur une série de technologies-clés et de secteurs cibles.
En matière de sécurité et de défense, nous nous sommes mis d’accord sur la nécessité de fournir un effort industriel majeur, afin de renforcer nos capacités d’acquisition et de production conjointes, ainsi que la résilience des chaînes d’approvisionnement de nos armées. Pour inciter les industriels à investir massivement, nous sommes en train de faire naître une demande européenne crédible. En parallèle, nous faisons en sorte de stimuler l’offre, à travers le renforcement des capacités de production dans toute l’Union européenne. C’est le sens de la stratégie industrielle de défense européenne de la Commission européenne. Avec aussi un programme européen d’investissement de défense qui suivra, ainsi que par une préférence européenne assumée au sein des instruments et la mise en place d’acquisitions conjointes.
Au-delà de la sécurité et de la défense, l’Europe s’est convertie à la politique industrielle, à la planification, et assume maintenant de soutenir massivement certains secteurs stratégiques, en premier lieu ceux sur lesquels nous nous étions accordés à Versailles : l’énergie, les matières premières critiques, les semi-conducteurs, le numérique, la santé et l’agriculture. En parallèle, l’Europe a fourni un effort massif pour équilibrer sa politique commerciale par la mise en place d’un arsenal législatif de réciprocité et de défense commerciale, qui donne lieu à des enquêtes dans les secteurs où la concurrence est faussée ou qui lutte contre les subventions étrangères affectant le marché intérieur, ainsi qu’avec la taxe carbone aux frontières et l’outil sur la déforestation importée.
L’Europe a aussi repris la main sur le numérique, notamment avec le DSA et le DMA, pour imposer partout, y compris en ligne, ses règles et ses valeurs, en vue de protéger nos concitoyens comme notre capacité d’entreprendre et d’innover, tout en respectant notre modèle de protection des droits d’auteur et de financement de la création.
L’Europe a décidé de mieux protéger ses frontières extérieures et de définir un cadre commun de gestion des migrations et de l’asile, qui se traduit par des procédures de filtrage plus efficaces aux frontières extérieures, davantage de leviers pour lutter contre les détournements de la procédure d’asile et agir avec les pays d’origine et de transit, ainsi que par une clarification et une simplification des règles de responsabilité des États membres, qui constituent le pendant d’un mécanisme de solidarité obligatoire mais flexible.
Nous devons être collectivement fiers du chemin parcouru, mais conscients de ce qu’il nous reste à faire. Nous avons largement réussi à mettre en place un agenda de défense et de protection, en réaction aux multiples crises que nous avons traversées ces dernières années. Nous devons désormais évoluer vers une approche plus proactive, plus offensive, pour que l’Europe soit encore plus maîtresse de son destin, capable d’agir efficacement dans un monde devenu plus compétitif et plus brutal. Dans cette perspective, les élections européennes de juin et l’agenda stratégique pour guider notre action au cours des cinq prochaines années seront essentiels.
Tous les États Européens réarment. L’Union européenne pourra-t-elle un jour disposer d’une politique de défense commune ? Comment voyez-vous le chemin pouvant y parvenir ?
Plusieurs États membres ont annoncé des hausses substantielles de leurs budgets de défense nationaux. En France, nous prenons toute notre part avec la loi de programmation militaire 2024-2030 : en dix ans, le budget de nos armées aura doublé.
Mais au-delà de ce que nous faisons à titre national, l’enjeu est de renforcer notre autonomie stratégique européenne en matière de défense. Nous voulons une Europe souveraine, capable de se protéger, dans une démarche complémentaire avec celle de l’OTAN. C’est en nous appuyant sur des armées nationales modernes et en investissant dans des capacités de défense communes que nous pourrons nous défendre collectivement.
J’avais eu l’occasion de le dire à Bratislava en mai dernier, lors du forum du GLOBSEC : la réponse apportée par l’Union européenne dès les premiers jours de la guerre a été rapide et claire. L’Europe a mobilisé près de 6,5 milliards € à travers la Facilité européenne pour la paix, afin de fournir du matériel létal et non létal à l’Ukraine, produire des munitions et des missiles, financer la mission EUMAM de formation des forces armées ukrainiennes. Plus de 40 000 soldats ukrainiens ont été formés. Au total, le soutien militaire de l’Union et de ses États membres est estimé à 28 milliards €, ce qui traduit concrètement l’engagement des Vingt-Sept à soutenir l’Ukraine dans la durée. Cette aide doit se poursuivre et s’intensifier. Mais nous pouvons d’ores et déjà constater qu’elle constitue un saut historique pour notre politique de défense commune.
La Facilité européenne de paix a permis de créer une vraie logique d’entraînement en Europe, c’est-à-dire de faire davantage que la somme des seuls efforts nationaux. Il nous faut désormais prendre acte que la logique de cession des stocks qui guidait cet instrument ne suffit plus, et le faire évoluer vers une logique de production et d’acquisition conjointes. C’est à cette condition que nous pourrons être à la hauteur des besoins prioritaires de soutien à l’Ukraine tout en renforçant la base industrielle de défense européenne.
Dans les mois à venir, il nous faudra encore davantage connecter notre agenda de défense de l’Ukraine à celui de la défense de notre autonomie stratégique européenne, dans l’esprit du Sommet de Versailles. Nous devrons accélérer la production de nos capacités européennes de défense. Nous développons déjà en Européens l’avion de combat, le char et le drone européen du futur mais trop de pays se tournent aujourd’hui encore vers des fournisseurs non européens. L’Europe de la défense dépendra donc aussi de notre capacité à bâtir le futur de notre souveraineté industrielle européenne, notamment grâce au fonds pour l’innovation et le fonds européen de défense, avec une claire préférence européenne.
Face aux défis lancés par les régimes autocratiques à l’Occident, quelles peuvent être les réponses de l’Europe ?
La guerre d’agression lancée par la Russie en Ukraine n’est pas seulement une agression territoriale. C’est une attaque contre nos principes démocratiques, contre nos valeurs, contre notre unité que la Russie a décidé de menacer de façon unilatérale. L’Union européenne a su y répondre avec rapidité, exemplarité et fermeté. Deux ans après, alors que le conflit dure, il nous faut redoubler d’effort pour permettre à l’Ukraine de se défendre et montrer à la Russie qu’elle ne peut pas faire le pari d’une quelconque fatigue dans le soutien des Européens à Kiev. C’est le sens de l’accord trouvé au Conseil européen du 1er février 2024 sur la facilité pour l’Ukraine, dotée de 50 milliards € et qui engage l’Union européenne pour quatre ans, de 2024 à 2027. C’est aussi le sens de la coalition « Artillerie pour l’Ukraine » dont la France a pris la tête le 18 janvier 2024 aux côtés de la cinquantaine d’États du Groupe de contact pour la défense de l’Ukraine, aussi appelé « format Ramstein ». C’est la cinquième coalition capacitaire qui voit ainsi le jour après celles sur la défense sol-air, les blindés, les forces aériennes et la sécurité maritime. Cette coalition permettra, à court terme, de fournir aux forces armées ukrainiennes de nouvelles capacités pour la défense de son territoire, et à long terme de construire la future artillerie ukrainienne grâce à de nouveaux partenariats industriels. C’est aussi le sens de l’accord bilatéral de sécurité que j’ai signé avec le Président Zelensky le 16 février à l’occasion de sa visite en France et qui a été présenté à l’Assemblée nationale et au Sénat, au titre de l’article 50-1 de notre Constitution, en recueillant un très large vote positif dans les deux chambres. Il prévoit non seulement d’apporter jusqu’à 3 milliards € d’aide militaire supplémentaire pour l’Ukraine en 2024 mais engage aussi le soutien de la France pour une durée de 10 ans dans les domaines de coopération prioritaires pour l’Ukraine.