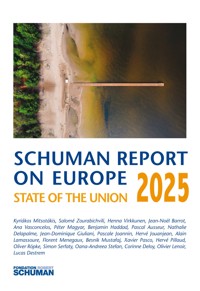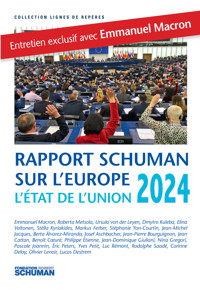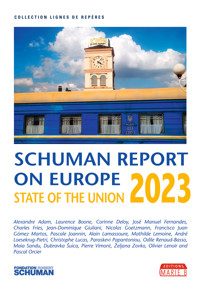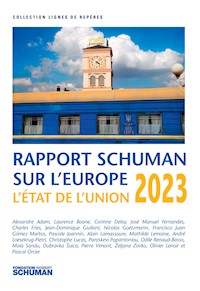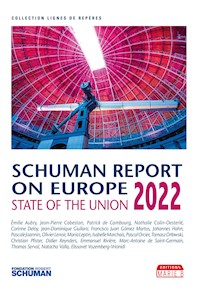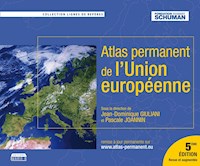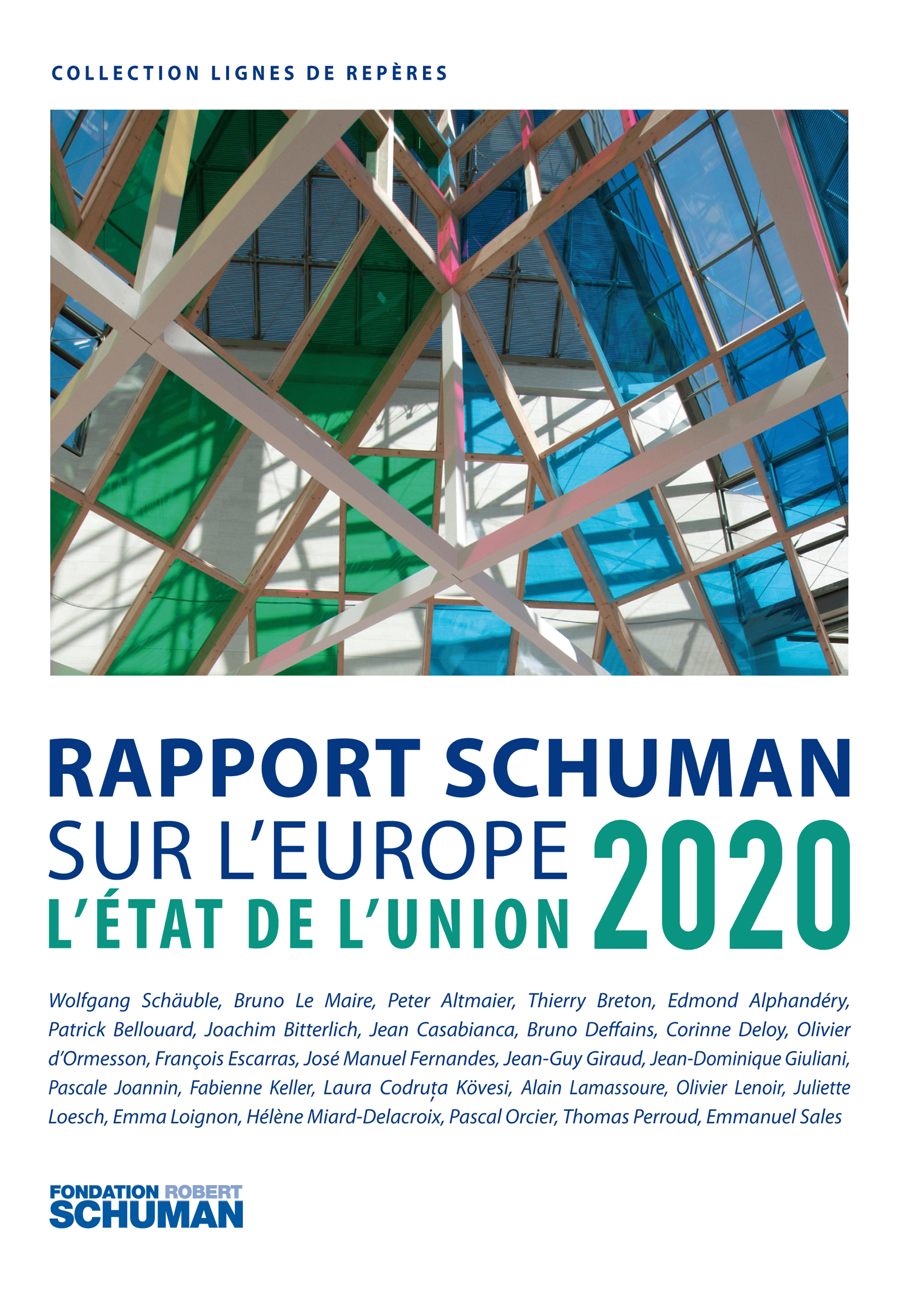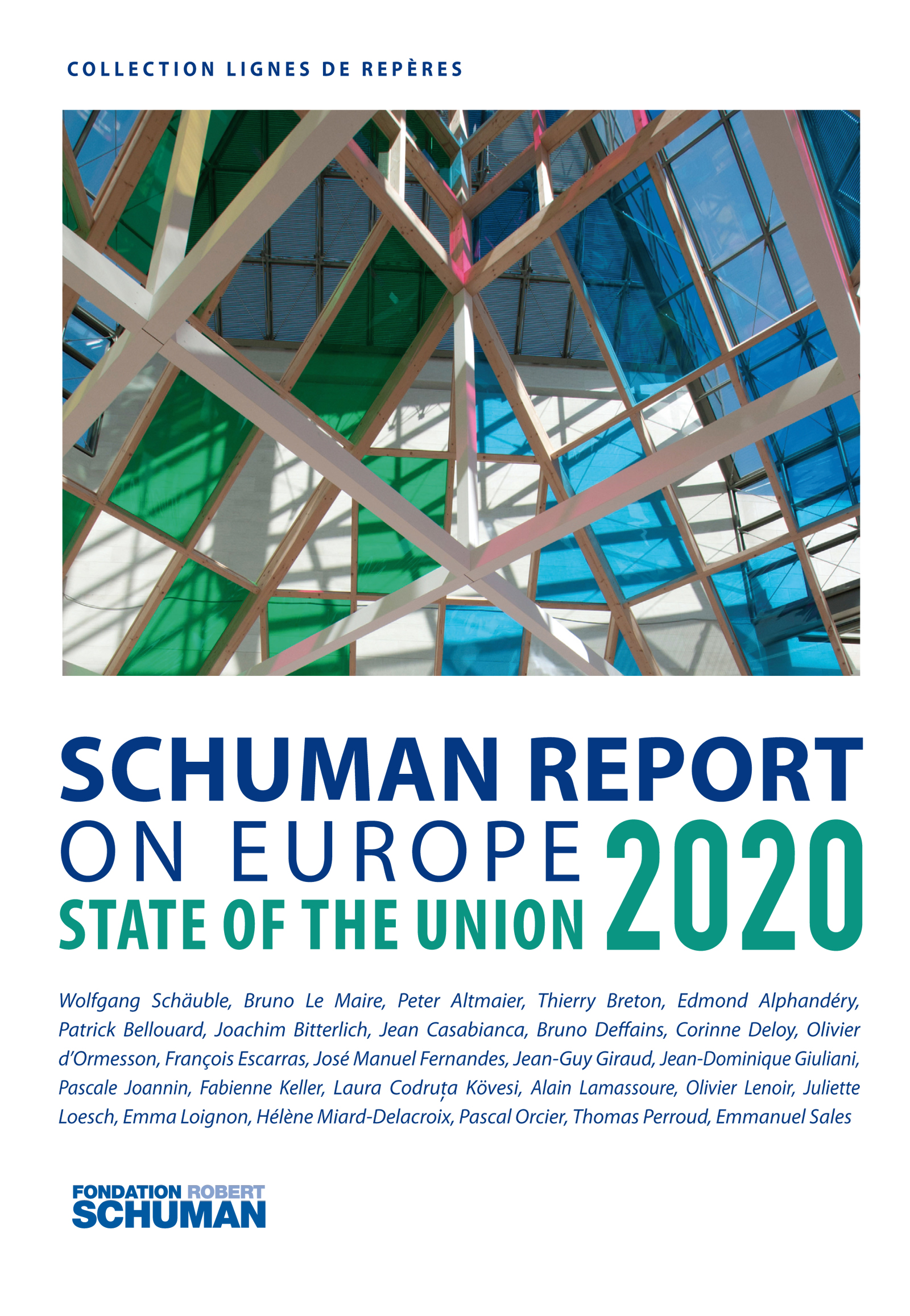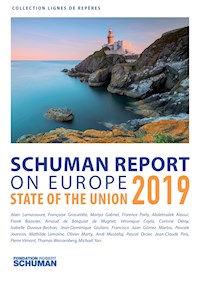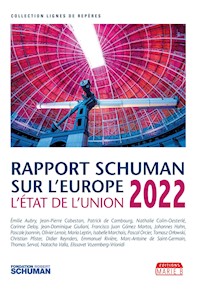
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Marie B
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
La guerre en Ukraine ajoute une crise à la suite impressionnante de difficultés auxquelles l’Union européenne a été confrontée ces dernières années.
Après la crise financière, après la pandémie, la voici désormais face à un nouveau défi d’une ampleur inégalée depuis 1950 : le retour de la guerre sur le continent.
La capacité de résilience de l’Union européenne s’est beaucoup améliorée.
Elle a fait face au virus et est devenue, grâce à la mutualisation de ses moyens, le premier producteur de vaccins au monde. Elle a su gérer au mieux les conséquences inédites d’une situation imprévisible.
N’étant pas en mesure d’affronter seule l’agression militaire lancée par la Russie, l’Union européenne a pris toute sa place dans l’Alliance atlantique ; elle s’est montrée solidaire, a su réagir vite et manifester un front uni.
Désormais, dans toutes les situations, on envisage une action européenne, une politique commune ou, au moins, concertée. L’Europe est en mouvement, pour longtemps et, vraisemblablement, pour toujours. Elle progresse au fil des difficultés mais aussi des exigences et de ses valeurs.
C’est pourquoi le
Rapport Schuman sur l’Europe – l’état de l’Union 2022 est si utile. Au-delà de la conjoncture, il permet de juger de l’efficacité des politiques communes désormais pérennes, des évolutions fondamentales de sa gouvernance et de ses pratiques. Il est, plus que jamais, un outil pertinent et indispensable pour comprendre la réalité de la construction européenne, ses avancées et ses hésitations. Agrémenté de cartes originales et contenant un ensemble unique de statistiques commentées, il constitue ce qu’on fait de mieux pour mettre à la disposition du plus grand nombre un instrument d’analyse, unique et pratique, sur l’Europe.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Ancienne auditrice de la 56e session nationale de l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN),
Pascale Joannin dirige le
Rapport Schuman sur l’Europe, l’état de l’Union, éditions Marie B, et codirige l’
Atlas permanent de l’Union européenne, éditions Marie B (5e édition), 2021. Elle est l’auteur de
L’Europe, une chance pour la femme, Note de la Fondation Robert Schuman, n° 22, 2004. Elle a publié de nombreuses études sur les questions européennes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’État de l’Union 2022 Rapport Schuman sur l’Europe est une œuvre collective créée à l’initiative de la Fondation Robert Schuman au sens de l’article 9 de la loi 57-298 du 11 mars 1957 et de l’article L.113-2 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle.
Textes originaux en anglais traduits en françaispar Ramona Bloj et Stefanie Buzmaniuk.
Mise en page : Nord CompoMaquette de couverture : Nord CompoImage de couverture : Wirestock/Alamy photo
Copyright : Éditions Marie B, collection Lignes de repères
ISBN : 9782492763090
Ce document numérique a été réalisé par Nord Compo.
Sommaire
Sommaire des cartes
1959-2022 : la construction européenne
Territoires de l’Europe
Europe au féminin
1. Les questions politiques
Préoccupation environnementale
L’Europe politique
2. Les questions économiques
Dépenses de R&D
Dépenses de santé (Union européenne)
3. L’Europe dans le monde
Missions maritimes européennes
Espace ultra-marin
Revendications en mer de Chine méridionale
4. L’Union européenne par les statistiques
Projections de croissance (reprise économique) au niveau mondial
Commerce extracommunautaire
Commerce intracommunautaire
Les principales zones de libre-échange
Dépenses militaires dans le monde
La population de l’Union
Migrations internes
Migrations externes
L’inflation dans l’Union européenne
Dette publique (Union européenne)
Indice de performance environnementale des États membres
L’État de l’UnionRAPPORT SCHUMAN 2022SUR L’EUROPE
Sous la direction de Pascale Joannin
Ont contribué à cet ouvrage :
Émilie Aubry, Jean-Pierre Cabestan, Patrick de Cambourg, Nathalie Colin-Oesterlé, Corinne Deloy, Jean-Dominique Giuliani, Francisco Juan Gómez Martos, Johannes Hahn, Pascale Joannin, Olivier Lenoir, Maria Leptin, Isabelle Marchais, Pascal Orcier, Tomasz Orłowski, Christian Pfister, Didier Reynders, Emmanuel Rivière, Marc-Antoine de Saint-Germain, Thomas Serval, Natacha Valla, Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Ont contribué à cet ouvrage
Textes
Émilie Aubry
Diplômée de Sciences Po Paris après des études littéraires, Émilie Aubry devient reporter à LCP en 2002 avant de présenter les grands évènements de la chaîne. En 2009 elle rejoint l’agence Capa pour présenter l’émission diffusée sur Arte « Global Mag ». En 2012, Arte lui confie l’animation des soirées THEMA ainsi que, depuis 2017, la rédaction en chef du magazine de géopolitique « Le Dessous des cartes », qui se décline désormais sur le numérique avec « Une leçon de Géopolitique ». Elle a également publié en septembre 2021 Un monde mis à nu, co-signé avec le géographe Frank Tétart (Arte Éditions/Tallandier).
Jean-Pierre Cabestan
Spécialiste du droit et des institutions du monde chinois contemporain, Jean-Pierre Cabestan est directeur de recherche au CNRS. Il a été professeur de science politique à l’Université baptiste de Hong Kong de 2007 à 2021. Il a inauguré et dirigé l’antenne de Taipei du Centre d’études français sur la Chine contemporaine (1994-1998) puis dirigé le Centre situé à Hong Kong (1998-2003). De 2003 à 2007, il a été rattaché à l’UMR de droit comparé de l’Université de Paris. Docteur d’État en droit et docteur en science politique, il est aussi diplômé de chinois et de japonais. Derniers ouvrages parus : Demain la Chine : démocratie ou dictature ?, Éditions Gallimard, 2018 et Demain la Chine : guerre ou paix ?, Éditions Gallimard, 2021.
Patrick de Cambourg
Président de l’Autorité des normes comptables (ANC) depuis 2015. À ce titre, Patrick de Cambourg est membre entre autres du Board de l’EFRAG, de l’IASB, des collèges de l’AMF et du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF). Il a présidé la Task Force du projet (Corporate reporting Lab@EFRAG) sur les travaux préparatoires à l’élaboration de normes de reporting non financier de l’Union européenne. Il préside actuellement une deuxième Task Force sur une normalisation européenne en matière de développement durable. Diplômé en sciences politiques, en droit public, en droit des affaires, il a effectué sa carrière professionnelle au sein du groupe Mazars dont il est, depuis fin 2014, Président d’honneur.
Nathalie Colin-Oesterlé
Députée européenne (PPE, FR) depuis juillet 2019. Après des études de droit à l’université Paris Panthéon-Assas, Nathalie Colin-Oesterlé devient notaire. Elle est élue locale depuis 2001 à Metz. Membre de la Commission environnement, santé publique et sécurité alimentaire et vice-présidente de la commission spéciale de lutte contre le cancer, elle a été l’auteure en 2020 du rapport sur les pénuries de médicaments en Europe.
Corinne Deloy
Diplômée de Sciences Po et titulaire d’un DEA de sociologie politique de l’université de Paris I – Panthéon Sorbonne, Corinne Deloy a été journaliste au Nouvel Observateur et secrétaire générale de la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol). Elle est chargée d’études au Centre de recherches internationales de Sciences Po (CERI) et rédactrice de l’Observatoire des élections en Europe (OEE) de la Fondation Robert Schuman.
Jean-Dominique Giuliani
Président de la Fondation Robert Schuman, Jean-Dominique Giuliani a été directeur de cabinet du Président du Sénat René Monory et directeur à la SOFRES. Ancien Conseiller spécial à la Commission européenne et membre du Conseil de Surveillance d’Arte, il codirige l’Atlas permanent de l’Union européenne, Éditions Marie B (5e édition), 2021. Il est l’auteur de Européen, sans complexes, éditions Marie B, 2022 et de La grande bascule, éditions de l’école de Guerre, 2019.
Francisco Juan Gómez Martos
Docteur ès Sciences politiques, économiste et ancien fonctionnaire de l’Union européenne, Francisco Juan Gómez Martos est actuellement professeur invité à l’Université Adam Mickiewicz de Poznan (Faculté des Sciences politiques et Journalisme). Il est l’auteur de plusieurs publications académiques dans des revues européennes et de nombreux articles publiés dans le journal El País. Il a publié de nombreuses études pour la Fondation.
Johannes Hahn
Commissaire européen en charge du budget et de l’administration depuis décembre 2019, Johannes Hahn a été Commissaire européen en charge de la politique régionale de 2010 à 2014 et Commissaire européen en charge de la politique de voisinage et des négociations d’élargissement de 2014 à 2019. Auparavant, il a occupé plusieurs fonctions de direction, notamment en tant que PDG de Novomatic AG pendant 5 ans. Entre 1992 et 1997, il a été directeur exécutif du Parti populaire autrichien (ÖVP) à Vienne. En 2002, il a été élu vice-président du parti et président en 2005. Membre du Parlement régional de Vienne de 1996 à 2003, il est devenu ministre fédéral des sciences et de la recherche en 2007.
Pascale Joannin
Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Ancienne auditrice de la 56e session nationale de l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN), Pascale Joannin dirige le Rapport Schuman sur l’Europe, l’état de l’Union, éditions Marie B, et codirige l’Atlas permanent de l’Union européenne, éditions Marie B (5e édition), 2021. Elle est l’auteur de L’Europe, une chance pour la femme, Note de la Fondation Robert Schuman, no 22, 2004. Elle a publié de nombreuses études sur les questions européennes.
Maria Leptin
Présidente du Conseil européen de la recherche. Après un doctorat à Bâle, des recherches postdoctorales à Cambridge, Maria Leptin a été la directrice d’un groupe de recherche à l’Institut Max-Planck de Tübingen et professeur à l’Institut de génétique de Cologne. Elle a effectué des séjours de recherche à l’UCSF, à l’École normale supérieure de Paris et au Sanger Institute de Hinxton, au Royaume-Uni. De 2010 à 2021, elle a été directrice de l’Organisation européenne de biologie moléculaire (EMBO). Elle est membre élue de l’EMBO, de l’Academia Europaea, de l’Académie nationale allemande, de la Leopoldina, membre honoraire de l’Académie des sciences médicales du Royaume-Uni et titulaire d’un doctorat honorifique de l’EPFL, à Lausanne.
Isabelle Marchais
Diplômée de Sciences Po Paris, titulaire d’une licence d’histoire et d’une maîtrise de Science politique, Isabelle Marchais a longtemps travaillé comme journaliste, couvrant à Bruxelles l’actualité européenne pour différents médias, dont la Société générale de presse et l’Opinion. Elle réalise des Entretiens pour la Fondation Robert Schuman dans la collection « Réveilleurs d’Europe ».
Tomasz Orłowski
Ambassadeur (ret.). Diplômé des universités de Łódź, Toruń et Poitiers, Tomasz Orłowski fut Auditeur à l’Institut des hautes études de la Défense nationale. De 1990 à 2021, il a exercé plusieurs fonctions au sein du ministère polonais des Affaires étrangères. En 2005, il est titularisé comme ambassadeur de Pologne et nommé directeur du protocole diplomatique. De 2007 à 2014, il est ambassadeur de Pologne en France et, de 2015 à 2017, en Italie. Il a été vice-ministre des Affaires étrangères. Membre correspondant de l’Académie des Sciences morales et politiques, Professeur à l’Académie Andrzej Frycz Modrzewski de Cracovie, il enseigne les relations internationales à Sciences Po-Paris, à l’Université de Varsovie et au Collège d’Europe.
Christian Pfister
Consultant, Christian Pfister a travaillé à la Banque de France où il a notamment été directeur général adjoint des études et des relations internationales, directeur général adjoint des statistiques et conseiller du Gouverneur sur la monnaie numérique de Banque centrale. Il enseigne à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à Sciences Po.
Didier Reynders
Commissaire européen à la Justice depuis décembre 2019, Didier Reynders devient député fédéral à la Chambre des Représentants en 1992. Sept ans plus tard, il devient ministre des Finances du premier gouvernement de Guy Verhofstadt. Il y restera douze ans avant de devenir ministre des Affaires étrangères fin 2011. De 2004 à 2019, il est également Vice-Premier ministre des gouvernements fédéraux successifs. Il a exercé la fonction de président du Mouvement Réformateur (MR) de 2004 à 2011.
Emmanuel Rivière
Directeur monde pour les études internationales et le conseil politique de Kantar Public depuis 2021. Emmanuel Rivière préside aussi le Centre Kantar sur le Futur de l’Europe. Il était auparavant Directeur Général France de ce groupe, dédié aux enjeux du secteur public et à l’action politique, dont l’activité était autrefois portée en France par TNS Sofres dont il fut directeur de l’unité stratégies d’opinion entre 2005 et 2016. Il fut auparavant responsable du pôle Observatoire de l’opinion du Service d’information du Gouvernement entre 1999 et 2005, après avoir débuté sa carrière à l’institut de sondages CSA. Il enseigne à Sciences Po Paris et à Paris I Panthéon Sorbonne.
Marc-Antoine de Saint-Germain
Amiral, Marc-Antoine de Saint-Germain est Directeur du Centre d’études stratégiques de la marine (CESM) à l’École militaire depuis juin 2021. Officier de marine, formé à l’École Navale en 1991, il a embarqué vingt ans à bord des navires de la Marine nationale, en particulier du porte-avions « Charles de Gaulle » qu’il a commandé de 2017 à 2019. Ses navigations sur l’ensemble des mers et océans du globe lui ont permis d’observer l’évolution des rapports de forces dans le monde et la place des espaces maritimes au XXIe siècle. Auditeur de la 66e session du CHEM et de la 69e session de l’IHEDN (2016-2017), il a intégré la Délégation aux affaires stratégiques du ministère de la Défense (DGRIS) et fut conseiller au sein du cabinet militaire du Premier ministre.
Thomas Serval
Titulaire de plus de cinquante brevets et huit récompenses d’innovation au CES de Las Vegas, Thomas Serval est cofondateur et CEO du groupe Baracoda. Entrepreneur, il entend créer de nouvelles routines de santé grâce à des technologies accessibles à tous et optimiser des objets du quotidien, pour que chacun puisse s’en saisir et devenir acteur de sa santé, dans une démarche préventive et durablement engagée. Ancien élève de l’École normale supérieure, il a été cadre dirigeant dans des entreprises technologiques telles que Microsoft et Google.
Natacha Valla
Doyenne de l’École du management et de l’innovation de Sciences Po, Natacha Valla est présidente du Conseil national de la productivité. Elle a été directrice générale adjointe pour la politique monétaire de la Banque centrale européenne (2018-2020), directrice de la recherche économique internationale de Goldman Sachs, directrice adjointe du CEPII et chef de la division politique et stratégie de la Banque européenne d’investissement.
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Députée européenne (PPE, GR) depuis 2014. Elissavet Vozemberg-Vrionidi a étudié le droit et les sciences politiques à l’université d’Athènes et elle pratique le droit depuis 1982, spécialisée dans le droit pénal et le droit de la famille. Au Parlement européen, elle est membre des commissions des libertés civiles (LIBE) et des transports et du tourisme (TRAN). Elle est membre de la commission parlementaire mixte sur les relations UE – Turquie. Elle est actuellement rapporteur du dossier sur le traitement des situations de crise et de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile.
Statistiques
Olivier Lenoir
Normalien (économie) et ancien élève du Collège des Ingénieurs, Olivier Lenoir est actuellement plume ainsi que directeur de cabinet chez Orange. Son parcours européen l’a également mené à La Sapienza, au Bureau International du Travail ou chez le Défenseur des droits.
Cartes
Pascal Orcier
Ancien élève de l’ENS de Lyon, Pascal Orcier est professeur agrégé et docteur en géographie, spécialiste des pays baltes, cartographe, enseignant en classes européennes au lycée Beaussier de La Seyne-sur-Mer (83) et en classes préparatoires au lycée Stanislas de Cannes (06).
PréfaceL’Europe dans la tempête parfaite
Jean-Dominique GIULIANI, Pascale JOANNIN
L’Union européenne ne cesse d’affronter des crises et des surprises stratégiques, toutes plus importantes et plus violentes. La guerre russe en Ukraine constitue la dernière en date. Il n’y a plus de crises, il n’y a que l’accélération d’évènements imprévus et de mutations profondes. Après les subprimes, les finances grecques, les réfugiés syriens, la pandémie de Covid, voilà le spectre de la guerre de retour sur le continent.
Tous ces défis mettent à mal la plupart des politiques communautaires tout en confirmant la pertinence de la construction européenne. Dans les crises, l’Union européenne a plus progressé en quelques mois qu’en trente ans.
Mais elle paie comptant ses retards et ses hésitations.
Elle doit réviser nombre de ses politiques et se projeter résolument dans un monde global, nouveau et plus brutal.
L’Union européenne a déjà beaucoup progressé
Dans la crise sanitaire, bien que le premier mouvement des États ait été national – fermeture des frontières, compétition pour les instruments anti-virus – il a rapidement cédé la place à une réaction commune qui s’est illustrée dans l’acquisition et la distribution des vaccins, dont l’Union européenne est vite devenue le premier producteur et le premier donateur mondial. Les États membres démunis se sont tournés vers la coopération européenne. Elle a fonctionné.
Le plan de relance qui a suivi a fait tomber nombre de tabous jusqu’ici infranchissables. NextGenerationEU, financé pour moitié par des emprunts communs, a ouvert la voie à des subventions directes des États les plus touchés par la pandémie. Du jamais vu. Il a donné une expression concrète à une solidarité européenne qu’on pensait régresser dans tous les domaines.
Enfin, la guerre russe en Ukraine a été l’occasion d’une réaction rapide et massive dans l’adoption de sanctions sévères envers nombre d’acteurs russes, au détriment parfois des intérêts économiques immédiats.
L’Union européenne s’est montrée beaucoup plus réactive qu’elle ne l’avait été jusqu’ici. Face à l’urgence, le « réflexe européen », qui n’avait pas joué pour faire face à la vague migratoire de 2015, s’est exprimé fortement. Les institutions communes ont compris que le facteur temps était une condition pour démontrer leur efficacité. L’adoption rapide de règles nouvelles, à vocation internationale, a surpris. D’abord en permettant le contrôle des investissements étrangers, ensuite en acceptant les emprunts communs et un rôle pivot de la Commission européenne comme acheteur de vaccins, puis de gaz. Le Digital Market Act et les textes à venir qui vont encadrer les activités numériques sur le territoire des Vingt-sept ont sonné l’heure de règlementations européennes applicables à tous les acteurs du secteur, quelles que soient leurs nationalités. En matière de défense et de diplomatie, les Européens ont su adopter une « boussole stratégique », premier pas vers une véritable stratégie mondiale. L’accélération – hélas trop lente encore – de la prise en compte, au niveau européen, du nécessaire réarmement de l’Europe est la plus récente des évolutions vers une réactivité et une efficacité renforcée de la coopération et des institutions européennes.
À ce titre, on pourrait aussi noter positivement un tournant de l’action commune des Européens, « rajeunie » par son plan de relance, mais aussi vers de nouveaux champs de compétences jusqu’ici en sommeil ou inexplorés, par exemple, le soutien aux technologies de rupture, la politique spatiale, l’informatique quantique ou la production de composants électroniques (Chip Act).
Certains pourront estimer insuffisantes ces évolutions, mais nul ne pourra contester qu’il s’agit là de ruptures majeures avec les pratiques précédentes de l’Union européenne et avec ses propres règles, pour beaucoup mises en sommeil. On notera aussi des initiatives individuelles ou bilatérales des États qui s’inscrivent manifestement dans une analyse européenne, telles que « l’Airbus des batteries », le Cloud européen ou les plans « hydrogène » plus ou moins concertés, le rôle du couple franco-allemand se révélant parfois déterminant.
Il n’en demeure pas moins que l’Union européenne paie comptant ses retards, ses hésitations et ses divisions. C’est particulièrement flagrant en matière énergétique et de défense.
Les refus réitérés de tous les États membres de construire une politique énergétique commune ont généré des dommages qui éclatent au grand jour. La dépendance vis-à-vis de ses fournisseurs, trop longtemps considérée comme un atout pour la coopération et l’avancée de l’État de droit à l’est ou au sud, constitue désormais une entrave considérable à sa marge de manœuvre diplomatique.
En matière de défense, le fait de considérer la construction progressive d’une autonomie stratégique, c’est-à-dire d’une liberté d’action, comme une attaque de l’OTAN, a freiné les velléités d’arrêter le désarmement européen et de bâtir en commun un véritable pilier européen de l’Alliance. Les Européens se sont trouvés à la remorque de leurs alliés d’outre-Atlantique, peu désireux de s’impliquer en Europe dans un rapport de force avec la Russie, tout obnubilés qu’ils sont par leur rivalité avec la Chine. La guerre en Ukraine a vu les États-Unis et le Royaume-Uni aux avant-postes de la riposte contre la guerre d’agression, tant en matière de renseignement et d’analyse que de soutien tangible à l’Ukraine attaquée.
Cette situation au demeurant démontre a contrario la complémentarité entre l’OTAN et l’Union européenne. La dernière dispose des moyens financiers pour assister l’Ukraine agressée, tandis que la première est performante sur le plan militaire. Les livraisons d’armes financées par l’Union européenne démontrent à la fois les limites de son action et l’évolution de ses règles. Inédites, elles transgressent les règles communes en s’en remettant aux États membres pour agir. L’un, la France, assurant la présidence semestrielle du Conseil, maintient le seul canal occidental de communication avec le dictateur russe, les autres, avec la Pologne et les pays d’Europe centrale et orientale, garantissant que l’Union européenne n’acceptera pas de laisser tomber un voisin qui l’appelle au secours.
La révision, l’évolution ou le lancement de politiques communes européennes constituent donc les travaux indispensables de l’Union dans le proche avenir
À l’évidence le pacte vert européen ne résisterait pas à une guerre prolongée, voire à un conflit qui impliquerait davantage les États membres. Le risque en est important. Dans de telles circonstances qui font passer l’urgence avant les politiques de long terme, on peut craindre des exceptions « obligées » et répétées à des dispositions déjà contestées par certains États membres. L’Union européenne doit adapter ses politiques avant d’être contrainte à passer à une économie de guerre.
La « taxonomie », dont se montrent si friands certains commissaires et le Parlement européen, a voulu exclure l’énergie nucléaire et a finalement accepté d’inclure le gaz dans les énergies « de transition ». Ce compromis boiteux n’aurait jamais dû concerner l’énergie nucléaire qui contribue à l’indépendance énergétique de l’Europe, ni inclure le gaz dont tous souhaitent désormais se délivrer ou pour lequel ils envisagent dans l’urgence de changer de fournisseurs. Les industries de défense qui font aussi l’objet d’une mise à l’index devraient être exclues expressément des mêmes tentatives.
En matière agricole, le sort fait aux pesticides, sans étude d’impact, risque d’entraîner une diminution des productions de céréales et d’accroître les pénuries et le prix des denrées de base au moment où la Russie et l’Ukraine, les deux principaux fournisseurs des pays en développement, diminuent leurs exportations de manière drastique. L’Union européenne a le choix : ou poursuivre sa politique élaborée sous la pression du lobby excessif d’ONG militantes et contribuer aux famines et aux révolutions, notamment sur les rives sud de la mer Méditerranée, ou alors, comme les ministres de l’agriculture l’ont déjà manifesté, remettre en culture certains espaces, accroître dans l’urgence les productions de produits essentiels pour éviter les conséquences sociales et politiques de ces pénuries. Elle renforcerait ainsi son rôle géopolitique auprès des États dans le besoin.
Il va de soi qu’une solidarité européenne effective entre ses membres doit aussi prendre en compte la dimension énergétique. Les États dépendants doivent pouvoir s’appuyer sur leurs partenaires pour mutualiser certains de leurs approvisionnements ou pour bénéficier d’une force collective de négociation auprès de nouveaux fournisseurs. Peut-être sera-ce l’occasion de jeter les bases d’une politique commune plus réaliste dans ce domaine-clé de la souveraineté européenne ?
Il en va de même en matière de défense. Actuellement, l’Union européenne finance la distribution d’armes à l’Ukraine, ce qu’elle est incapable de faire en interne. L’accélération et le renforcement du financement des industries de défense en Europe constitue une priorité qu’exigent autant l’objectif d’autonomie stratégique que les instances de l’OTAN. La politique commune de sanctions a impressionné par son ampleur. Elle ne saurait suffire ni dans l’immédiat ni pour le futur. Après la boussole stratégique adoptée au printemps, la prochaine étape est un vaste plan de financement des investissements de défense. Il vaudrait mieux qu’il soit coordonné, les annonces du Chancelier allemand en la matière semblant bien solitaires.
L’Allemagne va d’ailleurs être au cœur des problématiques européennes à venir
N’ayant aucune autonomie de défense, ne disposant pas d’une force armée efficace, ayant procédé à des choix énergétiques unilatéraux et peu solidaires de ses partenaires, dépendant de ses approvisionnements russes, souffrant de la fermeture des marchés chinois qui pourraient découler de la pandémie et des priorités politiques du parti communiste chinois, et devant gérer la conversion de son important secteur automobile, l’économie allemande va se trouver confrontée à de redoutables défis.
Évoluera-t-elle vers une intégration européenne renforcée comme elle l’affirme ou continuera-t-elle des politiques nationales qui ne manqueront pas d’avoir des impacts négatifs sur ses partenaires en leur faisant supporter une partie de ses erreurs passées ? Les réponses sont très importantes pour ce pays et pour l’ensemble de l’Union européenne.
La meilleure réponse serait de poursuivre résolument le parachèvement du marché intérieur, de l’Union bancaire et de l’Union des marchés de capitaux. L’Allemagne comme l’Union toute entière peuvent trouver dans ces chantiers une solution partielle aux urgences du moment et des solutions pérennes à une économie structurellement dépendante de pays tiers.
Les solutions sont européennes. Les réflexes des gouvernements et des citoyens deviennent de plus en plus européens. Les États membres pourraient y puiser la force de nouvelles initiatives, permettant de gommer les hésitations, les lenteurs, voire les erreurs du passé, pour se tourner résolument vers l’avenir.
La « tempête parfaite », c’est-à-dire violente, que traverse l’Union européenne est l’occasion de réviser certaines certitudes, d’adapter ses politiques et de conquérir un peu plus, par l’efficacité et la réactivité, le cœur des citoyens européens.
Le présent Rapport Schuman sur l’état de l’Union a été très largement nourri de contributions écrites avant le déclenchement de la guerre russe en Ukraine. Mais il demeure d’une grande actualité par les problématiques de long terme qu’il analyse et les propositions qu’il contient.
1Les questions politiques
La protection de l’État de droit au sein de l’Union européenne
Didier REYNDERS
L’Union européenne est, avant tout, une communauté de droit et de valeurs. Nos valeurs ont toujours été au cœur du projet européen et elles en constituent même le fondement. Parmi ces valeurs, l’État de droit est d’une importance particulière, car il garantit la protection de toutes les autres, y compris le respect des droits fondamentaux et de la démocratie. Sans accès à une justice indépendante, l’effectivité des droits fondamentaux ne peut être assurée. L’État de droit est également essentiel pour garantir une application efficace de la législation de l’Union européenne, la confiance mutuelle et la coopération judiciaire. Il est également un des piliers du bon fonctionnement de notre marché intérieur, pour maintenir sa compétitivité et promouvoir un environnement favorable à l’investissement.
Les dernières années ont toutefois démontré que nous ne pouvons pas considérer l’État de droit comme un fait acquis. La situation d’urgence causée par la pandémie n’a fait qu’amplifier ce constat. Au-delà de son impact sanitaire et économique immédiat, elle s’est révélée être un véritable « test de résistance » pour évaluer la résilience de nos systèmes nationaux en temps de crise.
Dans ce contexte, la protection de l’État de droit au sein de l’Union européenne est l’une des grandes priorités de mon mandat. En tant que gardienne des traités, la Commission a récemment élargi la gamme d’instruments à sa disposition pour assurer cet objectif. Un nouveau mécanisme européen a été développé, dont le pilier central est un rapport annuel sur l’État de droit. La publication du premier rapport, en 2020, a permis d’instaurer un cycle innovant pour promouvoir l’État de droit de manière plus proactive. L’objectif est de mieux prévenir les atteintes potentielles à l’État de droit et d’instaurer un dialogue régulier sur ces questions avec les États membres.
Toutefois, la promotion et le respect de l’État de droit ne peuvent être réduits à un processus descendant. C’est pourquoi le rapport sur l’État de droit est fondé sur une approche inclusive. En élaborant le premier rapport, nous avons recueilli les contributions d’un large éventail de parties prenantes, y compris la société civile. Inclure cette dernière est une démarche essentielle en vue d’approfondir notre connaissance de la situation au sein de chaque État membre.
Le rapport comporte quatre grands piliers ayant une forte incidence sur l’État de droit : les systèmes de justice nationaux ; les cadres de lutte contre la corruption ; le pluralisme et la liberté des médias ; et d’autres questions institutionnelles liées à l’équilibre des pouvoirs essentiels à un système efficace de gouvernance démocratique. Sur cette base, l’objectif de la Commission est de nourrir un débat inclusif et promouvoir une véritable culture de l’État de droit dans l’ensemble de l’Union européenne. Ce rapport devrait également aider l’ensemble des États membres à examiner les moyens de remédier à certaines difficultés, tirer des enseignements de leurs expériences respectives et mettre en évidence les possibilités de renforcer encore l’État de droit dans le plein respect des systèmes constitutionnels et traditions nationaux.
La Commission prévoit d’adopter le prochain rapport sur l’État de droit en juillet 2022. Il sera élaboré en suivant essentiellement la même méthodologie que les rapports 2020 et 2021, en intégrant un suivi des enjeux identifiés l’année précédente et, comme auparavant, une analyse des défis soulevés par la pandémie de Covid-19.
Une autre nouveauté par rapport à l’édition 2021 sera l’intégration de recommandations qui découleront des appréciations contenues dans les chapitres par pays et seront intégrées dans le rapport lui-même. En ce sens, ces recommandations sont une évolution logique des appréciations claires déjà formulées par la Commission. Leur objectif est de soutenir les États membres dans leurs efforts pour faire avancer des initiatives en cours ou envisagées, et de les aider à identifier les points où il est nécessaire de réagir à des changements récents ou de mettre en œuvre des réformes.
Dans le cadre de ce nouveau rapport, nous continuerons à stimuler le dialogue tant au niveau européen qu’au niveau national. En 2020, sous la présidence allemande du Conseil, nous avons déjà eu deux échanges très constructifs sur la base du rapport sur l’État de droit au sein du Conseil. En avril 2021, nous avons poursuivi ce dialogue avec un deuxième groupe de cinq États membres, sous la présidence portugaise du Conseil. Lors du Conseil de novembre 2021, la présidence slovène a choisi de reconduire ce dialogue avec un nouveau groupe de cinq États membres. J’ai déjà eu l’occasion de présenter la seconde édition du rapport au mois de décembre dernier à l’Assemblée nationale et au Sénat français et il figure en bonne et due forme à l’agenda de la présidence française du Conseil au premier semestre 2022.
Je me suis, en outre, particulièrement attaché à susciter un dialogue similaire au niveau des parlements nationaux, en présentant le rapport devant plus de vingt Parlements, avec lesquels j’ai eu l’opportunité de mener des discussions très constructives sur les conclusions du rapport et les bonnes pratiques dans chaque État membre.
Enfin, si le respect de l’État de droit dans l’ensemble de l’Union européenne n’est pas garanti, le risque est grand de mettre à mal la confiance mutuelle. Or, cette confiance mutuelle est la condition sine qua non de la construction de l’espace judiciaire européen et, dans les faits, la capacité des tribunaux, des notaires, des huissiers et de tous les praticiens à coopérer entre eux, au-delà des frontières. En l’espace d’un peu plus de vingt ans et depuis la déclaration de Tampere, l’Europe s’est dotée d’une législation complète sur la coopération judiciaire non seulement en matière pénale, mais également en matière civile et commerciale. Grâce à la confiance mutuelle et au degré très élevé de coopération, les citoyens et les entreprises bénéficient d’une grande sécurité juridique lorsqu’ils se déplacent, investissent ou entreprennent d’un État membre à l’autre. La Commission s’emploie donc activement à faciliter l’application du droit de l’Union au niveau national, en fournissant aux praticiens de nombreux outils et en soutenant, en particulier, le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (RJECC).
* * *
La Commission reste pleinement déterminée à utiliser tous les instruments dont elle dispose pour défendre et protéger l’État de droit au sein de l’Union européenne. La justice européenne est une construction de long terme et je suis fier d’avoir participé à poser des jalons complémentaires à cette construction. Cela restera une priorité jusqu’à la fin de mon mandat.
Quarante ans après le 13 décembre, où va la Pologne ?
Tomasz ORŁOWSKI
Le 13 décembre est gravé dans la mémoire collective des Polonais comme la date du coup d’État communiste de 1981. Le même jour a été signé, en 2007, le traité de Lisbonne. J’espérais que cette coïncidence servirait symboliquement de « fin de l’histoire » et marquerait l’avènement heureux de notre destinée européenne. Je me souviens l’avoir dit ce jour-là à Jacques Delors en le recevant à l’ambassade de Pologne à Paris. Malheureusement, j’ai maintenant l’impression que j’ai pêché par excès d’optimisme. Une maigre consolation est que je n’ai pas fait exception, car tel était alors le sentiment dominant.
Les dérives
Cet article décrit l’état dans lequel se trouve mon pays quarante ans après la déclaration de la loi martiale communiste et après six ans de pouvoir du parti national-conservateur Droit et Justice (PiS). Je n’avais pas imaginé que je devrais y ajouter les restrictions à la liberté de la presse. La nouvelle loi, adoptée par surprise et sans débat, en violation du règlement intérieur du Sejm (la Diète, chambre basse du parlement), veut supprimer toute forme de contrôle public sur le moindre risque d’arbitraire provenant des autorités. Elle nous ramènera ainsi quarante ans en arrière. La loi n’est pas entrée en vigueur en raison du veto présidentiel, mais ce pourrait n’être que partie remise. Dans la situation ou le gouvernement cherche à rétrécir la liberté de la presse, j’ai le fâcheux déjà-vu des temps quand les Polonais pour exprimer leurs opinions devaient faire recours à la presse libre des pays étrangers amis.
Il est toujours difficile et pénible de parler de manière critique de la situation dans son propre pays, même lorsqu’il s’agit d’abus de pouvoir flagrants. Si j’y suis obligé, c’est pour deux raisons : premièrement, ce qui se passe actuellement en Pologne peut menacer d’autres peuples qui sont confiants dans la démocratie, et constituer une menace pour l’avenir du projet européen ; deuxièmement, les références à la Pologne apparaissent de plus en plus fréquemment dans le débat politique français et sont largement utilisées par tous les opposants à l’Union européenne.
Notre seul chemin d’avenir souhaitable est le progrès continu et fructueux de l’intégration européenne. Je ne souhaite pas que ce qui nous arrive soit une excuse pour un changement de direction, la Pologne devenant un signal sous lequel se rassembleraient tous les opposants à l’Union européenne. Les démentis quotidiens des plus hautes autorités polonaises qui affirment ne jamais penser sérieusement à un « Polexit » ne changeront en rien le fait que ce processus est déjà en marche, comme une voiture dont les freins ont lâché. Je l’ai compris lorsque, étant ambassadeur à Rome, le ministre des Affaires étrangères m’a répondu directement : « Qui vous a dit qu’une Union toujours plus étroite est l’objectif de ce gouvernement ? ».
Les objectifs du gouvernement
Quel est alors l’objectif inavoué du gouvernement polonais actuel par rapport à l’Union européenne ? Une image pittoresque dit qu’il voudrait que l’Europe devienne une sorte de Société des Nations, oisive mais dotée d’un distributeur automatique ouvert 24 heures sur 24, où le montant des retraits serait sans limite. L’ambiance est nourrie par les parallèles insultants, infondés et scandaleux entre l’Union européenne et l’Union soviétique, de « l’empire de Moscou » à « l’empire de Bruxelles », tous utilisés par les dirigeants du parti Droit et Justice. Ceux-ci habituent l’opinion publique, répétant délibérément et inlassablement les mots « occupant », « ennemi », « diktat » en les banalisant.
Il ne s’agit pas seulement de s’attribuer les succès des politiques européennes et de rejeter sur l’Europe la responsabilité des échecs, ce que font régulièrement presque tous les gouvernements des États membres. La récente réunion des dirigeants des droites antieuropéennes, souverainistes et nationalistes à Varsovie à l’invitation du PiS montre la vraie cible à atteindre : l’affaiblissement et la division de l’Europe. Si ce genre de déclarations ne surprend plus chez les « amis » de Vladimir Poutine dont l’une a eu le mauvais goût d’adosser des droits de la Russie sur l’Ukraine durant sa visite à Varsovie, cela devrait surprendre de la part du gouvernement polonais, pays peu suspect de russophilie, qui a retrouvé dans l’Union européenne un havre le mettant à l’abri de l’instabilité géopolitique.
L’objectif du PiS est, en revanche, de faire reculer la Pologne, de la faire revenir en arrière au nom d’une souveraineté mythique qui existait il y a trois cents ans et qui n’existe plus dans un monde globalisé et une Europe intégrée. La souveraineté signifie, dans leur conception, aucune obligation envers aucun autre partenaire extérieur et le droit illimité de commettre moult erreurs, gaspillages ou méfaits dans son propre pays. L’intention délibérée de faire tout ce que le chef suprême souhaite, y compris des bêtises, fait penser à un seul autre pays : la Corée du Nord. Il s’agit d’un paternalisme archaïque en plein centre de l’Europe et ridicule dans une société éveillée qui aspire à la modernité. Ce n’est pas par hasard que Jaroslaw Kaczynski aime indiquer comme son héros favori Antonio Salazar !
Le risque d’un isolement
Cette approche signifie tout simplement l’isolement international de la Pologne que le gouvernement PiS poursuit patiemment en abandonnant la politique étrangère active, en décevant ses alliés et ses partenaires, en démantelant la diplomatie polonaise pour en faire la risée de tous. Elle fait ainsi un cadeau à tous nos adversaires qui aiment se servir de nos faiblesses. Elle convient amplement à la Russie, qui ne cache pas son triple objectif : recouvrer le territoire soviétique ; transformer l’Europe centrale en zone grise ; affaiblir, voire diviser, l’Union européenne. Ce n’est pas la Pologne, mais le parti PiS qui est en train d’accomplir cette tâche entièrement opposée à l’intérêt vital du pays.
Ce paternalisme archaïque, méfiant envers l’Europe, trouve trois autres catégories de compagnons de route. D’abord le milieu conservateur et ultra-conservateur, qui compte malheureusement une partie importante de la hiérarchie de l’Église catholique combattant toute idée de progrès, notamment vis-à-vis des questions sociétales. Ensuite, une agrégation informe – et multiforme – composée de tous les laissés-pour-compte de la société pour des raisons diverses (frustration, complexité, marginalité), justifiées ou imaginées, qui estiment pouvoir prendre enfin leur revanche. Enfin, de jeunes technocrates, opportunistes et sans scrupule, qui saisissent l’occasion pour s’enrichir grâce à des projets fantasques comme le creusement d’un canal vers un port qui n’existe plus depuis le Moyen Âge, ou la construction d’un méga-aéroport en rase campagne pour défier les grands aéroports… du voisin allemand.
Malgré le discours anticommuniste de rigueur, il existe pourtant certains nostalgiques de l’appareil communiste, cyniques, qui exécutent toutes les sales besognes, tel Stanisław Piotrowicz, procureur de la République à l’époque de la loi martiale. Tous ces projets irréalistes sont généreusement rétribués par le budget de l’État. La spoliation et le mensonge sont devenus des méthodes courantes de ce gouvernement. La télévision publique qui sert de vecteur de propagande sans retenue, reçoit une dotation annuelle spécifique de presque 500 millions €, alors que le même montant pour la lutte contre le cancer a été refusé par la majorité parlementaire du PiS.