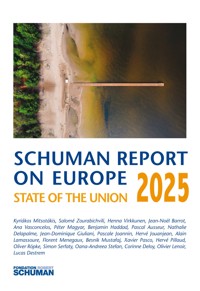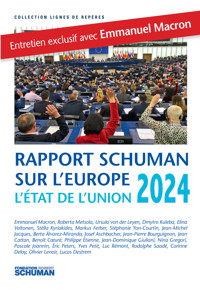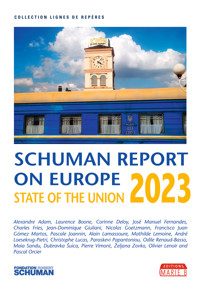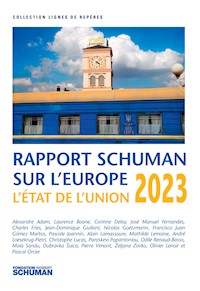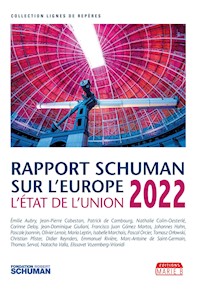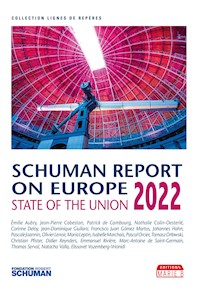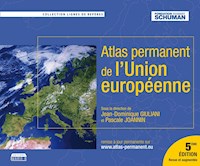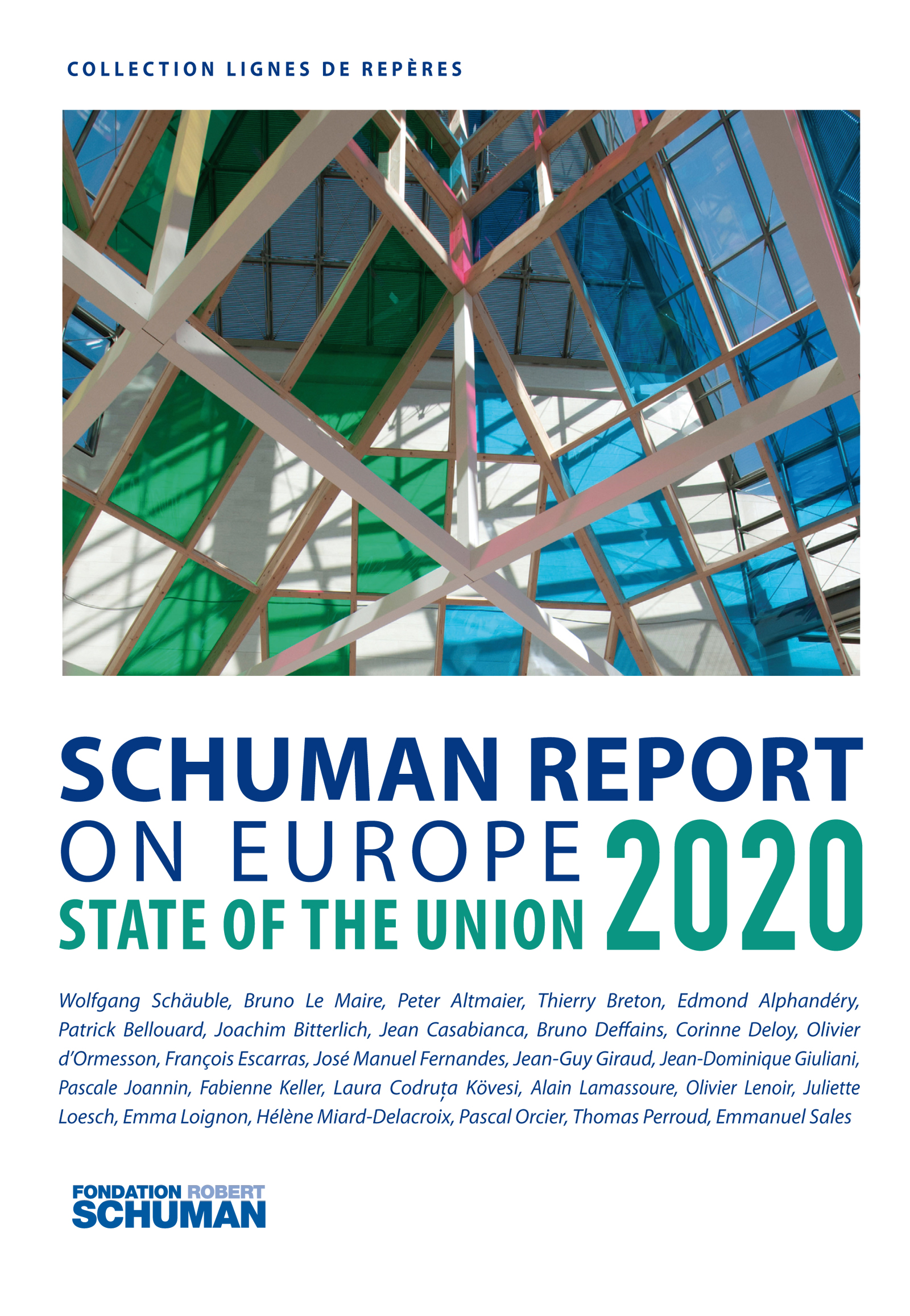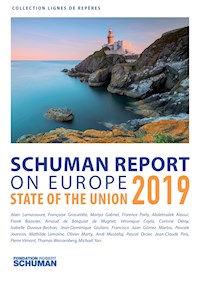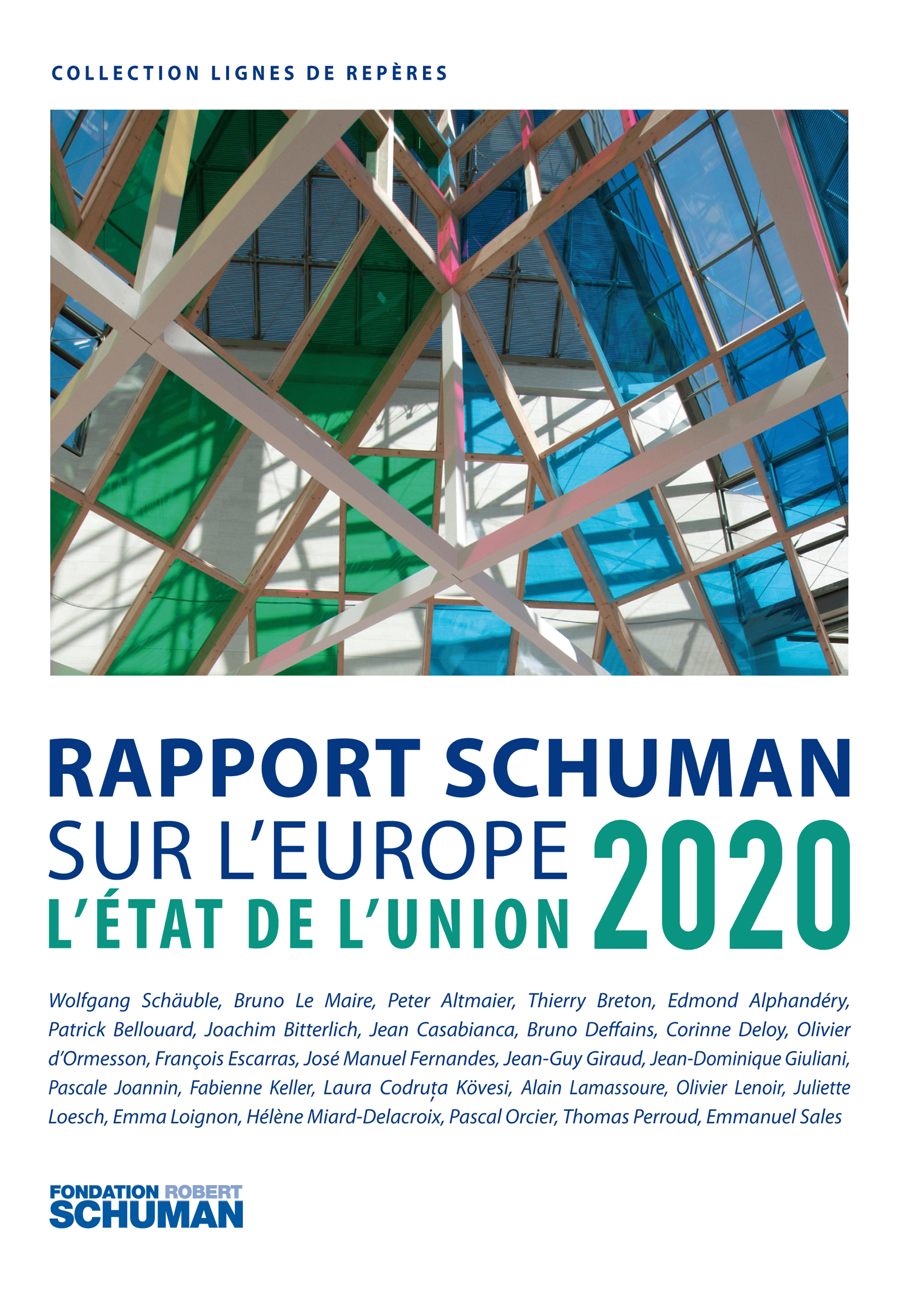
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Marie B
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Le Rapport Schuman sur l’Europe 2020, ouvrage de référence pour les décideurs européens, ressemble cette année les contributions des plus hautes personnalités et des meilleurs experts qui ont choisi de relever le défi de penser l’Europe de demain.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Pascale Joannin est directrice générale de la Fondation Robert Schuman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’État de l’Union 2020, Rapport Schuman sur l’Europe est une œuvre collective créée à l’initiative de la Fondation Robert Schuman au sens de l’article 9 de la loi 57-298 du 11 mars 1957 et de l’article L. 113-2 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle.
Textes originaux en allemand et en anglais traduits en français par Mathilde Durand
Mise en page : Nord CompoCouverture : M Graphic DesignImage de couverture :MUDAM Luxembourg (Alamy image)
copyright Éditions Marie B/collection Lignes de repères
ISBN : 9791093675817
Ce document numérique a été réalisé par Nord Compo.
Sommaire
Sommaire des cartes
1959-2020 : la construction européenne
L’Europe au 1er février 2020
Territoires de l’Europe 2020
Les espaces ultra-marins de l’Union européenne
1.Les questions politiques
La confiance des citoyens
Le Parquet européen
Les peurs allemandes
L’Europe politique en 2020
L’Europe au féminin
Le Parlement européen en 2020
2.Les questions économiques
Les grandes villes européennes
Les 13 plus grandes agglomérations mondiales en 2030
Un projet d’intérêt commun européen pour la chaîne de valeur des batteries
3.La place internationale de l’Europe
Enjeux maritimes en Méditerranée
Politique de défense européenne
Sécurité dans le monde : interventions et participations de l’Union européenne
Politique de défense
Enjeux maritimes de l’Union européenne
Présence maritime française
4.L’Union européenne vue par les statistiques
Importation et exportations extracommunautaires
Migrations internes
Migrations externes
La croissance économique en Europe
Géographie de la zone euro
La politique monétaire internationale
L’euro, monnaie de réserve mondiale
Inégalité et pauvreté dans les États membres
Attractivité du système universitaire européen
Le budget de l’Union européenne
Indice de performance environnementale des Etats membre
Part des énergies renouvelables dans le mix des Etats membres
Émissions de gaz à effet de serre par secteur d’activité
Stress hydrique dans les États membres
RAPPORT SCHUMAN SUR L’EUROPE
L’État de l’Union 2020
Sous la direction de Pascale Joannin
Ont contribué à cet ouvrage :
Edmond Alphandéry, Peter Altmaier, Patrick Bellouard, Joachim Bitterlich, Thierry Breton, Jean Casabianca, Bruno Deffains, Corinne Deloy, Olivier d’Ormesson, François Escarras, José Manuel Fernandes, Jean-Guy Giraud, Jean-Dominique Giuliani, Pascale Joannin, Fabienne Keller, Laura Codruța Kövesi, Alain Lamassoure, Bruno Le Maire, Olivier Lenoir, Juliette Loesch, Emma Loignon, Hélène Miard-Delacroix, Thomas Perroud, Pascal Orcier, Emmanuel Sales, Wolfgang Schäuble
AVERTISSEMENT
L’essentiel de cette quatorzième édition de « l’état de l’Union, Rapport Schuman sur l’Europe » 2020, a été bouclé avant le déclenchement de la pandémie due au virus Covid-19. Les personnalités et experts qui ont bien voulu nous confier leurs contributions n’ont donc pas pu prendre en compte son influence et ses conséquences.
Nous désirons, malgré cela, ne pas vous priver de leurs analyses qui, par leurs qualités, peuvent être détachées de l’actualité.
C’est pourquoi nous avons choisi de publier, dès à présent, le présent ouvrage en format numérique.
Pascale Joannin
31 mars 2020
Ont contribué à cet ouvrage
Textes
Edmond Alphandéry
Ministre de l’Économie de 1993 à 1995, Edmond Alphandéry a été président d’EDF puis président de CNP Assurances (1998-2012), ainsi qu’administrateur d’ENGIE et président de son comité stratégique (2010-2019). Président-fondateur de l’Euro50 Group qui suit les questions concernant la monnaie européenne, il a lancé en 2018 une « Task Force » sur le prix du carbone en Europe pour lutter contre le changement climatique. Diplômé de Sciences Po, il est agrégé d’économie politique. Il a enseigné de nombreuses années à l’Université Panthéon-Assas, dont il est maintenant professeur émérite.
Peter Altmaier
Peter Altmaier est ministre allemand de l’Économie et de l’Énergie depuis le 14 mars 2018. Ancien fonctionnaire à la Commission européenne (1990-1994), il devient en 1994 membre de la commission de la Justice du Bundestag. Il a été le porte-parole du groupe parlementaire CDU/CSU au Bundestag de la première commission d’enquête parlementaire (2002-2003), conseiller juridique du groupe parlementaire CDU/CSU (2004-2005). Secrétaire d’État parlementaire au ministère de l’Intérieur (2005-2009), ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sûreté nucléaire (2012-2013) et chef de la Chancellerie fédérale (2013-2018), il a été ministre chargé de Missions spéciales et coordonnateur du gouvernement pour le dossier des réfugiés (de 2015 à 2018).
Patrick Bellouard
Ingénieur général de 1re classe de l’armement (2S). Depuis 2015, Patrick Bellouard est président de l’Association EuroDéfense-France, dont il est membre du bureau depuis 2013. Il a été directeur de l’OCCAR-EA (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’armement – administration exécutive) de 2008 à 2013 et chargé de mission auprès du Premier ministre pour la coordination interministérielle du programme Galileo de 2004 à 2008. Chef du service des programmes aéronautiques de la DGA de 1999 à 2004, il a été également auditeur du Centre des hautes études militaires (CHEM) et de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN-48e session nationale).
Joachim Bitterlich
Ambassadeur e.r. et ancien conseiller européen, diplomatique et de sécurité du chancelier allemand Helmut Kohl. De 2003 à 2012, Joachim Bitterlich a été Executive Vice President International Affairs de Veolia Environnement, de 2009 à 2012, Chairman des activités du groupe en Allemagne. Il est membre du conseil d’administration d’institutions publiques et privées. Président du Cercle économique franco-allemand (DFWK) et membre de la commission indépendante d’historiens auprès du ministère allemand de l’Alimentation et de l’Agriculture, professeur à l’ESCP Paris, il est co-fondateur du Club rhénan et membre du comité scientifique de la Fondation Robert Schuman.
Thierry Breton
Thierry Breton est commissaire européen au Marché intérieur. Ancien président-directeur général du groupe Atos (2009 à 2019), il a également été directeur de la stratégie et du développement, puis directeur général de Bull (1996-1997), président-directeur général de Thomson Multimedia (1997-2002) puis de France Télécom (2002-2005). Il a été ministre français de l’Économie, des Finances et de l’Industrie de 2005 à 2007. Il a enseigné le Leadership et la responsabilité des entreprises à l’université de Harvard de 2007 à 2008.
Amiral Jean Casabianca
Ingénieur atomicien, diplômé de l’École navale, l’amiral Jean Casabianca a navigué essentiellement sur sous-marins mais aussi sur des bâtiments de surface avant de terminer sa carrière embarquée en 2002 comme commandant adjoint du porte-avions Charles de Gaulle. Breveté de l’École de guerre, il a servi durant trois années comme chef d’état-major de l’École navale et du groupe des écoles du Poulmic. Auditeur de la 55e session du Centre des hautes études militaires et de la 58e session de l’Institut des hautes études de défense nationale, il est nommé chef du cabinet militaire du ministre français de la Défense et haut fonctionnaire correspondant de défense et sécurité. Il est major général des armées depuis le 1er septembre 2018.
Bruno Deffains
Professeur de droit et d’économie à l’université Paris II-Panthéon-Assas, Président du pôle numérique du Club des juristes et directeur du Centre de recherches en économie et droit (CRED), Bruno Deffains a enseigné dans plusieurs universités (Yale, Columbia, Liverpool, Montréal, Berlin, Amsterdam). Il est membre de la Commission d’examen des pratiques commerciales et de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme. Il dirige le master « Droit des affaires et économie » à l’université Panthéon Assas, ainsi que le DU « Transformation digitale du droit et legaltech » et la Summer School organisée avec la Yale Law School et l’ESSEC Private Law and Economics.
Corinne Deloy
Diplômée de Sciences Po et titulaire d’un DEA de sociologie politique de l’université de Paris I – Panthéon Sorbonne, Corinne Deloy a été journaliste au Nouvel Observateur et secrétaire générale de la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol). Elle est chargée d’études au Centre de recherches internationales de Sciences Po (CERI) et rédactrice de l’Observatoire des élections en Europe (OEE) de la Fondation Robert Schuman.
Olivier d’Ormesson
Avocat spécialisé en droit de la concurrence, Olivier d’Ormesson a été membre du collège de l’Autorité de la concurrence de 2014 à 2019. Il a travaillé à Bruxelles et à New York. Il a débuté sa carrière d’avocat au sein du cabinet Gide Loyrette Nouel. Il devient associé responsable du bureau de Bruxelles, puis responsable du bureau de New York en 1989, avant de revenir prendre la responsabilité du bureau de Bruxelles en 1992. Sept ans plus tard, il rejoint le cabinet Linklaters, à Bruxelles, puis à Paris en 2003, en tant qu’associé responsable de l’équipe droit de la concurrence et droit communautaire. Il enseigne le droit de la concurrence à Sciences Po, HEC et Paris II-Panthéon-Assas.
François Escarras
Après des études en Histoire et en Sciences Politiques, François Escarras a intégré l’école du Commissariat de la Marine en 1995. Il a occupé divers postes embarqués à bord des bâtiments de la marine. Il s’est ensuite spécialisé dans les domaines des ressources humaines et des relations internationales. Il a occupé de 2013 à 2016 le poste d’attaché de défense près l’Ambassade de France à Lisbonne. Il est l’adjoint au coordonnateur ministériel pour la sécurité des espaces maritimes du ministère français des Armées depuis juin 2018. Il est breveté du cours d’état-major interarmées de l’Institut d’études supérieures militaires de Lisbonne.
José Manuel Fernandes
Député européen (PPE, PT) depuis 2009, membre de la commission des Budgets, José Manuel Fernandes est le négociateur du Parlement européen pour le Cadre Financier Pluriannuel 2021-2027, notamment sur la réforme des ressources propres. Entre 2014 et 2019, il a été rapporteur du budget de l’Union, du programme InvestEU et du Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (EFSI). Il préside la Délégation pour les relations avec la République fédérative du Brésil. Il a été maire de Vila Verde de 1998 à 2009. Il est diplômé en Ingénierie de Systèmes et d’Informatique de l’université de Minho.
Jean-Guy Giraud
Diplômé d’études supérieures de droit de l’université Paris I, de Sciences-Po Paris et de l’université Johns Hopkins (SAIS Washington DC), Jean-Guy Giraud a suivi une carrière européenne de 1973 à 2009, notamment au sein du Parlement européen : collaborateur d’Altiero Spinelli, membre de cabinets présidentiels, directeur des commissions puis du bureau de liaison à Paris. Il a également dirigé le secrétariat de la Cour de justice (Greffier) puis celui du Médiateur européen (Secrétaire général). Il a collaboré avec le Mouvement européen international et a présidé l’Union des fédéralistes européens-France. Depuis 2016, il tient un blog sur l’actualité européenne (https://www.lesamisdutraitedelisbonne.com).
Jean-Dominique Giuliani
Président de la Fondation Robert Schuman et Président de l’Institut Libre d’Études des Relations Internationales (ILERI), Jean-Dominique Giuliani a été directeur de cabinet du Président du Sénat René Monory et directeur à la SOFRES. Ancien Conseiller spécial à la Commission européenne et membre du Conseil de Surveillance d’Arte, il codirige l’Atlas permanent de l’Union européenne, Éditions Marie B, (4e édition, 2018). Il est l’auteur de La grande bascule, éditions de l’école de Guerre, 2019 et de Pour quelques étoiles de plus… Quelle politique européenne pour la France ? éditions Lignes de repères, 2017.
Pascale Joannin
Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Ancienne auditrice de la 56e session nationale de l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN), Pascale Joannin codirige l’Atlas permanent de l’Union européenne éditions Marie B, (4e édition, 2018). Elle est l’auteur de L’Europe, une chance pour la femme, Note de la Fondation Robert Schuman, no 22, 2004. Elle a publié de nombreuses études sur les questions européennes.
Fabienne Keller
Diplômée de Polytechnique et de l’université de Berkeley, Fabienne Keller a débuté sa carrière au ministère français des Finances et au Crédit Industriel d’Alsace et Lorraine. Conseillère départementale et régionale, elle est maire de Strasbourg de 2001 à 2008. Après son mandat de sénatrice de 2014 à 2019, elle est élue députée européenne (RE, FR) en mai 2019. Très engagée sur les sujets urbains, elle est particulièrement mobilisée sur les quartiers fragiles, avec le Conseil national des villes qu’elle co-préside et l’Intergroupe URBAN au Parlement européen dont elle est vice-présidente.
Laura Codruţa Kövesi
Laura Codruţa Kövesi est le premier Procureur général européen et l’ancienne Procureur en chef de la direction nationale anticorruption (DNA) de Roumanie, (2013-2018). De 2006 à 2012, elle a été Procureur général de Roumanie, rattaché à la Haute cour de cassation et de justice. Elle est titulaire d’un doctorat en droit. Sa thèse de doctorat s’intitulait « La lutte contre le crime organisé par le biais des dispositions du droit pénal ».
Alain Lamassoure
Diplômé de Sciences Po Paris et de l’ENA, Alain Lamassoure commencé sa carrière comme conseiller à la Cour des comptes. Ministre des Affaires européennes (1993-1995), ministre du Budget et Porte-parole du gouvernement français (1995-1997), il a été député à l’Assemblée nationale de 1986 à 1995 et député européen de 1989 à 1993 et de 1999 à 2019. Il a présidé la commission des Budgets (2009-2014) ainsi que les commissions spéciales sur les rescrits fiscaux (TAX 1 et 2) et a été rapporteur sur l’assiette commune consolidée sur l’impôt sur les sociétés (ACCIS). Il est le président du comité scientifique de la Fondation.
Bruno Le Maire
Normalien, agrégé de lettres modernes, diplômé de Sciences Po Paris et ancien élève de l’ENA, Bruno Le Maire commence sa carrière comme conseiller au ministère français des Affaires étrangères. Il devient en 2002 conseiller pour les affaires stratégiques du ministre des Affaires étrangères puis conseiller auprès du ministre de l’Intérieur en 2004. En 2005, il devient conseiller, puis directeur de cabinet du Premier ministre de 2006 à 2007. En juin 2007, il est élu député de l’Eure. Il est nommé secrétaire d’État aux Affaires européennes (2008-2209) puis ministre français de l’Agriculture et de la pêche (2009-2012). Il est depuis mai 2017 ministre français de l’Économie et des finances.
Juliette Loesch
Chargée de mission pour l’Asie du Sud-Est, Juliette Loesch est référente pour la stratégie de défense française dans l’Indo-Pacifique à la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère français des Armées. Elle a travaillé comme consultante pour des ONG dans le domaine de la paix et du développement aux Philippines. Elle est titulaire d’un master en relations internationales de Sciences-Po Aix et d’un master en droit international de l’université d’Aix-Marseille.
Hélène Miard-Delacroix
Professeur des universités en histoire et civilisation allemandes à Sorbonne Université depuis 2008, spécialiste de l’Allemagne contemporaine. Normalienne, Hélène Miard-Delacroix a été formée à la Sorbonne, à Sciences Po Paris et à l’Université de Fribourg en Brisgau. Membre de l’UMR 8138 SIRICE, ses recherches portent sur l’Allemagne dans les relations internationales, l’histoire de la République fédérale et des relations franco-allemandes, avec notamment, parmi ses nombreuses publications, Le défi européen. Histoire Franco-allemande de 1963 à nos jours (Presses du Septentrion, 2011). Elle est membre du conseil scientifique d’importantes institutions de recherche allemandes.
Thomas Perroud
Diplômé d’HEC, de Sciences Po Paris et docteur en droit de l’université Panthéon-Sorbonne, Thomas Perroud est aussi titulaire d’un MPhil et d’un PhD de la Warwick Law School. Il est professeur en droit public à l’université Panthéon-Assas, membre du Centre d’études et de recherches de sciences administratives et politiques (CERSA). Il est en outre régulièrement invité pour enseigner et faire des recherches : à Yale où il fut Deputy Director of the Comparative Administrative Law Initiative, à Berlin (université Humboldt), à l’université d’Oxford (Saint John’s College) ainsi qu’aux universités de Rome 2 et 3, et à Bocconi. Ses domaines de recherches sont le droit public comparé et le droit public de l’économie.
Emmanuel Sales
Président de la Financière de la Cité depuis 2005, Emmanuel Sales est ancien élève de l’École normale supérieure (Ulm) et agrégé de philosophie.
Wolfgang Schäuble
Après avoir étudié le droit et les sciences économiques aux universités de Fribourg et de Hambourg, Dr. Wolfgang Schäuble a obtenu son doctorat en 1971. Il est membre du Bundestag depuis 1972 où il a été secrétaire du groupe parlementaire CDU/CSU de 1981 à 1984, président du groupe parlementaire CDU/CSU de 1991 à 2000 et vice-président du groupe parlementaire CDU/CSU pour la politique étrangère et de sécurité de 2002 à 2005. Ministre avec attributions spéciales et directeur de la Chancellerie fédérale de 1984 à 1989, il a été ministre de l’Intérieur de 1989 à 1991 et de 2005 à 2009, puis ministre des Finances de 2009 à 2017. Membre du Comité exécutif fédéral de la CDU, il a été le président de la CDU de 1998 à 2000. Depuis le 24 octobre 2017, il est le président du Bundestag.
Statistiques
Olivier Lenoir
Élève à l’École normale supérieure (Ulm), où il suit un master en économie appliquée et politiques publiques, Olivier Lenoir a complété sa formation par un séjour de recherche sur les institutions européennes à La Sapienza à Rome et en travaillant à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, auprès du Défenseur des droits, au BIT et au sein des sociétés Xerfi et Orange. Il est également membre actif du Groupe d’études géopolitiques.
Emma Loignon
Élève à l’École normale supérieure (Ulm), Emma Loignon est titulaire d’un master en économie appliquée et politiques publiques. Après des expériences dans l’administration – à la préfecture d’Île-de-France et au ministère français de l’Économie et des finances, – elle s’est orientée vers les questions liées au développement des énergies renouvelables. Elle complète sa formation à l’université de Columbia, New York.
Cartes
Pascal Orcier
Ancien élève de l’ENS de Lyon, Pascal Orcier est professeur agrégé et docteur en géographie, spécialiste des pays baltes, cartographe, enseignant en classes européennes au lycée Beaussier de La Seyne-sur-Mer (83) et en classes préparatoires au lycée Stanislas de Cannes (06).
Préface
Une nouvelle histoire d’Europe
Jean-Dominique GIULIANI
Il n’est point de lieu où l’on ne puisse lire ou entendre des interrogations sur l’Europe, ses imperfections, ses retards, sa fin trop souvent pronostiquée. Longtemps critiquée par les peuples, elle l’est davantage désormais par les élites européennes, qui n’entrevoient pas ses évolutions possibles sans nouveaux transferts de compétences au niveau européen et donc sans perte de pouvoir. En 2019, les citoyens ont pris part majoritairement aux élections européennes. Les études d’opinion traduisent une remontée de la confiance des peuples et de véritables attentes envers la dimension européenne.
Jamais, pourtant, au sein des classes politiques nationales, des gouvernements et du Conseil de l’Union européenne qui en rassemble les représentants, les doutes n’ont été aussi forts sur la pertinence de l’Union européenne et de ses politiques. Il est d’usage de chercher « à ré-enchanter l’Europe », de « retrouver le rêve européen », avec une vraie nostalgie pour les débuts de l’Europe communautaire. On réclame même « un nouveau narratif » pour elle, comme les paroles d’une chanson oubliée. Autant d’affirmations un peu décalées par rapport à la réalité, au point de se demander si ce n’est pas la certitude du déclin qui anime leurs auteurs.
À 70 ans, la construction européenne a certainement besoin d’un lifting, à défaut d’une « réinvention » après laquelle courent nombre de politiciens en mal d’idées précises. De fait, l’Union entre dans une nouvelle ère, qui exige de nouveaux objectifs et certainement de nouveaux moyens. Elle ne mérite certainement pas nombre de jugements hâtifs qui lui sont consacrés. Elle ne peut être jugée que dans la durée, au regard de l’histoire. Et de ce point de vue, ses succès passés, malgré ses difficultés présentes, laissent entrevoir quelques espoirs de sursaut. Sa première histoire a été un succès longtemps contesté mais désormais incontestable. Il lui faut écrire une nouvelle histoire correspondant à un nouveau moment de l’histoire de la planète.
Après une phase de construction glorieuse, elle a, en effet, fort mal entamé le XXIe siècle. Mais ses évolutions récentes conduisent à penser qu’elle se transforme plus rapidement qu’on ne le dit.
Une première Europe réussie
L’intégration par le droit et l’économie fut un pari audacieux. Il a été gagné. En 1950, cinq ans après la fin des combats, il aurait été bien vain de vouloir engager le rapprochement des peuples d’Europe par la politique, le régalien et le partage des compétences de police, de justice, de diplomatie ou de défense. Les conflits avaient créé de graves divisions et une trop profonde méfiance, due aux horreurs du conflit, prévalait entre partenaires. En revanche, tous les États du continent étaient intéressés par la reconstruction et demandeurs de croissance économique.
La méthode Monnet, que porta politiquement Schuman, correspondait parfaitement aux exigences du moment. Elle était la bonne. Toute autre aurait échoué. Dans l’histoire, les fédérations se sont construites en partageant d’abord la force armée, la diplomatie, la police, la justice et ce ne fut jamais sans conflit.
Faire l’Europe à l’envers fut un choix délibéré car vouloir la construire autrement aurait vraisemblablement conduit de nouveau à la guerre. Nouer des intérêts communs et les développer concrètement en laissant de côté les questions régaliennes, a conduit les États membres à s’entendre pour s’intégrer chaque fois un peu plus : l’Union douanière a réclamé le marché intérieur qui a appelé à son tour l’euro…
De fait, les résultats furent au rendez-vous. L’Europe s’est reconstruite, redressée et, dopée par l’aide du plan Marshall, une vision intelligente des Américains et des intérêts de l’Amérique, elle est passée de l’état d’un véritable champ de ruines à celui d’un continent parmi les plus développés.
Les États membres de l’Union européenne ont connu une croissance soutenue de leur économie et une élévation massive du revenu par habitant. L’intégration européenne a apporté la prospérité et même le Royaume-Uni, pourtant son adversaire, a été convaincu et l’a rejointe. Jusqu’à la fin des années 80, cette croissance est comparable à celle des États-Unis, dont l’Europe affiche alors 80 % du revenu par habitant.
Le bouclier américain lui a assuré, à moindre coût, une protection efficace pendant la guerre froide. Aux succès intérieurs correspondait simultanément un désintérêt certain pour les affaires extérieures. On s’en remettait à d’autres, selon les conditions de la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’OTAN était en charge de la sécurité et a d’ailleurs rempli sa mission en développant l’interopérabilité entre les alliés, une situation dont les Européens tirent encore profit.
Les siècles n’ont pas forcément cent ans. Le XXe avait commencé en 1914 ; il s’est terminé avec la chute du Mur de Berlin en 1989 et la dissolution de l’Union soviétique en 1991.
C’est un tout nouveau contexte qui entoure l’Europe à partir de ces dates. L’Union européenne triomphe, son élargissement se poursuit, son modèle attire et elle « aspire » littéralement ses frontières de l’Est. Excès de confiance ? En réalité, depuis déjà le début des années 80 l’économie européenne a changé de visage : dépenses publiques et endettement en hausse, alternances politiques dans plusieurs pays de l’Union. C’est bien ce qu’indiquent les statistiques de croissance. La « période bleue », moment béni de l’économie européenne, semble terminée.
Un mauvais début dans le siècle
L’Europe termine le XXe siècle dans un laisser-aller budgétaire, une insouciance économique et une euphorie sécuritaire, qu’elle va immédiatement payer avec la crise des dettes publiques.
L’introduction de l’euro coïncide avec l’entrée dans le nouveau siècle. Phase essentielle de l’intégration politique de l’Union européenne, elle en est une étape inachevée sur le plan économique et budgétaire. Emportés par la générosité des fonds structurels européens, qu’on doit à la vision solidaire de Jacques Delors, la Grèce, l’Espagne, le Portugal et l’Irlande, leurs bulles spéculatives, immobilières et leurs déficits cachés, sont frappés de plein fouet par une crise venue de l’autre côté de l’Atlantique, comme un rappel brutal à la réalité. Certains, comme la France, s’affranchissent des disciplines et continuent à dépenser sans compter, spécialité qu’elle cultive depuis l’alternance de 1981. D’autres, comme l’Allemagne, adeptes avec certains États du Nord de l’ordo-libéralisme le plus strict, refusent la mutualisation des budgets et nourrissent le sentiment permanent de toujours « payer pour les autres ». Ils poussent aux mauvaises décisions, souhaitent faire payer les créanciers, donner une leçon aux dispendieux ; ils entrainent toute la zone euro dans les turbulences. C’est donc un euro inachevé qui doit faire face aux doutes des investisseurs, stimulés par les rivaux et adversaires de l’Europe. Les Américains auraient voulu inventer cette crise qu’ils ne s’y seraient pas pris autrement. Intellectuellement et financièrement, ils mènent l’assaut contre la monnaie unique.
Au laxisme succède alors la rigueur, autre erreur de politique économique. La Grèce est saignée à blanc mais néanmoins sauvée par la solidarité européenne, dont bénéficient aussi l’Espagne, le Portugal et l’Irlande. Les États peu enclins à la solidarité, qui auraient pu faire échec aux spéculateurs de quelques assurances assumées, se trouvent alors contraints de se porter garants et d’abonder un robuste mécanisme européen de solidarité, capable de mobiliser près de 700 milliards €, mais qui n’ira pourtant pas jusqu’à la création d’un Fonds monétaire européen.
Avec le recul, on peut dire que la gestion de cette crise ne pouvait pas être pire. Les mesures restrictives prise par l’Union européenne pour ses banques, ses compagnies d’assurance et ses budgets nationaux, à l’inverse des États-Unis, ont accentué et prolongé la crise.
Les dirigeants des États membres n’ont pris que tardivement et douloureusement la mesure de la crise et les institutions communes n’ont pas particulièrement brillé par leur action ! On se souvient que José-Manuel Barroso, président de la Commission européenne avait, dans un premier temps, nié la crise et que la chancelière allemande a exigé un hair-cut c’est-à-dire une annulation de près de 100 milliards des dettes contractées par la Grèce auprès des banques, déclenchant ainsi véritablement la crise de confiance envers la dette publique grecque.
La situation économique, l’immobilisme des grands acteurs politiques traditionnels et la montée des inquiétudes ont entraîné nombre d’alternances en Europe et ont nourri une véritable poussée populiste. Extrémismes et nationalismes réapparaissent sur le continent comme ils le font ailleurs, en Inde, au Japon, en Turquie, en Russie et bientôt aux États-Unis. L’Europe n’y échappe pas et se mettent en place des mécanismes centrifuges qui annoncent de profondes divisions entre le Nord et le Sud et entre l’Est et l’Ouest du continent.
Le Brexit en est l’une des expressions. À leur tour, les Britanniques ont été frappés de doute envers une construction qui a pris tellement d’ampleur et de compétences qu’elle est devenue un enjeu de politique intérieure. Le référendum du 23 juin 2016 a profondément divisé le pays alors qu’il était destiné à réunifier un parti, celui des conservateurs. Il a été, par la campagne électorale qui l’a précédé comme par l’incapacité d’en interpréter les résultats pendant trois ans, la plus parfaite illustration de l’inanité et des mensonges des promesses populistes.
Les conflits au Moyen-Orient, spécialement en Syrie, mais aussi en Afghanistan, ont engendré une très forte émigration à destination de l’Europe. Cette vague de réfugiés, s’ajoutant à une émigration économique de ressortissants africains, a surpris les Européens. Ils ont réagi dans le désordre et les efforts de la Commission européenne, notamment pour financer les États ou les organisations internationales qui hébergent les réfugiés loin du territoire européen, n’ont pas suffi à en tarir le flux. 34 000 personnes ont trouvé la mort dans la Méditerranée depuis l’année 2000. Un grave échec pour l’Europe.
Enfin, dans ce contexte mouvant et dégradé, l’Union européenne, ses États membres comme ses institutions communes, n’ont pas gagné la bataille de l’opinion. La confiance dans la construction européenne a reculé, des doutes sont apparus au sein des élites du continent, permettant à tous les partenaires, amis, rivaux ou ennemis, d’accentuer encore la pression sur une Europe ébranlée.
Le tournant du siècle restera comme celui des épreuves pour la construction européenne. Force est de reconnaître cependant qu’elle y a résisté. La crise des dettes publiques, la vague migratoire, le Brexit, la crise financière, les déstabilisations de ses voisins, n’ont pas eu raison d’une Europe résiliente et beaucoup plus forte qu’en apparence. Pendant les crises, l’intégration a continué, c’est-à-dire que l’évidence selon laquelle « l’union fait la force » s’est imposée dans de nombreux domaines. Les juges et les policiers veulent travailler ensemble à traquer la criminalité transfrontière, les militaires ont appris à intervenir ensemble et savent agir en coalitions, l’Union poursuit son travail progressif de mutualisation. Cette solidité pourrait permettre aux Européens d’écrire désormais une nouvelle histoire du continent.
Écrire une nouvelle histoire d’Europe
Alors que la planète se ferme et que nombre de régimes se replient sur eux-mêmes, l’Union européenne est confrontée à de nouveaux défis. Celui de sa sécurité, de son modèle de croissance, de ses valeurs contestées jusqu’en son sein, et de sa gouvernance.
C’est un tout nouveau contexte géostratégique auquel doivent répondre les Européens. L’environnement diplomatique, sécuritaire, politique et économique n’a plus grand-chose à voir avec celui des années 1950. Il convient donc, pour l’Union européenne, de se fixer des objectifs précis et de tout mettre en œuvre pour les atteindre, quitte à rompre avec les règles passées. D’ores et déjà apparaissent de nouveaux mots d’ordre jusqu’ici tabous dans les enceintes communautaires : sécurité, défense, politique industrielle, gouvernance.
Les valeurs de l’Europe sont directement interpellées par le nationalisme, qui a gagné toutes les régions de la planète. Il est, le plus souvent, le fait d’États-continents, qui ont la taille et les moyens d’engager des rapports de forces avec leurs rivaux. L’Union européenne n’est ni un État ni un empire. Alliance volontaire et inédite de nations souveraines, ses membres doivent toujours composer et s’entendre pour lui permettre de décider. Et cette caractéristique, dans cette période de bouleversements successifs, entrave sa capacité à agir et met en exergue les divergences entre ses membres.
Le retour du nationalisme en Europe, c’est l’assurance, à terme, de graves conflits. Et si l’Union s’est montrée résistante aux assauts de ceux qui lui reprochaient son laxisme et sa permissivité, elle demeure interpellée par exemple par la Chine, qui conteste la valeur universelle des droits de l’Homme, issus de ses rangs.
L’Europe est certainement l’espace politique où les libertés individuelles et collectives sont les mieux protégées, consacrées par des traités et sanctionnées par des juridictions. Elle est contestée pour cela par des régimes autocratiques ou totalitaires (Russie, Chine, Turquie), moquée parfois par certains de ses alliés, et attaquée de l’intérieur par des régimes politiques un peu jeunes (Pologne, Hongrie). Le défi de la défense et de la promotion de ses valeurs ne se résout pas à la défense évidente des droits de l’Homme ; nous devons aussi nous interroger pour comprendre pourquoi certains n’acceptent pas l’esprit de liberté et d’égalité qui a soufflé sur l’Europe depuis les années 1950 et trouver les moyens, au prix d’un combat politique plus vigoureux, de rattraper ces errements. Le retour d’une droite extrême, nationaliste et xénophobe, de l’antisémitisme dont on aurait pu croire l’Europe guérie, d’une extrême-gauche de plus en plus violente aussi, sont des sujets de préoccupation qui méritent un engagement politique fort et plus résolu. La violence de l’extrême-droite allemande et son discours complètement désinhibé sont à cet égard très inquiétants. Ils auraient vraisemblablement mérité un combat politique plus assumé.
Pour autant, il faut constater que le paysage politique européen n’a pas enregistré de victoire durable des mouvements populistes ou extrémistes. Au contraire, les traités, la pression des institutions communes et la recomposition politique dans nombre d’États membres ont permis de contenir, voire de battre ceux d’entre eux qui avaient approché la direction des affaires. L’Europe reste le continent des libertés, celui qui compte le moins d’ennemis et qui incarne les valeurs de dialogue, de solidarité sociale, de paix et de solidarité. S’il lui est nécessaire de réapprendre le langage des rapports de forces, cela fait d’elle un espace politique unique au monde. Elle pourrait valoriser ces caractéristiques et en engranger les bénéfices.
La souveraineté européenne est un objectif proposé par le président français et partagé par plusieurs de ses homologues. Elle concerne la défense et la sécurité du continent, mais aussi l’économie et la protection du modèle européen. De ce point de vue, une prise de conscience, tardive mais réelle, a réveillé les Européens. Jean-Claude Juncker a joué son rôle de président de la Commission européenne en lançant le Fonds européen de défense et la France et l’Allemagne ont rendu possible une « coopération structurée permanente » dans le domaine des équipements de défense. Avec un retard chronologique certain, avec des contraintes politiques et juridiques très particulières comme en Allemagne, la défense de l’Europe a fait en quelques mois des progrès inattendus. Ils devront être confirmés dans les faits et les budgets, mais ils constituent une innovation qui ne doit pas être négligée.
Le président français est allé plus loin que ses prédécesseurs en déclarant officiellement que la dissuasion française, désormais la seule au sein de l’Union, avait évidemment une dimension européenne et en invitant ses partenaires au dialogue nucléaire et à des exercices communs.
Une dizaine d’opérations extérieures européennes sont en cours. Des Européens sont au Mali aux côtés des forces françaises. Une mission de sécurisation européenne navigue dans le détroit d’Ormuz. La défense de l’Europe avance, même si certains estiment que c’est trop lentement. L’Union pourrait prendre acte de ces réalités sur lesquelles on ne reviendra pas. Elle pourrait partager très vite une culture stratégique commune, qui lui a longtemps fait défaut. Elle pourrait même apprendre à mieux défendre collectivement ses intérêts, y compris au loin. Elle dispose de l’article 44 du Traité d’Union européenne qui permet de confier une mission particulière à un groupe d’État membres et elle pourrait prévoir un jour le financement d’interventions extérieures sur crédits européens.
Cette souveraineté doit aussi s’affirmer dans les domaines économique et juridique. Le droit de la concurrence doit impérativement être réformé, comme le réclament plusieurs États membres. La commissaire européenne en charge, Margrethe Vestager, a promis d’entamer des consultations en ce sens. Une véritable politique industrielle se dessine, avec la décision de créer une filière européenne de batteries, de mieux contrôler les investissements étrangers et, peu à peu, comme pour la défense, d’introduire le principe de préférence européenne jusqu’alors ignoré. L’Union avait longtemps eu l’obligation de s’ouvrir au monde et son développement en dépendait. Elle avait alors raison. Sans se refermer, elle doit désormais se protéger, défendre ses intérêts et les promouvoir à l’extérieur. Ce sont de nouveaux objectifs correspondant à un nouvel état du monde.
Pour lutter contre l’immigration illégale et réguler les flux migratoires, les Européens ont créé un corps de garde-frontières et de garde-côtes européens qui pourra compter jusqu’à 10 000 fonctionnaires appuyant les efforts des États les plus confrontés à la pression. Celui-ci, peu à peu, se dotera de moyens propres et offrira à l’Union une véritable police aux frontières. Les États continuent de rapprocher leurs législations de l’asile et de l’immigration. Il leur faut accélérer et il est quasiment certain qu’ils seront contraints de le faire sous l’empire de la nécessité.
Autant d’avancées qui peuvent paraître tardives mais qui vont dans le sens d’une souveraineté commune revendiquée et organisée. Car si l’Union accuse un retard chronologique dans la prise en compte du nouveau contexte stratégique, ses membres partagent de plus en plus les mêmes craintes et pourraient donc s’accorder plus vite que prévu sur d’importantes évolutions.
Le bras de fer budgétaire auquel ils se livrent chaque fois qu’il faut adopter un budget commun est d’ailleurs la mesure de leurs convergences en la matière. Force est de reconnaître que les « radins » s’opposent toujours aux autres avec des arguments très nationaux, mais qu’ils sont de moins en moins nombreux.
Reste aux États membres à accepter de modifier et compléter des traités qui datent.
Sujet tabou, tant l’unanimité requise pour cela est réputée impossible à atteindre. Mais rester en l’état, comme si l’environnement n’avait pas bougé, pourrait s’avérer pire que de tenter des innovations.
Si un complément aux traités actuels n’est pas possible, l’Union avancera hors-traités, comme elle l’a déjà fait et ces transgressions se multiplieront sous l’empire de la nécessité.
La première obligation des dirigeants européens est de sortir d’un cadre purement diplomatique pour faire ensemble de la politique. Ils en sont capables quand l’urgence l’exige et que leurs intérêts le réclament.
La seconde est de ne pas tenter à tout prix d’avancer à 27. Quelques États membres suffisent pour développer des coopérations novatrices. Si elles s’inscrivent dans des objectifs européens et restent ouvertes aux autres, celles-ci constituent alors le meilleur moyen de progresser. La méthode communautaire, qui doit être conservée pour les politiques communes déjà engagées, ne peut pas toujours fonctionner pour des actions entrainant de vrais transferts de souveraineté dans des domaines relevant jusqu’ici exclusivement des États. « L’intégration par l’exemple », ouverte aux autres, risque d’être le seul véritable moyen de poursuivre la mutualisation nécessaire de nos moyens.
Pour cela, il faut se concentrer sur des objectifs précis avant que de penser aux moyens à mettre en œuvre. Une Union au sein de laquelle les chefs d’État et de gouvernement prennent toutes leurs responsabilités politiques et ne laissent pas à leurs diplomates le soin de trouver des compromis, est en mesure de s’élever au niveau des enjeux. Ceux-ci doivent être définis à quelques-uns comme des buts collectifs à atteindre.
Qu’on le veuille ou non, les Européens progressent dans cette direction plus vite qu’on ne le croit. Au regard des évolutions récentes, on peut affirmer que si « le verre de l’Europe » peut être jugé à moitié plein, à moitié vide, il se remplit. Peut-être trop lentement, mais sûrement et sans retour.
Il est temps d’écrire une nouvelle histoire d’Europe, en étant fiers du chemin accompli et lucides sur ses difficultés récentes. À chaque période de l’histoire correspond une Europe différente. Les Européens peuvent dessiner celle du XXIe siècle. Ils semblent avoir commencé ce travail.
1
Les questions politiques
La gouvernance de l’Union européenne
Alain LAMASSOURE
La gouvernance : l’histoire ancienne nous parle encore
Cent cinquante ans avant Jésus-Christ, l’historien grec Polybe est fasciné par la manière dont Rome vient de conquérir l’ensemble du monde méditerranéen en moins d’un demi-siècle. L’exploit est d’autant plus inouï qu’à la différence des empires vaincus, Rome est une étrange république, mue par une machinerie compliquée, incarnée, non par un homme-dieu mais par un sigle : SPQR1 – « le Sénat et le Peuple romains ». La République romaine lui paraît combiner heureusement les avantages des trois régimes déjà identifiés par les philosophes : la monarchie, pouvoir d’un seul ; l’oligarchie, pouvoir de plusieurs ; la démocratie ou pouvoir de tous. Le turbulent peuple de Rome est représenté par un magistrat incontournable, le tribun de la « plèbe » ; le tout-puissant Sénat ne réunit pas seulement une aristocratie ploutocratique, sa composition est aussi le fruit d’une remarquable sélection des élites, l’aboutissement du cursus honorum ; et si l’on recourt parfois à la désignation d’un dictateur-général en chef, c’est pour une durée limitée, quand l’exigent la gravité des temps ou l’urgence des ambitions.
Au fond, vingt-deux siècles plus tard, sous des formes évidemment très différentes, les démocraties complexes ont besoin du même trépied : le chef, les élites, le peuple. Désormais, la légitimité est montante : c’est la vox populi qui a l’autorité de la parole divine. Mais le pouvoir s’incarne finalement dans une seule personne, et la complexité des sociétés exige la formation, la sélection et le bon emploi d’élites très variées, à la fois miroirs de la société (élus, syndicats), vigies (enseignants, chercheurs, autorités spirituelles) et officiers de pont ou de machine (administrateurs, managers). Les systèmes qui réussissent sont ceux qui combinent les avantages du soutien du sentiment populaire, de la gestion par les meilleurs spécialistes et du pilotage par un seul. Cette personne seule est l’incarnation, non d’un pouvoir suprême, mais du pouvoir ultime : le dernier dans la chaîne de commandement, responsable de la « patate chaude » devant les citoyens, dans la limite des contrepoids et règles déontologiques de l’État de droit.
Et l’Union européenne ? Jugée à ce critère tripode, elle présente une situation originale. Paradoxalement, c’est le niveau intermédiaire, « l’oligarchie », l’élite, qui fonctionne le mieux – tout ce qui est généralement vilipendé sous l’image de la bureaucratie européenne : les institutions proprement communautaires, la Commission, le Parlement, la Cour de Justice, la Banque centrale, les agences, etc. L’ensemble constitue un moteur abominablement (inutilement ?) complexe, mais il tourne. Anu Bradford, professeur à l’Université de Columbia2, peu suspecte de préjugé pro-européen, décrit son étonnante performance sous le nom de « l’effet Bruxelles. » En revanche, le niveau supérieur et la base populaire sont particulièrement mal en point.
Base populaire ? Quarante ans après la première élection du Parlement européen au suffrage universel, reconnaissons que, dans les esprits et dans les cœurs, l’Union ne bénéficie pas d’une vraie légitimité démocratique directe. Au mieux, elle est vue comme un despotisme éclairé de technocrates, encadrés par des dirigeants nationaux, certes démocratiquement élus, mais chacun pour gouverner son seul pays. Au pire, pour les Brexiters, elle est illégitime par essence.
Niveau supérieur ? Au fait, qui s’intéresse à la fonction de « Monsieur ou Madame Europe » ? Le président du Conseil européen est élu par les dieux nationaux de l’Olympe continental, mais il n’a ni pouvoir, ni moyens propres. Il reste inconnu du grand public. La présidente de la Commission a été désignée après les élections européennes, mais sans avoir participé à la campagne électorale et contre les candidats des partis vainqueurs de ces élections. Elle devra donc son autorité politique à ses seules qualités personnelles. Après tout, Jacques Delors y était bien parvenu, dira-t-on. Certes, mais personne n’a imaginé que c’était à lui de négocier la réunification allemande et la fin de la guerre froide, qui étaient les événements planétaires du moment. Or, trente ans après, c’est désormais d’un leader parlant au nom de toute l’Europe dont on a besoin pour parler commerce, migrations, terrorisme, prolifération nucléaire, climat, pandémies, partenariat euro-africain avec Washington, Pékin, Moscou, Téhéran ou Addis-Abeba.
Comment remédier à ces faiblesses paralysantes ?
La conférence sur l’avenir de l’Europe : une occasion à saisir
Pour faire progresser l’Europe, on connaît deux approches classiques. La première, l’élaboration d’un nouveau traité, est bloquée pour longtemps : la naissance du traité de Lisbonne a montré que la durée de gestation du dinosaure européen est plus proche de neuf ans que de neuf mois, compte tenu notamment de l’exigence de l’unanimité des ratifications. La seconde consiste à mettre à profit la campagne de l’élection du Parlement européen pour faire valider des choix forts par les électeurs : c’est ainsi que, cahin-caha, les démocraties se réforment. Hélas, neuf élections au suffrage universel n’ont pas encore suffi pour que les partis politiques se servent de la campagne européenne pour parler d’Europe au lieu de se contenter d’en découdre à nouveau au niveau national, chacun chez soi.