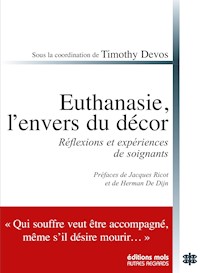
Huit soignants belges – professeurs d’université, médecins, infirmiers et éthiciens reconnus et expérimentés en accompagnement palliatif – tentent ensemble de dire leurs questions autour de la fin de vie, des soins palliatifs et de la pratique de l'euthanasie. Deux femmes médecins, française et israélienne, se sont jointes à eux. Les regards croisés de ces praticiens de la santé font la richesse et l’originalité de cet ouvrage.
Les auteurs partagent ici leur vécu et leurs réflexions face aux demandes d’euthanasie et d'accompagnement en fin de vie auxquelles ils ont été confrontés, dans un pays, la Belgique, où l’euthanasie, dépénalisée depuis 2002, est aujourd'hui souvent devenue un acte usuel, pour ne pas dire banal.
Ces récits évoquent l’envers du décor, l’autre face d’une réalité qu’il est grand temps de prendre en compte ou d'évaluer avec plus de rigueur.
Le livre s’adresse tant au milieu médical qu’à toute personne s’interrogeant sur le sens de la mort et de la souffrance, ainsi que sur la réalité de l’application d’une loi qui, votée en 2002, suscite toujours plus de questions.
Ce livre rend la parole aux soignants de terrain afin qu’ils partagent ce qu’ils ont vécu, des histoires concrètes. Ils permettent au lecteur de prendre conscience de la complexité des situations et des conséquences concrètes de la loi sur l'euthanasie.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Le Prof.
Timothy Devos est médecin interniste-hématologue aux Hôpitaux universitaires de Louvain (UZ Leuven) et professeur à la Faculté de médecine de l’Université de Louvain (KU Leuven).
Sous sa coordination, l'ouvrage collectif
Euthanasie, l'envers du décor a été réalisé.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EUTHANASIE, L’ENVERS DU DÉCOR
Sous la coordination du
Professeur Timothy Devos
EUTHANASIE,L’ENVERS DU DÉCOR
Réflexions et expériences de soignants
Pr Timothy Devos (hématologue), Jacques Ricot (philosophe),
Herman De Dijn (philosophe), Eric Vermeer (infirmier éthicien en soins palliatifs), Dr Catherine Dopchie (oncologue), Pr Willem Lemmens (philosophe et éthicien), Dr An Haekens (psychiatre), Dr Rivka Karplus (maladies infectieuses et hiv/sida), Dr Marie Frings (médecin en soins palliatifs), Pr Benoit Beuselinck (oncologue), Dr Julie Blanchard (médecin en soins palliatifs),
François Trufin (infirmier urgentiste en soins palliatifs)
Préfaces de Jacques ricot et de Herman De Dijn
éditions mols
collection autres regards
© éditions Mols, 2019
www.editions-mols.eu
La loi obéira à sa propre nature et non à la volonté des législateurs, et elle portera inévitablement les fruits que nous avons semés en elle.
G.K. Chesterton
Préface
Jacques Ricot1
Le mérite des auteurs de Euthanasie, l’envers du décor est de montrer avec efficacité que, quinze ans après le vote de la loi belge et au milieu d’un consensus assez général dans la classe médiatique et dans l’opinion publique, les idées reçues doivent continuer à être interrogées. Le choix de donner la parole à des acteurs de terrain qui expriment leurs perplexités en expliquant ce qu’ils vivent, permet de donner chair et consistance à leurs arguments. Au lieu de répéter le faux conflit entre les partisans d’une éthique de l’autonomie et les tenants d’une éthique de la vulnérabilité, ou encore celui de l’opposition caricaturale entre les « compatissants » devant la souffrance d’autrui et les « rigides » défenseurs de l’interdit de tuer, les auteurs présentent modestement leurs témoignages avant d’affirmer leurs convictions. Ce sont donc d’abord des faits, des expériences vécues qu’ils exposent, et dont ils déduisent leurs réflexions. Ce ne sont donc pas des a priori idéologiques qui guident leur démarche livrée sans pathos, ni arrogance. Ceux qui pratiquent l’euthanasie ne sont pas stigmatisés. On reconnaît même parfois leur délicatesse quand, par exemple une collègue, qui fait valoir son refus de s’associer à un acte euthanasique, se sent respectée dans son choix : l’équipe veillera à ce qu’elle ne soit pas présente au moment de l’injection létale. Mais s’ils ne sont pas stigmatisés, ils devraient se sentir interpellés par ces témoignages livrés courageusement à contre-courant et qui obéissent à la voix intérieure que dicte leur conscience.
Sans doute, ceux qui procèdent à des euthanasies mobilisent eux aussi leur conscience pour justifier leurs pratiques et il n’y a pas lieu de douter de leur sincérité. Pas plus qu’on ne saurait soupçonner la droiture de ceux qui utilisent leur droit à l’objection de conscience quand ils refusent de faire mourir leurs patients : on ne saurait les accuser d’obéir à des préceptes moraux ou religieux d’un autre temps quand ils prennent au sérieux le serment d’Hippocrate. Pourtant, cette objection de conscience subit des pressions diverses. Ainsi, l’un des auteurs écrit : « Le message actuel des sociétés libérales est de discréditer l’objection de conscience au nom de la tolérance. En d’autres termes, si un soignant est soi-disant tolérant, il est obligé d’exécuter tout ce qu’on lui demande, sans aucune réflexion de fond. La tolérance ne risque-t-elle pas de devenir tyrannique, dès lors qu’elle empêche un soignant de travailler avec sa conscience, en rendant illégitime toute réflexion personnelle sur le sens du bien et du bon ? » Et plus loin, on apprend que, lors d’une inspection d’hôpital, les inspecteurs communautaires ont sommé l’hôpital, qui interdisait dans son règlement intérieur les euthanasies, de se mettre à jour et d’établir une procédure d’euthanasie. L’objection de conscience, réduite à une dimension purement individuelle, se trouve alors singulièrement fragilisée, comme s’il s’agissait d’une simple tolérance à une déficience personnelle, une incapacité désolante à se soumettre à la loi commune. La question de la conscience est souvent réduite à un pur sentiment subjectif, à une opinion singulière, voire à « un sens du devoir dévoyé ». Et l’on oublie facilement que le recours à la conscience n’est légitime que si cette conscience est réellement « éclairée ». Or il faut convenir que les auteurs des témoignages ici présentés savent offrir les multiples éclairages trop souvent négligés dans la pratique de l’euthanasie. Pourquoi celle-ci est-elle qualifiée de manière inexacte de « mort naturelle » ? Pourquoi l’identité du médecin euthanasieur est-elle cachée « alors que, pour tout acte médical important, elle est toujours précisée »?
On connaît l’argument principal des promoteurs de l’euthanasie : il conviendrait de supprimer la souffrance d’un patient quand celle-ci est inapaisable et que la demande de mourir est avérée. Lui refuser ce soulagement, ce serait manquer de compassion et entraver sa liberté. Or ce raisonnement, produit souvent avec véhémence, mais aussi de bonne foi, recèle un défaut majeur, celui de nier la complexité des enjeux derrière une telle approche. D’une part, la souffrance dite inapaisable a des visages tellement multiformes qu’on ne la définit pas toujours avec une précision suffisante et, de plus, on dispose aujourd’hui d’une panoplie complète pour la soulager, y compris en recourant à la sédation palliative. D’autre part, la liberté de quiconque affirme qu’il ne voit pas d’autre issue que la mort à la situation qui lui est faite est-elle vraiment une liberté? Ces deux questions méritent examen.
Qu’est-ce que la compassion? Héritière de la pitié, elle peut conduire à des attitudes délétères lorsque, submergée par l’émotion, elle ne se laisse pas purifier par la correction d’une conscience éclairée. « Cela signifie que le soignant ne s’identifiera pas totalement à la souffrance de l’autre et qu’il ne sera pas supposé devoir agir du point de vue de son patient, mais qu’il pourra regarder véritablement la situation de l’autre. » En parlant de « pitié trompeuse et par là dangereuse », l’auteur de cette remarque retrouve la mise en garde formulée par Stefan Zweig dans son beau roman intitulé La pitié dangereuse ou encore celle qu’énonce Antoine de Saint-Exupéry : « Car j’ai trop souvent vu la pitié s’égarer. » Comme le dit un autre contributeur, « compassion signifie accompagner l’autre dans son épreuve ».
L’authentique compassion ne consiste certes pas à faire taire ses émotions et il arrive que celles-ci parlent quand la raison se tait. « C’est ce que vit ce médecin expérimenté, qui m’a dit, un jour, qu’au sein de son institution de soins il a déjà pratiqué de nombreuses euthanasies. Les yeux embués de larmes, il me confie que certaines nuits il se réveille en sueur avec devant lui le visage de personnes qu’il a euthanasiées. »
Ce que masque une conception tronquée de l’autodétermination du patient, c’est qu’il n’est de liberté que relationnelle dans le cadre du lien qui unit le patient à son médecin. Une liberté qui a besoin de l’autre pour se manifester n’a pas du tout le même statut qu’une liberté purement individuelle, comme celle de celui qui choisit de se suicider à l’écart de la vie sociale, face à lui seul. Quand le patient « embarque » le corps soignant dans un pacte mortifère, il transforme « l’alliance thérapeutique » en « un engagement contractuel ». On est alors fondé à parler de « fusion perverse ». « Il ne s’agit pas d’une autonomie responsable et libre mais de l’acte désespéré de deux personnes piégées par l’impuissance. » De façon étonnante, alors que l’on pense généralement que l’autonomie est une conquête du patient, on s’aperçoit à la lumière des témoignages « qu’avec la normalisation de l’euthanasie une nouvelle forme de paternalisme a réellement fait son entrée dans le monde médical belge. Car, finalement, c’est bien le médecin qui décide si oui ou non la demande d’euthanasie sera acceptée. »
L’intérêt de tous ces témoignages est de montrer que ce qu’on appelle parfois les dérives actuelles (les cas psychiatriques, les souffrances existentielles, les mineurs autorisés à demander l’euthanasie, l’idée de campagnes pour des directives anticipées choisissant l’euthanasie, etc.) sont la conséquence directe d’une loi qui a rompu une digue. Et, lorsqu’une brèche s’ouvre dans une digue, le flot ne peut qu’agrandir le trou qu’on avait cru naïvement circonscrire au départ.
Je pense à l’avertissement de l’ancien Garde des sceaux français de François Mitterrand, Robert Badinter, artisan de l’abolition de la peine de mort en 1981, contre l’opinion publique de l’époque. Dépassant les clivages politiques, lui, l’homme de gauche s’est déclaré en plein accord avec Jean leonetti, homme de la droite modérée et cheville ouvrière de la loi française de 2005. Robert Badinter a déclaré que la loi n’avait pas qu’une valeur répressive, mais surtout une valeur expressive qui traduit les valeurs éthiques d’une société. Et, parmi celles-ci, l’une commande toutes les autres et interdit que l’on fasse mourir délibérément autrui, serait-ce par une apparente compassion. J’ajouterai qu’interdire n’est pas empêcher, mais indique un repère anthropologiquement structurant. Car la transgression de la loi n’est pas sa négation, mais lorsque la transgression est inscrite dans la loi au prétexte de l’encadrer, elle n’est plus une transgression et c’est ce que j’ai appris aussi bien d’Aristote que de Paul Ricœur. La transgression relève de l’instance judiciaire, non de l’instance juridique.
Les témoignages livrés ici sont progressistes et prophétiques : ils sont ceux de résistants et de veilleurs qui ne considèrent pas que l’euthanasie puisse être un soin, une option neutre. Comme je l’ai dit souvent, l’euthanasie ne complète pas les soins palliatifs, elle les interrompt, elle ne couronne pas l’accompagnement, elle le stoppe, elle ne soulage pas le patient, elle l’élimine.
Préface
Herman De Dijn1
L’euthanasiasme [sic] est une atmosphère dans laquelle le tragique, inhérent à chaque vie humaine, se voit toujours plus nié.
Willem Jan Otten2
En tant qu’elle consiste à provoquer la mort d’un tiers, l’euthanasie relève du droit pénal, mais, depuis la loi belge du 28 mai 2002, elle n’est plus punissable moyennant le respect de conditions strictes déterminées par ladite loi. Entretemps, la pratique est tout-à-fait entrée dans les mœurs et l’euthanasie est perçue – notamment par la profession médicale – comme une composante normale des soins de fin de vie. Le grand public, quant à lui, ne la voit plus comme un acte qui ne serait permis que dans certaines circonstances exceptionnelles et bien définies, mais comme un droit qu’exerce le patient et que les soignants sont priés de satisfaire, à sa demande. Certains dirigeants politiques parlent même de l’inscrire, à titre de droit de l’homme, dans la Constitution. Comment en est-on arrivé là ? Les critères de la loi ont été progressivement élargis pour en faire « profiter » toujours plus de nouvelles catégories de patients. Les médecins, qui à l’origine n’étaient pas du tout demandeurs, se retrouvent aujourd’hui exécuteurs dociles de la loi. Quant aux soignants qui font appel à la clause de conscience, ils sont souvent perçus comme des « perturbateurs de l’esprit d’équipe ». L’analyse approfondie des pratiques, dans ce domaine pourtant d’une importance extraordinaire, ne semble intéresser personne. La commission officielle de contrôle et d’évaluation se trouve en grande partie entre les mains de fervents partisans qui prônent l’élargissement perpétuel de la loi. L’euthanasie est complètement « normalisée » de telle sorte qu’une réduction du champ d’application de la loi dans le futur semble n’être qu’un vœu pieux.
Cependant le présent livre s’oppose courageusement à cette normalisation. il donne la parole à des résistants directement concernés par l’enjeu colossal que représente l’expérience éthique et sociale qui se joue dans la société belge autour de l’euthanasie. ils posent des questions critiques et proposent des alternatives. ils veulent prévenir les abus et percer les illusions et les idées simplistes. Ces résistants ne sont pas des idéologues naïfs, mais des spécialistes – médecins, psychiatres, infirmiers – actifs dans le domaine des soins de fin de vie. Ils sont directement impliqués dans la pratique au quotidien, et confrontés aux demandes d’euthanasie de leurs patients. Ils savent réellement de quoi il s’agit. Leurs exposés contiennent souvent des exemples réels qu’ils ont vécus, des histoires qui permettent à tous de prendre conscience de la complexité des situations. C’est donc un ouvrage particulièrement important que tous ceux qui sont confrontés à la pratique de l’euthanasie en Belgique, partisans ou opposants, devraient lire et soumettre à une profonde réflexion. Espérons qu’il soit lu également par la classe politique qui doit faire face à de continuelles demandes d’élargissement de la loi.
Je tenterai ici de présenter brièvement les principales constatations et perspectives exprimées dans cet ouvrage, espérant ainsi encourager le lecteur à prendre lui-même connaissance de ces contributions. Si chacun réalise que la loi va se maintenir, dans l’état actuel des choses, tout le monde ne sait pas que d’autres formes de soins de fin de vie – comme les soins palliatifs, la sédation palliative, ou les soins de convalescence – ont une finalité propre et peuvent offrir une réelle alternative à l’euthanasie. À condition que soit créé un contexte où les patients se voient reconnaître le temps nécessaire pour mourir. Ce qui est en jeu, dans la pratique de l’euthanasie, ne concerne pas seulement la prise en charge de la fin de vie, mais également le sens que prend le soin médical et le rôle du soignant concerné. Cette thématique est abordée de différentes manières, au travers d’intéressantes perspectives. Ce que montre la pratique de l’euthanasie, c’est que le médecin est de plus en plus perçu, à la fois, comme un technicien qui répond aux désirs de son client (par exemple en assistant les patients psychiatriques dans leur suicide), mais aussi comme un fonctionnaire au service de la loi. Cette profession, qui devrait en réalité être animée d’une vocation éthique, se trouve instrumentalisée et fonctionnalisée. Apparemment, de nombreux soignants ne sont tout de même pas prêts à adopter les yeux fermés cette nouvelle conception de leur rôle. La médecine, particulièrement dans le domaine des soins de fin de vie, est ballottée entre l’acharnement thérapeutique et la négligence de fait à l’égard de son semblable. Ce trait transparaît très concrètement dans le chapitre sur l’alimentation artificielle en fin de vie. Dans cet exposé, et dans d’autres également, on promeut une éthique qui ne se réduit pas aux principes et aux protocoles.
Une éthique qui ne relève pas du « bon sens », une éthique qui n’est pas une « pratique humanisante », n’est pas une éthique. Ce n’est pas ce que j’appelle une « éthique du sens commun », mais c’est une sorte de réglementation purement pragmatique entre parties déterminées. Les médecins et les infirmiers contredisent leur profession et leur vocation lorsqu’ils expédient une euthanasie comme si elle était une intervention technique faite à la demande du patient. Qu’elle soit pratiquée soi-disant par compassion, par respect de la qualité de vie ou pour éliminer des situations humainement dégradantes, n’enlève pas cette contradiction.
La communication entre le médecin et son patient est d’une importance primordiale, particulièrement dans le contexte des soins de fin de vie. Cette communication ne peut pas se contenter d’être purement procédurale et informative. En réalité, la communication humaine est une conversation, un dialogue au sein duquel est recherché – par-delà la surface des mots – le besoin le plus profond de la personne, qui bien souvent n’est pas vraiment exprimé. Interpréter littéralement le « je veux mourir » d’un patient, surtout psychiatrique, est une incompréhension simpliste qui rend impossible pour cette personne l’ouverture, pourtant essentielle, sur une perspective d’espoir. La vraie communication exige de la confiance et du temps ; et c’est pour elle justement qu’on n’a plus guère de temps, tant du côté du médecin que de celui de la famille. D’où l’impossibilité de vivre ce qui représentait autrefois une part fondamentale de la fin de vie : la possibilité de se confronter, en présence de ses proches, au sens de sa propre vie et au mystère de sa propre mort. Cette possibilité est, en revanche, bien offerte – cela est souligné dans ce livre – dans le contexte des soins palliatifs qui poursuivent leur finalité propre, sans se laisser définir comme une étape vers l’euthanasie.
De nombreuses contributions expriment la conscience d’avoir assisté à un réel changement culturel, dont l’euthanasie est à la fois un symptôme et un renforcement. Ce bouleversement culturel apporte avec lui une vision radicalement différente de la vie et de la mort, du sens et de la souffrance. La vie se voit évaluée en termes de qualité mesurable qui indiquerait, lorsqu’elle descend sous un certain seuil, qu’il vaudrait mieux y mettre fin. La dignité humaine n’est plus une caractéristique inaliénable de chaque sujet humain, indépendamment de sa qualité de vie ou des capacités qui lui restent. C’est au contraire désormais la qualité qui détermine la dignité. Cette évolution implique qu’il y a un nombre toujours croissant de catégories de personnes dont la vie n’apparaît plus digne de protection. Le droit de quelques-uns à mourir se trouve déjà associé par certains éthiciens à l’obligation pour tous de mettre, à temps, un terme à leur vie afin de n’être plus un poids pour leur famille et pour la société. Et l’on peut continuer sur cette lancée : les vertus éthiques que sont la tolérance, la compassion ou le respect sont aujourd’hui dévoyées. Et on ne perçoit même plus l’appauvrissement moral, voire la corruption, liés à ces développements.
Un changement culturel aussi radical ne s’inverse pas sans heurt. Il ressort cependant de ce livre une volonté de ne pas s’y conformer, mais de maintenir brûlante, par une résistance personnelle, la flamme de la vraie vocation des soignants.
L’année dernière est parue la première étude internationale et interdisciplinaire sur le sujet, intitulée Euthanasia and Assisted Suicide. Lessons from Belgium3 de D. A. Jones, C. Gastmans et C. MacKellar. Il est remarquable de constater à quel point les conclusions des trois auteurs, basées tant sur leur expertise propre que sur l’information et les analyses présentées dans leur livre, s’accordent avec bon nombre des perspectives exposées dans le présent ouvrage. La recommandation qu’ils adressent aux pays confrontés à des projets de loi allant dans le sens de la loi belge, est claire : « Don’t go down that lane » (Évitez ce chemin). Entretemps, cette loi est devenue une réalité pratiquement irréversible en Belgique, avec toutes les conséquences que cela entraîne. Mais il ressort de ce livre Euthanasie : l’envers du décor qu’une troisième voie existe entre la résignation et la fuite. Ni se soumettre aux diktats, ni se détourner de la société dans laquelle nous vivons, mais résister, chacun à sa manière, chacun à sa place. Comme disait luther : « Je me tiens ici, et je ne peux pas faire autrement. »
Je connais bien une généraliste, qui a épousé, toute jeune, la cause de l’euthanasie, dès les années 1980, distribuant déjà à l’époque des cartes à porter sur soi, pour déclarer qu’on voulait être euthanasié. Elle a cependant attendu que la loi soit adoptée pour commencer à la pratiquer. Ensuite, elle était malade trois jours durant, après chacune d’elle. Pour sortir de cette contradiction douloureuse, elle est allée voir des psychologues qui l’ont persuadée que la solitude était la cause de sa souffrance, car l’euthanasie n’est pas du tout répandue dans sa région. Au lieu de s’interroger sur cette poignante réaction de la vie en elle, elle n’a de cesse de persuader les médecins de pratiquer l’euthanasie…
Hugo R. (proche)
Le syndrome de la pente glissante
Eric Vermeer1
J’ai professé, en tant qu’infirmier, pendant plus de 20 ans en service d’oncologie, puis de soins palliatifs. Enseignant et psychothérapeute depuis 10 ans, j’ai la chance de continuer de travailler avec des étudiants infirmiers dans des services de soins palliatifs et de psychiatrie, ainsi que de superviser des équipes de soins. Éthicien de formation, je fais partie d’un comité d’éthique dans un hôpital neuropsychiatrique. Ces différentes casquettes me donnent le grand privilège de rencontrer à la fois des patients en fin de vie ou souffrant de troubles psychiques, des soignants et des étudiants confrontés à des situations difficiles, et de relire, en comité d’éthique, des situations cliniques de grande souffrance.
La question de l’euthanasie est très régulièrement évoquée et suscite de nombreux débats, aussi passionnels que passionnants.
La dépénalisation de l’euthanasie
Depuis 2002, la loi belge a permis la dépénalisation de l’euthanasie sous certaines conditions. Cette loi avait pour objectif notamment de combattre les euthanasies clandestines, mais force est de constater qu’il n’en est rien. Selon une étude approfondie du British Medical Journal2, on peut estimer raisonnablement que la moitié des euthanasies sont encore pratiquées sans déclaration. Ce qui n’est guère étonnant pour ceux qui savent combien la mort de quelqu’un est toujours accompagnée d’émotions fortes et de décisions souvent prises à chaud.
Il y a cinq ans, un médecin a été jusqu’à dire, au Sénat, que cela faisait longtemps qu’il ne déclarait plus les euthanasies et qu’il n’appelait pas un deuxième confrère pour valider la demande d’euthanasie, comme cela est pourtant stipulé par la loi…3
Le sujet n’a cessé d’être alimenté par les médias qui, à coups de pathos, nous imposent l’idée que, pour mourir dignement, il faut se faire euthanasier.
Ce débat s’inscrit dans un pays marqué, comme les autres pays d’Europe, par l’augmentation des maladies graves, incurables, dont la durée est bien plus longue qu’autrefois. Ainsi, chaque année, en Belgique, plus de 40 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués, avec un pronostic de vraie guérison (rémission à plus de cinq ans) d’environ 60 %, mais, malgré les progrès de la médecine, plus de 15 000 Belges meurent d’un cancer tous les ans. À cela s’ajoute la flambée des autres maladies dites multifactorielles (maladie d’Alzheimer, maladies cardio-vasculaires, accidents vasculaires cérébraux, maladies neuromusculaires, comme la sclérose latérale amyotrophique, et la schizophrénie) ; autant de pathologies lourdes qui engendrent beaucoup de souffrances physiques et psychiques.
Ouvrir le débat sur la fin de vie était donc nécessaire. Encore fallait-il l’ouvrir loyalement, c’est-à-dire en impliquant tous les intervenants des soins de santé, et sans aucune orientation au départ. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé. En 2002, la Belgique a dépénalisé l’euthanasie et, en même temps, a valorisé les soins palliatifs4, comme pour signifier qu’il s’agissait d’une seule et même réalité. Or, s’il y a bien un message à faire passer en premier lieu, c’est de différencier clairement le processus de mort programmée qu’est l’euthanasie, de celui des soins palliatifs. Ceux-ci visent, on le sait, à développer une prise en charge particulière des symptômes physiques, et psychologiques, ainsi que familiaux et spirituels.
La définition, tant en Europe qu’au Canada, est pourtant claire et sans ambiguïté : « Les soins palliatifs ne hâtent ni ne postposent la mort. » De là découle que toute forme d’acharnement thérapeutique qui postpose la mort et tout acte euthanasique qui hâte la mort, sont étrangers à la philosophie des soins palliatifs.
La méconnaissance des soins palliatifs
Dès 2002, les Pays-Bas ont commencé à proposer, aux médecins belges de Flandre, des modules de formation sur l’euthanasie qui ont rencontré un franc succès, au détriment de diverses formations en soins palliatifs, en algologie et en antalgie5. C’est ainsi que beaucoup de médecins, par manque de formation en soins palliatifs, en arrivent rapidement à la conclusion que l’euthanasie est la seule solution, lorsque des situations de douleurs physiques ou psychiques semblent réfractaires aux traitements traditionnels.
Les soignants s’accordent à dire qu’aujourd’hui environ 95 % de toutes les douleurs peuvent être soulagées, alors que 60 à 65 % de patients meurent encore dans un contexte douloureux.
Une remise en question s’impose donc dans le cadre de la formation continue des médecins. Ne serait-il pas plus pertinent d’investir dans des formations sur le traitement de la douleur, plutôt que sur la manière d’euthanasier un patient douloureux ?
La première interrogation est : que nous demande vraiment le patient ? Désire-t-il réellement que l’on mette fin à ses jours ou souhaite-t-il être soulagé et accompagné ?
Envisager l’euthanasie comme étant le seul moyen de soulager une douleur réfractaire n’est pas forcément la réponse que les malades attendent. J’ai souvent eu l’occasion de poser cette question à des patients en demande d’euthanasie : « Désirez-vous mourir ou souhaitez-vous ne plus souffrir ? » Dans la plupart des cas, les patients demandent une meilleure qualité de vie plutôt qu’un « arrêt de vie ».
Évidemment, nul ne remet en question la pleine mesure de la souffrance d’un patient ni la manière dont il la traverse… Je ne remets même pas en question sa demande d’euthanasie, dès lors qu’il n’est pas soulagé. Par contre, je réagis face à la manière dont le médecin reçoit cette demande… J’entends souvent dire, de la part de médecins favorables à l’euthanasie, que celle-ci signe, de toute évidence, un constat d’échec médical. C’est parce que le médecin se sent impuissant (ou incompétent ?), devant la douleur ou la souffrance d’un patient, que l’euthanasie se présente comme la seule réponse à donner.
Cela étant, il est tout aussi évident qu’il reste des situations extrêmement difficiles ; une faible minorité de patients (environ 5 %) peuvent mettre l’équipe médicale dans l’impuissance, tant les douleurs sont complexes et multifactorielles. Nous avons alors la possibilité d’avoir recours à la sédation, dans ses nombreuses gradations.
De la même manière que la volonté d’établir la confusion entre soins palliatifs et euthanasie est réelle, il y a aussi une tentative d’amalgamer euthanasie et sédation, alors que ce sont deux réalités totalement différentes, à plusieurs niveaux.
Tout d’abord, alors que l’euthanasie ne devrait jamais être proposée au patient, la sédation, elle, est une possibilité à présenter au malade, lorsque celui-ci est dans une souffrance insupportable et difficilement gérable.
L’intention de l’euthanasie est de provoquer la mort, alors que l’intention de la sédation est de soulager un ou plusieurs symptômes.
Le processus de l’euthanasie est de garantir la mort par l’injection d’un produit létal, alors que le processus de la sédation est d’administrer des substances médicamenteuses qui doivent s’ajuster aux besoins du patient par une évaluation régulière et rigoureuse de ce processus.
Le résultat de l’euthanasie est la mort alors que celui de la sédation est une meilleure qualité de vie.
Ceux qui affirment que la sédation est une euthanasie travestie commettent une grossière erreur.
Mais revenons à ce manque de formation médicale et laissons la parole aux patients ; ce sont eux finalement qui détiennent la vérité.
Philippe souffre d’un myélome6depuis 3 ans et arrive aux urgences avec des douleurs intolérables dans le dos. Sa réaction semble sans appel : « J’ai vraiment trop mal… Je veux qu’on m’euthanasie… Même un chien, on ne le laisserait pas vivre comme ça… Au nom de ma dignité, je demande l’euthanasie… » L’anesthésiste de garde arrive rapidement et injecte, en péridurale, un produit antalgique qui se révèle souverain en quelques minutes. Une heure plus tard, je revois Philippe dans sa chambre et, après m’avoir raconté son histoire, il conclut : « Heureusement qu’on ne m’a pas écouté… mais, tu sais, quand on a mal, on est capable de tout demander… » Philippe a encore vécu trois ans, avec ses deux fils adolescents, et il me disait combien ce temps avait été nécessaire pour le processus de deuil de ses enfants…
La compétence de l’anesthésiste a neutralisé la demande d’euthanasie de Philippe. C’est ainsi qu’un médecin, peu ou pas formé à l’utilisation des nouvelles molécules antalgiques, peut commettre l’irréparable.
La banalisation de l’euthanasie
Les exemples vécus nous obligent à regarder la réalité, telle qu’elle est.
Madame B. souffre d’un cancer du foie avec métastases osseuses et pulmonaires. Elle se plaint régulièrement à l’assistant de sa situation conjugale difficile, à savoir un mari alcoolique et violent. Elle souffre également de ne plus voir ses deux filles de 25 et 27 ans, qui ne viennent jamais lui rendre visite. Après plusieurs rencontres durant lesquelles l’assistant semble désemparé devant la grande souffrance de cette patiente, il se permet, un jour, de l’interpeller en ces termes : « Compte tenu de votre cancer au stade terminal et de votre situation familiale, ne pensezvous pas que l’euthanasie pourrait se présenter à vous comme la moins mauvaise des solutions ? » La patiente s’est effondrée en larmes et le médecin a pris conscience de sa maladresse…
Mademoiselle V. arrive aux urgences psychiatriques pour une troisième tentative de suicide. Elle souffre de dépression chronique depuis deux ans, suite à un échec conjugal. L’infirmière lui demande : « Savez-vous que vous pouvez demander l’euthanasie ? » La patiente semble surprise et demande des informations. En attendant que la patiente soit transférée dans un service de psychiatrie, l’infirmière lui donne les coordonnées de l’ADMD7…
Monsieur B. est atteint d’un cancer du pancréas et il n’y a plus d’espoir de guérison. À plusieurs reprises, le médecin lui propose l’euthanasie, de manière douce mais insistante. Monsieur B. est fatigué et demande à sa famille d’être présente, 24 heures sur 24, car il n’a plus la force d’entrer dans ce genre de débat avec le médecin…
Madame V. est en maison de repos et de soins depuis quelques années et vient de faire un AVC8. Elle reste bien consciente, mais a perdu l’usage de la parole. Or on sait que, dans ces situations, une amélioration est souvent possible, surtout à deux ou trois jours de l’accident vasculaire. En réunion d’équipe, l’aidesoignante qui s’occupe d’elle, pose, tout naturellement, la question à l’ensemble du personnel : « Est-ce que nous ne pouvons pas proposer l’euthanasie à cette dame ? Elle est quand même fortement diminuée depuis son AVC… » La majorité de l’équipe a fortement réagi, mais cet exemple montre combien le sujet est abordé avec une légèreté glaçante et, surtout, en dehors des conditions de la dépénalisation légale.
Il ne s’agit pas de cas uniques et exceptionnels. C’est une réalité que beaucoup ne veulent pas voir. Les étudiants, qui me rapportent leur vécu de stage, en ont parfois les ailes brisées :
« Est-ce normal que le médecin propose l’euthanasie ? »
« Si c’est pour proposer l’euthanasie à une patiente dépressive et suicidaire, je change tout de suite de métier… »
Je suis, bien sûr, obligé de leur répondre que les médecins et les infirmières qui proposent l’euthanasie sont dans une totale illégalité. Sous couvert de compassion, l’euthanasie devient de plus en plus, pour certains soignants, un moyen, souvent inconscient, de se soustraire à la souffrance et à la détresse du malade.
Le sens du devoir dévoyé
Je ne souhaite pas mettre les médecins sur le banc des accusés, loin s’en faut. J’entends des médecins, en réelle souffrance, devant des demandes insistantes et devant la pression de certaines familles. Cela aussi est une réalité !
Mais prenons-nous le temps de proposer les soins palliatifs, comme la loi l’exige? Prenons-nous la peine d’entrer, un peu plus, dans l’histoire de la personne et d’explorer sa réelle demande ?
Lorsque je donne des formations en soins palliatifs aux médecins, je suis impressionné d’entendre certains me dire : « Lorsqu’un patient me demande l’euthanasie, je l’oriente tout de suite vers l’ADMD… C’est mon devoir… » Ma réaction est toujours de demander dans quel contexte la demande a été posée et de quelle manière elle a été reçue. La réponse est très souvent basique et primaire : « La loi permet l’euthanasie, je ne vois pas pourquoi je la lui refuserais… Il faut être tolérant… »
À nouveau, posons-nous la question : qu’est-ce la tolérance ? Sous le biais de celle-ci, avons-nous encore le droit de réagir avec notre conscience ? La tolérance est fondamentale, bien sûr, mais elle implique une réciprocité de respect et invite au dialogue. Elle ne doit, en aucun cas, évincer le questionnement éthique.
Il suffit parfois qu’un soignant ose simplement poser la question de la réelle demande d’un patient en fin de vie, pour se sentir jugé et condamné par ses pairs.
Pour celui qui tente de rester éveillé et unifié par les valeurs qui sous-tendent sa pratique, il s’entend parfois dire : « Pour qui te prends-tu ? Où est ta tolérance ? » Or le soignant doit-il se contenter de poser des actes, indépendamment de sa conscience, ou a-t-il encore le droit de réagir et de se sentir en porte-à-faux devant telle ou telle situation ?
La différence entre la conscience personnelle, qui relève de la vie privée, et la loi, qui régit les relations à l’intérieur de la société, est bien ancrée dans notre société. Or le problème, c’est que la relation nouée entre le médecin et le patient relève certes de la vie sociale gouvernée par le droit, mais aussi de la relation personnelle régie par l’éthique. Le risque, ici pour le praticien, est de se persuader lui-même qu’il est normal de faire taire sa conscience pour se conformer à la loi.
Plus grave : même la clause de conscience, qui permet au soignant de rester libre par rapport à l’autorisation de la loi et, donc, de ne pas se prêter à des actes que sa conscience réprouve, est mise en danger.
Brigitte, infirmière, invoquant la clause de conscience, a refusé de poser une perfusion dont le seul but était d’injecter un produit létal. Elle a subi des pressions médicales et s’est retrouvée, devant sa direction, à devoir se justifier. Elle a fini par quitter l’hôpital pour aller travailler ailleurs…





























