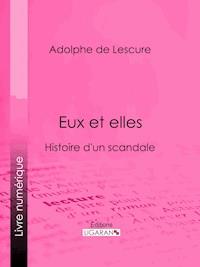
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "L'année 1859 a vu paraître trois ouvrages qui ne passeront pas comme elle et qui lui survivront, pour la punition de leurs auteurs : Elle et Lui, par madame George Sand ; Lui et Elle, par M. Paul de Musset ; Lui, par madame Louise Colet. Le premier a paru dans la Revue des Deux-Mondes. Le second dans le Magasin de Librairie. Le troisième, au Messager de Paris. Au moment d'affronter définitivement l'opinion publique, un des trois auteurs s'est retiré."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335091892
©Ligaran 2015
L’année 1859 a vu paraître trois ouvrages qui ne passeront pas comme elle et qui lui survivront, pour la punition de leurs auteurs :
Elle et Lui, par madame George Sand ;
Lui et Elle, par M. Paul de Musset ;
Lui, par madame Louise Colet.
Le premier a paru dans la Revue des Deux-Mondes.
Le second, dans le Magasin de Librairie.
Le troisième, au Messager de Paris.
Au moment d’affronter définitivement l’opinion publique, un des trois auteurs s’est retiré. Est-ce pudeur, lassitude ou dégoût ? Quel que soit le sentiment qui a inspiré cette abstention, il mérite d’être honoré. Deux auteurs ont poursuivi leur marche, j’allais dire persisté dans leur gageure. L’article et le feuilleton ont paru en volumes. La pierre de scandale, lancée d’abord dans les eaux d’une publicité restreinte, a élargi progressivement son cercle ondoyant. Les abonnés ont fait place au public.
Le journal de quelques-uns est devenu le livre de tout le monde. Cet appel volontaire au suffrage universel mérite au moins une réponse. Il l’aura. Quand la confession est publique, le confesseur doit parler tout haut. La franchise est toujours un devoir vis-à-vis de l’indiscrétion.
Le premier de ces livres que nous allons analyser est un roman mêlé d’histoire.
Le second est l’histoire sans le roman.
Le troisième n’est ni le roman ni l’histoire.
Elle et Lui est une apologie inopportune, et par suite, téméraire.
Lui et Elle est un pamphlet honnête, mais excessif.
Lui est un dithyrambe passionnel, une affiche autobiographique, un de ces livres qui viennent les troisièmes à la vitrine du libraire comme le quatorzième vient à table, une œuvre parasite qui trouvant prise la place de l’éloquence et du devoir, aime encore mieux manquer son effet que le perdre, être ridicule que de ne pas s’asseoir. Ajoutons, pour être juste, qu’il est difficile de faire plus poétiquement et plus gracieusement une bévue.
Le livre a tout l’esprit qu’il faut pour sauver une entrée équivoque. Mais ce qu’il a de plus spirituel, c’est encore son titre. L’auteur de Lui ne parle que d’elle. Il ne lui manque pour être pardonné que d’en convenir de bonne foi.
Mais continuons à détailler, c’est-à-dire à justifier notre appréciation.
Elle et Lui est une calomnie vis-à-vis d’un mort, ou le paraît, ce qui est malheureusement à peu près la même chose.
Lui et Elle est une violence vis-à-vis d’une femme.
Lui est une coquetterie en un volume, qui aura plusieurs éditions. C’est un de ces jolis livres qu’on rêve, mais que l’on n’écrit pas. S’il est inutile de se vanter de quelque chose, c’est surtout de ses regrets. La marquise Stéphanie de Rostan aura toujours aux yeux du public, comme à ceux d’Albert de Lincel, le tort d’être arrivée trop tard.
Elle et Lui défend par orgueil une réputation que Lui et Elle flétrit par vengeance, et que Lui compromet par vanité.
Ces trois livres sont trois fautes. Tous trois ont dépassé le but, pour mieux l’atteindre. Une tombe marquait la limite. Comment ne se sont-ils pas arrêtés, l’un par pudeur, l’autre par respect, le troisième par crainte ? Comment n’ont-ils pas prévu que le public, après avoir fait cercle autour des trois concurrents, leur dirait pour toute récompense, à celui-ci : On ne tire pas sur les tombeaux ; à celui-là : On ne tire pas sur les femmes ! à l’autre enfin : On ne tire pas sur soi-même !
Pour nous, incriminant le but plus encore que le résultat, nous dirons à Elle et Lui : On ne doit jamais se défendre au point de paraître attaquer. À Lui et Elle : On ne doit jamais attaquer jusqu’à paraître cesser de se défendre. À Lui : On n’intervient jamais dans un débat où on n’a ni le devoir de se défendre, ni le droit d’attaquer.
En présence de cette opinion universelle, de ce verdict du jury des lecteurs, notre travail devenait presque inutile. Nous l’avons pourtant achevé après l’avoir entrepris. Il y a de petits livres qu’il faut faire quand même.
D’ailleurs, si le jugement est connu, il reste à le formuler ; et, après l’avoir formulé, à le motiver. La tâche nous a semblé intéressante vis-à-vis de trois livres signés de trois noms célèbres, invoquant tour à tour l’excuse du devoir et la liberté de l’art, et ayant abordé comme au concours, forts d’une expérience personnelle, un des grands problèmes du cœur humain : la lutte étrange et éternelle dans l’amour de l’homme et de la femme.
Si nous étions de ces critiques timorés qu’une note inquiète et qu’arrête une préface, nous bornerions notre analyse et notre appréciation au côté purement littéraire ou purement moral des œuvres que nous étudions. Nous traiterions ces livres que la passion fait palpiter, comme d’indifférents croquis d’après la nature morte. Dans une sorte de voyage dans les limbes, nous nous tiendrions systématiquement dans l’air supérieur et froid de l’idéal. Nous ne demanderions à des personnages imaginaires, vivant d’une vie de fantaisie, que d’obéir machinalement, dans leurs évolutions, aux lois de la vérité absolue. Nous repousserions enfin, avec de vertueux scrupules, les provocations incessantes de l’allusion, maligne Galatée qui court de page en page, feignant de se cacher et souhaitant d’être vue, vous menaçant de l’œil et vous appelant du sourire. Mais ce n’est pas au nom de l’art que nous avons pris la plume, c’est au nom du cœur. Nous ne voulons pas discuter une thèse philosophique, nous voulons vider un procès moral. Dans ces causes-là, la réalité est toujours au banc des témoins.
Loin de nous donc les fausses pitiés, les fausses craintes, les fausses pudeurs, pâles inspiratrices des demi-jugements. Nous avons vu tout ce qu’il était possible de voir : nous dirons tout ce qu’il est permis de dire. Nous ne déchirerons pas les voiles, mais nous les soulèverons. Nous n’arracherons pas les masques : nous les rendrons inutiles en appelant les gens par leur nom. Nous serons polis comme on l’est au bal de l’Opéra, où jamais il n’y eut d’incognito. Le critique qui achète certains livres a payé chez le libraire le même droit que le danseur au contrôle. Il a payé le droit d’en demander davantage qu’il n’en veut dire à tout héros de roman qui, sous un masque connu, viendra l’intriguer.
L’auteur d’Elle et Lui n’a pas tardé, une fois le premier enivrement du triomphe passé (triomphe trop facile en vérité !) et bientôt remplacé par la douleur d’âpres représailles, à sentir combien il est difficile, sur certaines voies imprudemment ouvertes, d’arrêter l’interprétation. En vain on a cherché, par d’énergiques désaveux, à chasser du sanctuaire profané de la vie privée la foule avide de scandale. La foule a persisté à se tromper de porte. On lui ouvrait celle du roman, elle a violé celle de la réalité. En vain on lui a dit : Ceci est une fable. Elle a répondu : Ceci est une histoire. En vain on lui a crié : C’est une étude sur le cœur humain en général. Elle a persisté à répondre : C’est une étude sur votre cœur. L’auteur d’Elle et Lui ne voulait avoir que de l’imagination. On l’a condamné à avoir de l’expérience. Il ne voulait qu’être admiré, et on l’a plaint ou détesté malgré lui. Ce Laurent de Fauvel dont on prétendait faire une abstraction, un type, un héros de roman comme Lovelace ou Faublas, chacun a prétendu l’avoir connu, l’avoir rencontré dans le monde, dans tous les mondes. Chacun, aidé dans ce goût d’assimilation, que dis-je ? d’identification, si cher au lecteur français, par des chroniqueurs complaisants, a prononcé un nom que nous ne dissimulerons pas, le nom d’un grand poète mort prématurément, d’un grand poète bien fait pour la vie courte et les romans orageux, d’un poète prédestiné à toutes les gloires et à toutes les chutes, venu au monde avec le cœur de l’ange et l’esprit du démon, le goût de l’enfer et le mal du ciel.
C’est donc en vain que nous tairions ce que tout le monde a dit. Ô fatalité des livres ! Le lecteur, désappointé par les nombreuses réticences de l’Histoire de ma vie, mémoires en buste, où Alfred de Musset n’a qu’une mention, s’est obstiné à voir l’histoire dans le roman, peut-être parce qu’on lui avait refusé le roman dans l’histoire.
Nous n’irons pas même aussi loin que lui. Nous l’avons dit, nous respectons les masques. Mais nous ne croirons blesser aucune convenance, léser aucun droit, en cherchant dans l’allusion qui fait la base de tous ces livres, le point d’appui de notre critique ; en demandant enfin aux Œuvres de George Sand et d’Alfred de Musset l’explication de quelques-unes des aventures de Thérèse, d’Olympe ou d’Antonia, le secret de la conduite d’Albert, de Laurent ou d’Édouard. Nous procéderons comme l’enseigne une doctrine trop courageuse : pour n’être pas quelque peu cruelle. Nous étudierons d’après le cœur humain, modèle saignant. Mais cette étude pénible demeurera secrète, et nous n’en donnerons que le résultat.
Madame George Sand a répondu à la fois dans la préface de Jean de la Roche (Revue des Deux Mondes, du 15 octobre 1859) aux accusations de Lui et Elle et au public qui s’y était associé ; cette réfutation est aussi énergique que contradictoire. L’auteur d’Elle et Lui y dit à ses adversaires : – Respectez le vrai, c’est-à-dire ne le rabaissez pas au gré de vos ressentiments personnels ou de votre incapacité fantaisiste. Apprenez à bien faire ou taisez-vous. – Elle y dit aux lecteurs : – Respectez l’art, ne l’avilissez pas au gré de vos préventions inquiètes ou de vos puériles curiosités apprenez à lire ou ne lisez pas ! –
Nous connaissons des gens qui ont la prétention de savoir lire et qui ne comprennent pas par quel mystère de l’association des idées madame G. Sand a pu dans sa préface affirmer et nier tour à tour, sans se croire illogique, la même chose.
La préface de Jean de la Roche commence par exposer « les incidents comiques, accessoires obligés de toute publication offrant un caractère de réalité quelconque, » qui ont signalé l’apparition de Narcisse. Elle raille ces lecteurs prévenus qui ont, quand même, voulu trouver dans leur petite ville les héros de l’histoire mise en roman. Il est vrai, ajoute-t-elle, pour expliquer cette obstination « que l’auteur du roman imprimé avait commis une grande faute, il avait peint la figure extérieure de Narcisse. »
La même faute, au moins en ce qui concerne la figure extérieure du modèle, n’a pas été commise dans Elle et Lui.
Il n’en faudrait pas conclure que Elle et Lui est un roman pur, sans rapport avec la réalité. Après avoir développé les deux opinions, les deux systèmes : qui régissent ce genre de composition, madame Sand se prononce formellement pour celui dont la préférence indique l’emploi et justifie notre thèse.
« Deux opinions ont été mises en présence. Selon la première, l’artiste doit tout puiser dans son imagination, c’est-à-dire ne raconter, même sous le voile de la fiction, aucun enchaînement de faits observés par lui dans la réalité, et ne peindre aucun caractère, aucun type pris sur nature. D’après cette sentence, tout artiste qui retrace des scènes de sa propre vie, ou qui analyse des sentiments de son propre cœur, commet une indécence et livre son âme en pâture à la populace…
Selon l’opinion contraire, tout artiste, sous peine de ne plus être artiste du tout, doit tout puiser dans son propre cœur, c’est-à-dire qu’il ne doit écrire, parler, chanter, ou peindre qu’avec son âme, ne juger qu’avec son expérience ou sa conviction, n’étudier qu’avec son individualité, enfin, n’émouvoir les autres qu’à l’aide de sa propre émotion actuelle ou rétrospective. Il doit son âme à la multitude… »
Cette méthode « qui est la sienne » ne parait à l’auteur d’Elle et Lui soumise qu’à une double obligation.
« Le goût, qui est une règle d’art, et le respect des personnes, qui est une règle de conduite, exigent seulement une fiction assez voilée pour ne désigner en aucune façon la réalité des personnages et des circonstances. »
L’auteur d’Elle et Lui prétend être demeuré fidèle jusqu’au bout à cette double convenance d’un sujet « où elle utilisait son expérience. »
C’est à elle de le prétendre, mais c’est au public d’en juger. Et ici, à côté de la théorie de la liberté du roman, que l’on étend jusqu’au droit « de tracer la peinture du cœur humain tel qu’il a battu en soi-même, ou tel qu’il s’est révélé chez les autres, » il serait bon de placer la théorie de la liberté du lecteur qui, au risque d’être exclu « de l’aristocratie des lumières et de la saine bourgeoisie de la raison » souffre impatiemment qu’un écrivain, même un grand, le renvoie durement à l’école apprendre à lire, ou veuille malgré lui « faire son éducation. » C’est à ce public indépendant à juger si dans ce livre tant attaqué et tant défendu « rien n’a été écrit sous l’oppression d’un mauvais sentiment, si on y a été vrai sans amertume et sans vengeance, juste et généreux envers le passé qu’on s’est remis sous les yeux, si l’on n’y a peint les malheurs du caractère ou les égarements de l’âme, qu’en cherchant et en découvrant leur excuse dans la fatalité de l’organisation et des circonstances ; » si enfin cette excuse peut être agréable aux vivants qui représentent les morts, et s’ils n’ont pas dû trouver par trop indiscret, intempestif, empressé ce tendre pardon final qu’on n’avait pas demandé.
Elle et Lui n’est pas un roman d’intrigue, mais un roman d’analyse. Il a pour but de nous apprendre comment Laurent de Fauvel et Thérèse Jacques s’aimèrent et comment ils se quittèrent. Nous aurions préféré qu’il nous apprit pourquoi.
Trois lettres, dont une de mademoiselle Jacques, servent d’introduction au roman. S’il n’avait pas fallu faire un livre, ces trois épîtres le rendaient inutile. L’opposition du caractère et des idées y est indiquée avec un soin perfide. On sent si bien percer déjà, dans ces protocoles, du traité d’union, l’antagonisme futur, que l’on commence à trembler devant un dénouement inévitable. Ces lettres ont évidemment été écrites pour la cause. (N’oublions pas que ce roman est un plaidoyer.) C’est à ce point que ni Thérèse ; ni Laurent n’auront le droit de se plaindre tout à l’heure de la catastrophe finale. Il est impossible d’entrer en liaison avec moins d’illusions de part et d’autre. C’est un amour dos à dos.
Laurent a bien compris Thérèse. C’est par l’orgueil qu’il entrera dans la place. Thérèse a encore mieux deviné Laurent. Elle feint l’indifférence, et offre à ce jeune homme blasé qui fait le simple, qui fait l’enfant, l’amitié d’une sœur, l’affection d’une mère.
Les citations que nous avons accumulées en notes, pour ne pas interrompre nos déductions, n’auront sans doute laissé aucun doute au lecteur sur l’avenir réservé à une correspondance qui s’ouvre avec ce sans-gêne de part et d’autre, cette mutuelle familiarité, ce désintéressement presque cynique.
La faiblesse de Laurent attire Thérèse comme une occasion de domination. L’indulgence de Thérèse tente Laurent par l’espoir de toutes les surprises, surtout de celle de la liberté dans l’amour. Ils se précipitent dans les bras l’un de l’autre… pour huit jours.
Ce n’est pas cette insouciance d’un côté, cette clairvoyance de l’autre, qui nous gâtent cette introduction. Ce qui nous fâche le plus c’est cette présentation de Palmer au lecteur. Dès les premières pages, apparaît cet Hercule d’Amérique, à la tête d’Antinoüs, se carrant dans son obséquieuse nullité et promenant de l’un à l’autre, avec un sourire de marchand bel esprit, son banal dévouement. Eh bien ! ce Dick Palmer, dans lequel le lecteur pressent la providence bourgeoise du drame et comme le notaire du dénouement, ce Dick Palmer, avec sa fausse discrétion et ses lourdes prévenances, lui crispe les nerfs comme à Laurent. Thérèse seule l’a deviné, et le défend avec cette prévoyance qui la caractérise : « Vous l’avez pris pour un épicier, et vous vous êtes trompé. » Et dans cette défense intempestive ; on sent comme un des arguments de la future apologie. Palmer s’en va, mais pour tout le monde il est resté. Son souvenir est désormais entre Thérèse et Laurent, entre l’auteur et le lecteur. Chacun le devine derrière la porte, épiant l’heure de sa rentrée. C’est avec raison que Laurent déteste et menace cet intrus souriant, ce parasite de son bonheur. C’est avec raison qu’il s’indigne, sous le coup d’une jalousie anticipée, contre Thérèse, qui se défend avec l’impérieuse dignité d’un orgueil qui ne veut pas être soupçonné, l’âpre impatience d’une sécurité que l’on dérange. Et le lecteur, comme eux, se reproche de s’intéresser à un amour qui commence comme les autres finissent.





























