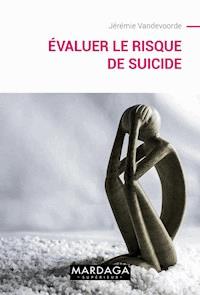
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mardaga
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Appréhender le suicide pour mieux le prévenir.
Toutes les 40 secondes, quelque part dans le monde, quelqu’un se donne la mort. En Belgique, on estime à 2 000 le nombre de morts par suicide chaque année. Ces chiffres symbolisent la nécessité de mettre en place des outils efficaces afin de suivre au mieux les personnes à tendances suicidaires. Au fil des pages, l’auteur présente une série d’outils inédits sous forme de fiches pratiques que le lecteur pourra utiliser directement dans le cadre de ses consultations ou de ses recherches. Tous ont comme objectifs l’évaluation et l’orientation des patients. Ils sont accompagnés de cas pratiques visant à guider de façon concrète le praticien ou le médecin dans son intervention.
A travers cet ouvrage, découvrez, sous forme de fiches pratiques, une série d’outils inédits destinés à l’évaluation et à l’orientation des patients.
EXTRAIT
Ce dernier paragraphe récapitule de manière synthétique la présence des signes d’alerte (warnings signs) et, bien qu’ils ne prédisent pas le geste suicidaire, la présence d’un seul d’entre eux donne une gravité particulière à la crise. À l’inverse, cependant, leur absence ne signifie pas qu’il n’y aura pas de passage à l’acte. Ces signes sont :
- une menace directe/annonce d’immédiateté ;
- une activité suicidaire délirante ou hallucinée ;
- un antécédent suicidaire grave ;
- un plan clair et défini ;
- une recherche active de moyens autolytiques ;
- un état de grande agitation ou une inertie complète ;
- une suspicion de dissimulation d’information (mensonge, etc.).
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jérémie Vandevoorde est docteur en Psychologie clinique et chargé des cours à l’université Paris Ouest Nanterre – La Défense. Il travaille depuis une dizaine d’années dans le suivi des personnes à tendances suicidaires. Ses travaux de recherche portent essentiellement sur la suicidologie, le passage à l’acte hétéro et auto-agressif, l’évaluation en Protection de l’Enfance, les phénomènes dissociatifs et la psychologie de l’action.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’auteur
Jérémie Vandevoorde est docteur en Psychologie Clinique, psychologue clinicien, qualifié aux fonctions de maître de conférences des Universités. Il a été chargé de cours à l’université Paris Ouest Nanterre – La Défense, membre associé du Laboratoire IPSé, expert (non inscrit) auprès des tribunaux. Il a travaillé dix ans dans le champ de la protection de l’enfance et exerce aujourd’hui aux urgences psychiatriques dans un hôpital de la région parisienne. Il y a fondé, avec ses collègues, l’Unité Hospitalière de Suicidologie et d’Étude sur la Violence (UHSEV) qui mène actuellement des recherches scientifiques sur le geste suicidaire. Il propose aussi une consultation suicidologique spécialisée et des formations à Paris.
Ses travaux de recherche portent essentiellement sur la suicidologie, la criminologie, le passage à l’acte hétéro et auto-agressif, l’évaluation en protection de l’enfance, les phénomènes dissociatifs et la psychologie de l’action. Il a publié un livre sur la psychopathologie du suicide et plus de 20 articles scientifiques sur ces thèmes. Il est membre de l’Union Nationale pour la Prévention du Suicide (UNPS) et du Groupement d’Étude et de Prévention du Suicide (GEPS).
Les contributeurs
Nicolas Estano est psychologue clinicien, titulaire d’un master professionnel et d’un master Recherche (Paris VII), il a complété sa formation par un échange universitaire à l’Université du Massachusetts (Boston), ainsi qu’avec trois D.U (criminologie, criminalistique et clinique et thérapeutique des auteurs d’infractions à caractère sexuel ; Paris V). Il exerce au sein de l’Unité de Psychiatrie et de Psychologie Légale de Ville Evrard/C.R.I.A.V.S Île-de-France Nord-Est. Il est également Psychologue Expert Près la Cour d’appel de Paris.
Ambre Sanchez Valero est psychologue clinicienne et exerce à l’hôpital René Dubos (Val d’Oise) au service des Urgences psychiatriques pour adultes et en maison d’arrêt. Diplômée de l’université Paris X, titulaire d’un master Recherche en psychologie clinique et psychopathologie, elle s’est spécialisée en victimologie ainsi qu’en criminologie appliquée à l’expertise mentale par le biais de deux diplômes universitaires obtenus à l’Université Paris-Descartes. Elle a participé à la rédaction de plusieurs articles scientifiques sur le suicide. Elle est membre de la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique du Val d’Oise (CUMP).
Morgane Thibaudet est psychologue titulaire d’une maîtrise en Psychologie clinique et d’un master en Psychologie de la Cognition de l’Université de Paris VII – Vincennes – Saint-Denis. Elle s’est également spécialisée en criminologie par l’obtention d’un diplôme universitaire dans cette même université. Elle a exercé au sein des urgences psychiatriques de l’hôpital René Dubos (Val d’Oise) et mène actuellement des recherches sur la cognition et le geste suicidaire.
Introduction
Le suicide est un acte de contestation maximale de l’existence. C’est la réponse dramatique que trouvent certains êtres humains au scandale mondial d’avoir doté l’Homme d’une condition existentielle qu’il peut potentiellement détester et, par conséquent, refuser. La douleur, le psychisme et le corps sont parfois ainsi : des choses absurdes dont on peut s’affranchir. Se tuer, c’est capituler face aux règles trop obscures du monde. C’est reconnaître qu’elles peuvent nous mettre en colère et que, dans certaines circonstances, nous ne savons guère quoi faire d’une existence comportant la curieuse possibilité d’être embarrassée par elle-même.
Si le passage à l’acte suicidaire en lui-même est le résultat d’un processus psychologique, le phénomène suicidaire, au sens large, est loin d’être banal. Quelques chiffres suffisent à lui donner une envergure relativement inquiétante :
le geste suicidaire provoque entre 800 000 et 1 million de morts dans le monde, ce qui correspond à un décès toutes les 40 secondes chaque année ;le suicide est la 13e cause mondiale de décès ;on dénombre 20 millions de tentatives de suicide dans le monde. C’est comme si environ un tiers de la population française tentait de se donner la mort chaque année.En 2004, le docteur Catherine Le Galès-Camus, sous-directeur général de l’OMS chargé des maladies non transmissibles et de la santé mentale, déclarait : « Chaque décès par suicide a des conséquences dévastatrices du point de vue affectif, social et économique pour d’innombrables familles et amis. Il s’agit d’un problème de santé publique mondial et tragique qui provoque plus de décès que les homicides et les guerres réunis. Il faut d’urgence intensifier et coordonner l’action au niveau mondial pour éviter ces morts inutiles. »
En France, 9 033 personnes sont mortes par suicide en 2014 (soit un taux de 13,6 pour 100 000 habitants ; chiffres CEPIDC). Après ajustement méthodologique, le taux de mortalité par autolyse s’élèverait plutôt à 10 000 décès annuels, ce qui représente trois à quatre fois plus de morts que celles causées par les accidents de voiture. On relève parmi ces suicidés environ 40 enfants de moins de 14 ans et 500 adolescents (Vandevoorde, 2015b). De surcroît, le phénomène suicidaire ne s’arrête pas à la mort effective d’une personne et inclut une activité psychologique bien plus large. Des enquêtes rapportent que :
entre 5,5 % (Beck et al., 2010)1 et 8 % (DREES, 2006)2 de la population française interrogée déclarent avoir fait au moins une tentative de suicide (TS) dans leur vie ;195 000 tentatives de suicide ont été répertoriées par le système de soins en 2002 ;2 % de la population présenteraient un risque suicidaire élevé ;3,9 % des 15-85 ans ont pensé à se suicider dans l’année qui s’est écoulée (INPS, 2010) ;5 % des personnes âgées entre 40 et 59 ans déclarent avoir eu des idées suicidaires au cours de l’année écoulée3 (DREES, 2014).Par ailleurs, une mort par suicide affecte entre 6 et 100 personnes pouvant elles-mêmes développer une souffrance ou des symptômes psychologiques.
Dans nos sociétés, la réflexion sur le suicide a évolué au cours des siècles, occupant tour à tour le champ téléologique, philosophique ou sociologique. Aujourd’hui cependant, même si aucune de ces disciplines n’a fort heureusement délaissé un thème si fondamental, la souffrance des personnes suicidaires relève de la recherche scientifique et du soin médico-psychologique. La vision alternative que nous donne la science est remarquable : le geste suicidaire n’est pas l’apanage d’un destin divin, ni le résultat d’un choix philosophique pur et rationnel (encore qu’il peut parfois en prendre la forme), ni les conséquences de modèles sociaux (encore que ces derniers jouent un rôle à leur manière), mais l’aboutissement d’un processus psycho-social. Cette idée de processus n’est pas négligeable puisqu’elle signifie que la compréhension du geste suicidaire peut être soumise à une activité d’exploration et de découverte scientifique, garantes d’un meilleur contrôle sur notre inconfortable condition.
L’enjeu est de taille car la découverte du processus suicidaire permet non seulement d’atténuer les souffrances mentales mais aussi de sauver des vies. À ce titre, les cliniciens chargés de la prise en charge des personnes ayant des désirs d’autolyse ont une mission délicate et franchement périlleuse dont on ne peut négliger la fréquence : aux États-Unis, 71 % d’entre eux, travaillant dans le champ de la santé mentale, ont au moins un patient suicidant dans leur consultation (Rogers et al., 2001) tandis que 23 % ont connu le décès par suicide d’au moins un de leurs patients avec des conséquences importantes sur leur niveau de stress au travail (Mc Adams et al., 2000). Nous n’avons pas d’étude française équivalente, mais, d’après notre expérience, rares sont les psychologues, les psychiatres, les autres médecins, les infirmiers, les éducateurs qui n’ont pas été un jour confrontés au problème du suicide et des idées suicidaires. Les plus concernés d’entre eux sont souvent amenés à prendre des décisions risquées, stressantes et incertaines quant aux résultats.
Fort heureusement, l’écoute assidue des patients, les observations cliniques rapportées par les thérapeutes et les techniques d’exploration ont commencé à nous révéler les premiers secrets du processus suicidaire, si bien que les premières modélisations de la crise suicidaire ont vu le jour il y a quelques années. Pièce par pièce, minutieusement, nous commençons à rassembler le puzzle psychopathologique du suicide. Nous n’avons pas encore tout découvert, et les pages des revues scientifiques seront encore noircies pendant de nombreuses décennies, mais nous sommes toutefois parvenus à identifier suffisamment de mécanismes pour disposer aujourd’hui d’un réservoir notable de connaissances suicidologiques.
Ce sont ces connaissances que nous avons rassemblées, triées et modélisées dans cet ouvrage. Ces travaux ont abouti à l’élaboration d’une démarche d’évaluation servant aussi bien la pratique clinique que la recherche. Après être brièvement revenus sur la notion de potentiel suicidaire et ses constituants, nous présenterons le Système d’Exploration et de Reconstitution Suicidologique (SERS) et le dispositif qui le compose : son encadrement épistémologique (le dispositif général de recherche et de clinique suicidologique – DGRCS), une nouvelle grille de recueil des données suicidologiques (la Carte de l’activité suicidaire – CAS) et une nouvelle technique d’entretien (Sonde Exploratoire par Entretien Clinique – SE-EC). Le principe, comme le proposait un précurseur, Shawn Christopher Shea (2008), est d’une insolente simplicité : au cours d’une séance d’échange, les patients souffrant d’envies suicidaires ou ayant tenté de se tuer sont invités à reconstituer mentalement et à rebours tout ce qu’ils vivent et ont vécu avant la mise en œuvre de leur geste. À l’image d’un jeu de construction et d’une enquête phénoménologique, on retrace les événements psychologiques qui ont formé l’engrenage suicidaire, on les identifie et on les assemble entre eux en érigeant une toile phénoménologique sur laquelle s’inscrit progressivement ce qu’a ressenti, fait, pensé le sujet avant de vouloir se donner la mort. Outre l’obtention rare du « film » de l’activité suicidaire, la méthode concède à une vue cumulative en facteurs de risque un angle processuel où chaque élément surgit dans un ensemble dynamique, telle une constellation qui remue progressivement ces différentes composantes (émotions, pensées, gestes, état de la conscience, etc.). À ce stade, le passage à l’acte peut être modélisé et présenté sous la forme d’une simulation chronologique.
Tous les auteurs de ce livre travaillent à l’hôpital, la plupart en service d’urgences, ou ont une activité d’évaluation médico-légale. Ils sont quotidiennement confrontés à l’évaluation de la probabilité d’occurrence d’un geste suicidaire ou d’un passage à l’acte violent. Le matin, ils ne savent pas ce à quoi ils vont devoir faire face. Mais le soir, quand ils rentrent chez eux, ils ne savent pas ce à quoi vont être confrontés leurs patients.
Nous l’avons dit : nous considérons ici le geste suicidaire comme un acte de contestation existentielle de la condition humaine et/ou un acte de contestation de l’état du monde conduisant le sujet à chercher, dans l’idée qu’il se fait de la mort ou de la non-vie, un changement (Vandevoorde, 2013a). Mais ce que nous n’avons pas dit, c’est que nous considérons la psychologie du suicide comme un effort humain de raffinement et d’élégance scientifique quant aux soins de tous ceux que la vie a blessés, abîmés, cassés, à un dégré si intense qu’ils ont émis le désir se donner la mort.
JV.
1. Échantillon de personnes âgées entre 15 et 85 ans.
2. Échantillon d’adultes (18 ans ou plus).
3. Année 2010.
Chapitre 1L’évaluation du potentiel suicidaire
Le potentiel suicidaire et la démarche des quatre évaluations (ou « 4 E »)
En médecine et en psychopathologie, les fondements de la méthode clinique reposent sur deux questionnements simples et essentiels :
De quoi souffre notre patient et quels sont les processus qui le font souffrir ?Comment puis-je l’aider ?La construction et l’application d’un protocole d’intervention auprès d’une personne en situation de peine mentale est une démarche qui émerge directement de l’évaluation et qui s’y articule pleinement. C’est l’analyse des éléments de souffrance, du fonctionnement psychologique, de l’étiopathogénie, révélés lors de l’investigation clinique qui constituera réellement la base sur laquelle se fonderont les axes de la prise en charge et de l’accompagnement global du patient (y compris l’accompagnement social et éducatif). Il s’agit ici d’établir la situation psychologique de la personne. Sans évaluation et sans point de repère scientifique, le clinicien ne peut que progresser à l’aveugle et espérer, avec une foi douteuse, que d’une simple conversation jaillisse une guérison ou un soulagement bienvenu. À vrai dire, l’évaluation est un véritable processus de singularisation du patient. Elle s’appuie sur l’idée éthique et déontologique de proposer le traitement le plus adapté à l’idiosyncrasie du patient en évitant de l’impliquer dans des suivis indifférenciés dont le résultat comporterait une déplorable part de hasard. Une offre de prise en charge, de soulagement, de soins et d’accompagnement, mérite d’être raisonnée et rationnelle, malgré la part d’incertitude inhérente à toute prise en charge médico-psychologique. Elle doit s’appuyer sur les connaissances scientifiques dont nous disposons, même si ces dernières sont incomplètes, imparfaites ou sans cesse bousculées par le dynamisme des découvertes et du débat épistémologique.
Contrairement à ce que l’on entend parfois, l’évaluation n’efface pas le patient derrière un diagnostic, des processus, des mécanismes ou des théories. Au contraire, elle singularise le fonctionnement du sujet et dresse le portrait de ses souffrances. Elle forme surtout un véritable et bienheureux guide clinique lorsque nous nous perdons, sans boussole, dans les mystères de l’humain. Probablement, ces mystères sont-ils d’ailleurs encore très nombreux, mais la recherche psychologique a aujourd’hui levé le voile sur une partie d’entre eux et il serait dommage de s’en priver. L’évaluation constitue par conséquent un acte interpersonnel de validation de la souffrance du patient ainsi qu’une estimation de la forme de cette souffrance, de sa gravité et de l’urgence à la traiter. N’oublions pas qu’un protocole d’intervention nécessite trois décisions (Vandevoorde, 2014b) :
établir le contenu de la prise en charge, c’est-à-dire les axes de travail choisis. On dispose aujourd’hui d’un large panel d’interventions à l’intérieur duquel on trouve des cibles thérapeutiques comme la gestion émotionnelle, la contenance motrice, le repositionnement familial, la restructuration cognitive, l’estime de soi, l’élaboration des conflits intrapsychiques, la libération des tensions profondes, l’entraînement mnésique, l’entraînement des fonctions exécutives, la négociation psychologique d’un traumatisme, le changement du trafic neuronal par voie de médication ou autre, l’apprentissage éducatif, etc. ;établir le type de traitement, c’est-à-dire la modalité de traitement qui sera la plus appropriée aux axes thérapeutiques précédemment choisis, par exemple : psychothérapie individuelle, séance psychanalytique, groupe de parole, groupe de remédiation, groupe structuré ou de psychoéducation, traitement médicamenteux, jeux de rôle, accompagnement socio-éducatif, etc. ;établir l’orientation, c’est-à-dire la prise en charge institutionnelle permettant de mettre en œuvre le contenu et le type de traitement, par exemple : hospitalisation, suivi ambulatoire, visite à domicile, sollicitation de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), demande d’orthophonie ou de psychomotricité, sollicitation de l’assistante sociale, demande d’un bilan complémentaire, interpellation de la protection de l’enfance ou de la médecine somatique, etc.Cette démarche classique correspond aux questionnements : Quel changement est nécessaire à l’amélioration de l’état du patient ? Quelle modalité de prise en charge permet d’y parvenir ? Et dans quel cadre institutionnel ? Autrement dit : quelle thérapie pour quel patient ? Naturellement, la nature du protocole d’intervention proposé dépendra de tout en ensemble de facteurs dont la situation familiale, sociale et environnementale de l’individu, la présence d’un trouble mental, les processus de personnalité et l’histoire du sujet. Sur un plan strictement psychiatrique par exemple, on ne propose pas le même traitement pour soigner une phobie simple et une schizophrénie. Le protocole d’intervention sera extrêmement différent si, face à un enfant qui ne parle pas en première consultation, on explique ce dernier phénomène par un autisme, un mutisme, une dysphasie, une phobie sociale, une inhibition ou simplement une timidité passagère. Les exemples sont nombreux. Dans le cadre de l’évaluation qui nous intéresse ici, on fera intervenir beaucoup d’autres variables pour établir un panorama bien plus large que la présence ou non d’une pathologie psychiatrique. Pour le suicide, l’estimation clinique est particulièrement cruciale puisque, pour des raisons de temps, les premières décisions doivent souvent être prises avant le terme du bilan. La sécurité immédiate du patient étant directement en jeu, nous sommes fréquemment amenés à poser un premier avis voire une orientation (par exemple celle d’une hospitalisation) malgré une analyse encore incomplète de la situation.
Établir le potentiel suicidaire d’une personne est un art clinique difficile et à haut risque puisque son intérêt premier, parmi d’autres, est d’éviter qu’une personne se tue, ce qui, à l’heure actuelle, est impossible à déterminer avec une probabilité de cent pour cent. Plusieurs notions sont utilisées en suicidologie pour effectuer ce type de pronostic : on emploie généralement le terme d’urgence suicidaire lorsqu’on se réfère à la probabilité qu’une personne se suicide dans les 48 heures. La notion de risque suicidaire reflète, quant à elle, un pronostic fait pour une période de 2 ans. Le potentiel suicidaire se définit comme une estimation de l’activité suicidaire d’un individu fondée sur le relevé des éléments cliniques directement liés ou associés au suicide. Il est important de souligner que l’activité suicidaire ne se limite au geste d’autolyse bien que ce dernier en constitue le pic paroxystique et la manifestation la plus grave. Elle comprend également le désir et les idéations suicidaires, les menaces, les périodes de crise, les fluctuations thymiques, les activités préparatoires au passage à l’acte et nombre d’autres éléments que nous détaillerons tout au long de cet ouvrage. L’objectif est de détecter la nature de la souffrance d’un patient, d’en prendre la mesure exacte et surtout d’en extraire la genèse et les processus qui la maintiennent ou l’alimentent. Fondé sur le cadre général de l’examen psychologique (Andronikof et Reveillère, 2004), le potentiel suicidaire consiste ainsi à capturer le rapport de force dynamique globale de l’individu entre ses points de faiblesse et de souffrance d’une part, et ses forces et ses ressources d’autre part. On cherche à établir l’articulation toxique entre la situation, l’histoire du sujet, son environnement, la maladie mentale, ses points de vulnérabilité, la personnalité et les processus spécifique au suicide.
Aussi, par son essence même et les enjeux cruciaux qu’elle implique, l’évaluation du potentiel suicidaire est une évaluation complète et maximaliste, c’est-à-dire qu’elle balaie l’ensemble de la situation du sujet, passé et présent, et propose une hypothèse ou un modèle sur l’agencement des mécanismes psychologiques actuels du patient. D’un point de vue épistémologique, cette démarche peut s’inscrire dans la perspective d’une « épigenèse probabiliste » et peut-être des modèles chaotiques (Vandevoorde, 2010).
Mais tout de même, à quoi sert un potentiel suicidaire ? À ce jour, aucune étude n’a réussi à prédire l’occurrence d’un geste autolytique. Pourquoi donc utiliser un indicateur clinique qui ne prédit pas le passage à l’acte ? Le potentiel suicidaire ne donne, certes, pas d’indication sur l’avenir des actes du patient mais il photographie la réunion des ingrédients cliniques concourant à de tels actes et filme l’engrenage général du processus. La faible, voire l’absence complète de capacité prédictive du risque ou du potentiel suicidaire légitimerait les objections sur la vanité de ce type d’évaluation. Toutefois, le rejet d’une telle démarche nuirait à la qualité de la prise en charge du patient en situation de crise. Les fonctions du potentiel suicidaire sont multiples et importantes :
il permet d’établir un bilan médico-socio-psychologique complet et de discuter, dans certains cas, des diagnostics différentiels ;il permet d’identifier le processus suicidaire, son évolution et son interaction avec le fonctionnement de la personnalité ;il permet de prendre en charge la présence d’une activité suicidaire. Cette activité constitue déjà en elle-même un signe de souffrance psychologique, quand bien même le sujet ne passerait jamais à l’acte ; il permet de déterminer des mesures de prudence, de vigilance et de prophylaxie ; il donne des indications psychopathologiques sur le fonctionnement de l’individu.Comme le souligne Shea (2008), le compte-rendu protège de surcroît le clinicien lorsque la mort d’un patient mène à l’ouverture d’une enquête de police et d’une investigation judiciaire
L’élaboration d’un potentiel suicidaire se compose de quatre grands secteurs d’investigation :
les facteurs de risque du geste suicidaire ; la présence d’une pathologie psychiatrique ; le fonctionnement psychologique du sujet ; et, le plus important, l’activité suicidaire en elle-même.Pour les trois premiers, les méthodes d’investigation et les sources d’informations sont multiples et peuvent être obtenus à travers :
un entretien direct avec le patient ;l’étude du dossier du sujet ;la récolte d’informations provenant d’autres intervenants suivant le patient (médecin généraliste, psychologue, etc.) ;l’utilisation de tests et d’outils psychologiques ;la récolte d’informations auprès de l’entourage du patient.Dans cette liste, rien ne remplace l’entretien clinique direct, mais lorsque l’on travaille sur la violence et des phénomènes aussi graves que le suicide ou le crime, on a particulièrement intérêt à varier nos sources d’informations. La multiplication des données augmente en effet la qualité, la fiabilité et la complexité de l’information.
Pour le dernier point, la détection de l’activité suicidaire en elle-même, nous proposons – et c’est le cœur de cet ouvrage – une nouvelle méthode complète d’enquête clinique fondée sur les connaissances actuelles disponibles en suicidologie que nous avons nommée le Système d’Exploration et de Reconstitution Suicidologique (SERS).
Figure 1 – La démarche des quatre évaluations
Figure 2 – Démarche et outils de l’évaluation suicidologique.
L’interprétation épidémiologique
R. De Tournemire (2010) attire notre attention sur les précautions et la prudence méthodologiques qui s’imposent lorsqu’on aborde le geste suicidaire chez l’enfant et nos outils de mesure.
Nous ne disposons pas d’une définition universelle et consensuelle du suicide en raison de la difficulté à différencier le suicide (ou ses diverses formes) d’autres comportements : accidents suspects, suicide passif, équivalent suicidaire, scarification, suicide « abouti » vs suicide « raté », « parasuicide », conduites à risque. On notera toutefois l’existence d’outils aidant à déterminer la nature d’un geste hétéro-agressif comme le Classification Algorithme for Determination of Suicide Attempt and Suicide (CAD-SAS) (Fedyszyn et al., 2012). Delamare (2007, 2013) rappelle que la plupart des causes de décès des 5-14 ans sont les « causes extérieures de traumatismes et empoisonnements », « causées d’une manière indéterminée quant à l’intention ».Il existe encore peu d’études distinguant réellement les classes d’âges. La plupart d’entre elles rassemblent en effet des données ciblant les 0-19 ans, les 10-18 ans ou bien les 15-25 ans. Or les enfants et les adolescents ne présentent pas les mêmes caractéristiques psychologiques. La généralisation de l’échantillon étudié à la population de référence ne va pas de soi. La représentativité nationale des échantillons et les biais liés aux sujets qui échappent au système de recueil de l’information méritent d’être systématiquement questionnés avant d’élargir les conclusions.Le recueil des données comporte plusieurs biais : les professionnels peuvent avoir une définition personnelle du suicide ou de la tentative de suicide ;il existe des imprécisions dans les certificats de décès, et certains ne sont pas transmis ;certains médecins peuvent émettre des objections à évoquer le suicide pour des raisons autres que médicales : pression de la famille, assurance décès en jeu, etc.La pression des médias ainsi que leur format synthétique et simplifié peuvent avoir un impact sur la production d’interprétations hâtives lorsqu’un professionnel clinicien est interviewé pour expliquer l’occurrence du phénomène suicidaire, son évolution et ses caractéristiques cliniques. Il convient toujours de distinguer les effectifs des taux de suicide (généralement pour 100 000 habitants).Il est important de considérer la mesure du phénomène suicidaire au regard de l’acceptation culturelle d’un tel geste.Nous ajoutons aux propos de De Tournemire (2010) que :
la méthode d’interrogation est fondamentale, particulièrement dans la recherche sur le suicide. Non seulement les résultats peuvent différer selon le support employé (entretien, questionnaire, etc.) mais surtout la formulation même des questions provoque des réponses différentes. Nous avons, par exemple, montré qu’une formulation spécifique des questions cliniques augmentait considérablement le nombre de patients suicidant ayant un plan suicidaire avant leur passage à l’acte (Vandevoorde et al., 2012) ;les causes du suicide ne sont pas les motifs suicidaires ;l’évolution du taux de suicide nécessite aussi d’être lu avec l’éclairage des progrès de la médecine et du taux, peu étudié, de sauvetage. Ainsi, certains patients ont commis un geste suicidaire extrêmement grave (ou utilisé un moyen extrêmement létal) qui aurait dû provoquer leur décès mais ils ont eu la chance de s’en sortir.Sur les taux épidémiologiques, Aouba et collaborateurs (2011) estiment que le taux de suicide en France est sous-évalué d’environ 10 %.
Le modèle suicidologique intégré
Globalement, la démarche d’évaluation va tenter de suivre et de reconstituer la chronologie du processus suicidaire en explorant la vulnérabilité de base, le dérèglement de la relation sujet-environnement, les états émergeants de souffrance pré-suicidaire, l’éclosion de l’activité suicidaire et les processus d’enclenchement du passage à l’acte et de disposition psychologique.
Figure 3 – Modèle dynamique et chronologique de l’émergence suicidaire
L’évaluation des facteurs de risque et la grille SYFR
Les variables
On relève plus d’une centaine de facteurs de risque liés au comportement suicidaire qui sont plus ou moins hiérarchisés selon leur qualité distale ou proximale. Ces facteurs ont été découverts lors de vastes études menées sur de grand échantillon de sujet. À cet égard, ils s’appliquent à l’échelle d’une population mais pas à celle de l’individu. C’est la raison pour laquelle, Shea (2008) évoque plutôt la notion de « prédicteurs de risque » qu’il définit comme « les caractéristiques d’un individu donné indiquant la vraisemblance de l’imminence d’un suicide chez ce même individu », soit des facteurs de risque individualisé.
Moraz et Danet (2008) proposent un découpage simple et pratique des facteurs de risque : la sphère psychiatrique, psychologique, environnementale, sociale, familiale, biologique, historique et conjoncturelle. Les deux premiers méritent une attention particulière et sont détaillés plus bas. Pour les autres nous retiendrons principalement :
sur le plan historique : antécédents d’activités suicidaires, antécédents de tentatives de suicide, antécédents de troubles psychiatriques, événements traumatiques, événements violents, antécédents de ruptures (déménagement, migration, placement, etc.), expériences de vie malheureuses, placement des enfants, victime d’humiliation ;sur le plan social : absentéisme ou rupture scolaire, perte d’emploi, chômage, isolement, problèmes d’intégration sociale et professionnelle, conflit d’autorité, victime de harcèlement, surinvestissement scolaire ou professionnel, évolution dans un milieu hostile, enrôlement dans des groupes à risque, contexte de persécutions ou de harcèlement, intégrisme religieux, pratique de secte, victime d’un abus de pouvoir, profession à risque (policier, prostitution, militaire) ;sur le plan familial : antécédents familiaux de geste suicidaire, troubles mentaux des parents ou dans la famille, conjugopathie, veuvage, célibat, absence d’enfant, conflits avec les proches, problèmes éducatifs, violences familiales psychologiques, violence familiales physiques, période de divorce ou de séparation, maladie de l’un ou des deux parents, difficultés relationnelles parents-enfant, toute forme de danger sur enfant, placement des enfants, victime d’une relation d’emprise ; sur le plan conjoncturel : deuil, perte d’un proche, situations de crise, difficultés financières soudaines, interruption volontaire de grossesse, changements brusques de la vie quotidienne, rupture sentimentale, accident, événements de vie négatif, période de vulnérabilité ; sur le plan environnemental : milieu à risque, prison, foyer, voisinage toxique, précarité de l’habitat, conditions de vie inadaptées, insuffisance des ressources matérielles et financières, contexte géographique, émigration ou immigration difficile ;sur le plan biologique : sexe (homme), âge (40-60 ans), mauvais état de santé, annonce d’une maladie, hyposérotoninergie, douleur chronique et maladie hyperalgique, altération du développement, problème de croissance fœtale, affection neurocérébrale, ménopause.Chez l’enfant, le contexte familial (au sens large) nécessite une attention particulière tandis que l’investigation mérite dans certains cas de s’enrichir d’une évaluation du danger sur enfant. Le Référentiel d’Évaluation de l’Enfance en Danger (REED) (Vandevoorde, 2013b ; Vandevoorde et al., 2016b) propose des points de repère sur les grands axes habituellement évalués en protection de l’enfance (tableau 1) :
le contexte environnemental général ;la dynamique du couple ;la présence de difficultés psychologiques chez les parents ;la qualité de l’éducation ;l’exposition de l’enfant à une vie familiale inadaptée ;la présence d’un danger de négligence ;la présence de brutalité et de maltraitance physique ;la présence d’un danger sexuel ;la présence d’un danger psychologique (rejet de l’enfant, indifférence, terrorisme, isolement, corruption de l’enfant, abus de vulnérabilité) ;l’insécurité de l’enfant auprès de ses parents ou des modèles adultes de référence.Tableau 1 – Contexte social
Tableau 2 – Disposition parentale générale envers l’enfant
Tableau 3 – Danger encouru par l’enfant
Tableau 4 – Attitude de l’enfant envers les parents
Tableau 5 – Développement de l’enfant
Tableau 6 – Relation avec les services d’aide
Le cas particulier de la relation d’emprise est défini ici comme une « atteinte portée à l’autre en tant que sujet désirant ». Elle se manifeste par :
un contrôle de l’autre, domination, intrusion ;une neutralisation du désir d’autrui ;une abolition de sa spécificité ;un abaissement de l’autre au statut d’objet.En suicidologie, la présence de l’un de ses facteurs augmente, statistiquement parlant, la probabilité d’occurrence d’un geste suicidaire, mais leur impact est relatif et parfois absurde si on applique un déterminisme mathématique naïf car :
aucune de ces variables n’est prédictive ;aucune de ces variables n’est spécifique au suicide ;aucune de ces variables n’est suffisamment sensible pour discriminer les suicidaires/suicidants ou futurs suicidés ;aucune de ces variables n’est suffisante pour expliquer le geste suicidaire ;aucune de ces variables n’est nécessaire pour expliquer le geste suicidaire à elle seule ;et le nombre de ces variables rend difficile la compréhension de leur interaction.La grille de Synthèse des Facteurs de Risque – SYFR
La grille de Synthèse des Facteurs de Risque, que nous nommerons « SYFR », est un relevé simple et direct des facteurs de risque historiques, sociaux, familiaux, conjoncturels, environnementaux et biologiques d’un individu. Elle est simple, rapide à remplir et complète les trois autres évaluations (psychiatrique, psychologique, suicidologique) que nous développerons ensuite.
Cette liste de facteurs décrit la situation extérieure du patient et les événements de vie qui ont pu fragiliser son état psychologique. En situation clinique quotidienne, leur détection résulte bien souvent d’une évaluation pluridisciplinaire entre tous les intervenants médico-socio-psychologiques qui se coordonnent autour du patient. Leurs poids exact dans la genèse du processus suicidaire est difficile à établir, sauf à dire qu’il augmente la probabilité de survenue d’une geste ou d’une idéation suicidaire. Aussi leur importance est-elle pondérée par le rapport unique personnalité-situation du patient. On observe toutefois une vigilance particulière pour les facteurs qui ont :
accru la solitude du patient et lui ont donné le sentiment de n’appartenir à rien, à aucun groupe humain ;dégradé l’estime ou la considération qu’il avait de lui-même ou la confiance qu’il avait dans les autres ;dégradé sa dignité ;exposé son intégrité physique, psychologique, son existence à la mort, à la violence, à la torture ou à l’humiliation.L’évaluation d’une pathologie psychiatrique
La détection d’une altération mentale pathologique est un élément essentiel de l’évaluation suicidologique. Outre la souffrance, les pathologies mentales entraînent des modifications psychologiques qui dégradent les relations entre l’individu et le monde. Des études dites d’autopsies psychologiques4 estiment que 90 % des suicidés souffraient d’un trouble mental au moment de leur mort auto-infligée (Cavanagh et al., 2003 ; Isometsa et al., 2001 ; Séguin et al., 2006 ; Anaes, 2001). Les troubles les plus fréquents sont la dépression majeure, le trouble bipolaire, les personnalité antisociale ou borderline, l’anxiété sociale, l’état de stress post-traumatique, l’alcool, l’éclosion délirante. Wenzel et collaborateurs (2009) soulignent néanmoins que, « virtuellement, toutes les maladies mentales peuvent être des facteurs de risque ». Mais, ici encore, la présence d’une pathologie mentale augmente certes le risque de développer une activité suicidaire, mais n’est en rien déterministe par rapport à ce dernier. La plupart des personnes qui souffrent de troubles psychiques n’exécuteront jamais de geste suicidaire, et la proportion de suicidant sou de suicidés parmi ceux-ci est en réalité infime.
On note quelques expressions pathologiques du geste suicidaire qui méritent une attention particulière :
dans le cadre d’une bouffée délirante aiguë : le geste suicidaire est imprévisible, incontrôlé, irrationnel, brutal et souvent spectaculaire ;dans le cas de la psychopathie : l’état zéro désigne un effondrement du narcissisme et du soi grandiose des sujets psychopathes si bien que leur habituelle arrogance s’effondre en une sorte de dépression asymptomatique, « molle » ; dans le cas de l’intoxication alcoolique aiguë : on observe une perte des freins moteurs ;dans le cas d’un virage maniaque : le geste suicidaire survient suite à une brusque hyperthymie trompeuse, une levée de l’inhibition motrice alors que les idées suicidaires continuent à parader dans l’esprit du patient ;les troubles de personnalité borderline et histrionique : le geste suicidaire comporte souvent des enjeux relationnels de type chantage, appel et contrôle de l’autre. Ce qui ne veut pas dire que les gestes sont moins létaux.La fiche RSC, signifiant « Relevé Sémiologique Court », est un support simplifié permettant de rapporter les principaux éléments sémiologiques, la discussion diagnostique et l’évaluation de la pathologie.
L’évaluation des processus psychologiques : la SPPV
Les différentes zones de l’activité psychopathologique
L’évaluation des processus psychologiques consiste à estimer quelles activités ou caractéristiques psychologiques dégradent le rapport qu’entretient l’individu avec le monde et provoque en lui de la douleur. Le terme « processus psychologiques » désigne la suite continue d’opérations mentales et comportementales ainsi que les relations fonctionnelles qui les animent. Considérer ces processus, c’est comprendre le psychisme comme un jeu mouvementé d’activités ayant des effets les unes sur les autres. On entend généralement par ce terme une série d’actions, de mouvements élémentaires, d’opérations en chaîne ou de combinaisons d’événements psychiques à l’origine de l’interaction dynamique entre l’être et le monde. Ces processus sont des événements qui se prolongent mutuellement et constituent en quelque sorte l’architecture du soi. Ils forment l’organisation dansante du psychisme.
Par souci d’ordre et de clarté, les sciences psychologiques distinguent différents secteurs d’activités psychologiques composant l’ensemble de la circulation mentale qui fabrique nos comportements, nos attitudes et nos états d’âme. La méthode clinique tente ainsi de déterminer :
l’état de conscience ;la conceptualisation du soi ;l’activité cognitive ;l’activité fantasmatique ;les aspects relationnels ;l’activité émotionnelle ;les processus de l’action ;le défaut de contrôle et les mécanismes liés à la kinesthésie ;le comportement général ;la motricité ;les processus liés aux conduites instinctuelles ;l’état des relations familiales, amoureuses, amicales.Ce découpage est scientifique et, par conséquent, arbitraire. Mais il a le mérite de préciser la cible des évaluations, d’isoler une activité psychologique particulière, d’intégrer l’ensemble des processus dans une modélisation globale du fonctionnement de la personne à traiter, d’adapter et de structurer la psychothérapie et de faire bénéficier l’analyse psychopathologique de découvertes scientifiques multiples, même lorsqu’elles se centrent sur des points très précis parfois considérés comme trop théoriques par les cliniciens de terrain. La découverte des caractéristiques et des processus qui composent chacun de ces secteurs est d’une importance psychopathologique capitale : une altération de ces derniers dégrade le lien entre l’individu et son environnement, provoque de la souffrance et génère des symptômes. Aussi doivent-ils faire l’objet d’un balayage clinique complet et d’une enquête approfondie.





























