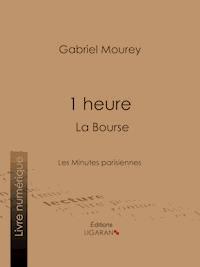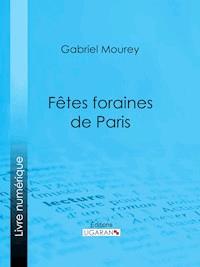
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Un arlequin de sonorités aiguës et ronflantes, qui fusent en pétarades nasillardes ou se traînent pâteusement sur une trame obstinée de batteries ; une salade d'airs cascadeurs ou pleurnicheurs, gouailleurs ou sentimentaux, qui courent les uns après les autres sans jamais se rattraper : toutes les scies de café concert, tous les pas redoublés, toutes les marches, toutes les romances..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un arlequin de sonorités aiguës et ronflantes, qui fusent en pétarades nasillardes ou se traînent pâteusement sur une trame obstinée de batteries ; une salade d’airs cascadeurs ou pleurnicheurs, gouailleurs ou sentimentaux, qui courent les uns après les autres sans jamais se rattraper : toutes les scies de café-concert, tous les pas redoublés, toutes les marches, toutes les romances, toutes les valses bleues ou roses, toutes les tziganeries à la mode d’hier et d’aujourd’hui, et le rythme spasmodique, haletant, comme cassé, de l’hallucinant cake-walk, de l’obscène matchitche, coups de matraque à la nuque et aux reins ; un salmigondis barbare, un inextricable pot-pourri de musiques qui se contrecarrent, s’embrouillent, se pénètrent, se heurtent, se battent, s’interrompent soudain pour reprendre aussitôt avec une frénésie nouvelle dans un tournoiement vertigineux scandé par des sifflements de machines à vapeur, des appels de sirène comme en pleine mer sous le brouillard, et des sonneries de cloches et des signaux de trompes ; un innommable et innombrable galimatias de bruits disparates et incohérents où les rugissements d’une ménagerie voisine se confondent avec le tonnerre d’un train en marche, des cris de femmes violées, les coups de gueule des aboyeurs sur les estrades, des détonations de pistolets et de carabines.
Une cacophonie analogue de couleurs, de formes, de gestes, de mouvements. Les verts acides qui font grincer les dents et les verts fades, modern style, qui lèvent le cœur, les roses vineux de roses trémières flétries, coudoient les jaunes faux, les bleus de blanchisserie, les répugnants violets de fraises à la crème, les rouges sang de bœuf caillé, les bruns de matières fécales, toute la gamme des colorations voyantes et inharmoniques, soutenue, sertie par des ors brutaux, des luisants métalliques, une folie de clinquant et de toc.
Cela, au plein soleil, supplicie la rétine, contracte l’épigastre, provoque la nausée ; mais cela, la nuit, parmi les jeux imprévus et changeants des lumières artificielles, dans le papillotement capricieux des flammes immobiles ou dansantes, flammes blanches, en boules de neige, des lampes à arc, flammes rougeâtres du gaz et du pétrole, lampions électriques, fleurs de celluloïd, lanternes vénitiennes ou chinoises, jets livides d’acétylène, suspensions à globe des salles à manger de la petite bourgeoisie, appliques à miroirs, pauvres chandelles en des tubes de verre, cela, parmi les indécisions, les contrastes, les différences d’intensité et de couleur de tous ces foyers lumineux, cela s’harmonise étrangement, cela revêt une certaine beauté tapageuse et qui s’accorde avec le tohu-bohu des cris, des musiques, des halètements de piston, des sons de cloche, des bruits de ferraille, des coups de feu. Les sensations de la vue complètent celles de l’ouïe ; elles se confondent même et s’intervertissent : l’œil perçoit des sons, l’oreille des couleurs… et l’odorat n’est pas moins délicieusement affecté. Il erre dans l’air des odeurs de fauves mêlées à des relents de friture, des parfums de crottin et d’urine confondus, l’été, avec l’arôme des sueurs humaines.
On va ainsi, durant des heures, dans le traînassement de la foule, à travers une avenue de boutiques, de carrousels, de théâtres, de ménageries, de musées de cire, de cafés et de rôtisseries en plein vent, de baraques de toute sorte, aux étalages, aux façades, aux estrades violemment bariolées sur lesquelles s’agite une humanité caricaturale et carnavalesque, épileptiquement gesticulante, avec un air de famille, à la fois arsouille et bon enfant, crapuleux et honnête…
De minables silhouettes de hères en oripeaux flambants, d’opulentes matrones en robe de soie et couvertes de faux bijoux, d’exquises et redoutables gigolettes en maillot et tutu ou voilant à peine sous la transparence de gazes pailletées des formes équivoques et garçonnières, des dompteuses et des lutteuses aux énormes cuisses lie de vin comprimées dans des caleçons de peau de tigre en peluche, des imprésarios en habit rouge, des barnums en habit noir avec de gros diamants au plastron douteux de leur chemise, des gars à casquette, en jersey rayé de canotiers, des gamins et des gamines costumés en pages ou en anges de féerie, de faux ou de vrais sauvages avaleurs de scorpions et mangeurs de choses immondes, des acrobates et des équilibristes à tête pommadée de garçons coiffeurs, des clowns, de ridicules, de pitoyables clowns de foire avec des cous de charretiers dans des collerettes jadis blanches, le chapeau pointu de caoutchouc planté sur une perruque carotte, une couche de plâtre balafrée de sang sur des joues et un menton mal rasés, tout un peuple de baladins, d’hercules, de jongleurs, de cabrioleurs et de bobinos, de nicolets et de paillasses, de charmeuses de serpents et de femmes torpilles, s’agite sur les tréteaux, parmi des piaillements de cacatoès, des gambades de singes, des bêlements de moutons à deux têtes, des boniments d’arracheurs de dents gueulés dans des porte-voix de zinc verni par des forts de la halle en toilette de soirée, cependant que trônent derrière eux, immobiles au milieu de ces frénésies, de belles demoiselles qui, sur de hautes tables drapées de tapis à ramages, édifient des piles de cartons crasseux et, durant que se poursuit la parade, mettent de l’ordre dans le tiroir à compartiments de la recette.
Et la foule s’amuse, rit de leurs grimaces et de leurs tours, applaudit aux plaisanteries grossières, toujours les mêmes, qu’ils débitent, les interpelle, les excite de ses quolibets ; une allusion obscène déclenche la gaîté, exalte l’enthousiasme ; on fraternise, les visages s’allument, la joie règne ! Femmes du peuple portant leurs enfants sur les bras, cercleux et calicots, ouvriers en bourgeron et demi-mondaines, apaches, bourgeoises et pierreuses, trottins et soldats, collégiens et vieillards, il suffit de quelques syllabes salaces, pour que les distances qui socialement, sinon moralement, les séparent, s’abolissent ; un instant, ils se sentent tous pareils les uns aux autres et solidaires, ils se voient égaux devant la sexualité. Entre ces êtres que rien ne rattachait naguère, des liens se créent tout à coup, l’obsession du désir qui fait des soirées de Paris, selon les lieux et les saisons, des fournaises de luxure et transforment la ville du travail et de la pensée en une brûlante cité d’amour.
Cependant, devant les jeux de massacre, les tirs, les loteries d’articles de ménage, se pressent de copieuses familles et les panopticums où, pour dix centimes, on peut faire le tour du monde, jouissent, auprès de ce public sérieux, d’une égale faveur.
Les affreux mannequins, contre lesquels s’acharne la maladresse de ces paisibles boutiquiers et de ces petits bourgeois amis de l’ordre, figurent à leurs yeux tout un état de choses pour le maintien duquel ils se feraient tuer mais qu’il leur plaît, de temps en temps, de bafouer, comme pour se convaincre qu’ils restent, malgré tout, des hommes libres. Qu’un juge, qu’un soldat, qu’un prêtre, qu’un sergot, qu’un gendarme soit culbuté, démoli par un boulet de chiffons, cela leur procure une espèce d’ivresse, leur donne une fierté. Il en est qui visent toujours la même poupée, avec une obstination rancunière ; ce leur est une manière de gesticuler leurs convictions politiques ou religieuses, d’exprimer les idées, les sentiments dominants de leur vie, leurs déboires, leurs désillusions. Celui-ci en veut au juge, celui-là au prêtre, tous au gendarme et à la belle-mère. Et haïe donc ! Les boulets de chiffons, avec un bruit mou, suppriment ces ennemis de l’humanité civilisée, les spectateurs applaudissent ; le massacreur, comme d’usage, est acclamé.
La psychologie est autre des couples qui, durant des heures, restent plantés, de longs cartons en main couverts de chiffres, devant les étalages étincelants de soupières, de saladiers, de vases à fleurs et de nuit, d’objets en porcelaine et en verre de tout genre et de tout emploi.
Ce sont gens d’intérieur qui songent au solide. De quel regard attendri ils contemplent le service à café Louis XV, six tasses, le sucrier et la cafetière, qui excite leurs convoitises ; ceux-là, par contre, c’est sur une garniture de toilette art nouveau, décorée de chardons et de ténias, qu’ils ont jeté leur dévolu ; ils se la montrent du doigt, ils en détaillent le charme, ils en supputent la valeur. On reconnaît un petit ménage d’employés, la femme, blonde grassouillette au visage chiffonné, dans les modes, le mari chez quelque gros commissionnaire du Sentier. « Je t’assure, dit-elle – et elle s’y connaît ! – que c’est l’article de 1795 à la Samaritaine ; le même, exactement. »
Mais un roulement de sonnette Tinte, comme pendant la messe, au moment de l’élévation, et tout le monde se tait. Les roues du hasard se mettent à tourner, elles tournent, elles tournent, éblouissantes, avec un léger bruit de moulin à café. Une minute, une éternité s’écoule ; elles tournent encore, elles tournent toujours.
Trois coups de sonnette, puis un roulement : elles viennent de s’arrêter. Enfin ! La même angoisse étreint tous les cœurs. Le numéro gagnant est proclamé : la garniture de toilette quitte à regret son étagère, se sépare sans plaisir du service à café Louis XV, des soupières, des saladiers, des vases à fleurs et de nuit.
La petite blonde, toute pâle et triomphante, conquiert le pot à eau, tandis que son mari se charge de la cuvette… et les voilà partis ; ils ne sont pas venus ici pour s’amuser. Je les devine rentrés chez eux, je jouis de leur joie puérile, j’entends la femme répéter sans relâche qu’« il n’y a pas à s’y tromper », que « c’est bien l’article de 1795 à la Samaritaine, le même exactement », je vois leur intérieur méticuleusement tenu, d’une irréprochable propreté, chambre en pitchpin, avec un parasol japonais au plafond, salle à manger Henri II en chêne ciré de chez Dufayel (douze mois de crédit, cinématographe, salle des fêtes, etc.). – Comme ils sont fiers de leur bien-être, comme ils sont heureux de vivre ! La chance leur a souri. N’y ont-ils pas, aussi, quelque mérite ?
Ils auraient pu, comme d’autres, se ruer aux montagnes russes, courir aux manèges d’automobiles, de cochons roses, de chats blancs, de maquereaux, d’autruches et de lions, se laisser glisser dans la fantastique spirale du toboggan, rendre visite aux derniers aztèques ou aux fauves de Bidel et de Pezon, pénétrer chez les dresseuses de puces ou chez la femme à trois jambes…
La femme à trois jambes ! Dans une niche de toile peinte, du style mauresque le plus pur, cette phénoménale personne exhibe sa difformité. Pour vingt centimes, pas davantage, on la peut voir juchée sur une estrade, vêtue d’un peignoir de satinette mauve et de dentelles et flanquée de deux cache-pots à paysages de décalcomanie où des coléus artificiels achèvent de se décolorer dans un terreau de mousse pisseuse.
C’est une forte demoiselle dont le teint est piqué de taches de rousseur et dont la chevelure, rare, a la couleur des blés pourris par une averse. La représentation commence, le rideau se lève, c’est-à-dire qu’elle relève sa robe jusqu’au-dessus de ses genoux. Serrées dans des mitaines de laine noire, trois jambes apparaissent, celle du milieu, la supplémentaire, moins grasse que les autres, aux doigts de pied moins bien tenus, et plus courte aussi, car la jeune beauté se met debout et il est facile de constater, – « Approchez-vous, mesdames et messieurs ! » – que cette patte superfétatoire ne touche pas le sol, reste suspendue dans le vide, pend comme une queue : ce n’est, après tout, pas autre chose qu’une queue. Qu’elle appartienne ou non au corps dont elle prétend être le précieux et exceptionnel ornement, que cette monstruosité soit réelle ou machinée, truquée, il n’importe ; l’illusion est complète… et des questions envahissent l’esprit. Cet appendice, comment s’attache-t-il, comment s’amorce-t-il au tronc, où se trouve son point de départ ?… « Ce que ça doit la gêner, tout de même, dans certains cas ! » murmure un loustic ; les deux femmes qui l’accompagnent éclatent de rire, puis lui parlent à l’oreille, le pressent d’interrogations. Il leur répond à mi-voix : on perçoit un susurrement de mots orduriers, d’allusions obscènes et scatologiques.
On voudrait fuir, mais une malsaine curiosité vous retient ; on songe, malgré soi, au mystère de ces dessous, on imagine d’étranges complications, de fantastiques déviations d’organes, on évoque des accomplissements anormaux des fonctions naturelles… Le spectacle, heureusement, prend fin ; le phénomène s’est réinstallé sur sa chaise et pudiquement a laissé retomber son peignoir mauve.
Déjà l’on est dehors, en plein air, l’on se hâte pour échapper aux répugnantes explications que l’homme continue de fournir à ses deux compagnes, à haute et intelligible voix maintenant… on est repris par le tourbillon des musiques, des cris, des coups de lumière, par le chatoiement de la foule dans les couleurs et les bruits où l’ignoble vision se dissipe.
L’horreur suprême, cependant, on ne la peut connaître, l’infini du dégoût, on ne peut l’atteindre qu’entre les murs de toile des musées d’anatomie. On y respire une atmosphère d’hôpital, de morgue, de cimetière, phénol et matières en putréfaction, fadeur du sang répandu, odeur des plaies ouvertes, des ouates iodoformées, des taffetas gommés, de l’éther, du chloroforme.
Dans des cages ou des bocaux, sous des globes et des cloches de verre, s’offre au regard un déballage d’amphithéâtre, un décrochez-moi-ça de salle d’opération et de boucherie humaine. Des membres écorchés saignent sur des étagères, se dressent ou pendent dans des cercueils de velours ; de crânes coupés en deux s’échappent de livides cervelles ; des segments de visages rongés par d’affreux lupus voisinent avec des yeux colossaux et de gigantesques oreilles ; des kystes pareils à des fruits dont la pulpe est bourrée de cheveux, d’épingles, de cure-dents, de pépins, de tout un résidu de poubelle, font pendant à des fœtus extraits de matrices entrouvertes par de reluisants forceps, tandis que des cœurs au péricarde transparent révèlent le mystère des ventricules et des oreillettes, des valvules et des veines pulmonaires, et que l’on peut assister, grâce à une série de planches et de reliefs, au travail complet de la digestion.
Mais ce ne sont là, si l’on peut dire, que les bagatelles de la porte, le pelotage avant le jeu : armez-vous de courage et franchissez, pour vingt-cinq centimes de supplément, le seuil du musée secret, où ne pénètrent que les jeunes gens au-dessus de quinze ans et les dames accompagnées. Aux relents de salle de garde s’ajoutent des parfums de mauvais lieu : c’est le sanctuaire de l’amour et de la mort, des suggestions aphrodisiaques et en même temps des hontes sexuelles, des tares inavouées ; c’est le royaume des épouvantements. On y parle à voix basse, la gorge serrée, les nerfs tordus par une angoisse ; on se sent blêmir en se penchant sur ces figurations, grandeur nature, d’organes rongés par d’épouvantables chancres, déformés par de parasites végétations, sur ces moulages de sexes composites, d’appareils génitaux fabuleux et excessifs. Cela est à la fois burlesque et lugubre, ridicule et effrayant ; on ne peut s’empêcher de songer, avec terreur, à l’existence atroce des pauvres êtres que la nature favorise de pareilles infirmités, à qui le hasard inflige le supplice de tels châtiments, d’aussi cruelles expiations ; et l’on a envie de pleurer et de vomir…
Quelle délivrance de se retrouver parmi des vivants, de voir des visages qui sourient, s’animent, des yeux qui brillent, au sortir de ce charnier ! et comme ces hommes et ces femmes, qui vont et viennent sous les guirlandes de fleurs électriques, cohue confuse que surexcite l’appétit du plaisir, paraissent séduisants, même beaux, après ce cauchemar de sang et de mort ! Ils s’amusent, ils sont de grands enfants dans le jardin des illusions, et il leur suffit de si peu pour oublier leurs misères, les menaces des maladies, des désastres, les luttes de la vie quotidienne, leur médiocrité, leurs inquiétudes d’avenir ! Ils s’amusent. Délicieuse naïveté, inestimable don d’échapper à soi-même, de se fuir ! Ils s’amusent, ou ils en ont l’air, et c’est assez pour créer cette fièvre de gaieté, cette contagion d’entrain.
Ces spectacles, ce mouvement, ces décors flamboyants, ces musiques, tout cela n’offre à leurs yeux aucune nouveauté, rien d’imprévu ni d’inédit ; ils le connaissent depuis des années. Ils en jouissent, cependant, aussi franchement et aussi fraîchement qu’au premier jour.