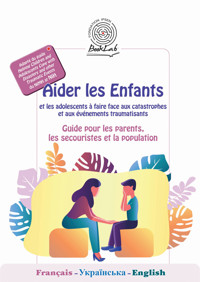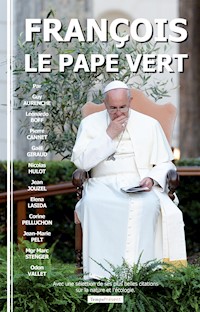
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Temps Présent éditions
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Un texte religieux qui a fait du bruit...
Onze personnalités de tous horizons livrent leurs analyses de l'encyclique du pape François sur l'écologie,
Laudato Si'. Cet ouvrage constitue à ce titre la première étude de fond qui porte sur ce texte majeur.
Ces auteurs expliquent pourquoi le pape a suscité, avec cette encyclique, une petite révolution dans l'Église catholique comme en dehors.
Si certains soulignent des contradictions ou des manques, tous constatent la puissance novatrice et la clarté du propos.
Une analyse intéressante du plaidoyer vert du pape François Ier !
EXTRAIT
Au-delà de la très forte visibilité de ce texte et des réactions d’enthousiasme qu’il a suscitées, auprès des catholiques comme des non croyants, des militants écologistes les plus aguerris comme d’un grand public moins initié, il marque, par certains aspects, un tournant dans le discours catholique. Ce constat est établi de façon unanime par les contributeurs de cet ouvrage. Le premier point qui l’atteste est que jamais aucune publication officielle du Vatican -
a fortiori aucune encyclique - n’avait été intégralement consacrée à l’écologie. Le sujet a été abordé dans d’importants textes, dont quelques encycliques (notamment
Caritas in Veritate, de Benoît XVI, en 2009) mais il n’en était pas le thème majeur.
Un deuxième révélateur concerne la radicalité du constat, et la très grande clarté d’expression du pape dans la façon dont il l’expose.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Un guide de lecture passionnant -
René Poujol
LES AUTEURS
-
Guy Aurenche, avocat, président du CCFD-Terre solidaire
-
Leonardo Boff, théologien brésilien
-
Pierre Cannet, responsable du programme « climat et énergie » à WWF-France
-
Gaël Giraud, jésuite, économiste
-
Nicolas Hulot, envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète
-
Jean Jouzel, climatologue, membre du GIEC et du Conseil économique, social et environnemental
-
Elena Lasida, économiste franco-uruguayenne, professeur à l'Institut catholique de Paris, chargée de mission « écologie et société » à la Conférence des évêques de France
-
Corine Pelluchon, philosophe
-
Jean-Marie Pelt, botaniste, essayiste, président de l'Institut européen de l'écologie
-
Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes, président de Pax Christi – France
-
Odon Vallet, historien des religions, essayiste
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
INTRODUCTIONLaudato Si’, une révolution durable ?
De mémoire de catholique, on n’avait jamais vu ça : l’accueil réservé à la lettre encylique du pape sur l’écologie, Laudato Si’, est inédit. Le successeur de Benoît XVI, élu le 13 mars 2013, avait déjà réussi à marquer son début de pontificat d’une spectaculaire notoriété. Par des gestes et des paroles qui en ont réjoui beaucoup et agacé quelques-uns - jusqu’à l’intérieur du Vatican - il a frappé les esprits en s’exprimant à propos des personnes homosexuelles (« Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger ? »), des divorcés-remariés (qui « font toujours partie de l’Église »), des dérives du Vatican (« Le peuple de Dieu veut des pasteurs et pas des fonctionnaires ou des clercs d’État ») et plus généralement des pauvres, des exclus, des marginaux dont il s’est fait le porte-parole de façon fracassante, maniant comme personne le pouvoir des images : on l’a vu laver les pieds de prisonniers et de personnes handicapées, embrasser et enlacer un homme défiguré… Ce qui laissait certains observateurs sceptiques, jugeant qu’il s’agissait là surtout de communication, mais que rien ne changeait vraiment sur le fond, c’est-à-dire dans la doctrine - « Le pape François fait-il surtout du marketing ? », s’interrogeait le quotidien La Libre Belgique, le 31 janvier 2014.
Jusqu’à cet « appel » du 18 juin 2015, jour de publication de Laudato Si’. Qui déclencha aussitôt un véritable tourbillon vert. Et qui amorce quelques petites révolutions, aussi bien théologiques que politiques. De nombreux catholiques parlent d’un texte « prophétique », à l’image de Jean-Marie Pelt, dans sa contribution au présent ouvrage. Et n’a t-on pas vu l’une des grandes figures des mouvements altermondialistes, l’essayiste canadienne Naomi Klein, publier une tribune dans la prestigieuse revue américaine The New Yorker : « A radical Vatican ? » (10 juillet 2015). Elle qui a été invitée officiellement à présenter l’encyclique lors d’une conférence de presse au Vatican, le 1er juillet 2015, aux côtés de trois représentants de l’Église catholique…
L’importance de ce texte est apparue dans les jours et semaines qui ont suivi sa publication, grâce à des indicateurs très précis. D’une part, le document est très vite devenu un best-seller de l’été. Un mois seulement après sa parution, plus de cent mille exemplaires avaient été vendus en librairie en France. Alors même que l’on pouvait se le procurer gratuitement sur à peu près tous les sites catholiques, ainsi que sur de nombreux autres. Celui du quotidien La Croix a enregistré des milliers de téléchargements dans les quinze jours qui ont suivi sa mise en ligne.
Grâce au pape, l’écologie fait vendre
D’autre part, les médias, toutes catégories confondues, s’en sont emparés immédiatement et massivement. Dans la presse écrite, enquêtes, commentaires et tribunes se sont succédé pour décrypter le contenu de l’encyclique. En France, cela fut particulièrement vrai dans les journaux et revues catholiques, qui ont enchaîné dossiers et horsséries. L’écologie est devenue un argument de vente pour la presse, ce qui est une vraie première ! Ce thème était jusque là dédaigné aussi bien par les rédacteurs en chef que par les services marketing des journaux, catholiques ou non. Aux États-Unis, où la religion et la théologie sont beaucoup plus présentes dans le débat public, tous les grands quotidiens et magazines s’en sont également emparés. Dans les médias chrétiens, dont certains ont une audience et une influence très fortes, et où les débats théologiques sont beaucoup moins feutrés qu’en France, de très nombreuses analyses ont été publiées, souvent très fouillées, parfois contradictoires, qui ont décortiqué l’encyclique dans ses moindres détails.
Enfin, la vague d’enthousiasme soulevée par Laudato Si’ a pu se mesurer au nombre de réunions, débats et conférences qu’elle a suscités. Chez les catholiques d’abord, où paroisses et groupes de réflexion se sont emparé de ce sujet les uns après les autres, sollicitant parfois des spécialistes pour la décrypter, comme en témoigne Pierre Cannet, du WWF, dans ce livre. L’événement de l’été en France fut la tenue à Saint-Étienne (42) des Assises chrétiennes de l’écologie, co-organisées par le diocèse et l’hebdomadaire La Vie, qui ont rassemblé près de deux mille participants en trois jours ! Beaucoup plus que les universités d’été organisées par les partis politiques cet été-là… Nicolas Hulot, qui n’est pas pour rien dans ce nouvel intérêt des catholiques pour l’écologie, puisqu’il a incité tous les responsables religieux qu’il a pu rencontrer ces dernières années, jusqu’au pape, à s’emparer de ce sujet, organisa le 21 juillet 2015, à Paris, un Sommet des consciences. Il rassembla représentants religieux, associatifs et politiques venus du monde entier, signataires d’un « Appel des consciences » destiné aux négociateurs de la Conférence des Nations-Unies sur les changements climatiques (COP21) : « Vous contribuerez, aux côtés de millions de personnes à travers le monde, comme récemment le pape François, à faire du changement climatique et de la protection de notre planète un enjeu qui concerne personnellement chacun dans ses croyances et ses valeurs. »
Quelques semaines plus tard, le 16 septembre, le pape reçut au Vatican les ministres de l’Écologie des principaux pays européens, ainsi que deux commissaires européens, à qui il demanda d’« honorer [la] dette écologique, surtout entre le Nord et le Sud » et d’« unir la lutte contre la dégradation de l’environnement à celle contre la pauvreté ». Il évoqua le sujet à nouveau lors de ses deux déplacements historiques, à Cuba, puis aux États-Unis, où, le 24 septembre, pour la première fois de l’histoire de ce pays, un pape a été invité à prendre la parole devant le Congrès (qui réunit en session spéciale le Sénat et la Chambre des représentants). Puis le 25 septembre, devant l’Assemblée générale de l’Onu, à l’occasion d’un Sommet sur le développement durable, où il rappela que « toute atteinte à l’environnement est une atteinte à l’humanité ». Le pape François savait précisément ce qu’il faisait en publiant Laudato Si’ quelques mois avant la tenue de la COP21 à Paris : il s’agissait de faire pression sur les principaux chefs d’État et de gouvernement de la planète, informés que l’issue de la conférence serait jugée par un arbitre non négligeable, le chef de 1,2 milliard de catholiques.
L’Église catholique a choisi son camp
Au-delà de la très forte visibilité de ce texte et des réactions d’enthousiasme qu’il a suscitées, auprès des catholiques comme des non croyants, des militants écologistes les plus aguerris comme d’un grand public moins initié, il marque, par certains aspects, un tournant dans le discours catholique. Ce constat est établi de façon unanime par les contributeurs de cet ouvrage. Le premier point qui l’atteste est que jamais aucune publication officielle du Vatican - a fortiori aucune encyclique - n’avait été intégralement consacrée à l’écologie. Le sujet a été abordé dans d’importants textes, dont quelques encycliques (notamment Caritas in Veritate, de Benoît XVI, en 2009) mais il n’en était pas le thème majeur.
Un deuxième révélateur concerne la radicalité du constat, et la très grande clarté d’expression du pape dans la façon dont il l’expose. Cela apparaît plus particulièrement à deux niveaux. D’une part, celui des arguments scientifiques. Comme le confirme un membre éminent du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), Jean Jouzel, dans les pages qui suivent, le pape s’est explicitement inspiré des rapports de cet organisme, qui rassemble des scientifiques de nombreux pays et divers domaines d’activité, pour décrire la situation actuelle. Tandis que certains catholiques pouvaient être hésitants, et que d’autres affirmaient clairement leur opposition à déclarer les activités humaines comme coresponsables du réchauffement climatique, le doute n’est plus permis : l’Église, par la voix de son premier représentant, a choisi son camp. Et ce n’est pas celui des climato-sceptiques. Il n’est sans doute pas anodin, à ce titre, que le pape ait choisi de citer Teilhard de Chardin dans Laudato Si’. Il semble vouloir renouer ici avec une tradition de cohabitation sereine et constructive entre l’Église catholique et la communauté scientifique. Sans doute sa formation d’ingénieur chimiste n’est-elle pas étrangère à cette prise de position.
D’autre part, il y a le lien fait avec l’économie et la politique. Le pape dénonce, comme principales responsables des atteintes portées à l’environnement, les politiques économiques dont le seul objectif est la recherche du profit. Comme le souligne l’économiste Gaël Giraud dans sa contribution à cet ouvrage, François vise en particulier les grandes firmes qui n’hésitent pas à piller les ressources des pays pauvres, celles qui se font les apôtres d’un progrès technologique sans frein et sans fin, et les décideurs politiques qui laissent tous ces prédateurs agir sans limite. Un article du site américain spécialisé Religion & Politics a parfaitement analysé dans un long article ce double axe, moral et politique, autour duquel tourne le propos de Laudato Si’ : « L’encyclique écologique porte-t-elle un discours moral ou un acte d’accusation politique ? » (24 juin 2015 - www.religionandpolitics.org). Si les prédécesseurs de François étaient à peu près sur la même ligne de dénonciation de la globalisation financière et de la course folle au profit, ils n’étaient pas allés aussi loin ni dans la précision ni dans la radicalité des accusations. Et ils n’avaient pas mis ces critiques au service d’une vision plus large de la protection de l’environnement.
Certains, qui se sont sans doute sentis visés, ont d’ailleurs réagi assez vivement. Aux États-Unis en particulier, où la campagne des primaires pour la présidentielle de 2016 battait son plein au moment de la publication de l’encyclique et du voyage du pape à New-York et Washington. Un article du New York Times a rapporté les propos de candidats à la primaire républicaine, tous deux catholiques et… climato-sceptiques : « Je ne m’inspire pas, pour ma politique économique, de ce que disent mes évêques, mes cardinaux, ni même mon pape », déclara Jeb Bush ; « les hommes ne sont pas responsables du changement climatique, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire », commenta pour sa part Marco Rubio, sénateur de Floride (« Le point de vue du pape sur le changement climatique met la pression sur les candidats catholiques », 16 juin 2015). De son côté, le site The federalist, qui se présente comme conservateur et de droite, répliqua en publiant la tribune d’un pasteur luthérien : « Pape François, la terre n’est pas ma sœur » (www.thefederalist.com, 23 juin 2015).
La bioéthique à l’arrière-plan
Sur un plan plus théologique, deux inflexions sont clairement marquées dans Laudato Si’. La première concerne les questions bioéthiques. Si la protection de l’environnement était un sujet secondaire dans les textes et discours des deux prédécesseurs de François, c’est en partie parce qu’elle s’effaçait derrière un impératif absolu pour ces tenants de « l’écologie humaine » - expression popularisée par Jean-Paul II, à laquelle François préfère l’« écologie intégrale » - : le respect de la dignité humaine, c’est-à-dire de l’intégrité de la personne de sa conception à sa mort, c’est-à-dire essentiellement l’interdiction de l’avortement, de la manipulation des embryons et de l’euthanasie. Quasiment aucun texte ni discours sur l’écologie ne se concluait sans accorder une place centrale à ces questions, de la part de Jean-Paul II comme de Benoît XVI.
« L’action en faveur de la paix ou de la nature est donc subordonnée au respect de l’embryon et du fœtus. De fait, au soutien de principe que l’Église fournit à la cause écologiste, ne correspond pas un engagement concret comparable à celui qu’elle déploie dans la lutte contre l’avortement, la procréation assistée ou le mariage homosexuel », analyse Isacco Turina, professeur de science politique et sociale à l’Université de Bologne, à propos du pontificat de Jean-Paul II (« L’Église catholique et la cause de l’environnement », revue Terrain, mars 2013). Il rappelle une citation éloquente de ce dernier : « Aucun mouvement écologique n’est à prendre au sérieux s’il ferme les yeux sur les mauvais traitements et l’extermination d’un nombre incalculable d’enfants viables dans le sein de leur mère » (« Choisir la vie, défendre la vie. Discours aux jeunes devant l’université de Münster », 1987. La documentation catholique, n° 1941). Ce discours avait pour conséquence directe, entre autres, de faire fuir l’immense majorité des militants écologistes, qui ne voulaient pas être associés à ces prises de position.
Sur le fond, François ne change pas grand chose à la doctrine catholique en matière de bioéthique. En revanche, il renverse radicalement la hiérarchie des valeurs : quand il parle d’écologie, ces questions sont abordées de façon très succinte, quasi évasive, ce qui, de fait, les relègue à un lointain arrière-plan. Dans Laudato Si’, le mot avortement n’apparaît qu’une fois. Son interdiction est rappelée dans un des paragraphes les plus courts du texte, et tient en une phrase : « Puisque tout est lié, la défense de la nature n’est pas compatible non plus avec la justification de l’avortement » (§ 120). Idem pour les expérimentations sur l’embryon, dont la condamnation est rappelée de façon très lapidaire en une formule : « En général, on justifie le dépassement de toutes les limites quand on fait des expérimentations sur les embryons humains vivants » (§ 136). Quant à l’euthanasie… elle est absente du texte.
Autre sujet de prédilection de ses prédécesseurs, Benoît XVI particulièrement, que François bouscule ici de façon beaucoup plus vive, celui du relativisme. Tout le projet de Benoît XVI consistait à vouloir consolider la doctrine catholique sur ses dogmes fondamentaux pour la rendre plus cohérente et forte, et, pensait-il, plus apte à la faire entendre dans un monde en pleine perte de repères. D’où sa condamnation récurrente du relativisme, et son insistance à démarquer le catholicisme des autres religions, voire des autres croyances, pour mieux affirmer sa spécificité, sa valeur ajoutée en quelque sorte (c’est notamment l’un des thèmes développés dans Caritas in veritate). Or que fait le pape François dès les premières lignes de Laudato Si’ ? S’il se réfère largement à Jean-Paul II et Benoît XVI, affirmant à travers eux sa fidélité à la tradition, il cite également un patriarche orthodoxe, Bartholomée, un philosophe protestant, Paul Ricœur et… un musulman soufi, Alî al-Khawwâç !
Dans un article d’America, hebdomadaire jésuite américain, un enseignant d’université, Kevin Ahern, glisse aux lecteurs de l’encyclique le conseil qu’il donne à ses élèves dans ses cours sur la doctrine sociale de l’Église : « Suivez les notes de bas de page » (« Follow the footnotes », 18 juin 2015). Et de souligner qu’avec cet indice, on peut mesurer la distance que François prend avec ses prédécesseurs. En effet l’auteur fait remarquer que d’habitude, les notes de bas de page des encycliques font exclusivement référence à des auteurs catholiques : « Par exemple, Caritas in veritate, l’encyclique sociale du pape Benoît XVI publiée en 2009, compte 159 notes. Elles font majoritairement référence à la doctrine sociale officielle professée par les autres papes ; plusieurs autres rappellent ses propres enseignements ; quelques-unes mentionnent les écrits des grands saints ou des publications officielles du Vatican. Aucune ne mentionne des sources non catholiques ou non doctrinales. C’est aussi largement le cas avec les encycliques sociales de Saint Jean-Paul II. » Pour la première fois, François rompt avec ce principe, et cite des auteurs non catholiques. « Les notes de François marquent une significative prise de distance avec la tradition », constate Kevin Ahern.
En suivant ces notes, l’auteur livre un second indice intéressant : elles font également référence à des décisions prises par des épiscopats nationaux. L’auteur a compté pas moins de dix-huit pays cités. Ce qui est tout à fait nouveau, et rappelle la volonté, énoncée à plusieurs reprises déjà par le pape François, d’aplatir la pyramide hiérarchique de l’institution catholique, en donnant plus de place et d’importance aux conférences épiscopales nationales. Et de fait, moins de place et d’importance aux prises de position du pape, c’est-à-dire moins d’autorité à ce dernier. « C’est un signe adressé en faveur d’une vision plus décentralisée de l’Église, où les déclarations des conférencesépiscopales prennent de la valeur dans la constitution de la doctrine sociale de l’Église catholique », écrit Kevin Ahern. Alors que « sous les pontificats de Jean-Paul II et Benoît XVI », elles étaient perçues comme n’ayant « aucune autorité en matière d’enseignement » de la doctrine sociale, rappelle l’auteur. Il s’agit donc ici, esquissée mais bien présente, d’une petite révolution.
L’importance accordée aux conférences nationales des évêques, et plus précisément à celles de pays du Sud, abondamment citées, marque un rapprochement qui fait lui aussi office de petite révolution : celui du Vatican avec la théologie de la Libération. L’une de ses principales figures, le théologien brésilien Leonardo Boff, se réjouit dans l’ouvrage présent du contenu comme de la forme de l’encyclique Laudato Si’, et décrypte les sources d’inspiration qu’elle puise explicitement dans la théologie de la Libération. Or faut-il rappeler que Leonardo Boff avait été interdit d’enseignement en 1984 par le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi… un certain Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI ?
Dans sa tribune du New Yorker, Naomi Klein raconte sa rencontre marquante à Rome avec le prêtre et théologien irlandais Sean McDonagh, ancien co-directeur de Greenpeace-Irlande, qui a été un des artisans de Laudato Si’. Tout en lui rappelant que la tradition catholique irlandaise, comme les sud-américaines, avait réconcilié depuis longtemps « un Dieu chrétien avec une terre mystique », il lui expliqua que sa dernière audience papale, avant d’avoir été appelé par François, remontait à… 1963. En insistant sur les changements profonds qui sont à l’œuvre au Vatican, il déclara à son interlocutrice : « Nous allons vers une nouvelle théologie. »
Nuances et impasse
Ce constat général appelle cependant quelques modérations. D’une part, les innovations de Laudato Si’ méritent d’être en partie relativisées, d’autre part, ses impasses et contradictions doivent être soulignées.