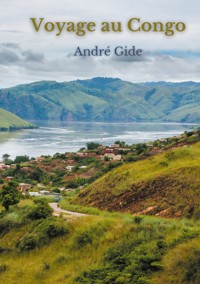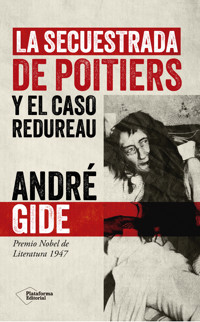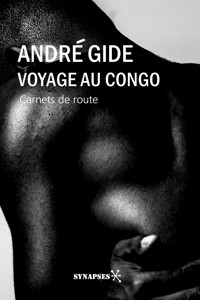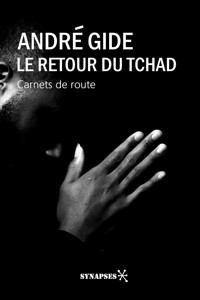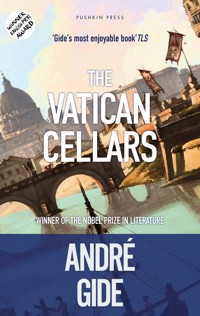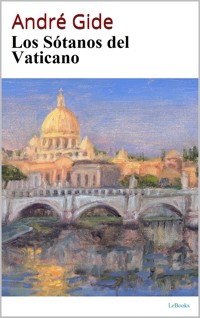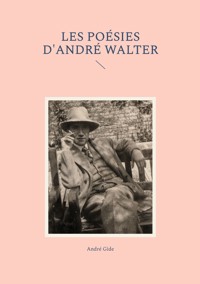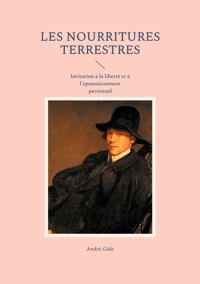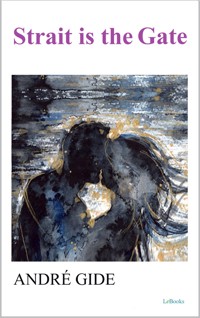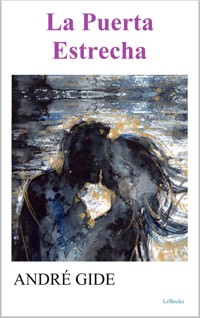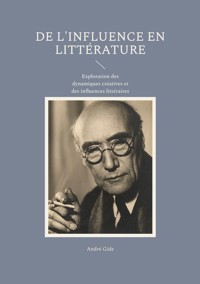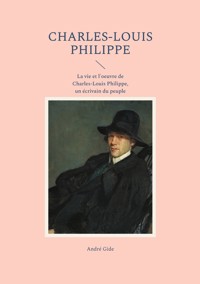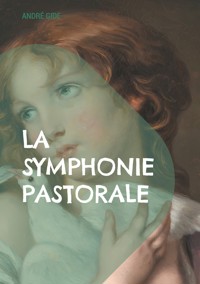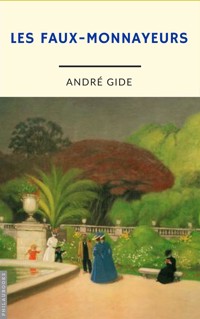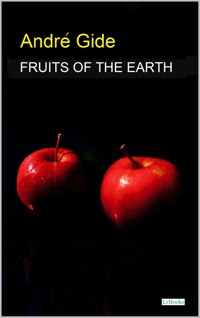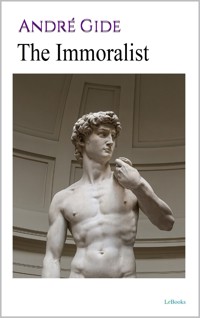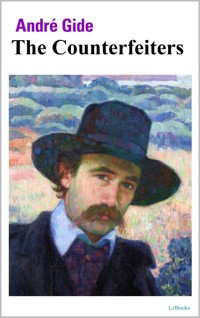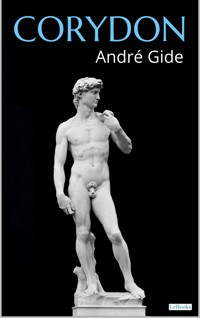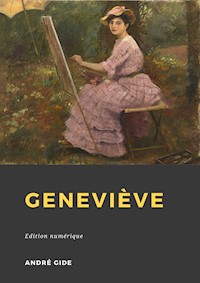
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Librofilio
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Geneviève, sous-titré La Confidence inachevée, est un roman d'André Gide publié en novembre 1936 aux éditions Gallimard. Il fait partie d'une trilogie, dont il constitue le « troisième tome » incluant
L'École des femmes (1929) et
Robert (1930), et pourrait s'intituler La Nouvelle École des femmes. En août 1931, Geneviève X demande à André Gide de publier son récit personnel, à la suite de l'édition du journal de sa mère Éveline X paru sous le titre de L'École des femmes et du droit de réponse de son père Robert X paru, peu après, sous celui de Robert. Elle relate son enfance et son éducation, vécues entre des parents dont le couple aux points de vue si différents n'est plus en harmonie, et sa découverte d'une passion trouble et inavouée pour l'une de ses condisciples de lycée, Sara Keller, la fille d'un peintre juif célèbre.
À PROPOS DE L'AUTEUR
André Gide (1869 - 1951) était un auteur français et lauréat du prix Nobel de littérature (en 1947). La carrière de Gide s'étend de ses débuts dans le mouvement symboliste à l'avènement de l'anticolonialisme entre les deux guerres mondiales. Auteur de plus de cinquante livres, au moment de sa mort sa nécrologie dans le New York Times le décrivait comme "le plus grand homme de lettres contemporain de France" et "jugé le plus grand écrivain français de ce siècle par les connaisseurs littéraires".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geneviève
André Gide
– 1936 –
GENEVIÈVEouLA CONFIDENCE INACHEVÉE
Peu de temps après la publication de L’École des Femmes, puis de Robert, j’ai reçu, en manuscrit, le début d’un récit en quelque sorte complémentaire, c’est-à-dire pouvant être considéré, s’ajoutant aux deux autres, comme le troisième volet d’un triptyque.
Après avoir longtemps attendu la suite, je me décide à donner ce début tel quel, avec, en manière d’introduction, la lettre qui l’accompagnait.
ANDRÉGIDE.
Août 1931.
Monsieur,
Puis-je espérer que vous consentirez à couvrir de votre nom, comme déjà vous avez fait pour le journal de ma mère, puis pour la défense de mon père, le livre que je vous envoie ?
Je crains que ce livre ne soit pas du tout de nature à vous plaire. N’étant guère friande de littérature, je ne vous ai pas beaucoup lu, je l’avoue ; assez toutefois pour me convaincre que les questions qui m’intéressent vous laissent indifférent ; du moins je n’en trouve pas trace dans vos livres. Les sujets que vous y abordez échappent autant qu’il se peut à ce que vous semblez considérer comme des « contingences » indignes de votre attention, tandis que vous ne trouverez ici, exposés sans art, que des problèmes d’ordre pratique. Votre esprit plane dans l’absolu ; je me débats dans le relatif. La question n’est point pour moi, comme pour les héros que vous peignez et pour vous-même, d’une façon vague et générale, que peut l’homme ? mais bien, d’une manière toute matérielle et précise : Qu’est-ce que, de nos jours, une femme est en mesure et en droit d’espérer ?
N’est-il pas naturel que ce « problème » paraisse, pour la femme encore jeune que je suis, de première importance ? Si important soit-il, ce n’est que de nos jours qu’il commence vraiment à se dresser. Oui, ce n’est que depuis la guerre, où tant de femmes ont fait preuve d’une valeur et d’une énergie dont les hommes ne les eussent point crues capables, que l’on commence à leur reconnaître, et qu’elles-mêmes commencent à revendiquer, leurs droits à des vertus qui ne soient pas simplement privatives, de dévouement, de soumission et de fidélité ;de dévouement à l’homme, de soumission à l’homme, de fidélité à l’homme ; car il semblait jusqu’à présent que toutes les vertus affirmatives dussent demeurer l’apanage de l’homme et que l’homme se les fût toutes réservées. Je crois que nul ne peut contester aujourd’hui que la situation de la femme a changé considérablement depuis la guerre. Et peut-être ne fallait-il pas moins que cette catastrophe effroyable pour permettre aux femmes de rendre manifestes des qualités qui semblaient jusqu’à ce jour exceptionnelles ; pour permettre à la valeur des femmes d’être prise en considération.
Le livre de ma mère s’adresse à une génération passée. Du temps de la jeunesse de ma mère, une femme pouvait souhaiter sa liberté ; à présent il ne s’agit plus de la souhaiter, mais de la prendre. Comment et à quelles fins ? c’est ce qui importe et que je vais tâcher de dire, du moins pour ce qui est de moi.
Je ne me pose pas en exemple ; mais il me semble que le simple récit que je veux faire de ma vie peut avertir ; je le donne comme une suite au journal de ma mère, comme une Nouvelle École des Femmes. Et pour bien indiquer que ce n’est là qu’un exemple entre maints autres, qu’un exemple particulier, je l’intitulerai Geneviève, nom d’emprunt sous lequel je figure déjà dans le journal de ma mère.
PREMIÈRE PARTIE
En 1913, comme je venais d’avoir quinze ans, ma mère me fit entrer au lycée, malgré la vive désapprobation de mon père ; mais, de volonté faible en dépit de ses airs assurés, mon père cédait toujours, quitte à se payer de sa défaite en une menue monnaie de critiques continuelles. Cette éducation de lycée fut responsable, selon lui, de ce qu’il appela mes « écarts de pensée », puis, plus tard, de mes « écarts de conduite ».
Je tiens de ma mère un certain goût pour le travail, et une assiduité naturelle qu’elle encourageait en feignant de s’instruire à travers moi. Lorsque je rentrais du lycée, elle m’aidait à mes devoirs, apprenait avec moi mes leçons, et je lui rapportais tout ce que j’avais appris en classe, comme d’autres raconteraient ce qu’ils ont vu ou entendu dans une sortie en ville. C’est ce qui lui donna, je crois, l’illusion que je pusse avoir eu sur elle plus d’influence qu’elle n’en avait eu sur moi. Cette illusion – si c’en est une – elle cherchait à me la donner à moi-même, et rien ne servit plus à me mûrir, à entretenir mon zèle et une certaine confiance en soi, qui lui manquait.
Je dois également à ma mère un ardent désir, un besoin de me rendre utile, et si déjà ce désir existait naturellement en moi, sommeillant, elle sut l’éveiller, l’aviver sans cesse. Il était alimenté chez ma mère par un extraordinaire amour pour les pauvres, les souffrants et tous ceux que mon père appelait (que ma mère se refusait d’appeler) « nos inférieurs ». J’ai d’autant plus à cœur de le dire que ni le journal de ma mère, ni le plaidoyer de mon père, n’en laisse rien connaître. Ma mère se dépensait et se dévouait non seulement sans ostentation, mais même en se cachant, comme de tout ce qui eût pu lui attirer quelques louanges. Cette pudeur extrême et cette modestie (que je n’ai pas héritées d’elle, il faut bien que je l’avoue) étaient telles que l’on pouvait vivre près d’elle longtemps sans se douter de ses vertus. Mon père avait, tout au contraire, un aussi constant souci de se faire valoir que ma mère de s’effacer. Il semblait qu’il attachât plus de prix à l’apparence de la vertu qu’à la vertu même. Je ne pense pas qu’il fût précisément un hypocrite et qu’il ne cherchât pas à devenir tel qu’il se montrait ; mais chez lui le geste ou la parole précédait toujours l’émotion ou la pensée, de sorte qu’il restait toujours en retard et comme endetté envers lui-même. Ma mère souffrait beaucoup de cela ; et je l’aimais trop pour ne pas détester mon père.
En classe, ma voisine de droite était, de toutes mes camarades, celle qui attirait et retenait le plus mon regard. De peau brune, ses cheveux noirs bouclés, presque crépus, cachaient ses tempes et une partie de son front. On n’eût pu dire qu’elle était précisément belle, mais son charme étrange était pour moi beaucoup plus séduisant que la beauté. Elle s’appelait Sara et insistait pour qu’on ne mît pas d’h à son nom. Lorsque, un peu plus tard, je lus Les Orientales, c’est elle que j’imaginais, « belle d’indolence », se balancer dans le hamac. Elle était bizarrement vêtue, et l’échancrure de son corsage laissait voir une gorge formée. Ses mains rarement propres, aux ongles rongés, étaient extraordinairement fluettes.
– Qu’est-ce que vous avez à me reluquer comme ça ? – me dit-elle brusquement le premier jour.
Je détournai les yeux en rougissant beaucoup et n’osai lui dire que je la trouvais ravissante. Les autres élèves ne semblaient pas de mon avis et, dans les conversations que je surpris, on s’accordait à critiquer son teint de « bohémienne ». Son air grave et le presque constant froncement de ses sourcils, qui plissait légèrement son beau front, semblaient indiquer une tension de volonté singulière, une attention… j’aurais voulu savoir à quoi, car ce n’était certes pas au cours. Lorsqu’il arrivait qu’on l’interrogeât, on se rendait aussitôt compte qu’elle n’avait rien écouté ; et si, dans ses moments de tension, elle paraissait plus âgée qu’aucune de nous, encore qu’elle me dît être exactement de mon âge, de brusques élans de joie, des sortes de transes de gaieté, la replongeaient aussitôt après dans l’enfance.
Dès les premiers jours, je m’épris pour elle d’un sentiment confus que je n’avais jamais encore éprouvé pour personne et qui me paraissait si neuf, si étrange, que je doutais si c’était bien moi, Geneviève, qui l’éprouvais, et si ne m’envahissait pas une personnalité étrangère qui me dépossédait de ma volonté et de mon corps. Cependant Sara semblait me remarquer à peine, et je ne sais de quelle extravagance je me sentais capable pour attirer son attention. Je cherchais ce qui pouvait lui plaire ; elle semblait malheureusement insensible à tous les succès scolaires et je me dépitais qu’elle parût si peu remarquer les miens. Lorsque je lui parlais, elle me répondait à peine ; ce que je lui disais ne semblait jamais l’intéresser. Elle était certes loin d’être sotte et son prestige, à mes yeux, était tel que je ne pouvais croire qu’elle ne fût pas supérieure dans quelque domaine ; mais je ne pouvais découvrir en quoi. Certain jour de concours de récitation, j’eus une brusque révélation. Après que plusieurs élèves et moi-même nous eûmes plus ou moins péniblement ressassé les stances du Cid, le songe d’Athalie ou le récit de Théramène, sans autre souci que de ne point trébucher et comme si ces vers n’eussent été écrits qu’en vue d’exercer notre mémoire, notre maîtresse de français appela Sara :
– Quitter votre place, venez devant la chaire et montrez-nous comment on doit dire les vers.
Sara, sans gêne aucune, s’avança puis, face aux élèves, commença de réciter la première scène de Britannicus. Sa voix, plus pleine et plus grave que d’ordinaire, prenait une sonorité que je ne lui connaissais pas encore. Ainsi que les autres élèves j’avais appris ces vers par cœur ; notre maîtresse nous les avait commentés, en avait fait valoir les mérites, mais je ne m’étais pas encore avisée de leur beauté. Celle-ci m’apparut soudain à travers la récitation de Sara ; et un frisson quasi religieux coula le long de mon dos, me secoua tout entière tandis que les larmes emplissaient mes yeux. La maîtresse elle-même semblait émue.
– Mademoiselle Keller, – dit-elle enfin, après que la récitation fut finie, – nous vous remercions toutes. Avec les dons que vous avez, vous êtes inexcusable de ne pas travailler davantage.
Sara fit une courte révérence ironique, une sorte de pirouette, et rejoignit sa place auprès de moi.
J’étais toute tremblante d’une admiration, d’un enthousiasme que j’eusse voulu pouvoir lui exprimer, mais il ne me venait à l’esprit que des phrases que je craignais qu’elle ne trouvât ridicules. La classe était près de finir. Vite, je déchirai le bas d’une feuille de mon cahier ; j’écrivis en tremblant sur ce bout de papier : « Je voudrais être votre amie » et glissai vers elle gauchement ce billet.
Je la vis froisser le papier ; le rouler entre ses doigts. J’espérais un regard d’elle, un sourire, mais son visage restait impassible et plus impénétrable que jamais. Je sentis que je ne pourrais supporter son dédain et m’apprêtais à la haïr.
– Déchirez donc ça, – lui dis-je d’une voix contractée. Mais, soudain, elle redéplia le papier, passa sa main dessus pour l’aplanir, et comme ayant pris une résolution… À ce moment, j’entendis mon nom : la maîtresse m’interrogeait. Je dus me lever, je récitai de manière machinale un court poème de Victor Hugo qu’heureusement je savais fort bien. Dès que je fus rassise, Sara glissa dans ma main le billet au verso duquel elle avait écrit : « Venez chez nous dimanche prochain, à trois heures. » Mon cœur se gonfla de joie et, enhardie :
– Mais je ne sais pas où vous habitez !
Alors, elle :
– Passez-moi le papier.
Et tandis que, la classe finie, les élèves rassemblaient leurs affaires et se levaient pour partir, elle écrivit au bas du billet : « Sara Keller, 16, rue Campagne-Première. »
J’ajoutai prudemment :
– Je ne sais pas encore si je pourrai ; il faut que je demande à maman.
Elle ne sourit pas précisément, mais les coins de ses lèvres se relevèrent. Ça pouvait être de la moquerie ; aussi ajoutai-je bien vite :
– Je crains que nous ne soyons déjà invitées. Habitant dans un tout autre quartier et assez loin du lycée, je devais me séparer de Sara dès la sortie ; d’ordinaire je m’en allais seule et très vite. Ma mère, qui voulait me marquer sa confiance, ne venait pas me chercher, mais elle m’avait fait promettre de rentrer toujours directement et de ne m’attarder point à causer avec les autres élèves. Ce jour-là, je courus durant la moitié du trajet, tant j’étais pressée de lui faire part de la proposition de Sara. Je n’étais pas du tout sûre que ma mère acceptât, car, en dehors du lycée, elle ne me laissait que rarement sortir seule. D’ordinaire je n’avais rien de caché pour ma mère ; pourtant je ne sais quelle pudeur m’avait jusqu’alors retenue de lui parler de Sara. Je dus tout dire en une fois : et la récitation de Britannicus et mon enthousiasme que je ne cherchai pas à cacher, et même cette attirance singulière que j’aurais été bien incapable de taire et qui se marquait malgré moi dans mon récit. Comme j’avais enfin demandé : « Est-ce que tu me permettras d’y aller ? » maman ne répondit pas aussitôt. Je savais qu’elle avait toujours peine à me refuser quelque chose :
– Je voudrais d’abord en savoir un peu plus sur ta nouvelle amie et sur ses parents. Lui as-tu demandé ce que faisait son père ?
J’avouai que je n’y avais pas songé, et promis de m’en informer. Deux jours nous séparaient encore du dimanche.
– Demain, je viendrai te chercher à la sortie, – ajouta ma mère ; – tu tâcheras de me présenter cette enfant ; je voudrais la connaître.