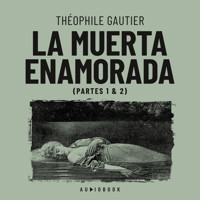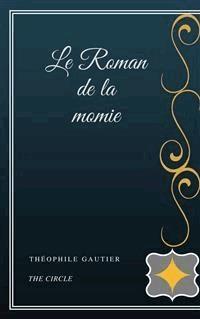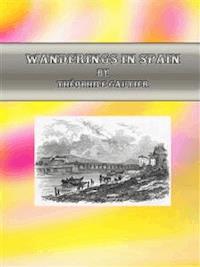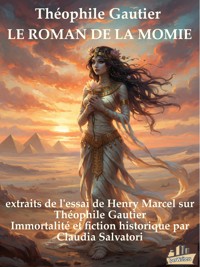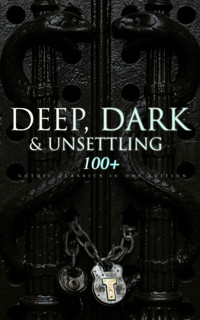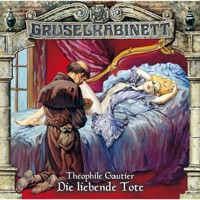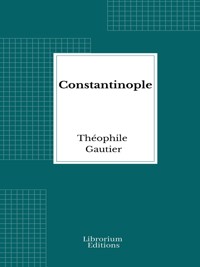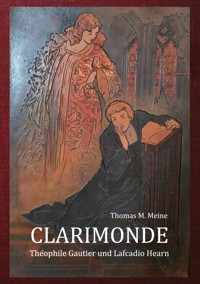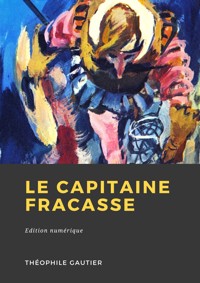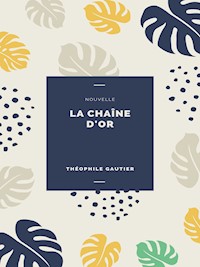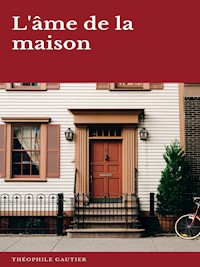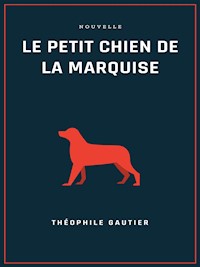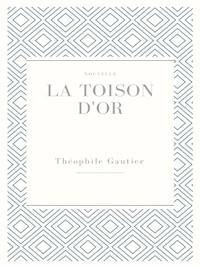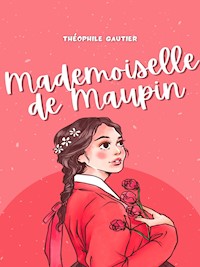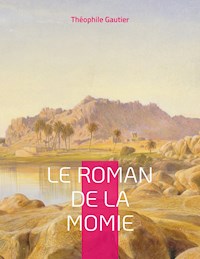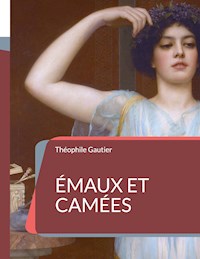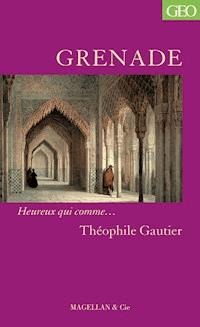
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Heureux qui comme...
- Sprache: Französisch
Partager les émotions des premiers écrivains-voyageurs et retrouver les racines d’un monde intemporel.
Théophile Gautier explore l’Andalousie pendant l’été 1840. Son récit est le modèle du voyage romantique, avide d’aventures pittoresques, d’archaïsmes et de mélanges orientaux. À Grenade, il se fait enfermer dans l’Alhambra, visite les tanières des gitans et voyage dans le temps.
Récit extrait du Voyage en Espagne de Madrid à Jérez, publié en 1843.
Plongez dans ce récit d'aventures poétique qui offre un portrait de l'Andalousie au 19ème siècle !
EXTRAIT
En entrant, vous avez en face de vous, formant le fond du parallélogramme, la salle du Tribunal, dont la voûte renferme un monument d’art d’une rareté et d’un prix inestimables. Ce sont des peintures arabes, les seules peut-être qui soient parvenues jusqu’à nous. L’une d’elles représente la cour des Lions même avec la fontaine très reconnaissable, mais dorée; quelques personnages, que la vétusté de la peinture ne permet pas de distinguer nettement, semblent occupés d’une joute ou d’une passe d’armes. L’autre a pour sujet une espèce de divan où se trouvent rassemblés les rois maures de Grenade, dont on discerne encore fort bien les burnous blancs, les têtes olivâtres, la bouche rouge et les mystérieuses prunelles noires. Ces peintures, à ce que l’on prétend, sont sur cuir préparé, collé à des panneaux de cèdre, et servent à prouver que le précepte du Coran qui défend la représentation des êtres animés n’était pas toujours scrupuleusement observé par les Maures, quand bien même les douze lions de la fontaine ne seraient pas là pour confirmer cette assertion.
A PROPOS DE LA COLLECTION
Heureux qui comme… est une collection phare pour les Editions Magellan, avec 10 000 exemplaires vendus chaque année. Publiée en partenariat avec le magazine Géo depuis 2004, elle compte aujourd’hui 92 titres disponibles, et pour bon nombre d’entre eux une deuxième, troisième ou quatrième édition.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Théophile Gautier est un poète, romancier et critique d'art français. Ce maître du récit de voyage, dont s’inspireront tous les grands auteurs du XIXe siècle, lance ici la mode de voyage en Espagne et de l’orientalisme.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heureux qui comme…
Collection conçue et produite par Marc Wiltzen partenariat avec le magazine GÉO
LE « PARADIS DE L’ESPAGNE »
Si j’avais eu de la fortune, j’aurais vécu toujours errant.J’ai une facilité admirable à me plier sans effort à la viedes différents peuples. Je suis russeen Russie, turc en Turquie, espagnol en Espagne, où je suis retournéplusieurs fois par passion pour les courses de taureaux,ce qui m’a fait appeler, par La Revue des deux Mondes,« un être gras, jovial et sanguinaire »1.
Depuis qu’elle a résisté à l’invasion napoléonienne pendant la guerre d’indépendance (1808-1814), l’Espagne est à la mode en France. Les Espagnols ont paru héroïques aux Français et suscité leur admiration. Puis, avec la guerre qui déchire le pays entre 1833 et 1837, l’Espagne prend place dans l’actualité. Les Français se partagent comme les Espagnols entre tenants de la loi salique, dits carlistes, et partisans d’Isabelle II, héritière du trône selon les christinos. Enfin, en 1838, le baron Taylor provoque l’engouement pour la peinture espagnole en organisant à Paris une exposition qui fait découvrir les grands maîtres espagnols : Vélasquez, Murillo, Zurbaran et Goya.
Les écrivains romantiques sont les premiers à se passionner pour l’histoire de l’Espagne, ils étudient sa littérature et créent des cercles d’amateurs, ouvrant de nouveaux horizons qui nourrissent le rêve d’Espagne. Vers 1840, ceux d’entre eux qui voyagent se donnent le mot et vont voir par eux-mêmes la réalité du pays fantasmé. Mais leurs lectures ont construit leur regard. Ainsi, Théophile Gautier (1811-1872), qui traverse la frontière en 1840 pour un séjour de six mois en Espagne, craint la confrontation avec la réalité de « l’Espagne de [s]es rêves, l’Espagne du romancero, des ballades de Victor Hugo, des nouvelles de Mérimée et des contes d’Alfred Musset ».
Il a alors vingt-neuf ans et accompagne Eugène Piot, esthète et archéologue muni d’un daguerréotype pour fixer les images du voyage. Étrangement, on ne trouve pas trace de cette expérience à laquelle Gautier ne fait qu’une vague allusion quand il se donne une « mission de touriste descripteur et de daguerréotype littéraire ».
Leur périple en Espagne se déroule du 5 mai 1840 au 7 octobre de la même année. Ils entrent dans le pays par la Navarre, visitent la Castille, découvrent l’Andalousie qui enthousiasme l’écrivain, passent par le détroit de Gibraltar et remontent la côte est par Alicante, Valencia et Barcelone. Le voyage s’achève à Port-Vendres. De Grenade, Gautier écrit à sa mère, le 4 juillet 1840 : « Voilà deux mois passés, il n’en reste plus qu’un : nous avons vu Burgos, Vittoria, Valladolid, Olmedo, l’Escurial, Tolède, Madrid, Aranjuez, Jaën, Grenade ; il nous reste à voir Cordoue, Séville, Cadix et Valence. »
Les nombreuses impressions qu’il recueille pendant son périple nourriront sa poésie et lui inspireront des contes fantastiques. Mais c’est avec son Voyage en Espagne de Madrid à Jérez, publié en 1843 après une publication en feuilleton de 1840 à 1843, que Théophile Gautier est reconnu comme un maître de la littérature de voyage. Cet ouvrage, réédité dix fois entre 1843 et 1875, sert de référence à Victor Hugo, Alexandre Dumas et Stendhal, qui traversent les Pyrénées après Gautier, et multiplient les récits de voyages en Espagne, attisant la curiosité du public et son goût pour l’exotisme.
Si le Voyage en Espagne de Gautier est le parangon du voyage romantique, la traversée des terres sauvages d’Alpujarras en est le manifeste : « Ce qui constitue le plaisir du voyageur, c’est l’obstacle, la fatigue, le péril même. (…) Un des grands malheurs de la vie moderne, c’est le manque d’imprévu, l’absence d’aventures. Tout est si bien réglé, si bien engrené, si bien étiqueté, que le hasard n’est plus possible ; encore un siècle de perfectionnement, et chacun pourra prévoir, à partir du jour de sa naissance, ce qui lui arrivera jusqu’au jour de sa mort. La volonté humaine sera complètement annihilée. Plus de crimes, plus de vertus, plus de physionomies, plus d’originalités. Il deviendra impossible de distinguer un Russe d’un Espagnol, un Anglais d’un Chinois, un Français d’un Américain. L’on ne pourra plus même se reconnaître entre soi car tout le monde sera pareil. Alors un immense ennui s’emparera de l’univers, et le suicide décimera la population du globe, car le principal mobile de la vie sera éteint : la curiosité.
Un voyage en Espagne est encore une entreprise périlleuse et romanesque : il faut payer de sa personne, avoir du courage, de la patience et de la force ; l’on risque sa peau à chaque pas ; les privations de tous genres, l’absence des choses les plus indispensables à la vie, le danger de routes vraiment impraticables pour tout autre que des muletiers andalous, une chaleur infernale. »
On le voit, le voyageur romantique trouve en Espagne un pays propice à l’aventure. Son ascension du pic du Mulhacen en fournit une plutôt physique ; mais ce qui réjouit Gautier comme ses successeurs en Andalousie – la destination préférée des romantiques –, ce sont surtout les trouvailles pittoresques et les archaïsmes du pays. D’ailleurs, pour cette raison, les signes du passé les intéressent plus que les signes du progrès. De là une opposition constante entre la recherche de pittoresque du voyageur, dont les intérêts sont d’ordre esthétique, et la volonté pratique des habitants, épris de progrès : « Ils tiennent à honneur, comme presque tous les bourgeois des villes d’Espagne, de montrer qu’ils ne sont pas pittoresques le moins du monde et de faire preuve de civilisation au moyen de pantalons à sous-pieds. »
Apparemment déçu que les habitants de Grenade ne partagent pas son goût du pittoresque, Gautier déplore l’uniformisation du monde : « Ils vous demandent d’un air visiblement contrarié si vous pensez qu’ils ne sont pas aussi avancés que vous en civilisation, tant cette déplorable manie d’imitation anglaise ou française a pénétré partout. » On peut y voir les prémices d’une conscience de la « mondialisation » à venir au siècle suivant : « C’est un spectacle douloureux pour le poète, l’artiste et le philosophe, de voir les formes et les couleurs disparaître du monde, les lignes se troubler, les teintes se confondre et l’uniformité la plus désespérante envahir l’univers sous je ne sais quel prétexte de progrès. Quand tout sera pareil, les voyages deviendront complètement inutiles, et c’est précisément alors, heureuse coïncidence, que les chemins de fer seront en pleine activité. » Cependant, de la promenade Alameda aux tanières des gitans, la Grenade de 1840 semble finalement encore riche en expériences pittoresques et l’écrivain comblé n’hésite pas à qualifier la ville de « véritable paradis terrestre ».
Mais pour Gautier, l’histoire de Grenade aurait dû s’arrêter à l’apogée esthétique de la ville, selon lui : son époque mauresque. Que « trois ou quatre cents ans et des flots de bourgeois [aie]nt passé sur le théâtre de tant d’actions romantiques et chevaleresques » déçoit l’écrivain romantique dont le cliché idéal de Grenade figure « une ville moitié mauresque, moitié gothique, où les clochers à jours se mêlent aux minarets, où les pignons alternent avec les toits en terrasse » et « des maisons sculptées, historiées, avec des blasons et des devises héroïques, des constructions bizarres, aux étages chevauchant l’un sur l’autre, aux poutres saillantes, aux fenêtres ornées de tapis de Perse et de pots bleus et blancs, enfin la réalité d’une décoration d’opéra, représentant quelque merveilleuse perspective du Moyen Âge. » On voit néanmoins que le caractère artistique et théâtral de cette représentation ne lui échappe pas. Ainsi, plus loin : « L’on a d’abord de la peine à prendre ces enluminures pour des habitations sérieuses. Il vous semble que vous marchez toujours entre des coulisses de théâtre. »
En cherchant à Grenade les signes de son héritage mauresque, Gautier souscrit à la mode orientaliste des écrivains romantiques. Et paradoxalement, son enthousiasme pour les Maures n’exclut pas l’admiration de leurs progrès techniques, notamment « leurs travaux hydrauliques » qui « attestent une civilisation des plus avancées ». Fidèle à son amour de « l’Espagne orientale », Gautier se passionne pour l’Alhambra où il passe quatre jours et quatre nuits. Sa longue description du palais rappelle le peintre (Gautier fut peintre avant de devenir écrivain) et le critique d’art en lui : de même qu’il sait offrir de merveilleuses ekphrasis des tableaux, il donne à voir l’Alhambra par une transcription littéraire habile et précieuse qui tient peut-être de ce qu’il appelle « daguerréotype littéraire ».
Comme à Pompéi2, le passé ressuscité exerce une fascination puissante sur l’écrivain. Ces vestiges admirables excitent son imagination jusqu’à la nuit propice aux visions fantastiques : « Je ne suis pas sûr de n’avoir pas vu les Abencérages3 se promener le long des galeries au clair de lune portant leur tête sous le bras : toujours est-il que les ombres des colonnes prenaient des formes diablement suspectes, et que la brise, en passant dans les arcades, ressemblait à s’y méprendre à une respiration humaine. »
N’est-ce pas en définitive un voyage dans le temps que l’Espagne offre aux romantiques ?
1.Extrait d’un autoportrait de Gautier publié dans L’Illustration le 9 mars 1867. (N.d.É.)
2.Voir Pompéi, du même auteur, dans la même collection, n° 2. (N.d.É.)
3.Membres d’une famille qui a joué un rôle essentiel dans les intrigues de la cour du royaume arabe de Grenade au XVe siècle. Les Aventures du dernier Abencérage de Chateaubriand (1826) conte le retour à Grenade du dernier descendant de cette famille. (N.d.É.)
Extrait du Voyage en Espagne de Madrid à Jérez publié en 1843
GRENADE
Au sortir de Jaën, l’on entre dans une vallée qui se prolonge jusqu’à la Vega de Grenade. Les commencements en sont arides ; des montagnes décharnées, éboulées de sécheresse, vous brûlent, comme des miroirs ardents, de leur réverbération blanchâtre ; nulle trace de végétation que quelques pâles touffes de fenouil. Mais bientôt la vallée se resserre et se creuse, les cours d’eau commencent à ruisseler, la végétation renaît, l’ombre et la fraîcheur reparaissent. Le rio de Jaën occupe le fond de la vallée, où il court avec rapidité entre les pierres et les roches qui le contrarient et lui barrent le passage à chaque instant. Le chemin le côtoie et le suit dans ses sinuosités, car, dans les pays de montagnes, les torrents sont encore les ingénieurs les plus habiles pour tracer des routes, et ce qu’on peut faire de mieux, c’est de s’en rapporter à leurs indications.
Une maison de paysans où nous nous arrêtâmes pour boire était entourée de deux ou trois rigoles d’eau courante qui allaient plus loin se distribuer dans un massif de myrtes, de pistachiers, de grenadiers et d’arbres de toute espèce, d’une force de végétation extraordinaire. Il y avait si longtemps que nous n’avions vu de véritable vert, que ce jardin inculte et sauvage aux trois quarts nous parut un petit paradis terrestre.
La jeune fille qui nous donna à boire dans un de ces charmants pots d’argile poreuse qui font l’eau si fraîche, était fort jolie avec ses yeux allongés jusqu’aux tempes, son teint fauve et sa bouche africaine épanouie et vermeille comme un bel œillet, sa jupe à falbalas, et ses souliers de velours dont elle paraissait toute fière et tout occupée. Ce type, qui se retrouve fréquemment à Grenade, est évidemment mauresque.
À un certain endroit, la vallée s’étrangle, et les rochers se rapprochent au point de ne laisser que tout juste la place du rio. Autrefois, les voitures étaient forcées d’entrer et de marcher dans le lit même du torrent, ce qui ne laissait pas d’avoir son danger à cause des trous, des pierres et de l’élévation de l’eau qui, en hiver, doit s’enfler considérablement. Pour obvier à cet inconvénient, l’on a percé de part en part un des rochers et pratiqué un tunnel assez long, dans le genre des viaducs des chemins de fer. Cet ouvrage, assez considérable, ne date que de quelques années.
À partir de là, la vallée s’évase, et le chemin n’est plus obstrué. Il existe ici, dans mes souvenirs, une lacune de quelques lieues. Abattu par la chaleur, que le temps, tourné à l’orage, rendait véritablement suffocante, je finis par m’endormir. Quand je m’éveillai, la nuit, qui vient si subitement dans les climats méridionaux, était tombée tout à fait, un vent affreux soulevait des tourbillons de poussière enflammée ; ce vent-là devait être bien proche parent du siroco d’Afrique, et je ne sais pas comment nous n’avons pas été asphyxiés. Les formes des objets disparaissaient dans ce brouillard poudreux ; le ciel, ordinairement si splendide dans les nuits d’été, semblait une voûte de four ; il était impossible de voir à deux pas devant soi. Nous fîmes notre entrée à Grenade vers deux heures du matin, et nous descendîmes à la Fonda del Comercio, soi-disant hôtel tenu à la française, où il n’y avait pas de draps au lit, et où nous couchâmes tout habillés sur la table ; mais ces petites tribulations nous affectaient peu, nous étions à Grenade, et dans quelques heures nous allions voir l’Alhambra et le Generalife.
Notre premier soin fut de nous faire indiquer, par notre domestique de place, une casa de pupilos