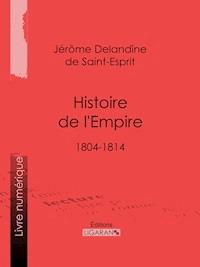
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Extrait : "Napoléon, le grand homme de l'histoire contemporaine, fut l'homme de la nécessité, et non l'homme de la patrie ; il jouit pendant dix années d'une puissance enlevée par surprise. L'exaltation et l'ambition lui avaient dessiné un horizon ; il s'y plaça, et, appuyé sur son épée, il se souleva et atteignit les annales du monde. « La force est toujours la force ; l'enthousiasme n'est que l'enthousiasme ; mais la persuasion reste et se grave dans les cœurs. »"
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Napoléon, le grand homme de l’histoire contemporaine, fut l’homme de la nécessité, et non l’homme de la patrie ; il jouit pendant dix années d’une puissance enlevée par surprise. L’exaltation et l’ambition lui avaient dessiné un horizon ; il s’y plaça, et, appuyé sur son épée, il se souleva et atteignit les annales du monde.
« La force est toujours la force ; l’enthousiasme n’est que l’enthousiasme ; mais la persuasion reste et se grave dans les cœurs. »
Ces paroles de Bonaparte ont formulé le programme de sa vie d’empereur : la destruction de sa force éteignit l’enthousiasme ; la persuasion nationale qu’il ne pouvait pas rendre la France heureuse, le fit tomber.
La république lui donna un drapeau, le consulat un piédestal ; l’empire plaça un globe dans sa main ; la restauration un écueil sous ses pas.
Il croyait à la fortune de son étoile ; son esprit était empreint du beau idéal de la gloire, il s’en nourrit jusqu’à son dernier soupir.
Le panégyrique de Napoléon est dans ses institutions plutôt que dans ses victoires ; les unes sont restées et fructifient, les autres ont coûté du sang et n’ont rien laissé ; et pourtant, par une anomalie du siècle, le peuple qui a tant pleuré en élevant ses trophées, aujourd’hui n’exalte qu’eux.
Napoléon, tout en répudiant les principes révolutionnaires, s’est incarné avec eux. L’Europe et l’Asie sont encore vibrantes de ses proclamations ; il sembla faire revivre l’empire de Charlemagne, tout en sapant les vieilles dynasties. Des sceptres furent à ses pieds ; des princes vinrent à son bivouac, implorer, après les batailles, les couronnes que la serre de l’aigle avait enlevées ; il les déposa sur ces fronts humiliés.
Le fils de la révolution, d’une main jeta au sol les germes de la liberté ; de l’autre il les étouffa avec son sabre. Napoléon semblait s’écrier : « Je veux ! je serai ! à moi l’avenir ! je découvre l’univers !… on n’avait rien vu avant moi ; le monde m’attendait ! »
Dans le triomphateur, il y a deux natures : la première ouvre une voie nouvelle au présent, la seconde a failli au passé. Un jour, il cherche à conquérir la sanction du temps ; un autre jour, il se rit des siècles, et s’empare du progrès pour se pousser en avant.
Dans son ascension, il a un instinct prophétique. Napoléon s’éblouit, il est dans l’ivresse ; mais, arrivé au faîte des grandeurs ; il tombe, et l’optique de l’orgueil est brisé sur un tombeau.
Le sépulcre est le creuset où se rectifient les renommées ; ce qui doit être enregistré par les âges surgit au-dessus de la vie ; c’est une lumière sans éclipse. Une gerbe se déploie sur le catafalque de Napoléon : ce sont ses traités de paix et ses institutions, qui ont agrandi la France et avancé la civilisation.
L’année 1797 vit le traité de Campo-Formio ; ce traité amassa des territoires sous ses drapeaux 1801 donne la paix à l’Église par un concordat, et le repos aux peuples par le traité de Lunéville 1802 voit faire un pas à l’intelligence humaine : la création des écoles primaires s’unit aux bienfaits d’une diplomatie de pacification ; l’amnistie des émigrés, le traité de paix d’Amiens, la création de la Légion-d’Honneur deviennent les banderoles de la gloire 1803 s’ouvre par l’union américaine, et 1804 par la promulgation du Code civil.
À cette époque, Bonaparte avait mis ses trophées en faisceau : Montenotte, Millesimo, Mondovi avaient jeté à l’Europe leur son d’airain ; Altenkirchen, Rastadt, Castiglione et Neresheim pavoisèrent la patrie d’étendards ; puis le pas de charge marqua la conquête de Wurtzbourg, de Bassano, d’Arcole et de Rivoli. Aux Pyramides, à Sedyman, à Samhoud, les siècles sont réveillés par le houra de la France. Le camp français est posé devant Pfullendorf et Stockbach, et leurs murailles croulent ; Magnano, Cassano, Bassignana tressaillent, chancellent et tombent ; l’armée les foule et va plus loin.
Les triomphes d’Orient ne donnent pas trêve aux rois de l’Occident ; Napoléon et ses soldats combattent à la fois sur tous les sols : Bergen, Dietikon et Kastribkum font plier la herse de leurs remparts. La carrière n’est pas remplie ; une autre moisson de gloire est faite à Fossano, à Engen, à Moeskirch et à Biberach. La tente consulaire est couronnée des palmes de Montebello, d’Hoschtedt et de Marengo.
Ces batailles donnent le dernier salut au nom de Bonaparte ; l’ère de Napoléon va s’ouvrir.
L’empire se pose : le traité de la confédération des États du Rhin signale la marche de la grande armée ; cette marche enveloppe les champs de bataille d’Austerlitz, d’Iéna, de Friedland, d’Esling, de Wagram, de Sainte-Euphémie et d’Auerstadt. Les peuples font une halte, puis ils reprennent les armes et viennent lutter à Medina et à Vimeiro. Ce n’est pas encore assez : les combats d’Espinosa, de Tudela, de Médélin et d’Oporto donnent des fleurons à nos baïonnettes. Le nord comme le midi paie encore une fois des tributs à la grande épée de Napoléon : Sacile, Abensberg, Eckmulh, font faire un pas de plus aux victoires de l’empire. Notre armée avance toujours ; elle prend Esling, Raab, Enzersdorff, et va bivouaquer sur le champ de Wagram.
Le Te Deum est incessant : il retentit pour la prise de Talavera-la-Reyna, il sonne pour la soumission d’Ocana, de Busaco ; il éclate pour la reddition de la Gebora et des Arapilès : ses sons deviennent un glas pour les populations détruites de Sagonte.
Les houras de guerre se répercutent ; ils vont se perdre dans les régions glacées. Smolensk, Polotsk et la Moscowa vibrent du cri déchirant de l’aigle ; ce cri fait encore tressaillir l’Europe à Malojaroslawetz, à Wiazma, à Lutzen. L’armée mutilée le suit.
L’aigle blessé plane encore ; il secoue des foudres à Dresde, à Hanau et à Leipsick. Partout c’est un adieu de gloire, partout c’est un salut de sang : Vittoria, la Rothière, le Mincio, Orthez et Craonne proclament l’agonie d’une armée.
La campagne de France s’ouvre avec sa gloire de revers : Montereau, Montmirail, Champ-Aubert, jettent de dernières lueurs sur nos armes.
Le colosse se repose ; il se relève un moment et s’abat : c’est Waterloo qui reçoit sa chute ; de cette chute devait jaillir du feu ; l’avenir l’absorbe.
Ainsi l’Empire, cette grande page d’un siècle, ce volcan du sol de France, ouvre son cratère, lance sa lave et s’éteint.
Le temps a passé ; la postérité a commencé pour Napoléon. Le monde est las des grandeurs et du bruit. Il s’écrie devant la tombe du conquérant : « Quoi ! cette dépouille parée pour paraître grande, est celle qui naguère dominait, sous la simple capote des camps, toute la splendeur des monarques ! »
« Comment ! c’est là cette renommée, cette personne, cette race, pour qui l’Europe battait des mains ! dont on aurait payé un cheveu, un sourire, un regard du sacrifice de l’existence ! »
De la cendre, c’est tout ;… les rois s’en vont : les âges qui s’écoulent résument les âges antérieurs. Ce qui existe nous réfléchit ce qui a existé. « Par les uns, nous dit Homère, on peint les autres. » C’est la parole future qui se coordonne avec la voix des siècles. On écoute et on apprend.
Les générations ont décru sous les pas de Napoléon. La société a remonté à une vie nouvelle. Mais les peuples, dans leur émancipation, sont devenus inhabiles à vivre de la vie sociale. Le mouvement est incohérent ; les progrès ont mis en faisceau un amas de charpente sans ouvriers pour bâtir… et dans le présent, on ne voit plus ce qui sera.
LE BLOCUS CONTINENTAL
Le blocus continental était l’étendard levé, c’était la déclaration de guerre, c’était l’action, le bras d’une transmission de crainte, qui remplit les fastes du consulat et de l’empire ; en étudiant ses rapports, ses ramifications, on s’initie à la politique qui a agité tous les royaumes ; c’est le phare sur l’écueil.
Les revers éclairent l’expérience, ils mitigent l’orgueil des hommes qui s’élèvent, ils relèvent les peuples qui se courbent. Suivons donc l’histoire du coup d’État qui a rempli les destinées napoléoniennes.
La lutte de la France et de la Grande-Bretagne était incessante, on aurait dit que les Anglais avaient entendu bruire à leurs oreilles la harangue de Démosthène pour la Chersonèse.
« Faites attention, Athéniens, que vous courez le risque le plus grand qu’ait couru aucun peuple de la Grèce. Le dominateur ne pense pas seulement à vous soumettre, mais à vous détruire ; vous n’êtes pas faits pour servir, vous êtes trop accoutumés à commander. Il sait qu’à la première occasion, vous lui donnerez plus de peine que toute la Grèce ensemble. »
En effet, l’Angleterre, en traversant les entreprises du premier consul, lui avait donné à elle seule plus de peine que l’Europe entière sous les armes. Il sentit qu’il ne pourrait jamais jouir en paix de son ovation, tant que le cabinet de Saint-James aurait de l’influence, et il n’eut rien tant à cœur que de dissoudre cette prépondérance qui agrandissait la destinée d’un peuple au préjudice de sa propre gloire.
Alors tous les moyens furent trouvés bons, tous furent employés pour abattre un sceptre qui entravait son élévation et empêchait sa suprématie de prendre son essor.
C’est alors que le système continental fut créé et prit cours ; Bonaparte chercha à jeter l’interdit sur le commerce anglais ; il somma les États de ne plus correspondre avec la Grande-Bretagne.
Le monde entier pesa les lois de Napoléon et les subit ; un décret « déclara de bonne prise tout bâtiment qui se trouverait chargé en tout ou partie de marchandises anglaises, quel qu’en fût le propriétaire. » Il interdisait « l’approche des ports de la France à tout navire neutre qui aurait touché les côtes de l’Angleterre ; » et ordonnait « de mettre à mort tout marin de nation neutre qui se trouverait sur un bâtiment anglais. »
On aurait dit que l’ère de 1793 n’était point finie…
La Grande-Bretagne entra profondément dans la haine : la liberté des mers, les libertés publiques furent faussées par le génie de la guerre ; on combattait sans apitoyance, on se plaçait avec rage en dehors des nations civilisées.
Ainsi tout ce qui venait de la rive anglaise était repoussé et brûlé ; les douanes avaient établi un cordon infranchissable, non seulement en France, mais dans les royaumes circonvoisins.
La Hollande, l’Italie, l’Espagne et le Portugal se soumirent. Plus de relations commerciales, plus de chances pour vendre et trafiquer dans les ports des États libres. Bonaparte avait lancé ses firmans, et ses firmans allèrent jusqu’à boucher à l’Angleterre le passage des Dardanelles avec les escadres du Divan.
La diplomatie s’enflamma ; les têtes des hommes d’État fermentèrent.
Les États-Unis résistèrent : des captures furent faites, et devant le vouloir de Napoléon, le pays de la première indépendance perdit sa liberté : l’homme-combat, et comme consul et comme empereur, donna partout une consigne, elle fut observée.
Il traîna devant toutes les populations son épée conquérante ; cette épée l’avait créé chef d’une nation de trente millions d’habitants, tous de races guerrières. Cette attitude impressionna le siècle, et le siècle fut tout au système continental.
Les ministres anglais suivirent pas à pas les préparatifs qu’une domination universelle avait entrepris ; cette ligue gigantesque s’avançait, se repliait, et contournait les évènements, selon l’intérêt et l’action d’une politique ombrageuse ; c’était une réunion de griefs, de lois, de règlements, dont le but était toujours un vif ressentiment contre l’Angleterre.
Dans cette ligue, la République française avait déjà appelé à elle la République ligurienne et la République helvétique : elle convoqua la Westphalie et le Danemark ; ces puissances amenèrent leur pavillon à bord des frégates françaises pour prendre le mot d’ordre.
Cette fédération faussait les idées et asservissait les peuples. Le mal fit fausse route, il ne releva ni les princes, ni les États.
Dans ce conflit, le prince laïque, Talleyrand-Périgord, ex-évêque d’Autun, fut consulté ; il dirigea avec plus d’ardeur encore les apprêts du blocus continental. Mais ce maître en diplomatie eut beau avoir recours aux artifices, pour colorer les avantages que les empires devaient retirer en fermant leurs ports aux Anglais, le voile était léger, on vit au travers, et on reconnut que l’intérêt général était sacrifié pour en servir un seul.
Le système continental fut tamisé par tous les partis, il n’en sortit rien de pur ; c’était des mesures d’une unité oppressive, appuyées par des mesures d’envahissement, et toujours la voie de la domination était agrandie : le blocus continental était le prétexte ; le but était de changer les constitutions des gouvernements, pour établir des royaumes de famille.
Ainsi, par des lois votées à la suite de nos drapeaux, les puissances de la confédération du Rhin plièrent le genou devant deux frères de Bonaparte qui portaient couronne, et qui surveillaient l’exécution de ses ordres.
Napoléon, sous l’aspect de la neutralité, voulut réorganiser un ordre dynastique, et subordonner tous les pouvoirs au pouvoir de l’Empire : tant que la gloire parla, il réussit ; mais quand la vénalité s’en mêla, il n’avança plus.
Bientôt la politique plaça près des vieilles monarchies, des garnisaires armés ; mais cet appareil des sergents du fisc ne releva point la moralité du système continental, il l’abaissa : la lime du droit des nations ne mord pas sur l’acier.
Cependant la couronne de Suède avait ressenti une secousse : la France faisait particulièrement surveiller les négociations de cette puissance avec l’Angleterre. Napoléon livra son secret au prince de Ponte-Corvo.
Bernadotte louvoya autour du sceptre de la Suède, avant d’y porter la main. Là, l’Empereur s’apprêta non seulement à maintenir le blocus continental, mais il résolut de faire décréter, par le canal de la Suède, la guerre à la Grande-Bretagne, par toutes les puissances qui étaient encore en paix.
Ce fut l’un des anneaux de la chaîne des potentats : il fallut opter entre une guerre océanique, ou une guerre sur le terrain des vieilles luttes.
La Suède hésita : cette ancienne reine du Nord vit que Napoléon voulait faire d’elle une vassale ; il exigeait une obéissance passive, il mettait en réquisition ses soldats, sa marine, son argent et une rançon de deux mille matelots, et avant de connaître si une prise de possession conviendrait aux Suédois, il fit proclamer comme avant-garde de la souveraineté le système continental, et dirigea dans les ports de la Suède les douaniers à la cocarde tricolore.
Devant cet empiétement offensif, la Suède tint un congrès populaire : chaque paysan sortit de ses vallées pour déposer son vote, et pourtant jamais gouvernement ne fut régi sous des formes plus absolues.
Gustave IV avait hérité d’un sang bouillant et brave, sa franchise, l’élévation de son âme en avaient fait un ennemi de Napoléon. Ce prince ne l’appelait pas autrement que « l’assassin du duc d’Enghien, » et quand le maître des légions de France convoqua à Erfurt, sur un champ de victoire, les puissances belligérantes, Gustave IV dédaigna de se trouver aux conférences.
Napoléon voulut connaître si la fierté de ce petit potentat ne s’abaisserait pas devant un joyau de la couenne, il lui, fit offrir une portion du Danemark. Gustave IV fit aussitôt connaître au prince régnant les propositions de l’Empereur, et mit à la disposition du Danemark, en cas d’attaque, les forces de la Suède. Ce caractère noble et grand était pour Napoléon une défaite morale, il ne les aimait pas !…
Napoléon, depuis ce temps, conserva contre Gustave IV un levain, il résolut de détruire ses États, et bientôt il décida l’empereur Alexandre à envahir la Suède. Les liens du sang n’arrêtèrent point l’autocrate du Nord. La Finlande devint la possession des Russes, et toujours les Russes s’avançaient.
Gustave voulut combattre ; quoique réduit, le joug cessait sa fierté ; il y avait de la vie au cœur chez ce roi, il voulut s’en aider : il fit un appel à l’honneur, mais l’honneur resta froid.
Les patriotes suédois étaient gagnés ; ils préférèrent plier sous l’étranger, qu’obéir à un prince qui sentait sa dignité.
Les mécontents voyaient à leur tête le major-général Adlercrutz. Ce seigneur démocrate fit des représentations humiliantes Gustave tira son épée ; le major osa le désarmer, c’était dire qu’il n’était plus roi. « Sire, souvenez-vous, dit le conjuré, que votre épée vous a été donnée pour la tirer contre les ennemis de la patrie, et non contre les vrais patriotes, qui ne veulent que le bonheur de la Suède. »
De ce moment, le roi fut retenu prisonnier, et enfermé à Drontingholm ; il paya sa liberté par une abdication et par l’exil.
Le duc de Sudermanie, son oncle, fut nommé régent, puis il fut élu roi sous le nom de Charles XIII.
La Suède n’en fut pas plus heureuse : le blocus continental était le cauchemar des nations, il fallait le subir, et au réveil, il durait encore.
Napoléon ne s’était point ralenti dans ses prohibitions. Ses décrets frappaient toujours : bientôt les denrées coloniales furent mises à l’index de sa politique ; l’usage du café parut suspect, on torréfia la chicorée, on jeta dans les alambics la fève d’Arabie, on en composa un sirop aromatique : on eut aussi besoin de remplacer l’indigo la gaude et le pastel établirent un bleu rival ; mais il n’y eut de transfusion imitative ni pour le chocolat ni pour le quinquina ; l’écorce de marronnier et les sucs les plus amers ne purent y suppléer. Les déjeuners stomachiques et les guérirons de la fièvre furent suspendus pour les fortunes modestes. Le tarif des denrées d’outre-mer fut excessif ; le prix de la livre de sucre s’éleva à plus de six francs, et le suc de la betterave fut distillé. Les étoffes de coton devinrent d’un prix plus élevé que les étoffes de soie ; les besoins de la vie, les goûts, les habillements, tout fut proscrit, tout subit les rigueurs du blocus continental.
Les marchandises anglaises furent brûlées par masse en Hollande et sur les bords de la Baltique : c’était un vandalisme qui encourageait la contrebande ; ces objets déclarés de bonne prise, auraient pu être répartis dans les hôpitaux et vêtir le pauvre ; tout fut violent, rien ne fut humain. La vénalité seule eut voix.
Le monopole s’établit ; on vendit des licences ; c’était le droit de trafiquer à ciel ouvert ; c’était le privilège de la fraude. Les villes anséatiques furent remplies de marchés honteux ; Hambourg, Brême, Lubeck formèrent des comptoirs d’infraction légale. Les rois ne pouvaient violer le système continental, mais les favoris de l’Empire avaient la prérogative de le faire.
Les évènements du Nord se pressaient ; la mort de Christiern Auguste de Holstein-Augustembourg, prince royal de Suède, laissait une voie à l’ambition ; un congrès secret fut tenu et protégé par la France : trois noms furent jetés dans l’urne des aspirants ; c’étaient le roi de Danemark, le duc d’Oldembourg et le prince de Ponte-Corvo.
L’élection parut indépendante, elle ne fut que forcée : le prince de Ponte-Corvo sortit triomphant du ballotage ; Charles-Jean Bernadotte fut appelé par les États-Généraux à la succession du trône de Suède.
Napoléon qui avait donné la main à son frère d’armes pour monter au trône, en fut bientôt jaloux ; il dit avec dépit : « En donnant mon consentement, j’éprouvai un arrière-instinct qui me rendait la chose désagréable et pénible. »
Cet arrière-instinct fermenta, la franchise manqua, et de sourdes menées environnèrent les lettres d’émancipation que Bernadotte reçut et de la France et de la Suède.
Napoléon alla jusqu’à dire à ses confidents : « Quand Bernadotte aura cinquante mille hommes à ses ordres, il les emploiera à me faire la guerre. »
Il semblait que les évènements de 1813 lui étaient révélés… Charles-Jean vint prendre congé de l’Empereur : on vit alors dans un refus authentique du nouvel élu tout ce qu’on avait à redouter ; il ne consentit point à signer l’engagement de ne jamais prendre les armes contre la France, il trouvait que c’était blesser l’indépendance d’une nation ; il fit ainsi connaître qu’il y avait dans son âme des restrictions princières. « Partez ! que vos destinées s’accomplissent, » tels furent les adieux de Napoléon. Ces mots, prononcés d’une voix étouffée, étaient le pressentiment de l’avenir.
Il fallait à Charles-Jean une abjuration pour atteindre à la couronne de Suède, il la prononça : pour arrher un trône, il renonça et à sa foi religieuse, et à sa foi politique.
Néanmoins son ovation n’était pas encore assise : le gouvernement suédois lui reprochait trop de partialité pour la France ; le gouvernement français, trop de nationalité pour sa nouvelle patrie.
L’Empereur connaissait les hommes, il ne tarda pas à mettre Bernadotte à l’épreuve ; il préférait voir un ennemi en face, qu’un ami douteux. Il lança encore un décret d’oppression, c’était un perfectionnement du système continental, c’était l’ordre avancé, l’ordre du jour, l’appel aux armes.
Bernadotte savait que lorsque Napoléon mettait un pied dans un État avec le blocus des ports, il ne s’arrêtait plus ; c’était le premier pas de la course, c’était le premier bond des envahissements. Bernadotte alors boucla son armure, tout en faisant des représentations respectueuses ; mais ces représentations, Napoléon ne les supportait pas. Dans ce moment une pensée traversa le cerveau de l’Empereur ; il déclara : « que si le prince royal l’ennuyait, il pourrait bien lui faire achever son cours de suédois à Vincennes. » C’était indiquer la place où était mort un prince chevaleresque, c’était dire qu’avec un mot Bernadotte serait enlevé au milieu de la cour de Suède, et fusillé en France !…
Méhée, le trop fameux Méhée, celui qui avait épié les jours du duc d’Enghien sur la terre étrangère pour les livrer à prix d’argent à la police, était à son poste, il était en Suède ; il rôdait incognito aux alentours de la résidence princière, il allait trafiquer d’une vie de plus, lorsque Bernadotte déjoua la trame : Méhée fuit à la hâte, et Charles-Jean arma les Suédois.
Alors Napoléon donna l’ordre à ses troupes d’avancer… La Poméranie fut occupée, Davoust et Friant s’emparèrent de Stralsund. Bernadotte s’écria : « Puisqu’il agit ainsi, il lui en coûtera cher. » Il expédia des courriers à Saint-Pétersbourg et à Londres, et se tint en arrêt.
Pourtant, avant de rompre entièrement son alliance, Charles-Jean écrivit en ces termes à Napoléon : « Je ne suis pas un Coriolan, je ne commande pas les Volsques, mais j’ai assez bonne opinion des Suédois pour vous assurer, sire, qu’ils sont capables de tout oser et de tout entreprendre pour venger des affronts qu’ils n’ont point provoqués, et pour conserver des droits auxquels ils tiennent peut-être autant qu’à leur existence. »
Cette lettre était trop imbue d’indépendance pour trouver grâce devant Napoléon, sa réponse fut l’expédition des ordres de combat à outrance. Il fit raser les citadelles de la Suède, saccagea de nouveau ses provinces : c’est alors que Bernadotte se rendit secrètement sous la tente de l’empereur de Russie, et, comme Coriolan au camp des Volsques, il pactisa contre l’ennemi commun, et contre son pays.
Le cabinet britannique, par un traité, s’engagea à solder toutes les coalitions qui se formeraient contre la France, et bientôt toutes les bannières marchèrent contre elle.
Le temps à fait connaître que la puissance la plus élevée tombe quand elle blesse la nationalité des peuples.
Napoléon est tombé, et Bernadotte est debout… L’un, comme empereur, usa sa pourpre à force d’en étendre l’ampleur ; l’autre, comme roi, se resserra dans des limites pour mieux fortifier la base. Le premier vainquit l’Europe et disparut, le second fut soumis à l’Europe et resta. Ces deux soldats de fortune payèrent tous deux leur couronne par leurs chevrons de bataille ; tous deux avaient flatté le peuple, tous deux avaient vaincu ; mais au jour où les bannières dynastiques furent soulevées, on ne compta plus que les services d’unité monarchique. Bonaparte avait combattu pour détruire un principe d’ordre, Bernadotte avait versé son sang pour le maintenir : au jour où la légitimité triompha, Napoléon eut une île pour exil, Bernadotte un royaume pour apanage. La restauration fut faite en France, il n’y en eut point en Suède : une puissance acquise remplaça le droit.
Ainsi l’exemple de la résistance est profitable dans l’action du bien des rois et nuisible dans l’action des peuples. L’histoire des révolutions publie cette vérité ; c’est un acte de foi, il ne varie point. Tous les fastes de l’Empire rappellent cet enseignement : la politique de Napoléon fit tant de faux pas, qu’elle boita sur tous les sols.
Naples fut encore un des États où les volontés de Napoléon débordèrent les évènements. Murat, le roi des camps, le sabreur de diadèmes, avait organisé le blocus continental comme une loi martiale ; mais son zèle pour les intérêts de la France ne fut pas de longue durée : un trône, un peu d’or étranger et l’exemple de Bernadotte portèrent haut son esprit d’insoumission. Murat, le fidèle Murat, ce lieutenant de Napoléon, prit aussi dans un royaume octroyé par baïonnettes françaises, un galon de félonie ; et dans une période rapprochée, il s’arma, trahit son maître, et mourut.
Ainsi les mesures de la force et l’intérêt matériel, sous l’Empire, ne firent pas honneur aux hommes et ne portèrent pas bonheur au pays.
18 mai 1804
Tout cercle revient à son point de départ : la révolution avait repoussé la monarchie et avait hâté le pas ; une monarchie arrêta son trajet. Une main de fer se posa entre l’étranger et la patrie ; elle s’étendit pour revendiquer le prix de la gloire sur le terrain des batailles.
Napoléon, dès le 3 mai 1804, franchit d’un seul bond les frêles jalons de la puissance consulaire ; il les brisa et fit brèche sur le sol de l’indépendance. Le Tribunat jeta un diadème sur les lambeaux de la toge républicaine ; Napoléon le releva.
Les voix des députés qui traduisaient l’avenir en dévoilant l’ambition du chef de l’armée, accueillirent les propositions faites, le 30 avril, de conférer à Napoléon le titre d’empereur. Le nom d’empire fut donc prononcé ; une clameur remplit l’enceinte, des protestations éclatèrent ; mais devant un pouvoir ombrageux le silence régna, et laissa la voie libre pour les membres du sénat ; ils vinrent y planter un écusson dominateur. Un huis-clos législatif, protégé par des baïonnettes, suffit à l’ovation : le 18 mai 1804, Napoléon fut proclamé empereur.
Les acclamations de l’armée imposèrent la sanction nationale ; la France, lasse d’anarchie, la donna. La manœuvre politique était consommée ; la garde consulaire se rangea autour de son chef couronné. Napoléon, d’une voix forte et regardant le pays en face, dit : « J’accepte le titre que vous croyez utile à la gloire de la nation. »
L’Europe contempla avec étonnement l’officier de fortune qui avait sous ses pieds la hache de la terreur, et à ses genoux les régicides qui avaient souillé leur vie pour briser le contrat monarchique qu’ils venaient reconstituer.
Les palais reprirent leur aspect royal ; le luxe d’une cour resplendit dans l’enceinte des Tuileries, où l’émeute était montée pour traîner à la mort un roi descendant de soixante-cinq rois ! Là, derrière les grilles gardées par les soldats de l’empire, le même peuple qui avait crié : « Plus de rois ! » se pressait pour regarder briller aux feux des lustres les livrées et l’or des courtisans.
La France était attentive et l’Europe attendait.
Napoléon s’était mesuré en personne avec tous les dangers ; il connaissait ceux que le génie et la force peuvent maîtriser ; il ne recula que devant les obstacles où sa volonté ne pouvait rien. Ainsi, la tempête qui dispersa plus d’une fois des convois maritimes en vue des côtes d’Angleterre, donna naissance au système continental, à cet écueil gigantesque où se déchira l’aile de l’aigle impérial.
Les circonstances dessinent les hommes, les évènements les font connaître. Dans une brumeuse soirée d’automne, Napoléon, assis devant une grande table, entouré d’un cercle d’officiers de marine et de généraux, entendait siffler le vent dans la rade de Boulogne. « La mer doit être mauvaise, » dit-il, « les tempêtes sont le vrai rempart des Anglais… » « Écoutez !… c’est le canon de détresse d’un navire ! encore un orage !… » En ce moment un des aides-de-camp de service annonce qu’une canonnière est entraînée par l’ouragan.
Napoléon frappe du pied avec violence et sort en s’écriant : « Toujours la furie des vagues !… »
On le suit sur le port ; là le tumulte sourd d’une nuit orageuse se laissait apercevoir à la lueur des éclairs. La voix de Napoléon s’élevait, et répondait au canon d’alarme de la canonnière.
« Vite des embarcations à la mer !… Allons, marins ! au secours de vos camarades ! »
Mais pour la première fois l’immobilité répondit à un ordre de l’Empereur.
« Qu’on appelle mes grenadiers ; ils n’ont peur, eux, ni du canon, ni des vagues ! »
L’amour-propre fit ce que n’avait pu faire l’humanité : les matelots s’élancent, la rame lutte contre les lames houleuses. Napoléon hâte les hommes, il voudrait comprimer l’Océan ; et frappant la terre, il répète : « L’orage !… toujours l’orage ! »
Puis, apercevant l’espace éclairé par le feu du ciel, il suit la direction des chaloupes ; tout à coup il s’écrie : « Ils font fausse route, ils dévient, ils vont se briser sur les rochers !… Un canot, vite, un canot. »
– « Mais, Sire, » dit un officier de marine, « la mer est horrible. » – « Silence, Monsieur !… N’avez-vous donc pas d’oreilles pour l’agonie de ce malheureux navire ?… »
Le frêle esquif est prêt, Napoléon s’élance ; la foule pressée sur le rivage suit avec stupeur l’homme du destin marchant contre les éléments.
Le canot, tour à tour englouti dans l’écume et ramené sur le haut d’une vague, était conduit par quatre rameurs et un novice timonier : – « Avançons-nous ?… dit Napoléon. – À peine, Sire. »
Alors, il accusait la mollesse des rameurs, et le pilote, pour toute réplique, montrait à l’Empereur un flot qui montait jusqu’à lui ; Napoléon lança furieux sa tabatière contre la vague qui se riait de sa colère, et qui vint se briser sur son genou. « La mer !… la mer !… elle se révolte ; mais on peut la vaincre… »
Une lame furieuse répondit à la menace du conquérant : « La mer n’est pas tenable, » dirent tous les marins, « nous y périrons, Sire, et nous ne les sauverons pas. »
Une secousse plus violente encore décida enfin l’Empereur à regagner le rivage ; mais sa pensée restait en courroux sur l’Océan ; il répétait à voix basse : « Les malheureux ! entre la mort et les Anglais ! » Puis, en abordant, il frappa fortement la grève et s’écria : « Oui,… la terre,… la terre… elle ne manque jamais au pied du soldat : elle ne se soulève pas pour le repousser, elle ne s’entrouvre pas pour l’engloutir ; elle a toujours un champ de bataille pour la victoire. Oh !… la terre… oui, la terre !… »
Napoléon passa la nuit sur le port ; au point du jour la tempête s’apaisa et la canonnière, secourue par les premières embarcations, rentra dans la rade.
Le lendemain une estafette portait à l’impératrice Joséphine cette relation, écrite par l’empereur :
« Le vent ayant beaucoup augmenté cette nuit, une de nos canonnières qui était en rade, a chassé et s’est engagée sur les rochers à une lieue de Boulogne. J’ai cru tout perdu, corps et biens ; mais nous sommes parvenus à tout sauver. Ce spectacle était grand : des coups de canon d’alarme, le rivage couvert de feux, la mer en furie et gémissante ; tout m’a tenu dans l’anxiété de sauver ou de voir périr nos marins ; l’âme était entre l’éternité, l’Océan et la nuit. À cinq heures du matin, tout s’est éclairci, tout a été sauvé, et je me suis couché avec la sensation d’un rêve romanesque ou épique. »
Plus d’une fois, dans la lutte du système continental, la nuit de Boulogne, qui peignit dès les premières pages de l’empire la décevance de la volonté du dictateur, revint à la mémoire de ceux qui avaient entendu Napoléon s’écrier : « Oh ! la terre, la terre ! »
10 juin 1804
Il est des associations toutes d’action et de vœux, qui ne sont point des complots. Le trône de la vieille monarchie était renversé, ses anciens soutiens cherchaient à le relever ; ils servaient un drapeau et ne conspiraient pas. Leurs regrets indiquaient leur pensée, et leur pensée était une ligne de conscience.
Les partis étaient en guerre, ils jetèrent le gant devant les supplices et la mort ; il fut relevé.
Napoléon venait de revêtir la pourpre impériale ; Louis XVIII lança ce manifeste :
« En prenant le titre d’empereur, Bonaparte vient de mettre le sceau à son usurpation. Ce nouvel acte d’une révolution où tout, dès l’origine, a été nul, ne peut sans doute infirmer mes droits. Mais, comptable de ma conduite à tous les souverains, dont les droits ne sont pas moins lésés que les miens, et dont les trônes sont tous ébranlés par les principes dangereux que le sénat de Paris a osé mettre en avant ; comptable à la France, à ma famille, à mon propre honneur, je croirais trahir la cause commune en gardant le silence en cette occasion. Je déclare donc, en présence de tous les souverains, que, loin de reconnaître le titre impérial que Bonaparte vient de se faire déférer par un corps qui n’a pas même d’existence légitime, je proteste contre ce titre et contre tous les actes subséquents auxquels il pourrait donner lieu. »
Les rois furent attentifs ; ces paroles eurent de l’écho. Il y eut guerre, et guerre à mort ; mais il fallait que la mort fût apportée avec des armes loyales. Une guerre de pièges n’était plus dans nos mœurs ; elle fit tache, et les drapeaux se cachèrent.
Tout ce qui se rattachait au point de vue de la légitimité était sourdement détruit. Un attentat prémédité menaça la vie du roi sur la terre étrangère. Des meurtriers furent envoyés de France à l’étranger ; les détails firent refléter des charges graves contre le dictateur couronné. Deux hommes se détachèrent du ministère des relations extérieures avec des passeports très en règle. Ils étaient porteurs d’instructions qui devaient les mettre en rapport avec un nommé Caulon qui tenait une taverne où venaient fréquemment les domestiques de Louis XVIII. Avant de quitter la France, l’un des envoyés révéla au jeune Descorches de Sainte-Croix, employé comme lui au même ministère, « qu’il avait accepté la mission de passer les frontières pour affranchir Napoléon des importunités que lui causaient les prétentions de Louis XVIII. » À cet aveu, Descorches conseilla à son condisciple d’entrer, en apparence, dans les vues criminelles qui lui étaient confiées, et de sauver le roi en le prévenant avec assez d’adresse pour ne pas se compromettre. Quelque temps après, on saisit sur la table de Louis XVIII des légumes empoisonnés : on appela des médecins qui constatèrent la présence de l’arsenic. Le gouvernement prussien ne poussa pas plus loin les investigations ; les coupables eurent le temps de passer à la Guadeloupe, où ils obtinrent des emplois, et le roi de Prusse, qui ménageait alors Napoléon, interdit au roi de France tout asile dans ses États. Ainsi la politique étrangère se joignait à un déni de justice devant un grand attentat ; ainsi, pendant que les serviteurs du roi légitime étaient poussés vers l’échafaud, le prince issu d’une lignée qui s’était grandie sur les trônes, trouvait à peine dans l’Europe un lieu où il pût reposer sa tête.
Le pays était tourmenté ; les partis étaient en présence ; ils lancèrent tous leur cri de mort. L’opinion avait désigné un fils de France pour guider le dévouement dans les mouvements insurrectionnels ; la Vendée allait encore offrir son tribut de foi et de courage ; mais, en rapprochant ses forces de Paris, il fallait provoquer une libération, et non entrer dans une conjuration de meurtre. Jamais les Bourbons n’avaient mis à l’encan la vie du premier consul ; une route souillée ne pouvait pas servir d’avenir au petit-fils de saint Louis ; un masque sur un attentat eût réussi, un plan sans voile échoua.
Les idées chevaleresques donnèrent accès à un cartel politique. Napoléon reçut un message authentique qui le prévint, « que son escorte serait attaquée par un prince de la maison de Bourbon, et qu’en cas de succès, le roi serait proclamé sur les cendres de Louis XVI. »
Le duc de Berry avait loué une maisonnette sur la grève étrangère, la trahison le releva de ce poste. Les premiers débarquements de sujets fidèles se firent sans obstacles sous la falaise de Beville, entre Dieppe et Tréport. On établit des étapes jusqu’à Paris ; quinze chaumières de distance en distance furent occupées ; là, on trouvait gîte et assistance. L’abordage était périlleux, un bateau pouvait rester couvert par la falaise ; puis il fallait escalader un à un le rivage, à l’aide d’une corde tendue du haut d’un rocher. Le capitaine Wrigth était chargé du débarquement ; des hommes sûrs étaient à leur poste pour hisser les arrivants et les déposer sur la côte !
La première station de cette course était une hutte sur la grève, près du village de Guillemecourt, et la seconde la ferme de la Poterie. Là apparurent, comme premières vedettes de la légitimité, les deux fils du duc de Sérent, ancien gouverneur des princes. Ils venaient sonder les dispositions des royalistes de l’Ouest ; et près de la colonne de Beaumanoir, où leur nom héraldique était inscrit, ils renouvelèrent le pacte du serment des trente. Ces deux passagers furent saisis et fusillés sur la plage.
La seconde embarcation portait Georges-Cadoudal et huit de ses compagnons ; la troisième mit à terre le général Pichegru et son ancien aide-de-camp, Lajollais ; la quatrième devait amener à la rive le frère du monarque, le comte d’Artois, et le duc de Berry. Les signaux détournèrent la voile et sauvèrent les princes.
Tous les serviteurs de la cause royale se joignirent, s’entraidèrent, unirent leurs efforts et leur vie. Charles d’Hosier et Dessole étaient allés au-devant de Georges-Cadoudal, et Georges au-devant de Pichegru. Les moyens étaient concertés : on arriva à Paris par petits pelotons. Charles d’Hosier, sous la livrée d’un cocher, conduisit Georges jusqu’aux barrières de la capitale ; là, Bouvet de Lozier l’attendait, il se chargea de son logement. Son premier refuge fut rue du Bac, au coin de la rue de Varennes ; ensuite il trouva un abri quai de Chaillot, n° 6 ; puis il se rendit rue Carême-Prenant, où l’un de ses compagnons lui construisit une cache impénétrable.
Pichegru donna avis à son frère, ancien prieur des Dominicains, de son arrivée ; mais il ne lui fit pas connaître le lieu de sa demeure. Il partagea pendant quelque temps la retraite de Georges ; peu après il alla se loger chez un de ses amis, Roland, entrepreneur de transports militaires.
Tous les hommes d’action s’étaient vus. Mais bientôt les premiers Bretons de l’armée royale qui parurent à Paris furent arrêtés et transférés dans une prison d’État. Le général Savary eut ordre de surveiller les rivages de l’Ouest. Les tentatives d’un prince qui avait attaché les destinées de sa maison à une lutte qui portait l’empreinte d’un combat en champ clos échouèrent. Napoléon préféra garantir son pavois par sa police plutôt que par ses armes.
La mort du duc d’Enghien avait mis un gouffre entre la royauté et l’empire ; Louis XVIII redoubla d’énergie et stigmatisa ainsi l’auteur de cet attentat.
« Il ne peut y avoir rien de commun entre moi et le grand criminel que l’audace et la fortune ont placé sur le trône, qu’il a eu la barbarie de souiller du sang pur d’un Bourbon, du duc d’Enghien. La religion peut m’engager à pardonner à un assassin, le tyran de mon peuple doit toujours être mon ennemi. Si la Providence, par des motifs inexplicables, me condamne à finir mes jours en exil, jamais, ni mes contemporains, ni la postérité ne pourront dire que, dans le temps de l’adversité, je me suis montré indigne jusqu’au dernier soupir d’occuper le trône de mes ancêtres. »
Cette voix foudroyait l’usurpation ; elle devint le cri de combat des Vendéens. Les bras, les plans, les œuvres de tous les royalistes furent consacrés à la défense de la légitimité. Tous les guerriers, tous les hommes d’État qui eurent foi aux droits légaux, aux principes conservateurs de la vieille monarchie, s’unirent. On rassembla tous les mécomptes, on groupa les haines, on invoqua les dissidences pour former un ensemble de force : c’était une voie de contre-révolution plutôt qu’une conspiration. Les hommes qui étaient entrés tête levée dans la ligue royaliste redoublèrent d’efforts. Georges Cadoudal et Pichegru avaient sondé Moreau ; mais l’incertitude avait laissé en suspens sa coopération.
Cependant le général Moreau, tout en affectant l’obscurité, visait à la renommée ; il attirait, loin de les éviter, tous les hommes qui avaient été froissés par le gouvernement. Moreau, le vainqueur d’Hohenlinden, ne pouvait stationner au pied du trône du vainqueur de Marengo. Il avait vu avancer la révolution du 18 brumaire, et ne s’en était point emparé ; le pouvoir seul était effacé de ses services. Moreau, auquel la nature avait refusé la promptitude de volonté qui domine et abat les obstacles, était peu propre à mesurer le génie audacieux qui tenait les rênes de l’État. Le premier consul le savait ; il se tint debout, et comprima toutes les célébrités qui visaient à sa chute.
Il y avait pourtant dans les prévisions des athlètes de la royauté quelque chose qui froissait la franchise. Moreau avait dénoncé Pichegru, son ancien chef, son protecteur, son compagnon d’armes ; cette dénonciation avait amené, au 18 fructidor, sa proscription ; et dans cet instant, il cherchait dans le mystère à unir son gantelet avec celui de Pichegru pour attaquer l’ennemi commun. L’orgueil blessé avait fait faire un pas ; ce pas était-il assez avancé ? On en doutait. Napoléon était pour tous, il est vrai, un rival de gloire ; mais ce n’était pas suffisant pour que les conjurés livrassent leur vie ; ici, il fallait la mettre en jeu : encore un effort, elle devint l’arrhe d’une réaction. Moreau voyait, dans un changement politique, un avenir de dictature, Pichegru une réparation, et Georges Cadoudal un levier monarchique.
La patrie avait contracté envers Moreau des engagements d’honneur ; elle était restée muette. Pichegru, le vainqueur de la Hollande, avait été muselé, et envoyé de Paris à Rochefort dans une cage de fer, pour gagner ensuite les déserts de Sinnamary ; une telle violence lui était allée au cœur. Georges avait mis ses engagements dans le devoir : dans les landes de la vieille Armorique il n’avait prêté qu’un serment, celui fait au roi de France. Tous voyaient dans Napoléon un soldat de fortune qu’ils auraient pu commander ; obéir à ses ordres révoltait leur fierté, blessait leur caractère et entachait leurs prouesses. Voilà les hommes drapeau. Mais pour soulever les masses il n’y avait ni unité dans les œuvres, ni unité dans les principes. Il fallait prendre des voies obliques ; elles réussissent peu en France, et alors elles n’eurent que de faibles adhérents.
Par ordre des princes, on abdiqua les poignards et les machines de meurtre ; cela entrait dans des lois de conscience. Les Bourbons ne connaissent que les voies franches et pures. L’histoire, d’ailleurs, avait montré que tous les pouvoirs de la république, qui étaient nés du sang et qui avaient voulu vivre dans le sang, étaient tombés. Les échafauds de 1793 tuèrent la Convention ; les mitraillades balayèrent le Directoire. On ne pouvait viser au triomphe qu’en atteignant un but noble et avoué ; on le chercha dans une restauration.
La police était aux écoutes ; elle offrit cent mille francs à celui qui lui livrerait Georges et Pichegru : avec une telle somme, on attaque bien des consciences. La police avait étendu son espionnage sur toutes les rives d’abordage ; afin de la mettre en défaut, les débarquements partiels furent changés, mais pas assez prudemment. Deux frères d’armes de Georges, Picot et Bourgeois, furent arrêtés à Pont-Audemer, et traduits immédiatement devant une commission militaire. Aucun aveu ne sortit de leur bouche, ils furent condamnés à mort : on leur offrit leur grâce pour parler, ils se turent et surent mourir. Un autre compagnon de Georges, nommé Querolle, fut soumis à la même épreuve ; sa tête devait tomber, mais avant, on le livra à la torture : ses doigts furent posés dans des étaux ; la douleur de la pression lui arracha des révélations qu’il n’avait point faites devant un arrêt de mort. Ainsi la torture, abolie par Louis XVI, fut inaugurée pour tuer le principe dynastique, par les hommes qui avaient crié liberté ! au pied des échafauds de 1793.
En broyant la loi avec une main de fer, on arracha à l’un des patients des aveux qui compromirent la cause commune. Le gouvernement livra à la publicité la découverte du grand complot qui, selon lui, « était tramé contre la vie de l’Empereur. »
Alors l’adulation des grands corps de l’État fit fléchir bien des genoux. Le clergé, rallié au nouveau pouvoir, inscrivit dans ses mandements des actions de grâces. Tout prit une attitude impressionnable et menaçante.
Cependant les hommes d’exécution n’avaient point perdu leur énergie. Georges et Pichegru avaient de nouveau conféré avec Moreau, à Chaillot ; mais ils n’avaient pas été satisfaits de l’entrevue. Moreau paraissait vouloir agir dans des vues personnelles, et Georges avait dit à Pichegru en se retirant : « S’il veut travailler pour lui, il faut le laisser. » Il fut laissé, mais la cause royale n’avança plus ; puis elle eut trop de confidents pour ne pas être trahie.
Napoléon avait rapproché de son cabinet le conseiller d’État Réal ; il l’avait investi du droit de suivre pas à pas toutes les démarches des royalistes. Ce mandataire s’était entendu avec Fouché ; ces deux hommes suppléaient aux investigations du grand juge Reynier. Bientôt quarante-sept prévenus furent mis en arrestation. Les lois qui protégeaient les accusés gênaient les ressentiments : avant de donner cours à la procédure, Napoléon fit annuler toutes les dispositions qui étaient la sauvegarde des prévenus. Un sénatus-consulte intervint le jour même des arrestations ; il suspendait pendant deux ans les fonctions de jury, et cela en ce qui touchait la connaissance des crimes d’État. Les prévisions de mort ne s’arrêtèrent pas là : le lendemain une loi déclara que le recéleur des conjurés serait jugé et puni comme les auteurs du crime. Devant une justice à la turque un tribunal révolutionnaire fut improvisé, il instruisit.
Réal, pour mettre en relief son zèle, pressait Napoléon de faire arrêter Moreau ; à ce nom, il hésita. Son empire n’était pas bien affermi ; devant un coup d’État la base pouvait manquer, et la couronne qui allait bien aux lauriers, pouvait passer sans grande secousse sur le front de son compétiteur en gloire. Le temps, les circonstances, le danger, tout était palpitant ; l’avenir était gros d’orages.
Cependant Napoléon ne recula devant aucune considération, ni devant aucun obstacle ; Moreau, qui habitait la belle terre de Gros-Bois, fut arrêté à quelques pas de cette résidence, et conduit au Temple. Georges, après avoir changé chaque jour de domicile, fut reconnu en cabriolet, à la descente de la montagne Sainte-Geneviève. Son cheval est arrêté ; il tire une arme à feu et brûle la cervelle à l’agent de police qui avait entravé sa route. Au bruit de l’explosion, le peuple accourt ; un chapelier et deux garçons bouchers se jettent sur lui et sur Léridan, son compagnon. Les deux premiers qui lui mirent la main sur le collet furent décorés peu après de la Légion-d’Honneur ; c’était Coqueluit et Langlumé. Pichegru fut plus facile à saisir ; il s’était réfugié chez un nommé Leblanc, rue Chabannais ; il fut vendu pour toucher la rançon de la délation. Comminges, l’un des plus fameux suppôts de la police, envahit sa retraite la nuit, le garrotta dans son sommeil et le déposa dans un cachot, enveloppé dans sa couverture.
Quelques jours après, les comtes de Polignac et le marquis de Rivière tombèrent au pouvoir des agents de la force publique : ce dernier portait sur son cœur un portrait du comte d’Artois avec ces mots : « À mon fidèle aide-de-camp de Rivière, pour les voyages périlleux qu’il a faits pour mon service. »
Chaque heure amenait une arrestation de plus. Bientôt la sellette du tribunal d’exception se remplit : on voyait les accusés rangés sur trois lignes. À la tête de la première colonne qui devait être abattue, figurait Georges Cadoudal ; Moreau était à la seconde ; c’était la réserve.
Un homme allait manquer au trépas juridique : Pichegru devait faire des révélations dans les débats ; on savait qu’il devait livrer la correspondance anglaise ; elle donnait à entendre que Napoléon, pour assurer la sécurité de son passage d’Égypte en France, avait promis son concours pour relever le trône des Bourbons ; et aujourd’hui il poussait vers l’échafaud tous ceux qui avaient gardé la foi au cœur et servi cette cause ; mais il n’y eut pas de révélations…
Pichegru fut trouvé étranglé sur sa couche. Son cadavre fut apporté dans la salle des séances. Les procès-Verbaux de commande établirent : « Qu’il avait passé dans sa cravate un tronçon de fagot, qu’il en avait fait un tourniquet ; que pour le fixer, il s’était couché dessus, et qu’il était expiré. »
« Cela me paraît incontestable, » dit ironiquement un habile physiologiste ; « et je ne doute même pas que Pichegru étranglé n’ait tiré le cordon de sa sonnette pour avertir qu’il était mort… »
Le capitaine Wrigth avait aussi quelque chose à dire hautement : plus tard il fut trouvé au Temple décapité dans son cachot ; les déclarations portèrent : « Qu’il s’était coupé le coup avec un rasoir. » On n’accordait aux prisonniers aucun rasoir, et pour tous il y avait un barbier. On frissonna devant tous ces attentats ; quelques voix prétendirent que la ceinture des Mamelouks était tachée, et qu’elle portait le secret de deux suicides.
Le grand drame juridique était ouvert. Des magistrats improvisés avaient été choisis pour servir la vengeance, plutôt que l’équité. On espérait tout de leur obéissance ; leur conscience était comptée pour rien ; quelques-uns méritaient cet affront.
Hémard présidait : ancien juge criminel, sa dureté pour les accusés était devenue proverbiale comme celle de Gérard, procureur-général ; on les appelait tous deux les chercheurs de coupables. L’ancien régicide, Thuriot, avait été nommé juge instructeur : Georges ne l’appela dans les débats que Tue-roi. Granger partageait ses sympathies. Bourguignon était l’ancien ministre de la police sous le Directoire. Desmaisons, comme terroriste, s’était expatrié après la chute de Robespierre ; Selves avait été évincé des tribunaux, il y rentra pour juger tout ce que l’honneur pouvait offrir de plus digne en célébrité et en courage.
Les autres juges étaient Clavier, Lecourbe, Martineau, Laguillaumie, Rigault et Dameuve. Ceux-là arrivaient sans antécédents fâcheux. Ils résistèrent longtemps aux préventions ; et on entendit Clavier, dans les premières délibérations où Thuriot opinait pour la mort du général Moreau, en assurant que le premier consul lui ferait grâce, s’écrier : « Et qui nous la fera à nous ! » mots sublimes, dignes des temps antiques.
Ainsi se préparaient les débats de ce procès qui a retenti dans les causes célèbres. Les interrogations de Georges firent les honneurs d’un cortège de mort.
« Votre nom ? – Georges Cadoudal. – Votre âge ? – Trente-cinq ans. – Depuis quel temps êtes-vous à Paris ? – Depuis environ cinq à six mois. – Où avez-vous logé ? – Nulle part. – Pourquoi refusez-vous de le dire ? – Parce que je ne veux pas augmenter le nombre des victimes. – Au moment de votre arrestation, ne logiez-vous pas rue et Montagne-Sainte-Geneviève, chez une fruitière ? – Au moment de mon arrestation, je logeais dans un cabriolet. – Que veniez-vous faire à Paris ? – Je venais pour attaquer le premier consul. – Quels étaient vos moyens ? – J’en avais encore bien peu ; je comptais en réunir. – De quelle nature étaient vos moyens d’attaque ? – Des moyens de vive force. – Où comptiez-vous trouver cette force-là ? – Dans la France tout entière. – Aviez-vous beaucoup de monde avec vous ? – Non, parce que je ne devais attaquer le premier consul que lorsqu’il y aurait un prince français à Paris, et il n’y en a pas encore. – Vous avez, à l’époque du 3 nivôse, écrit à Saint-Régent, et vous lui avez fait des reproches de la lenteur qu’il mettait à exécuter vos ordres contre le premier consul ? – Le billet que vous me présentez n’est pas de moi, je nie de l’avoir jamais écrit à Saint-Régent ; d’ailleurs ce billet est du 29 décembre ; j’étais à cent trente lieues de Paris ; l’affaire du 3 nivôse avait eu lieu le 24 ; je n’ai donc pu la décider par cet écrit. – Quels étaient les quatre hommes que vous vouliez introduire au palais des Tuileries ? – Je n’ai voulu introduire personne. Le premier consul était sur ses gardes, et mon intention n’a jamais été de le faire assassiner dans le palais des Tuileries en y introduisant quatre hommes. – Qui vous avait chargé de venir en France ? – J’y étais venu de concert avec les princes français. – Vous êtes resté à Paris quatre ou cinq mois, et vous n’avez rien proposé pour exécuter votre projet ? – J’avais à proposer, mais je n’avais encore rien absolument d’arrêté. – N’est-ce pas, au contraire, que vous n’aviez pas trouvé les moyens d’exécuter vos desseins ? – Si je n’avais pas trouvé de moyens, je m’en serais allé ; car il est inutile de se faire tuer pour ne pas réussir. – Quelles sont les personnes que vous fréquentiez le plus habituellement à Paris ? – J’ai vu quelques personnes, mais je ne les nommerai pas. – Avez-vous vu Coster Saint-Victor ? – Personne ; généralement je ne nommerai personne. – Qui devait fournir les fonds et les armes ? – J’avais les fonds, je n’avais pas encore les armes. – N’est-ce pas avec ce poignard que, secondé par des conjurés, vous vous proposiez d’assassiner le premier consul ? – Je devais l’attaquer avec des armes pareilles à celles de son escorte. – À quelle époque avez-vous servi dans l’armée royale ? – En 1793. – Lors de la pacification, y avez-vous consenti ? – On vint nous dire que l’intention de Bonaparte était de rétablir la monarchie ; c’était alors l’opinion publique en France, et nous vînmes à Paris pour l’aider et concourir à la rétablir. »
La franchise de Georges mit en relief les droits et la pureté de la cause qu’il servait. Il montra sa main que les sicaires avaient enfermée sous les vis d’un chien de fusil. Son courage avait surmonté la torture. Il n’avait dénoncé aucun de ses compagnons ; il avait dit : « Vous me tenez, c’est assez de ma vie. » Devant de telles épreuves on était sûr qu’il saurait mourir ; on ne fut point trompé.
Pendant que les dénégations des services rendus à la royauté étaient offertes en holocauste à la défense de la plupart des accusés, Georges releva la monarchie sur son trajet de supplice. Il mit en scène son drapeau ; il semblait le placer en face de ses juges pour braver la révolution. Ses déclarations furent toujours énergiques ; c’est ainsi qu’il s’exprima à la clôture de la séance :
« Monsieur le procureur-général m’a reproché de n’avoir pas tenu à la paix signée avec le général Brune. J’ai dit la vérité, je la répète : le gouvernement ne voulut pas ratifier les conventions passées entre ce général et moi. Le général Clarke et le premier consul se le rappellent sûrement. Alors croyant avec raison que le gouvernement, qui ne voulait pas ratifier le tout, pourrait très bien ne tenir à rien, il a bien fallu que je prisse mes sûretés. Mais la preuve que je tenais à la paix, c’est que depuis, je n’ai pas fait la guerre, et je pouvais la faire. Toujours attaché à la France et à la famille des Bourbons, les deux années passées en Angleterre ne m’avaient pas refroidi. Toutes les nouvelles que je recevais de France m’annonçaient que l’opinion publique était prononcée, que le vœu le plus ardent des Français était de voir renaître le gouvernement d’un seul. Au moment du traité d’Amiens, je n’ignorais pas qu’il était question de proclamer Bonaparte empereur. D’après ces nouvelles, je me déterminai à passer en France et à voir par moi-même si l’esprit public était réellement tel qu’on l’avait annoncé être. Mon dessein était d’examiner s’il n’était pas possible de faire tourner cette opinion en faveur de la famille des Bourbons. Si je l’avais trouvée favorable à cette famille, j’aurais sollicité l’arrivée d’un prince, et j’eusse calculé avec lui les moyens propres à obtenir le résultat désiré. Trompé dans mes espérances, je me suis abstenu de cette demande, et je n’avais pas réuni, six hommes. Voilà la vérité tout entière. Je ne sais si cette conduite porte le caractère d’une conspiration. Je ne connais pas les lois ; vous les connaissez, messieurs, je laisse à vos consciences à en décider. »
Après de tels aveux, on n’avait plus besoin de preuves pour faire tomber des têtes.
Pendant ce temps, Moreau écrivit à l’Empereur, et nia sa coparticipation à l’œuvre de régénération. Il traita de rêves et de folie les actes de la royauté ; il se justifia du reproche de n’avoir pas de nouveau dénoncé Pichegru, son frère d’armes, et prit une place à part dans les débats.
Voilà comment son défenseur repoussa l’accusation :
« Moreau ne dénonça pas Pichegru ; mais il battit l’armée autrichienne sur toute la ligne du Rhin ; il prit Kaiserslautern, Newstadt, Spire, défit Würmser, passa le Rhin en présence de l’ennemi, gagna les batailles de Renehen, de Rastadt, d’Ettenheim. Il ne dénonça pas Pichegru, mais, l’année suivante, il fit cette mémorable retraite à travers cent lieues de pays ; cette retraite, l’admiration des plus habiles généraux. Tant et de si brillants exploits étaient un moyen de déconcerter un complot plus sur sans doute, et plus glorieux peut-être qu’une dénonciation. Au surplus, si Pichegru conspirait, c’était contre le Directoire, contre un gouvernement dont l’expérience nous a montré les vices et les dangers, contre un gouvernement qui, quatre ans après, tomba sous le bras d’un héros et le cri unanime de la nation ; le chef qui nous gouverne a aussi conspiré. »
L’opinion royaliste ne prédominait pas ; l’intérêt était groupé sur de nouveaux trophées. La gloire de Moreau était aux prises avec la gloire de Napoléon ; c’était une lutte qui devait abattre des têtes : l’esprit public allait s’armer, et la geôle de Moreau s’ouvrit sous la pression du peuple et sous celle des armes. Georges avait dit : « Si j’étais le général Moreau, j’irais coucher ce soir aux Tuileries. » Cette prévision était juste. L’enthousiasme pour l’illustre prisonnier était général : lorsqu’il arrivait à l’audience, par un mouvement subit, tous les soldats de garde lui portaient les armes, et Moncey, qui commandait la gendarmerie, fit dire à Napoléon « que s’il ne faisait finir les débats, il ne répondrait plus de la troupe. »
La position devenait des plus critiques : le chef de l’État était renfermé avec Fouché ; il n’osait plus se montrer, il avait été hué ; c’était le signe précurseur d’une grande commotion.
La délibération durait depuis vingt-quatre heures ; elle se faisait presque sur la place publique. Tout le monde énumérait les voix ; on savait à l’avance qu’Hémard, Thuriot, Selves et Granger étaient pour la mort ; que Bourguignon proposait l’excuse qui éloignait la peine capitale, et que la majorité l’emportait pour la liberté du général Moreau, tout en frappant la plupart des autres accusés. On apprit qu’après les voix recueillies, le président avait différé de prononcer l’acquittement pour ramener ses collègues à la condamnation : c’était un crime de lèse-justice qui s’introduisait dans la chambre du conseil ; on avait remis en délibération une cause jugée, on replaçait sur la sellette des accusés absous. Ce délit était révoltant ; c’était une chambre ardente et non un tribunal. En prolongeant la discussion sur un arrêt rendu, le président ramena plusieurs juges à se réformer ; l’agitation était au comble ; enfin la porte s’ouvrit. L’encombrement gagna toutes les avenues ; on fit silence, et le président lut cet arrêt :
« La cour, considérant : que d’après l’instruction et les débats, il est constant qu’il a existé une conspiration tendant à troubler l’État par une guerre civile, en armant les citoyens les uns contre les autres, et contre l’exercice de l’autorité légitime ; que Georges et Jean Cadoudal, Bouvet de Lozier, Russillon, Rochelle, Armand de Polignac, d’Hosier, de Rivière, Ducorps, Picot, Lajollais, Roger, Coster, Deville, Gaillard, Joyaut, Burban, Lemercier, Lélan, Mérille, sont convaincus d’avoir pris part à cette conspiration, qu’ils l’ont faite dans le dessein du crime ;
Les condamne à la peine de mort, et déclare leurs biens acquis à l’État. »





























