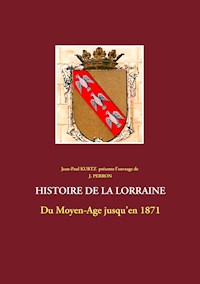
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Ce livre rédigé à la fin du XIXe siècle retrace l'histoire de la Lorraine depuis le Moyen-Age jusqu'à l'annexion de la Moselle par l'Allemagne en 1871. Cet ouvrage comporte de nombreuses gravures qui illustrent parfaitement le texte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 99
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AUTRES PUBLICATIONS DE L’AUTEUR
Ouvrages de l’Auteur
- DICTIONNAIRE DU GỂNIE CIVIL – Conseil International de la Langue Française (CILF) – Paris - 1997
- DICTIONARY OF CIVIL ENGINEERING – Kluwer Academic Publisher puis Springer – New-York – 2004
- DICTIONNAIRE ÉTYMOLOGIQUE DES ANGLICISMES ET DES AMÉRICANISMES (3 volumes) - (Réédition) – Books On Demand (BOD) – 2013
- NOUVEAU RECUEIL DE CITATIONS ET DE PENSỂES - (Réédition) - Books On Demand (BOD) – 2013
LES OUVRAGES DE GỂNIE CIVIL – Books On Demand (BOD) – Décembre 2013
Rééditions de livres par les soins de M, KURTZ
- LA BRETAGNE VIVANTE (Réédition) – Books On Demand (BOD) – 2012
- FÊTES ET COUTUMES POPULAIRES (Réédition) – Books On
Demand (BOD) – 2012
- LES BRETONS - (Réédition) – Books On Demand (BOD) – 2012
- LA VIE EN CHEMIN DE FER - (Réédition) – Books On Demand (BOD) – 2013
- LES BÊTISES SACRÉES - (Réédition) – Books On Demand (BOD) – 2013
- L’ART DE PAYER SES DETTES ET DE SATISFAIRE SES CRÉANCIERS SANS DÉBOURSER UN SOU, ENSEIGNÉ EN 10 LEÇONS - (Réédition) – Books On Demand (BOD) – 2013
- GUIDE PRATIQUE DES TRAVAUX MANUELS - (Réédition) –
Books On Demand (BOD) – 2013
- DICTIONNAIRE CRITIQUE DES RELIQUES ET DES IMAGES MIRACULEUSES (3 volumes) - (Réédition) – Books On Demand (BOD) – 2013
TABLE DES MATIỂRES
PREMIÈRE PARTIE
La Lorraine au moyen âge.
I. Des origines aux invasions barbares
II. La Lorraine depuis le commencement du moyen âge jusqu'à la fin du XIII
e
siècle
III. La Lorraine au XIV
e
et au XV
e
siècle - Jeanne d'Arc
DEUXIÈME PARTIE
L'âge moderne.
I. Les grands faits de l'histoire lorraine du XV
e
siècle à 1789
II. Organisation administrative de la Lorraine
III. La vie sociale en Lorraine
IV. Les lettres et les arts en Lorraine
TROISIÉME PARTIE
La période contemporaine.
I. Les grands faits de l'histoire lorraine de 1789 à nos jours
II. Changements apportés par le XIX
e
siècle à la vie de la Province
HISTOIRE DE LA LORRAINE
PREMIÈRE PARTIE
*******
La Lorraine au Moyen Age
Le nom de Lorraine date de plusieurs siècles; il n'a pas toujours désigné la même étendue de pays.
Au Xe siècle, la région lorraine était très vaste : elle allait des sources de la Meuse et de la Moselle à la mer du Nord. Aujourd'hui, on appelle Lorraine la contrée comprise entre la Franche-Comté au sud, la Champagne à l'ouest, l'Alsace à l'est, la Belgique et le Luxembourg au nord; c'est un plateau adossé au massif des Vosges, et dont les rivières principales Meuse, Moselle et Meurthe s'écoulent dans la direction du Nord. - L'histoire de ce pays, ainsi délimité, fait l’objet de ce petit livre.
I
DES ORIGINES AUX INVASIONS BARBARES
Les premiers habitants du pays ne connaissaient pas les métaux. Pour chercher leur nourriture et pour se défendre contre les attaques de leurs ennemis, ils se servaient d'instruments d'abord en pierre taillée, plus tard en pierre polie. On a trouvé en beaucoup d'endroits, notamment près d'Allain, de Morville-lès-Vic, de Sion et de Rebeuville, des haches polies, des flèches en silex délicatement travaillées, des marteaux emmanchés.
Les hommes de cet âge lointain n'étaient probablement pas très nombreux; ils n'aimaient pas les vallées, où l'on était trop exposé aux attaques des voisins; ils préféraient établir leurs demeures au sommet des collines; soit dans le creux des rochers, soit dans des huttes qu'ils construisaient eux-mêmes, comme on le voit par le mur préhistorique de la Trinité sur le plateau de Malzéville. Ils cultivaient le blé, l'orge et le seigle; ils connaissaient les boissons fermentées; ils tissaient le lin ou l'écorce du tilleul pour s'en faire des vêtements; ils savaient confectionner des vases en terre cuite.
Les ossements d'animaux qu'on a découverts dans les tombeaux montrent qu'ils élevaient quelques animaux domestiques, comme le cheval, et le porc. Ce sont les tombeaux, du reste, qui nous renseignent le mieux sur ces temps préhistoriques; quelques-uns d'entre eux sont très curieux. À Granges, par exemple, on a découvert autour d'un squelette huit haches en silex formant auréole.
La découverte des métaux : bronze d'abord, fer ensuite, constitua un grand progrès; c'était un pas en avant vers la civilisation.
Près de Vaudrevange, aux environs de Frouard et de Rosièresaux-Salines, les archéologues ont trouvé de nombreux objets en métal, qui remontent à cette époque : haches de toute forme, faucilles, couteaux, rasoirs, armes, poignards, épées, lances et flèches. Les colliers, épingles, bracelets et anneaux montrent que les femmes aimaient déjà les parures. On a découvert aussi des poteries, des pièces de harnachement fort compliquées.
Les habitations sont descendues dans la plaine, sans doute parce que la sécurité était plus grande qu'auparavant. Les cimetières, dont les traces nous restent, révèlent des populations pacifiques, car les tombeaux ne renferment pas d'armes.
Vers le IVe siècle avant notre ère, apparurent les Celtes ou Gaulois; ils soumirent tout le pays et s'y installèrent. Quelques Germains se mélangèrent à eux; mais ils perdirent très vite le souvenir de leur origine et adoptèrent les mœurs gauloises.
RUINES DE L’AMPHITHÉATRE ROMAIN. GRAND (Vosges)
CLOÎTRE DE L’ABBAYE DE LUXEUIL. (Haute-Saône)
Deux grands peuples celtes occupèrent la Lorraine.
Au sud les Leuques, dont le territoire s'étendait jusqu'au confluent de la Meurthe et de la Moselle.
Au nord les Médiomatriques.
Au sud-ouest, les Lingons s'avançaient jusqu'aux sources de la Saône.
Il n'y avait pas de grandes villes; les Gaulois habitaient plus volontiers la campagne; c'étaient des paysans souvent très pauvres. Ils vivaient des produits de l'agriculture ou de la chasse; les forêts des Vosges étaient giboyeuses et renfermaient des bêtes étranges, énormes survivances d'espèces disparues. Ils se réunissaient parfois pour organiser une expédition militaire ou pour entendre les récits des voyageurs et des guerriers; car, en Lorraine comme ailleurs, les Gaulois étaient sensibles à l'éloquence et à la gloire des combats.
La richesse était très inégalement répartie. Au-dessus du peuple, très nombreux, et qui ne comptait guère dans la société, vivait une classe aristocratique composée des grands propriétaires, à qui appartenaient l'influence et l'autorité. Cette classe noble était encore très puissante à l'arrivée de Jules César.
Les Leuques et les Médiomatriques adoraient beaucoup de dieux, non seulement des dieux tout-puissants que la Gaule tout entière avait en vénération, et dont les prêtres, appelés druides, étaient très écoutés, mais aussi des dieux locaux, particuliers au pays.
Tel le dieu du Donon, par exemple, qui protégeait toute la haute vallée de la Meurthe. Sur la colline de Sion se trouvait aussi un sanctuaire très souvent visité; on y a trouvé un ex-voto, dédié à la déesse Rosmerte, par un père dont le fils très malade avait, été subitement guéri. On connaît enfin le dieu Vosegus dont les autels s'élevaient dans la forêt vosgienne. Tous ces dieux se montraient exigeants; on leur sacrifiait parfois non seulement des animaux, mais aussi des hommes, superstitions absurdes et cruelles, que la conquête romaine devait faire en partie disparaître.
Cette conquête se fit sans bruit. Tandis que sur d'autres points de la Gaule, la résistance à César fut vigoureuse, héroïque même, en Lorraine aucune bataille ne fut nécessaire. Si les Leuques entendirent le bruit des armes, ils ne prirent pas part à la lutte. Peut-être envoyèrent-ils des troupes à Vercingétorix, lors du grand soulèvement qui devait aboutir à la défaite d'Alésia; César ne nous le dit pas. Ce qui est certain, c'est qu'ici comme ailleurs, la domination romaine fut facilement acceptée.
Le pays des Leuques et des Médiomatriques fit partie de la province de Belgique première avec Trêves pour capitale. Aucune colonie romaine n'y fut fondée, aucune garnison ne s'y implanta; la population resta ce qu'elle était auparavant. Le souvenir de l'indépendance disparut rapidement; on devint volontiers sujet de Rome; aucun privilège ne fut bientôt plus envié que celui de citoyen romain.
Cette soumission volontaire n'a pas lieu de nous surprendre. Jamais la Gaule n'avait été aussi heureuse que sous la domination romaine, et le pays des Leuques ne fait pas exception. Villes et campagnes jouissaient maintenant des bienfaits de la paix et de la civilisation. L'agriculture était prospère malgré les impôts de toute sorte. Des cités s'élevèrent, qui témoignaient par leur richesse de la prospérité générale ; on y voyait des constructions somptueuses et des monuments grandioses: arcs de triomphe, thermes, temples, etc., telles furent les villes de Grand; Scarpone et Naix. En certains endroits, la pioche de l'archéologue rencontre encore des débris de murs, des pierres tombales, des ruines de camps romains.
Les villes étaient réunies entre elles par des routes commodes, avec des bornes pour indiquer la distance. Toutes les routes qui traversaient notre province partaient de Reims : l'une allait de Reims à Strasbourg par Verdun et Metz; une seconde, de Reims à Toul par Naix; une troisième unissait Reims à Besançon et passait au sud-ouest du département actuel des Vosges. Enfin une voie transversale qui allait de Trèves à Lyon, traversait Nijon, Solimariaca (près de Rebeuville), Solicia (Soulosse), Toul, Scarpone, Metz. - On faisait peu de trafic sur toutes ces routes; mais c'est là que passaient les fonctionnaires et les soldats; c'est par là que les riches propriétaires, allaient visiter leurs domaines ou fréquenter les stations thermales, comme Plombières, dont les eaux étaient déjà connues et appréciées.
La présence des soldats et des fonctionnaires contribua à répandre la langue latine. Bientôt le celtique disparut et on ne parla plus qu'un latin corrompu, qui devait donner naissance plus tard à notre langue française.
La vieille religion gauloise dura plus longtemps.
Les Romains n’y prirent point garde; ils se contentèrent d'ajouter leurs divinités aux divinités celtiques. Parfois même elles se confondirent, au point que les érudits de notre temps ont peine à distinguer ce qui est gaulois de ce qui est romain. Les superstitions survécurent, sauf les sacrifices humains.
Au IIIe siècle apparurent les premiers chrétiens; ils eurent très vite converti la province. Les autorités locales les accueillirent mal; dès le début il y eut des persécutions, et, comme ailleurs, des martyrs, dont la légende complaisante a embelli la vie. Cent ans suffirent à la religion nouvelle pour remporter la victoire; il ne resta bientôt plus du paganisme que quelques souvenirs et de vieilles coutumes que les siècles ne parvinrent pas à détruire.
Dès le IVe siècle commencent les invasions barbares.
LACS DE RETOURNEMER ET DE LONGEMER
Les Germains d'au-delà du Rhin, pauvres et besogneux, jetaient depuis longtemps des regards de convoitise sur les terres de l'Empire romain, fertiles et bien cultivées; ils quittaient famille par famille leur pays d'origine, franchissaient le Rhin, et s'installaient en Gaule, soit comme colons, soit comme soldats; c'était une sorte de pénétration pacifique. Ce ne fut guère qu'au milieu du IVe siècle que les groupes d'envahisseurs devinrent plus nombreux et plus dangereux. Les plus terribles parmi les barbares furent les Huns, d'origine asiatique, qui traversèrent notre province sans s'y arrêter, ne laissant derrière eux que la ruine et la misère. D'autres peuples furent plus stables, comme les Alamans, les Francs ripuaires et les Francs saliens; ceux-ci élurent domicile dans le pays, et fondèrent leur puissance sur les ruines de la domination romaine.
Pour mieux résister à l'invasion, les habitants avaient pris l'habitude de se retrancher dans les villes, que l'on entoura de fortifications. Les villes fortes se construisaient de préférence sur le sommet des coteaux; la défense pouvait s'y organiser plus facilement.
ARMES ET BIJOUX FRANCS, TROUVÉS À NANCY.
II
LA LORRAINE DEPUIS LE COMMENCEMENT
DU MOYEN ÂGE
JUSQU'À LA FIN DU XIIIe SIÈCLE
La Féodalité laïque.





























