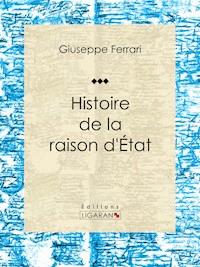
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Rien ne répugne à la nature comme de faire les hommes libres et égaux. Elle prodigue la vie sans règle ni mesure ; elle se plaît à la lutte, aux contrastes ; la discorde est son élément, la guerre semble son but dernier ; partout nous trouvons le règne de la force. Prenez la famille : l'homme commande à la femme, le père à l'enfant, le maître au domestique qu'il ravale au rang du bœuf et de l'âne..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335034899
©Ligaran 2015
Ce n’est pas la justice qui fonde les royaumes, ni la vertu qui distribue les couronnes ; le crime peut présider à l’origine des empires, l’imposture crée parfois de vastes religions, et une évidente iniquité fait souvent paraître et disparaître les États, comme si le mal était aussi nécessaire que le bien. Une nature également indifférente à Dieu et à Satan explique seule les libertés, les servitudes, les partis, les guerres, les révolutions, les sectes qui les enfantent et celles qui les résolvent ; seule, elle dispense le caractère, les passions, l’énergie, toutes les forces qui enchaînent la fortune à la suite de ses élus ; le drame des principes n’arrive qu’après, comme une œuvre fictive, capricieuse et changeante.
Cette vérité surgit pour la première fois des batailles italiennes, au milieu de perpétuelles révolutions qui emportaient une multitude d’États sans diètes, die villes sans lien, de citoyens sans lois, d’hommes sans patrie. Les déceptions qui se multipliaient Firent désespérer de la morale, et on chercha un principe supérieur à tous les principes, une raison supérieure à la raison elle-même, pour s’élever au-dessus de tous les gouvernements, à l’imitation du souverain pontife, qui règne sur toutes les nations. Bientôt 424 écrivains enseignèrent hardiment l’art de mener les rois, de surprendre les peuples, de flatter les chefs, d’écraser les rebelles, de dominer les évènements, l’art, en un mot, de produire de grands effets par de petites causes, en bouleversant les États par une sorte de nécromancie politique. On exhuma de l’antiquité cette doctrine mystérieuse qui avait sacrifié tant de victimes humaines à l’aveugle divinité du Salut public, et, cette fois, on songea à lui immoler l’Église elle-même avec toutes ses traditions. En vain, un prélat de la cour de Rome, Monseigneur de la Casa, s’efforça d’arrêter cette nouvelle insurrection contre les dieux du Moyen Âge. Quand il la dénonça à Charles-Quint, sous le nom jusqu’alors inconnu de Raison d’État, cette parole, plus puissante que sa pensée, se retourna contre lui et retentit chez toutes les nations où 470 écrivains nouveaux répondirent à ceux de l’Italie, pour chercher la raison des États au sein des nouvelles révolutions de Luther, de Richelieu et de la Fronde.
La politique est si éphémère, ses traités même les plus abstraits obéissent tellement aux circonstances du moment, que longtemps il me fut impossible de m’orienter au milieu de cette littérature aujourd’hui perdue dans les coins les plus inexplorés des bibliothèques. Je n’y vis d’abord que des écrivains bizarres, solitaires, se succédant au hasard, se copiant de même, tombant dans de continuelles redites, les uns scolastiques, les autres pédants et trop souvent odieux, tantôt à cause de leur perfidie systématique, tantôt de leur bassesse illimitée. Autant de têtes, autant d’avis ; nul fil apparent qui ralliât des théories si diverses ; partout des transitions brusques, des contrastes imprévus. Celui-ci apprend à conspirer, celui-là à réprimer les conspirations ; ici on fait l’éloge du prince, là de la république : l’un vous propose le modèle de David, l’autre celui de Tibère. D’abord on se fatigue, bientôt on se perd au milieu de tant de préceptes, si ouvertement contradictoires. En effet, on naît politique ; personne n’enseigne le tact, la présence d’esprit, l’à-propos, le coup d’œil, la parole impérative, le silence créateur qui décident des grandes actions. Les situations seules inspirent les héros ; chaque révolution enfante ses chefs : la vieille république produit César, le jeune empire élève Trajan ; aucun maître n’apprend à se résoudre promptement dans les diverses alternatives de la vie. Loin de là, chaque maxime se présente accompagnée de la maxime contraire ; si l’une conseille la clémence, l’autre recommande la terreur, et les plus grands écrivains nous jettent dans l’irrésolution en ouvrant à tout propos des avis opposés.
J’aurais donc laissé les politiques italiens à leur sommeil séculaire, si tout à coup je ne m’étais aperçu qu’inutiles dans l’action, condamnés à une éternelle stérilité dans la pratique, leurs préceptes acquièrent un sens nouveau dès qu’on les considère comme l’expression de lois générales auxquelles les hommes obéissent à leur insu. Ces lois, en effet, ne dirigent pas ceux qui fondent les monarchies ou les républiques ; mais tout État sera toujours monarchique ou républicain ; ils ne guident pas ceux qui flattent ou qui tuent, mais toute démarche, en présence d’un adversaire, ne sera jamais qu’un piège ou une attaque ; enfin, pour employer une comparaison tirée de l’art poétique, on n’apprend rien au poète, en lui disant que tout drame se divise en actes, mais on révèle au philosophe que la représentation scénique a besoin de repos, d’intervalles, de retours, de distances mystérieuses, ou que la fable a sa cadence comme le vers, sa mesure comme les colonnes d’un édifice, et son dénouement comme la coupole d’une cathédrale. La Raison d’État enseigne à son tour les distances, les intervalles, les retours qui alternent les gouvernements, le rythme qui les oblige, dans l’espace aussi bien que dans le temps, à se succéder d’une manière déterminée avec tels, ou tels chefs. Le monde a toujours obéi à ces lois qu’il a toujours ignorées et que la politique italienne a entrevues sous la forme absurde du précepte.
Le jour où je saisis cette idée, la confusion des théories se dissipa devant moi comme par enchantement ; je dominai le chaos des opinions, je suppléai au silence des écrivains, je comblai les lacunes et restituai la continuité du progrès à des théories qui semblaient la nier. Mon travail cessa d’être aride, je lus un autre livre dans chaque livre, j’entendis la voix unique du Destin à travers tant de voix discordantes, et je me plus dès lors à la monotonie de ces écrits où je voyais se confirmer les lois générales avec tant d’obstination et où les hommes qui se croyaient maîtres de la nature n’en étaient que les plus aveugles instruments. Peu m’importait désormais leur bassesse ou leur perfidie ; seule, impassible, implacable, là Raison des États les classait à la suite des monarchies ou des républiques, des révolutions ou des réactions, juste au moment où la divine comédie de l’histoire réclamait leur apparition avec un rôle prédestiné.
Pour expliquer ce spectacle saisissant, je devais transporter le lecteur en dehors des batailles du jour, au-dessus des évènements contemporains, dans une région supérieure à toutes les nations, à une hauteur où les hommes disparaissent dans les masses qu’on voit enfin se mouvoir avec la précision du nombre. Sans s’écarter des mille voies obscures et tortueuses de la biographie, on ne pouvait se placer dans la grande route des partis où tous les hommes finissent par aboutir. La politique des nations écrase celle des savants. J’ai donc dû diviser mon ouvrage en deux parties distinctes et presque opposées. Dans la première je montre comment les peuples naissent deux à deux, voués à une guerre éternelle ; comment ils fondent les États les uns contre les autres en n’écoutant que les suggestions de la guerre ; comment leurs traditions constamment doubles se retrempent l’une l’autre en s’interrompant tour à tour par des formes incendiaires et néfastes. Après avoir exposé le travail de la nature et la gravitation générale des États avec ses déviations périodiques, il m’a été permis de suivre, dans la seconde partie, la raison des États telle que l’ont conçue les écrivains qui se sont succédé en se combattant, soumis eux-mêmes à l’ordre, à la symétrie et aux contrastes de la guerre universelle. Les grandes lignes étant ainsi tracées, chaque individu a pris aisément sa place, les abréviations sont devenues faciles ; j’ai pu hâter le pas accélérer la marche, traiter militairement les détails et les pédanteries trop nombreuses. Ma tâche simplifiée ne m’imposa plus que de mettre à la place d’une scolastique superflue une statistique exacte des auteurs, un classement rigoureux de leurs rêveries, un dénombrement complet qui développât en chiffres la force de leurs idées. Ici je n’ai épargné ni les voyages ni les recherches ; les bibliothèques de Milan, de Paris, de Florence, m’ont révélé leurs trésors, et je n’ai pas négligé les manuscrits politiques, plus précieux que les livres dans les époques de silence.
Cependant, si j’attends quelque indulgence des philologues, que j’ai mis en mesure de vérifier mes assertions les plus personnelles, je ne dois pas dissimuler aux politiques que je parle d’une science occulte, tuée par la publicité moderne et solennellement proscrite par la Révolution de 1789. La justice trône seule désormais dans les papiers publics ; les gouvernements la représentent, leurs ennemis eux-mêmes la prêchent avec un surcroît d’ardeur, et la vertu reçoit partout sa récompense. On ne voit plus l’homme dans l’inexorable alternative de se faire l’esclave d’un chef ou d’une loi, d’une tradition ou d’une révolution, d’une patrie ou de la guerre universelle. On pourrait se croire sous le règne de la grâce. Que ferons-nous donc, nous qui étudions le règne de la force ? Dissimulerons-nous sous des contours efféminés les rudes vérités de la nature ? Mentirons-nous parce que la science n’est plus à la mode ? Ou exigerons-nous que les rois deviennent philosophes ? Non, nous nous adresserons à ceux que l’amour du vrai amène dans la république des lettres, aux solitaires qui n’ont aucun rôle à jouer, aux historiens habitués à considérer les peuples de haut et de loin, en un mot, aux philosophes pour lesquels il n’y a ni parti ni patrie. Montrons l’homme tel qu’il est, sans sermons ni pruderie, et sachons nous suffire assez pour dédaigner les vides consolations de l’erreur.
Tout progrès enfante une conquête. – Toute conquête conduit à la monarchie universelle. – Exemples anciens. – Exemples modernes.
Rien ne répugne à la nature comme de faire les hommes libres et égaux. Elle prodigue la vie sans règle ni mesure ; elle se plaît à la lutte, aux contrastes ; la discorde est son élément, la guerre semble son bût dernier ; partout nous trouvons le règne de la force. Prenez la famille : l’homme commande à la femme, le père à l’enfant, le maître au domestique qu’il ravale au rang du bœuf et de l’âne : considérez l’État ; il est la proie du plus fort qui donne le nom de rebelles aux vaincus : regardez l’humanité ; le blanc condamne le nègre à l’esclavage, toutes les races se disputent le sol les armes à la main ; nulle part on ne voit deux peuples, deux climats, deux terres, deux situations qui s’équilibrent spontanément comme deux quantités mathématiques. Les lots du globe seraient artificiellement distribués par un génie bienfaisant à des tribus égales en nombre, en force et en dispositions que les reflets seuls du soleil ou les caprices des nuages sèmeraient encore d’un côté la misère, de l’autre la richesse, partout cette amère différence qui nous rend ennemis, guerriers et conquérants.
Un bouclier plus facile à manier, une épée mieux forgée, une pique plus longue ou plus légère, une invention nouvelle, un dernier perfectionnement ; bref, le moindre avantagé, suffit pour donner aux uns la victoire et aux autres la défaite, de même qu’à la course un pouce de distance décide du triomphe. Or, une première conquête étant accomplie, l’inégalité grandît : deux fois plus nombreux, plus aguerri, mieux armé, le peuple victorieux fait main basse sur ses faibles voisins, il devient le noyau d’une avalanche, il augmente ses forces en marchant et il entraîne tous les peuples dans son tourbillon dévastateur, pour ne plus se reposer que dans la monarchie universelle. Nous sommes sur la terre comme des gladiateurs dans le cirque et comme si la couronne du monde était offerte au plus fort sortant de la mêlée universelle.
En effet, les premières légendes des anciens parlent de Fou-hi, de Sésostris, de Ninus, de Sémiramis, qui subjuguent en quelques jours la moitié du genre humain. Les premières pages de l’histoire montrent d’abord les Perses de Cyrus soudain maîtres de toutes les régions depuis l’Égypte jusqu’à l’Inde, et bientôt les Grecs d’Alexandre dont l’expédition féerique dompte la moitié de la terre habitée. Plus tard les Parthes deviennent en peu de temps si puissants, que les Césars les redoutent et que Rome copie leurs chasses et leurs modes. Les Huns d’Attila, que personne ne connaissait en 250, s’étendent en deux siècles depuis la grande muraille de la Chine jusqu’aux remparts de Paris. Cent ans suffisent à l’islamisme pour régner depuis les Pyrénées jusqu’à l’Oxus, et, en moins de cent ans, les Mongols de Gengiskhan improvisent un empire qui enveloppe, dans son extravagante étendue, d’un côté la Chine, la Perse, la Tartarie, et une foule de royaumes intermédiaires ; de l’autre la Russie, la Hongrie et la Pologne, encore aujourd’hui attardées, grâce à cette épouvantable invasion.
Les conquêtes d’une rapidité moins convulsive montrent encore mieux la tendance de toute nation à s’emparer de l’univers. Ainsi, pourquoi Rome dévore-t-elle, les uns après les autres, les Latins, les Étrusques, les Grecs, les Gaulois, tous les peuples du monde connu ? Par cela seul qu’une fortune, une vertu, ou un hasard primitif lui ont accordé un avantage préalable, un temps d’avance sur tous les États des alentours. Elle subjugue les Samnites, parce qu’elle a vaincu les Latins ; elle dompte Cartilage, à cause qu’elle avait broyé les Samnites ; elle entraîne tous les peuples dans son orbite, car, à chaque conquête elle a augmenté son poids, dont la gravitation rompt enfin l’équilibre de la terre. La même cause donna à la Chine une population de trois cents millions d’hommes, depuis cinq mille ans soumise à un même chef, à un même gouvernement, aux mêmes lois, et si compacte dans sa fusion intérieure, qu’elle absorbe désormais jusqu’aux invasions étrangères en renversant ainsi jusqu’aux lois de la conquête. Que si nous tournons nos regards vers les régions solitaires de la jeune Amérique, nous voyons encore la civilisation s’y manifester par les deux empires de Mexico et du Pérou, c’est-à-dire par deux grandes invasions organisées, par deux conquêtes expansives, par deux États destinés à envahir les deux parties de ce continent, en imitant les Romains, les Chinois ou les Mongols.
Qu’est-ce qu’une capitale ? – Babylone. – Rome. – Paris. – Immortalité des capitales. – Leurs ruses. – Leurs haines. – Leurs amours.
Toute ville est une œuvre de guerre et le premier fruit d’une conquête expansive. Entourée de remparts, protégée par des tours, isolée par des fossés, on la bâtit afin qu’elle règne sur le sol en dominant les fleuves, les gorges, les plaines, les côtes, tous les endroits par où l’ennemi peut la surprendre. Sans doute les arts, les plaisirs, les joies de la paix s’y donnent rendez-vous, et ses habitants semblent ne se réunir que pour mieux fraterniser entre eux ; mais à qui dérobent-ils leur bonheur ? à des voisins ; sur quoi se fonde leur fraternité ? sur la nécessité de combattre dans les mêmes rangs, et leurs fêtes seraient de courte durée, si les sentinelles cessaient de veiller.
En se multipliant, les villes forment l’État ; et c’est encore l’art militaire qui les engendre, les rallie entre elles, les hiérarchise et les subordonne à une capitale régnante, comme le quartier général d’une armée, ou comme le navire amiral d’une flotte. Toute capitale représente le mouvement d’une conquête. Elle dirige les combattants, distribue les rôles à des cités subalternes, les anime, les façonne, les transforme en relais pour arriver à la frontière, et fait de l’État un être organisé avec un rayonnement d’entrepôts, de bazars, de fabriques et de forts corrélatifs à l’irradiation des forteresses, des arsenaux et des forces guerrières. C’est ainsi que la superbe Babylone s’élève sur le sol enchanté qu’arrosent les quatre fleuves de l’Éden, dans ces lieux où la terre se confond avec le ciel. Un immense emplacement sert tout ensemble de repaire aux armées et d’abri aux rapines. Des rois conquérants y vivent au milieu de festins merveilleux, faisant construire des édifices titaniques par des myriades de captifs et entourant la ville de bastions si formidables, que leur vue seule arrête l’ennemi. Ses victoires s’étendent par l’extermination des royaumes, et, vaste comme une province, remplie de terres vagues qui nourrissent ses habitants, elle agit comme un inépuisable volcan dont les éruptions ensevelissent les régions inférieures prédestinées à l’esclavage. Dès son origine, le grand empire de la Chine tourne également autour d’une capitale gigantesque, et quand, après une longue crise de près de mille ans, un empereur rétablit l’unité primitive, Nien-Yong surgit au milieu d’épouvantables dévastations, où les villes disparaissent par centaines et les hommes par millions. Nous ignorons l’origine de Thèbes aux cent portes et de ses monuments granitiques, mais nous la voyons sortir d’une guerre aux nomades, qui s’enfuient refoulés dans les profondeurs de l’Arabie, et nous entendons encore leur cri dans la Bible qui attribue la fondation des villes à Caïn, meurtrier de son frère. Rome, à son tour, ne se développe-t-elle pas par une longue série de fratricides héroïques qui commencent avec l’assassinat de Rémus, s’étendent avec la ruine de toutes les cités du Latium, du Samnium, de l’Étrurie, se multiplient par le ravage de l’Afrique, de l’Espagne, de la Gaule, de l’Allemagne, de la Grèce, de l’Asie, et se terminent à la réorganisation complète de la terre, en remplaçant d’innombrables capitales par un seul centre de six millions d’habitants, ravitaillé par des routes éternelles et appuyé en sous-ordre par de grandes succursales, telles que Milan, Aquilée, Trêves, Cologne et Antioche ? Quelques-unes parmi ces villes reçurent le nom de seconde Rome, et toutes, modelées sur la capitale, régnèrent sur de vastes contrées, où, servant d’entrepôt, elles s’offraient aussi comme étapes aux légions qu’elles lançaient aux confins.
Pour être moins dévastateurs et moins sanguinaires, les centres fondés depuis l’ère chrétienne ne sont pas moins implacables contre les obstacles qu’ils rencontrent. La plus parfaite parmi les capitales modernes, Paris, semble naître avec la France ; au milieu d’une grande plaine, sur un fleuve docile, dans des terres fertiles, presque toujours habitée par ses rois, on la dirait dispensée de la funeste nécessité de ravager les alentours ; la nature paraît seule en avoir fait le point de ralliement des Français. Cependant son existence tient à une longue série de dévastations quasi romaines, et son heureuse position ne sert qu’à la destiner aux conquêtes. Elle vit en combattant la Bretagne, la Gascogne, la Provence, la Lorraine ; sa centralisation ne s’étend qu’en refoulant la triple invasion de l’Allemagne, de l’Angleterre et de l’Espagne ; sa prospérité sème la désolation dans les cités détrônées. Que de victimes autour de la nouvelle Lutèce ! Arles, Toulouse, Rouen, Rennes, Aix, ont été des capitales riches, florissantes, redoutables ; Provins, Abbeville ont compté parmi les plus grandes villes du Moyen Âge, et aujourd’hui elles égalent à peine la Rochelle et Soissons ; et leurs municipalités ne peuvent ni couper un bois, ni contracter une dette, ni faire grâce d’un jour de prison sans la permission de leur ancienne ennemie. – On pourrait croire que Milan, jadis plus heureuse que Lutèce et déjà siège des empereurs, n’avait qu’à survivre pour continuer à être le centre de la Gaule cisalpine ; mais dans la géographie politique, survivre, régner, combattre sont synonymes, et pour garder sa place au milieu de la Lombardie, il fallut que la ville de Bellovèse recommençât sa carrière, imitât Paris et subjuguât plusieurs fois l’une après l’autre toutes les localités voisines, depuis les plus misérables bicoques de la Martesana et de Seprio jusqu’à l’ambitieuse Pavie, qui voulait lui opposer un royaume. Que dis-je ? L’élégante Florence, la petite Rome, comme l’appellent ses chroniqueurs, cette fée qui se nourrit d’art et de poésie, cette nouvelle Athènes vouée au culte de la liberté sous toutes les formes, ne s’empare de la Toscane qu’à force de luttes et de batailles, rasant Simifonti, assiégeant Prato, s’avançant à pas de fourmi, recommençant sans cesse d’effroyables combats contre Pise, Pistoie, Sienne, Arezzo qui lui résistent jusqu’aux derniers jours de la renaissance italienne, toujours prêtes, même à travers les révolutions postérieures, à renouveler leurs anciennes levées de boucliers.
Fondés par des conquêtes séculaires, où le travail de l’homme explique celui de la nature, les grands centres acquièrent une sorte de vitalité organique qui les rend infiniment supérieurs aux vues des individus, aux desseins des conquérants, à nos volontés, à nos partis pris, à nos colères d’un jour. Démantelées plusieurs fois, leurs murs se relèvent comme s’ils repoussaient seuls ; dévastées, saccagées, elles réparent leurs désastres, et quelques années suffisent à reproduire leur splendeur ; détruites, elles ressuscitent de leurs cendres comme Babylone, qui renait à Ctésiphon, à Séleucie, à Bagdad, ou comme Rome qui remplace la perte d’une domination universelle par la conquête, d’une suprématie spirituelle. C’est que les routes y ramènent le commerce, les choses y reconduisent les hommes ; les villes, jadis subalternisées, y cherchent encore leur point de croisement ; des forteresses de relais y réclament leur base stratégique, l’expérience du passé sert de leçon à l’avenir, et à défaut de réflexion la superstition des habitudes replace la civilisation dans l’enceinte qui lui a servi de berceau. Ainsi Jérusalem détruite par les Assyriens se lève de nouveau à la voix de ses prophètes qui n’avaient cessé d’attendre Cyrus ; Milan se joue de la colère de Frédéric Barberousse qui a semé le sel sur ses ruines ; et il faut que le monde moral tourne sur son axe pendant mille ans pour qu’un grand centre laisse ses débris dans le sable du désert ou dans les marécages d’un port obstrué. Enfin, lorsqu’une capitale tombe, ne fût-ce que pour un jour, on peut dire sans exagération que sa chute retentit dans le monde entier. Elle suppose de nouvelles invasions, de terribles déplacements, une espèce de tremblement de terre, l’apparition de Sésostris, d’Attila, de Gengiskhan, de Charlemagne, de ces météores qui se montrent à de rares intervalles pour éblouir et attrister le genre humain.
Semblable à l’araignée au centre de sa toile, toute ville régnante possède un instinct qui l’éclaire, une adresse qui se confond avec ses besoins ; elle a des tendances persévérantes, des ruses naturelles, des desseins invariables ; elle parle un langage qui emprunte ses signes à la géographie politique et qu’on entend toujours, même dans le silence de l’histoire, même dans le tumulte des révolutions. Partez de cette incontestable donnée que chaque capitale veut s’étendre, qu’elle ne souffre aucune rivale, qu’avide à l’infini, elle exploite toutes les forces, profite de toutes les occasions, ne s’oublie devant aucun évènement, ne recule devant aucun sacrilège, et vous comprendrez pourquoi Madrid défend constamment la monarchie, l’inquisition et le roi, lorsque Saragosse ou Cadix, Séville ou Tolède proclament les juntes et se déclarent insurgées. Ce sont des centres détrônés dont la capitale espagnole combat les prétentions sous toutes les formes. Pour la même raison, Paris combat les ligues, les accuse de rébellion, et la populeuse Lyon lui paraît républicaine pendant tout le Moyen Âge, quoique aux jours de la République elle la mitraille, l’accusant de royalisme. Les capitales italiennes, toutes consacrées par une victoire sur une ville inférieure et jadis indépendante, se montrent sans cesse guelfes quand la rivale subjuguée suit les gibelins ou réciproquement gibeline quand elle suit les guelfes. Ôtez cette manœuvre de la haine et Milan ne saurait régner sur Pavie, ni Parme sur Plaisance, ni Florence sur Pise, ni Rome sur Bologne, ni Naples sur Palerme. On conçoit donc que Londres reste fidèle aux anglicans, puisque Édimbourg suit toujours les puritains, que Byzance s’engage chaque jour davantage dans l’arianisme en présence de Rome vouée à la trinité catholique et que dans des temps plus reculés Rome elle-même regrette les infamies de Néron, de Tibère, de Caligula, en présence des césars vertueux qui arrivent des provinces, à la suite de Galba, lui apporter l’insurrection de ses sujets et le joug de l’étranger. Enfin d’où vient la plus splendide des dualismes, l’hérésie manichéenne, cette poétique apothéose de la lumière et des ténèbres, de la vertu et du crime, de la communauté et de la propriété, de tous les contrastes de la politique, de la morale et du culte ? Elle vient de Persépolis opprimée par Gundischapor, de l’ancien centre asiatique supplanté par la capitale sassanide ; seul il se prétend voué au culte d’Oromaze, de même que Rome seule prétend connaître la véritable nature du Christ, et Cosroë ne sauve l’empire persan et son siège renouvelé qu’en égorgeant cent mille manichéens. Enfin, quel que soit l’État où vous êtes né, passez la frontière, vous vous sentirez hors de la protection du sol organisé, vous vous trouverez chez l’étranger et alors vous comprendrez mieux votre patrie, votre nationalité qui vous aura armé d’antipathies, de préjugés, de proverbes, de dérisions contre les autres peuples, et vous arriverez à cet axiome fondamental que, dressé pour le combat, avide par nécessité, par éducation, par tradition, partout vous regardez vos voisins comme vos ennemis. Qu’est-ce qu’être Français ? C’est haïr l’Allemagne, jalouser l’Angleterre, railler l’Italie, se moquer de l’Espagne et rêver les conquêtes des croisés, de Louis XIV ou de Napoléon. Et d’où vient ce froid glacial qui nous pénètre par tous les pores à l’approche d’un Anglais ? de son égoïsme chiffré, de la seconde nature du commerce qui lui fait transporter l’inimitable flegme du comptoir dans toutes ses actions, en présence de tous les peuples, dans les situations les plus héroïques ou les plus tragiques de la vie.
Les amours des capitales et leurs sympathies ne sont pas moins intéressées que leurs haines. Voyez la docilité de Constantinople sous les Turcs qu’elle avait combattus à outrance avant 1435 ! Cette soumission s’explique par cela seul qu’avant cette époque les musulmans lui avaient enlevé l’Asie Mineure, tandis qu’en s’établissant eux-mêmes dans la ville de Constantin ils lui assurent l’obéissance, non seulement de l’Asie Mineure, leur siège provisoire, mais de presque toutes les provinces révoltées ou perdues. Londres semble endormie ou insouciante de ses intérêts quand elle accepte pour roi le fils de Marie Stuart, son ennemie. La grande cité voudrait-elle recevoir des ordres d’Édimbourg ? Au contraire, en se donnant à Jacques, elle prend l’Écosse qui le suit et que, cette fois enfin, elle décapite moralement. N’est-elle pas merveilleuse la tendresse des czars pour les populations schismatiques opprimées par l’islamisme ? C’est qu’ils convoitent l’empire de Byzance ; c’est qu’ils commencent par protéger des croyants dont ils veulent s’emparer ; c’est que partout les protecteurs sont des maîtres dans l’attente, soit qu’ils promettent la liberté, soit qu’ils se disent des frères, soit qu’ils arborent la croix, soit qu’ils glissent mystérieusement dans nos mains le symbole démocratique du triangle.
Par une dernière bizarrerie, ces capitales, ces nations si Jalouses des voisins, si habiles à saisir leur faible, si impitoyables contre les étrangers, prodiguent les témoignages d’amitié aux nations les plus lointaines. La France multiplie sans cesse les avances à l’Écosse, au Portugal, à la Pologne : d’une sensibilité maladive, elle fraternise continuellement avec les Italiens insurgés ; les catholiques d’Irlande l’attendrissent ; les Turcs de Byzance lui inspirent un grand intérêt ; les républicains de l’Amérique méritent son appui, et, tandis que ses armées marchent sur Bruxelles, sur Madrid, sur Vienne, ses élans fraternels cherchent les extrémités de la terre. C’est ainsi qu’elle se sert de ses alliés lointains pour frapper les voisins ses ennemis : lorsque l’Anglais, l’Allemand et l’Espagnol se liguent contre Paris, ils se voient menacés sur les derrières par Édimbourg, Lisbonne, Varsovie ou Byzance, et partout on obéit sans exception à ce principe que les ennemis de nos ennemis sont nos amis.
On conçoit donc que les anciens aient parlé du secours magique que la Terre donnait à Antée, et on conçoit aussi qu’ils l’aient représentée par le symbole du serpent. Elle en a l’astuce, les forces invisibles, les pièges mortels, les secours inespérés ; c’est elle qui égaré par de faux guides l’armée de Frédéric Barberousse ; qui fait échouer les Avares sous Byzance instruite mystérieusement de toutes leurs manœuvres ; qui fait naufrager les Arabes dans le Pont, où le feu grégeois les dévore ; qui évente les attaques, déjoue les surprises, et poste des paysans sur toutes les routes, dans chaque taillis des tirailleurs, à chaque avenue des barricades, et, parfois, à Béthulie, sous Sagonte, à Pise, à Rimini, à Saint-Marin (car il n’y a pas de si petit espace qui ne puisse singer un empire), de ces ressources soudaines, inespérées, héroïques et capricieuses, qui mettent au néant les entreprises les mieux concertées.
Fondées par les capitales. – Elles résument le règne de la force. – Dominations intellectuelles à l’imitation des dominations politiques.
Si les conquêtes créent les capitales, celles-ci enfantent les monarchies. C’est déjà une monarchie que le règne de la force, car on ne conçoit nulle guerre sans capitaine, nulle bataille sans le droit de vie et de mort dans le chef qui commande. C’est encore une véritable monarchie que la domination d’une capitale sur les provinces ; tout y est privilège, tout y conduit aux distinctions, et de loin le citoyen se voit déshérité, condamné à la dépendance, à l’obéissance, à l’ignorance. Dans l’impossibilité de connaître le gouvernement, n’est-il pas forcé d’accepter des révolutions inconnues, des ordres incompris, une humiliation continuelle ? Mais dès que la capitale dirige la guerre permanente contre les voisins, la force des choses concentre le pouvoir, et les conditions mêmes de toute guerre, je veux dire le silence, la rapidité et la soudaineté des décisions exigent qu’on écarte la foule, qu’on se méfie du nombre et que tout tienne à la pensée d’un chef. Aussi les grandes conquêtes sont-elles dues à des rois ; leurs armées partent d’une capitale sous une direction unique, et, quelle que soit la meilleure forme de gouvernement, la guerre choisit toujours la monarchie.
Que les républiques sont rares au milieu de la guerre universelle ! Que leur durée est précaire, éphémère et pour ainsi dire forcée ! Et encore les voit-on obligées d’obéir à des maîtres ! Leurs chefs sont des rois en puissance, leurs factions des tyrannies effrénées : parlez-vous des villes libres de l’Allemagne, elles vivent sous l’empereur : de celles de l’Italie ? elles se donnent sans cesse à Naples, à Milan, à la France. Non contentes de la royauté annuelle du consulat, l’ancienne Rome nomme en quelques années plus de cinquante dictateurs. À Venise, à Raguse, à Florence, à Lucques, les magistrats n’ont été le plus souvent que des inquisiteurs mensuels, et, par un terrible contresens, les États libres considèrent les généraux destinés à les défendre comme leurs plus redoutables ennemis. Au milieu de la plus brillante civilisation républicaine, ne voyons-nous pas Périclès commander à la Grèce ? Dans la plus barbare liberté, chez les Goths, les Huns, les Vandales qui envahissent l’empire romain, chaque peuple ne suit-il pas des rois ?
Même en dehors de la politique tous les instincts nous suggèrent de nous élever : l’envie, l’émulation, la vanité, la jalousie, l’amour même, quel sentiment n’aspire à régner ! Nous avons vu que la famille, ce rudiment de la société, forme déjà une monarchie, que l’homme règne sur la femme, le père sur le fils, le maître sur l’esclave ; mais le vieillard règne à son tour sur la tribu, le plus fort dans le camp, le plus éloquent sur la foule, le plus sage dans le sénat ; l’art se développe royalement par ses magiques adulations prodiguées aux chefs victorieux, et tandis que les poètes ne parlent que de sceptres, de couronnes, de conquêtes, la littérature et la science constituent elles-mêmes de grandes monarchies intellectuelles à la suite d’Homère ou de Platon, de Dante ou de Machiavel. Qu’on le place dans le passé ou dans le plus lointain avenir, l’âge d’or implique la domination des capacités qui suppose à son tour des autorités constituées et en définitive un pontife dans le monde, puisqu’il serait impie de contester le rang suprême au plus digne. Cette papauté se présente d’autant plus nécessaire que dans la sphère mitoyenne la nature semble tâtonner, hésiter, se plaire à la répétition, à la monotonie, à l’équivalence ; puis elle s’élève soudain en plaçant ses véritables chefs à d’incommensurables hauteurs. Certes les philosophes distingués sont nombreux dans la Grèce, dans l’Italie du Moyen Âge et surtout chez les modernes ; mais combien d’Aristotes comptons-nous ? Qui a pu inventer tout à coup la métaphysique, la physique, la logique dans toutes ses formes, la rhétorique, la poétique, l’histoire naturelle et mériter qu’on le comparât même de loin au génie de Stagire ? d’ailleurs quelle distance entre Alexandre et ses généraux ? quel abîme entre Charlemagne et les rois de son temps ? Que ces grandes inégalités soient créées au hasard ou par un mystère organique ou par cela seul que des positions uniques dans leur genre n’admettent qu’un seul occupant comme la boussole n’accorde le prix de sa découverte qu’à un seul inventeur, l’effet reste le même, il n’est pas moins royal. On veut toujours des couronnes. Pour obtenir l’humilité de ses adeptes, le christianisme promet aux derniers de ce monde les premières places dans le ciel ; et pour formuler une idée de toutes les perfections, la philosophie donne à Dieu le trône de l’univers.
Ses avantages. – Sa discrétion – Son équité. – Ses progrès dans l’histoire de France ; – de Rome ; – et de Byzance. – Son influence dans la religion catholique ; – et dans celle du bouddhisme.
La tendance de toute véritable monarchie est d’étendre ses frontières en développant son despotisme. D’ordinaire, on désigne sous ce nom de despotisme un gouvernement odieux, livré à une série de caprices qui partent d’en haut pour dévorer la fortune des citoyens et menacer leurs vies, et on ne reconnaît à ses chefs d’autre mérite que celui d’un orgueil effréné, soutenu par un vain entourage de femmes, d’eunuques, de courtisans et de favoris. On répète qu’ils se fondent sur la crainte, qu’ils stérilisent la terre, qu’ils étouffent toute vertu, qu’ils proscrivent le génie et qu’ils détruisent l’industrie en coupant l’arbre à la racine pour en cueillir quelques fruits. Sardanapale dans son harem, Balthazar dans son festin, Louis XIV à Versailles, voilà les types et les souvenirs du gouvernement dont nous parlons. Tel est, en effet, son caractère aux yeux des peuples libres, qui l’abhorrent justement chez eux ; cependant ce serait s’aveugler volontairement que de méconnaître les qualités qui le rendent indispensable aux multitudes agglomérées dans les grandes monarchies.
Comment les plus hardis publicistes ont-ils défini la souveraineté de l’État ? Ils l’ont déclarée une, indivisible, absolue ; ils lui ont attribué le droit de dire et de se dédire, de faire les lois et de les abroger, de disposer sans contrôle de la vie et des biens des citoyens, et ils l’ont mise au-dessus de la morale, car, s’il fallait suspendre l’exercice d’un droit sous prétexte qu’on en abuse, ni le propriétaire ne garderait sa propriété, ni l’homme sa liberté, ni l’État sa souveraineté. Or la politique à son tour ne tient pas moins à s’assurer le droit de dire que celui de se dédire, le droit de faire des lois que celui de les abroger, d’accorder grâce, de proclamer des exceptions, de varier la constitution et l’organisation de la société. Car tout change autour de nous ; on ne plonge jamais deux fois dans le même fleuve, les scènes de la guerre ne sont jamais les mêmes, et l’État enchaîné à une loi inflexible, à un système préétabli, et dans l’impossibilité de se transformer indéfiniment, serait condamné à sombrer, comme le navire forcé de marcher toujours en avant avec les mêmes voiles, sous le même vent, dans la même direction. Malheur à la nation qui ne saurait changer de principes et qui prétendrait s’imposer impérieusement à la nature ! C’est dans cette faculté de pouvoir manœuvrer au milieu des récifs de la réalité que consiste le despotisme, au reste toujours distinct du gouvernement tyrannique. Son rôle n’est nullement d’opprimer, d’abuser du suffrage universel qui le sanctionne, de trahir l’enthousiasme qui le crée ou l’adoration qui le conserve, de gaspiller à dessein les forces ou les richesses de la monarchie ; en apparence, et peut-être en réalité fantasque, inique, absurde, son intérêt lui conseille d’entretenir l’enthousiasme et l’adoration, de sauver la patrie, de reculer ses frontières et de la faire prospérer. Que tantôt il emprisonne les mécontents et tantôt les comble de faveurs ; qu’un jour il aille à la messe et l’autre au sermon ; qu’une fois il massacre les huguenots et une autre fois les chefs de la Ligue ; qu’ici conquérant, il réduise en esclavage d’entières nations ; que là libérateur, il s’obstine à multiplier les concessions et les bienfaits ; le despote est libre à l’infini ; tout lui est permis, le pouvoir discrétionnaire règle seul sa conscience, et sans ce pouvoir il ne serait ni roi, ni conquérant, ni guerrier.
Quels que soient les vices du despotisme, la qualité qui le rachète, c’est d’être l’ennemi de cette légalité que Platon dénonçait, il y a deux mille ans, à la vindicte des philosophes. Rien de plus triste que ses aveugles injonctions ; tantôt obscure et cruelle comme un oracle, tantôt débonnaire et stupide comme une idole, elle ne s’enquiert ni des intentions ni de la moralité des accusés. Tout extérieure, son lourd niveau s’abat pour frapper indistinctement le plus grand criminel et l’homme momentanément égaré ; son inaction laisse passer également le vice sans punition et la vertu sans récompense. Quand elle commande, elle n’admet aucune dispense ; quand elle se tait, elle n’admet aucun précepte ; sans prévoyance, sans intelligence, en la voyant, immobile et surannée, comme à Sparte ou à Londres, perpétuer des inégalités monstrueuses ou des corruptions sans nom, on regrette ou du moins on comprend comment se propagent les monarchies. Joint que dans les guerres sa force enchaîne l’action à la délibération, aux parlements, aux diètes, à des lenteurs insensées, à la divulgation des secrets, aux provocations dangereuses, à l’exaltation enfantine, aux paniques absurdes, aux plans obstinés des partis et à l’impossibilité de s’arracher aux catastrophes, même en modifiant la loi. Effectivement, dès qu’à la place d’un chef on proclame la loi, il faut la subir jusqu’au bout ; on doit la rendre immobile à dessein, l’éterniser, s’interdire de la modifier et lui sacrifier la raison, l’urgence, le progrès, sans aucune rémission : la faculté de la changer détruirait son prestige, dissiperait la superstition qui la protège, l’opinion qu’elle est irrévocable, supérieure au gouvernement, indéfiniment supérieure à toutes les volontés. Aussi les chefs des anciennes républiques multiplient-ils les plus bizarres précautions contre la force du temps et de l’expérience. Engagés dans une lutte fantasque contre l’invisible inimitié des idées, on les dirait des borgnes inquiets et jaloux de maintenir l’aveuglement universel. Lycurgue veut mourir en exil, parce que ses compatriotes lui ont promis de ne pas toucher aux lois avant son retour ; Charondas exige que tout novateur fasse sa motion la corde au cou, et qu’il subisse le dernier supplice si elle n’est point acceptée ; Zaleucus s’arrache un œil pour honorer la loi qui aveugle son fils innocent ; afin de ne pas altérer la vieille loi des douze tables, les Romains dénaturent les faits par des suppositions imaginaires, et leur droit devient une comédie où l’on s’efforce de tromper, de démontrer artificieusement que le peuple n’a pas marché, et que les mœurs nouvelles et la nouvelle humanité ne donnent aucun démenti à la barbare législation des décemvirs. Quoi de plus ? la légalité abhorre tellement la raison, que, lorsqu’il s’agit de nommer des magistrats, elle préfère le choix du sort à la décision des hommes ; lorsqu’il faut, comme à Gênes ou à Venise, élire le chef de l’État, elle s’en rapporte à d’aveugles ballottages pour exclure la délibération des assemblées, et, quand il s’agit d’administrer, elle abolit l’interprétation même du code et l’équité du juge, en sacrifiant de propos délibéré le sentiment moral à l’injustice écrite. Or le despotisme anéantit les lois hétéroclites, les fictions prétoriennes, les ballottages absurdes, les vertus capricieuses, la jurisprudence qui tue le droit.
Une fois admis, le despotisme se développe rapidement comme la monarchie, la centralisation et les conquêtes. Dans la France de l’an mil tout seigneur était maître chez lui, d’entières provinces ne relevaient du roi que d’une manière nominale, les libertés féodales étaient si fortes, qu’elles s’élevaient jusqu’au droit de guerre. Bientôt la trêve de Dieu réduisit de la moitié les combats ; les croisades exilèrent les seigneurs, les ordonnances de saint Louis supplantèrent les barons et généralisèrent la justice du roi ; plus tard, des royaumes disparurent, la Normandie perdit son parlement, Toulouse son comte, la Provence son roi ; sous Louis XI l’armée royale écrasa les longues rébellions des villes et des barons, et plus tard encore, dans la nuit de la Saint-Barthélemy, nous assistons à un massacre universel, organisé, centralisé et supposant l’action du roi une et identique dans toutes les provinces, comme Hugues Capet ou saint Louis ou Louis XI n’auraient osé l’espérer. Mais que de libertés protégeaient encore les citoyens ! Vous aviez çà et là des parlements, des quasi-républiques, de monstrueuses immunités : Lyon avec le droit de garnison, partout des lois spéciales, des coutumes locales, de petits États, d’innombrables franchises. Sous Louis XIV tout cède à l’unité du faste, sous Robespierre tout succombe à une Saint-Barthélemy philosophique, sous Napoléon tout plie sous le niveau du Gode, et on ne cesse de demander au chef de l’État les secours, l’ordre, les routes, les protections, les réformes qu’un peuple républicain ne veut devoir qu’à ses libres associations.
Si des actes jadis prohibés sont aujourd’hui tolérés ou permis à tout le monde, ce n’est pas la liberté, mais le progrès qui les a amnistiés en déplaçant les questions. Quitter Versailles pour aller à Port-Royal, ce n’est plus dénoncer au public les débauches du roi ; professer le protestantisme, ce n’est plus décomposer la France, s’allier à l’Angleterre et fraterniser avec l’Allemagne. Rien donc de plus naturel que les jansénistes soient libres et les calvinistes tolérés. Cependant renouvelez leur audace, appliquez-la à des idées contemporaines, attaquez le Code ou la propriété, ou l’exercice des cultes, ou l’unité de la France, ou la monarchie, et vous verrez que le progrès de la police n’est pas moins considérable que celui de l’industrie et des arts. Nous ne pouvons pas même nous dire plus humains que nos devanciers ; les philosophes de la Révolution n’ont-ils pas décrété des massacres qui auraient fait reculer les bourreaux de Charles IX ? Les prêtres de la sainte alliance n’ont-ils pas organisé une répression que Léon X eût maudite ? La poste, la vapeur, le télégraphe, ne sont-ils pas venus successivement accélérer l’obéissance des subalternes ? L’art militaire n’a-t-il pas transformé le soldat en une machine faisant partie de la cavalerie, de l’artillerie et des équipages ? De même, les Romains de la république commençaient par donner à leurs sujets le titre d’alliés, ceux de l’empire étaient tellement asservis, que pas un fugitif ne pouvait se dérober aux peines qui le menaçaient, et sous les césars de Byzance le servilisme arrivé à l’apogée punissait de mort jusqu’aux rêves contre l’empereur. Nulle part l’intelligence ne se raffine sans créer une foule d’arrêts, d’ordonnances, de décisions mobiles, rapides, changeantes, qui nous surprennent et nous emportent à tout instant pour faire de nous la partie d’un tout incompris ou le rouage d’un mouvement inconnu, et de toutes manières un être complètement dénaturé. On dirait, au reste, que le despotisme semble inséparable de l’usage de la raison, puisque dans toutes les situations imprévues, dans toutes les positions désespérées, soit que des esclaves se révoltent, soit qu’un danger menace la patrie, soit que des hordes tartares, en s’étendant rapidement, provoquent mille ennemis, soit que des capitaines improvisent des armées comme Wallenstein, c’est toujours à l’arbitraire qu’on demande le salut.
Les religions confirment enfin d’une manière éclatante les avantages du pouvoir discrétionnaire. Pourquoi l’Église catholique, assaillie par tant d’hérésies, attaquée par tant de rois, niée par tant de philosophes, a-t-elle néanmoins surmonté toutes les révolutions et mis en déroute ses innombrables adversaires ? Pourquoi a-t-elle proclamé encore de nos jours l’Immaculée Conception sur les ruines de la philosophie et des écoles modernes, de même qu’elle avait proclamé jadis la divinité du Verbe incarné sur la ruine des théories de Platon ? Parce qu’elle obéit à un chef infaillible, parce que son pontife, divinisé, à l’exception près des miracles, possède la faculté de lier et de délier, parce que, n’étant lui-même lié qu’au point de vue du dogme, il lui est permis d’ajourner les préceptes, de convoquer des conciles, d’absoudre les peuples du serment de fidélité et de dispenser les fidèles de l’obligation d’obéir aux lois. C’est ainsi que le catholicisme a prospéré à la suite de tous les missionnaires, depuis les apôtres du Moyen Âge jusqu’aux jésuites de la Chine et du Paraguay ; c’est ainsi que les divinités païennes de l’Orient, de la Scandinavie, des Slaves, des Germains, ont pris peu à peu la forme de la divinité chrétienne et que mille concessions faites à la faiblesse de l’homme, accompagnées de mille surprises habilement dirigées contre l’ignorance universelle, ont pu faire triompher la plus philosophique et la moins attrayante des religions. Son chef s’est tant méfié de la lettre et des lois, qu’il n’a laissé aucun écrit. Ses disciples seuls ont recueilli sa parole, mais les conciles l’ont interprétée, un pontife s’en est constitué dépositaire, et, toujours vivante, elle a fondé un despotisme qui défend jusqu’à la lecture de la Bible, pour accepter tous les progrès du genre humain. Quelle prodigieuse distance entre le christianisme féodal de Charlemagne et le christianisme spirituel de Grégoire VII ! Que de révolutions n’a-t-il pas admises pour passer de l’aveugle adoration des croisés aux raffinements intellectuels de saint Thomas, et plus tard aux miracles artistiques de Léon X !
Un autre culte encombre une vaste région de l’Asie, opposant au christianisme une plus haute antiquité et un plus grand nombre d’adhérents. Mais qui a soumis au Lama tant de peuples si divers depuis le Thibet jusqu’au Japon ? Qui lui a fait détrôner tant de divinités enfantées par l’imagination asiatique, aussi anciennes que le monde et aussi absurdes que l’ignorance humaine ? Qui l’a rendu supérieur aux philosophes de l’Inde, aux lettrés de la Chine, aux guerriers de la Tartarie, aux magistrats du Japon et à tous les sages de l’Asie ? Qui lui a donné une si prodigieuse quantité de martyrs, de confesseurs, de pénitents, de moines, de voyants et de docteurs ? Çakiamouni mort depuis vingt-cinq siècles sans laisser une parole écrite, fondateur d’une église sans textes, premier prédécesseur d’une série de pontifes qui le représentent encore vivant aujourd’hui, ennemi de toute loi qu’il considérait comme un aveugle caprice, de toute propriété qu’il regardait comme un empêchement au salut, de toute caste qui se réduisait pour lui à une apparition éphémère, de toute autorité extérieure, matérielle, qu’il redoutait comme un piège pour l’esprit et un danger pour le cœur. À ce prix le bouddhisme pouvait donner des ordres impossibles, faire adorer des reliques révoltantes, outrager la raison par des dogmes insensés, couvrir l’Asie de fanatiques mendiants et parodier à son tour, de même que le christianisme, la république de Platon, l’État sans loi, le discours sans écriture, l’intelligence sans mémoire, l’esprit sans préjugés.
Inséparable du despotisme. – Ses progrès sous les seigneurs italiens ; – sous les rois de France ; – sous les grands conquérants ; – sous les papes de Rome ; – et sous les empereurs de la Chine.
Si nous généralisons les avantages du despotisme, nous le trouvons créateur de la démocratie, prise dans le sens le plus vaste. En s’avançant par la destruction des castes, des privilèges, des droits acquis ; en supprimant d’anciennes libertés, en violant l’antique légalité, comment se ferait-il pardonner ses méfaits si ce n’est à force de bienfaits ? De quelle manière obtiendrait-il ses absolutions multipliées sans compenser ses crimes par de grandes réformations ? Proscrit-il les révolutionnaires, il propage la révolution ; combat-il des royalistes, il fortifie la monarchie. Défend-il de penser, il sonde le ciel, la terre, les lois de la nature, celles de l’humanité, et tire d’une science occulte des innovations inattendues qui étonnent les républiques. Tandis que Gênes refuse les offres de Christophe Colomb, Ferdinand le Catholique lui donne une flotte et découvre l’Amérique ; tandis que les États libres pourrissent dans leurs vieilles législations et deviennent les places fortes de tous les préjugés, les Césars font paraître les meilleures lois sur la propriété et la famille. Constantin abat d’un coup la servitude du paganisme, Justinien et les médiocres compilateurs du Bas-Empire détruisent soudainement une multitude d’abus transmis par l’ancienne république, et, si la Grèce libre foulait aux pieds les ilotes et les éginètes, mutilant, aveuglant, massacrant ses esclaves, l’empire de la Chine surpassait tous les États par la douceur avec laquelle il traitait ses parias. C’est encore à l’époque des seigneurs que paraissent invariablement les meilleurs statuts italiens auparavant rendus impossibles par les sectes qui bouleversaient les républiques. Plus tard chaque État se renouvela au milieu d’une crise effroyable, ses plébéiens arrachèrent, le sceptre à tous ceux qui le prenaient, des tribuns réclamèrent l’abolition des dettes, la suppression de la rente et jusqu’à celle de l’hérédité. Mais qui accomplit les réformes ? Michel Lando l’insurgé de Florence ? les sans-culottes de Bologne ? les gueux de Gênes ? les nombreux chefs de Sienne ou de Pavie ? Non, ce furent les Médicis, fondateurs de la monarchie toscane, les Sforza, réformateurs de Milan, et tous les seigneurs rétablis ou renouvelés. De même, dans la révolution qui bouleverse alors l’Europe, ce ne sont ni les Hussites, ni Jean Cade, ni Inglebert, ni Harvat, ni aucun des chefs plébéiens de l’époque qui renouvellent les États, ce sont au contraire Louis XI, les Tudor, les Habsbourg, les Vasa, les fondateurs du despotisme moderne.
Rien ne répugne plus au progrès de la démocratie que les délibérations des parlements, les droits des assemblées ou les franchises des villes. Même républicaines, même incendiaires, les diètes le font avorter ou le précipitent vers l’absurde. Là où chaque tribun veut surpasser son émule, la fièvre de la contradiction s’empare des orateurs ; dès que l’un attaque l’hérédité, l’autre en veut à la propriété, l’autre à la famille, et dans la république d’Athènes Aristophane se moque déjà des femmes révoltées contre le joug des maris, à l’instant où ceux-ci s’insurgent contre celui du gouvernement. Sans doute, il est facile de faire l’éloge des parlements : le moindre dépit contre un maître l’embellit de couleurs si agréables, que personne ne résiste à la tentation de le répéter. Mais la discussion suppose des intérêts communs, les mêmes principes adoptés, la certitude que l’on s’arrêtera devant la raison, l’assurance que personne n’apportera son épée à l’assemblée, qu’on n’y viendra ni conspirer, ni cabaler, ni tendre des pièges au peuple, ni forger des fers à la plèbe, et que la délibération ne tombera que sur les moyens de résister à un même ennemi, ou de vérifier des faits incertains ou d’y appliquer des lois hors de doute. Mais quelle assurance, quel accord, quel débat peut-on obtenir au milieu de cette incertitude universelle qui s’appelle démocratie ? Quelle institution, quel principe, quel dogme se dérobe à ses atteintes ? Ici chaque parti n’entend que soi ; chaque sectaire ne suit que son chef, les opinions flottent au gré des batailles, et faute d’un chef c’est la guerre qui règne.
Tout despote profite donc aux multitudes : plus il est jaloux, inique, fastueux, décidé à imposer l’adoration de sa personne par les mystères du luxe, de l’étiquette et du culte, plus ses vices mêmes l’enchaînent au char de la démocratie, qu’il précipite vers les abîmes de l’avenir de toute la fougue de ses passions. Néron naturalise l’Achaïe, Charlemagne propage le christianisme, Henri VIII donne le protestantisme à l’Angleterre, Ivan IV réforme le schisme des Russes ; ces êtres diaboliques étaient, dans leur temps, plus utiles que des saints. Rendez à la modération Pierre Ier, ou à la modestie Louis XIV ; les strelitz subsisteront en Rusries, les barons en France. Peu importe l’antre d’où souffle le vent, il faut que l’orage éclate, que l’atmosphère soit bouleversée, que ses miasmes se dissipent.
Même les conquêtes se développent comme les inévitables scandales de la démocratie. Toute victoire s’annonce déjà comme un exploit plébéien. Quand Alcibiade bat les Spartiates, la multitude d’Athènes massacre les Quatre-Vingts ; quand Rome triomphe, le sénat perd ses privilèges ; et, au contraire, quand Athènes essuie la déroute de Nicias en Sicile, quand les Thébains sont vaincus par les Denophiles, quand Rome est cernée par l’ennemi, c’est l’aristocratie qui l’emporte. Mais, si les multitudes s’enhardissent dans l’État du vainqueur, leur succès est mille fois plus grand chez les vaincus, où toute nouvelle domination se présente au nom d’une plus vaste démocratie. Aussi étaient-ce les peuples opprimés qui frayaient la route aux phalanges d’Alexandre ; chez une foule de nations les insurgés contre l’ancienne Rome s’alliaient à l’invasion des Germains pour constituer la liberté de l’Occident, et les Ottomans eux-mêmes arrivaient à Constantinople bénis par les provinces grecques, qu’ils délivraient de la fiscalité byzantine. En parcourant l’histoire des invasions on s’étonne toujours du petit nombre des conquérants, mais la surprise cesse quand on s’aperçoit que des populations frémissantes devançaient leur victoire, et qu’elles renonçaient à leur ancienne indépendance pour renverser leurs tyrans indigènes. Que de fois les multitudes conquises n’ont-elles pas trahi par une sournoise inertie les colères de faux tribuns qui voulaient les asservir de nouveau sous prétexte de combattre la domination étrangère ! C’est ainsi que dans l’ancienne Gaule elles détestaient tous les chefs de l’insurrection contre les Romains, alors maîtres du nivellement universel.
Partout les arts, le commerce, l’industrie, consacrent l’œuvre du despotisme et de la force : partout les règnes les plus heureux se montrent à la suite des dévastations monarchiques. Pour trouver l’élan de la littérature grecque, il faut le chercher sous Périclès ; les beaux jours de la littérature romaine commencent sous César, et Virgile reçoit la protection d’Auguste. La littérature se développe en Italie sous Léon X, chef de l’invasion espagnole ; en Espagne sous Philippe II, chef de la réaction européenne ; en Angleterre sous le règne despotique d’Élisabeth ; en France sous Louis XIV, le plus absolu des rois ; et ce sont les despotes éclairés du dix-huitième siècle qui ont prodigué les plus grandes faveurs aux arts et aux sciences dans l’intérêt de la monarchie et de l’égalité. Cherchez des poètes, des philosophes, des orateurs dans la république de Sparte, vous n’en trouverez pas un ; cherchez-les dans celle de Florence, Dante, Pétrarque, Boccace fuient leur patrie pour hanter les cours de Ravenne, de Milan ou de Naples ; Aristote suit Alexandre, Platon s’offre à Denys, tyran de Syracuse, tandis que la littérature grecque des meilleurs temps des républiques est unanime à préférer les tyrans.
Si on hésitait à croire que les institutions les plus humaines arrivent toujours à la suite du despotisme, le grand exemple de la papauté catholique dissiperait seul tous les doutes. Quelle religion la surpasse dans le développement de la fraternité universelle ? quel culte poussa plus loin la solidarité des secours réciproques ? quelle secte a découvert, même en imagination, des associations, des partages, des communautés, que ne puisse admettre cette monarchie cléricale qui puise sa force dans l’ascétisme et ses élans dans les couvents ? De nos jours le socialisme en a été réduit à parodier le despotisme du saint-siège. Il a proclamé un Dieu plus que catholique, des chefs semblables à des papes, à des popes, à des archevêques. Ses adeptes n’ont-ils pas été des Franciscains moins le froc, des Dominicains moins la Bible, des ermites moins la foi ? Mais ne parlons que du passé ; partout où l’Église a secondé les rois, les castes se sont dissoutes, les multitudes se sont affranchies, et les nobles ont marché de catastrophe en catastrophe. N’est-ce pas l’Église qui a donné à Constantin la victoire sur le formidable monopole de la conquête romaine ? À qui les barbares ont-ils dû d’être admis dans l’empire pêle-mêle avec les Romains ? Qui a renversé l’aristocratie des Goths et celle non moins barbare des Lombards ? Qui a engagé tous les rois des invasions, francs ou allemands, polonais ou hongrois, scandinaves ou saxons, à réprimer les grands au profit des multitudes ? Toujours l’Église ; et les successeurs de Clovis, en se dévouant à Rome, se sont toujours trouvés, à toutes les époques de l’histoire, les chefs du royaume le plus démocratique de l’Europe. De même en Asie, ce sont les lamas qui ont anéanti les castes que la liberté sacerdotale des brahmanes protège encore dans l’Inde, et les empereurs ont poussé le nivellement de la Chine jusqu’à l’abolition de toute distinction héréditaire, en sorte que tout y est livré à la mobile hiérarchie du mérite, des services rendus et des grades distribués d’après le résultat d’examens solennels.
Leurs chefs constamment républicains ; – font table rase du gouvernement ; – mais leurs idées ne triomphent que lorsqu’ils sont sacrifiés ; – et que la monarchie se renouvelle.
La destinée se plaît à multiplier les douleurs ; notre nature se développe sous le cri des besoins, et la nature des États demande à son tour des douleurs et du sang, non seulement pour se rajeunir et s’étendre, mais aussi pour se conserver et lutter contre la mort. Quelque prospère que soit une nation, une pensée assombrit donc le front du despote ; parmi les fêtes, au milieu des ovations, il rencontre des regards mystérieux, il sait que des poignards cherchent sa poitrine, que des conspirateurs épient l’instant de le frapper, et qu’il suffit d’une main hardie et d’un orage imprévu pour transformer soudain les adorations en fureurs.
En effet, tout gouvernement a ses adversaires, ses mécontents, ses ennemis domestiques qu’on appelle opposition et qui, sous les rois, se compose de rebelles, de bannis, de révolutionnaires, jaloux de détruire la monarchie en proclamant la république. De quoi se plaignent-ils ? Sont-ils transportés par des passions ? Est-ce l’ambition qui arme leur bras ? Est-ce l’amour de l’humanité qui les pousse au régicide ? Sont-ce des héros ou de grands criminels ? Peu importe, ce sont d’implacables furies : la Discorde les a produits, son démon les inspire ; ils veulent la guerre contre la paix, la paix contre la guerre, si le despote est entreprenant, ils crient à la dilapidation ; est-il avare de la fortune publique, ils le poussent aux grandes entreprises, opposant résolument un non à toutes ses affirmations, et, comme l’essence du despotisme consiste dans l’arbitraire, ils le combattent en proclamant une loi réelle ou imaginaire.
Or le jour arrive où le despote cesse de répondre à l’esprit de son temps ; attaché à des idées fausses, attardées, inadéquates, il résiste aux innovations urgentes que le peuple réclame, et alors les idées nouvelles refluent vers l’opposition, l’orage éclate, l’insurrection se déclare permanente : c’est le moment de la liberté républicaine. On ne se souvient plus de la vieille monarchie que comme d’un songe dont on se réveille ; sa longue tradition ressemble à une longue erreur fondée sur l’ignorance des multitudes et sur la violence des chefs, et l’instant présent l’emporte tellement sur le passé dans la chétive raison des mortels, que l’on croit l’ère des despotes close à jamais. D’entières générations naissent avec la naïve persuasion qu’on n’osera plus les ramener au silence des vieux temps ; la liberté de tout dire semble l’état naturel du genre humain ; on entend chaque jour le fracas d’un jugement universel.





























