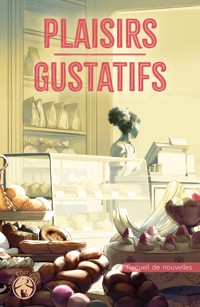Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Otherlands
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Découvrez ce recueil de nouvelles fantastiques jutueuses dans lesquelles chaque auteure dévoile sa face cachée...
Douze reines de l’imaginaire vous ont concocté le sommaire de ce présent recueil. Douze femmes qui ont retroussé leur manches pour vous préparer des histoires aux petits oignons. Soyez prêts à déguster ! Elles ont aiguisé leurs plumes, choisi les meilleurs morceaux à travailler, et n’ont pas hésité une seconde, pour votre plus grand plaisir, à revisiter l’idée même du surnaturel. Chaque texte est une pièce de choix, et elles ont su cuisiner leurs personnages à la perfection, pour trouver ce juste équilibre, cette saveur subtile entre le récit doux-amer et l’histoire bien saignante. Vingt neuf récits élaborés avec minutie, écrits d’une main de maitresse ! Alors découvrez les faces cachées de nos douze auteures et savourez les juteuses histoires fantastiques, terrifiantes ou horrifiques qu’elles vous ont préparées avec amour.
Histoires fantastiques, terrifiantes ou horrifiques sont au rendez-vous !
À PROPOS DES AUTEURS
Ouvrage collectif :
Beatrice Ruffié,
Johanna Almos,
Célie Guignery,
Françoise Grenier Droesch,
Florence Barrier,
Kate Dau,
Christine Penaux,
Marielle Ranzini,
Maritza Jaillet,
So-Chan,
Elodie Boivin,
Wendy Daw.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 646
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les nouvelles restent la propriété de Otherlands, et de leurs auteurs respectifs. Tous les textes sont inédits, sauf mention contraire.
Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes de l’article L. 122-5, 2è et 3è a, d’une part, que les « copies ou reproduction strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon, sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Histoires
Surnatur'elles
Que n'a-t-on pas dit sur les femmes ? Incorrigibles romantiques ? Douces et attentionnées ? Tendres et passionnées ? Il suffit pourtant de lire les journaux, regarder la télévision, pour savoir que ces dames peuvent être tout aussi machiavéliques que leurs homologues masculins.
Pour preuve ces vingt-neuf récits, écrits uniquement pas des auteures ; si vous les croisiez, vous les trouveriez sûrement charmantes ! Mais leur talent caché, elles l'exercent derrière un clavier, quand elles laissent libre cours à leur imagination, pour vous emmener sur des chemins tortueux, à la poursuite de créatures monstrueuses ou pour vous perdre au cœur d'autres dimensions...
Alors faîtes-vous plaisir, et parcourez ces histoires que nous avons rassemblé pour vous. Vingt neuf nouvelles, où la féminité s'exprime d'une manière bien peu commune...
Elle
Béatrice Ruffié
Le pigeon posé sur le rebord de la fenêtre était chétif, un peu déplumé. Sans doute un oisillon tombé du nid, recueilli par les enfants de l’école voisine, et qui était venu finir sa vie ici, une fois qu’ils l’avaient fièrement rendu à la vie sauvage. Je ne me lassais pas de contempler son corps décharné et son plumage terne. Il semblait si faible, une proie rêvée pour un prédateur…
— Je vous dérange, Mademoiselle ?
Je sentis le sang heurter la fine peau de mes joues, comme si mon cœur résonnait dans mon visage. Je devais être écarlate. C’était à moi que le prof s’adressait, toute la classe était en train de se tordre de rire en me regardant, et moi tout occupée que j’étais à contempler la vie animale, je n’avais rien entendu…
— Euh…vous pouvez répéter ? tentai-je prudemment. Ce à quoi mes camarades répondirent par un immense éclat de rire.
— Vous êtes collée, Mademoiselle, deux heures, samedi matin. Dois-je le répéter, ça aussi ?
J’aurais voulu me cacher dans un trou, être une petite souris, disparaître. L’heure qui suivit me parut interminable, et lorsque la sonnerie retentit enfin, je ne pus réprimer un long soupir de soulagement.
Je déteste le lycée. Ma famille et moi sommes arrivés dans cette nouvelle ville depuis un an déjà, mais je n’ai jamais pu lier la moindre amitié avec mes camarades de classe. Les filles d’ici sont des bêcheuses, obnubilées par le maquillage et les vêtements de marque. Passionnées par les téléréalités, elles rêvent toutes de devenir un jour une idiote en seize neuvième. Les garçons ne sont pas mieux. Sauf qu’eux, bien sûr, c’est ce genre de filles qui les passionne. On tourne en rond. Avec mon père et mon frère Hector, nous déménageons sans arrêt. Papa prétend que les voyages forment la jeunesse, alors nous ne restons jamais plus de deux ou trois ans dans la même ville. Hector souffre parfois de devoir abandonner ses copains et ses petites amies. Pas moi. Aussi loin que je me souvienne, je n’ai jamais eu d’amis. J’ai fait des efforts, enfant, pour intégrer les groupes de filles. J’ai même joué à la poupée. Mais je ne comprenais pas le plaisir qu’elles avaient à déshabiller et rhabiller sans cesse leurs mannequins de plastique. Les miennes vivaient des aventures extraordinaires, elles étaient reporters, chasseuses de fauves ou dompteuses de cirque, et elles n’avaient que faire des brushings et des escarpins ! Depuis toujours, qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes, je provoque un sentiment de rejet autour de moi. Même ma mère est partie, c’est dire ! Quand j’entre dans une pièce, les regards se tournent souvent vers moi… pour s’en détourner aussitôt. Je ne sais ce que j’inspire à mes semblables, si c’est de la crainte ou du dégoût. Toujours est-il que mes arrivées sont toujours suivies d’une imperceptible gêne, qui ne met que quelques secondes à se dissiper, mais que je devine d’instinct dans le regard des hommes. Pourtant, physiquement, je ne paie pas de mine, comme on dit. Je suis brune, les yeux marrons, à peine un peu plus petite que la moyenne. J’ai les hanches étroites, une poitrine discrète, et ma seule originalité réside dans la longueur de mes cheveux : depuis que je suis enfant, papa ne me les a coupés que deux fois. Aujourd’hui ils descendent bien en dessous de ma taille et ruissellent dans mon dos comme une cascade d’ébène. Mais peu de personnes les ont déjà vus ainsi. La plupart du temps, je les noue en nattes ou en catogan, de façon à passer inaperçue.
Collée samedi… ça tombait vraiment mal. C’était le jour où je devais accompagner Hector à son match de basket. Il venait juste de commencer les tournois, et papa comptait sur moi pour prendre quelques photos de ses premiers exploits. Évidemment, lui n’irait pas. Il sortait de plus en plus rarement de chez nous, même pour son activité de traducteur. Depuis qu’il avait commencé à travailler par internet, il n’était plus obligé de rencontrer qui que ce soit. Et ça le ravissait. Alors quand il se passait enfin quelque chose dans nos vies, j’étais chargée de prendre des photos, de capturer l’instant sur papier glacé. Papa partage notre vie en diaporama. Il a sans cesse un appareil à portée de main et nous mitraille dès qu’il en a l’occasion. Parfois, je me demande s’il sait que nous sommes des personnages réels, faits de chair et d’os. On dirait qu’il veut sans cesse emprisonner le temps, l’instant, dans une petite boîte, pour ne pas qu’il s’enfuie. Pas comme ma mère sans doute. Elle est partie quand j’avais deux mois. On n’a jamais su où, avec qui, ni même pourquoi. Maman était traductrice, comme papa. Ils s’étaient rencontrés sept ans plus tôt et travaillaient pour la même société. Tous les matins, ils prenaient leur petit déjeuner et se rendaient au bureau ensemble. Leur couple se portait bien, ils ne se disputaient pas, enfin pas plus que les autres. Je venais d’arriver dans leur foyer, et maman avait repris le travail depuis peu. Ce matin-là, comme d’habitude, mon père était sous la douche pendant que ma mère nous habillait et nous préparait pour aller passer la journée chez la nounou pour moi, à l’école pour mon frère. Mais quand mon père est sorti de la salle de bains, elle n’était plus là. J’étais prête, allongée dans mon berceau, et Hector, le regard encore embué par le sommeil, buvait un bol de céréales sur un coin de bar. Mon père a d’abord cru à une mauvaise blague. Il a questionné Hector : oui, il avait bien croisé sa mère, elle l’avait embrassé, mais non, elle ne lui avait rien dit, et il ne l’avait pas entendue sortir. Ce jour-là, nous sommes arrivés en retard chez la nounou et à l’école. Papa a attendu, longtemps, le retour de sa femme. Puis voyant l’heure tourner, il s’est résigné à nous déposer, espérant sans doute la retrouver au bureau. Elle n’y était pas. Le soir venu, il l’attendit encore. Et tous les autres soirs de la semaine. Puis les mois ont passé, et les années… En vérité je crois qu’il l’attend toujours. Je me demande même parfois si cette façon de courir la campagne n’est pas une façon de partir à sa recherche… Les années qui ont suivi ont été douloureuses. Puis quand j’ai eu douze ans, papa a démissionné. Et nous avons commencé à déménager. Les gens me demandent souvent si ma mère me manque. Je n’en sais rien. Je ne la connais pas, ne l’ai jamais connue. Comment savoir si quelqu’un vous manque quand vous n’avez pas la moindre idée de qui est cette personne ? Bien sûr, enfant, papa m’a parlé d’elle. Hector aussi, enfin le peu qu’il s’en souvienne. Mais c’est comme s’il me parlait de Mickey ou de Harry Potter. Des histoires… Rien à voir avec ma réalité.
C’était quand même dommage pour samedi… Papa ferait la tête.
Je suis sortie du cours la tête basse, un peu sonnée. Quand je suis rentrée, la maison était plongée dans le noir. Mon père avait dû travailler tard la veille et ne s’était pas encore réveillé, les volets roulants étaient fermés. Il a toujours préféré travailler la nuit. Quand nous étions enfant, il nous servait souvent notre petit déjeuner les yeux cernés et la mine défaite. Il nous a même amenés plus d’une fois à l’école en pyjama ! Maintenant que nous sommes autonomes, il n’est pas rare que nous passions la journée sans le voir, et que nous ne le croisions dans la cuisine que tard dans la soirée, quand il prend son premier café. J’ouvris les volets et les fenêtres en grand, et je laissai l’air froid de l’hiver pénétrer dans la maison. Hector était toujours en retard le matin et ne prenait jamais le temps d’aérer. J’avais beau pester contre l’atmosphère confinée de la maison, j’étais toujours la seule à le faire. Le ciel était bas et blanc, il allait bientôt neiger. Notre département était en alerte orange depuis deux jours déjà, mais je sentais que la première neige serait pour cette nuit. Il faudrait couvrir les arbres me dis-je, et préparer le sel… Je pensais à toutes les menues tâches qui nous restaient à accomplir avant d’être bloqués par la neige, quand un bruit me fit sursauter. Une pie s’était posée sur le rebord de la fenêtre et s’en prenait à la jardinière en fer qui en ornait le rebord. Je l’observai un moment, quand mon ventre se mit à gargouiller et ma tête à tourner violemment. Encore un malaise… C’était le troisième cette semaine. Mon père avait tenu à ce que je rencontre un médecin, persuadé que comme toutes les jeunes filles de mon âge, je faisais je ne sais quel régime pour anorexique. Il a du mal à intégrer que je ne suis pas comme toutes les jeunes filles de mon âge, je crois. Il m’a traînée chez un spécialiste, qui n’a rien décelé de particulier, et m’a donné à prendre tout une batterie de vitamines que je n’avalerai jamais… Cette fois, je me retrouvais le nez collé à la vitre, les membres tétanisés, comme raidis par une force spectaculaire. C’était douloureux, mais d’une douleur si intense que nul cri ne sortit de ma bouche. Comme hors de moi-même, je me sentis glisser sur le sol, poignardée.
Black out.
Quand je repris mes esprits, j’étais dans ma chambre. Elle était en moi à nouveau, je le savais, je le sentais. Le matin déjà, je n’avais pas agi comme d’habitude, j’étais sur la défensive, agitée. C’était toujours comme ça ces matins-là. Dès que je m’étais éveillée, j’avais senti que la transformation serait pour aujourd’hui. Je me levai en hâte. Il fallait que je me cache, le temps que la phase se termine. Cela durait maintenant entre une et cinq heures, jamais plus. Avant, je ne sentais pas venir le moment, et j’étais prise au dépourvu. J’avais honte. Aujourd’hui, c’est fini. Je sais. Je sens. Et j’en suis fière. Évidemment je ne pouvais pas rester chez moi. Papa et Hector ne savent pas ce qui m’arrive. Je ne leur ai rien dit, ils ne comprendraient pas. La première fois, j’avais douze ans. Le quatorze janvier deux mille douze. Si je me souviens précisément de la date, c’est parce que c’est ce jour-là que j’ai eu mes règles pour la toute première fois. J’étais tout heureuse de ce micro-événement, mais papa avait mal réagi. Il était resté taciturne toute la journée, comme s’il m’en voulait d’avoir grandi. J’avais été blessée par sa réaction, même si je la comprends aujourd’hui. Sans doute l’absence de ma mère lui était-elle encore plus insupportable ce jour-là. Le soir, je m’étais couchée tôt, triste et un peu vexée, mais je m’étais assoupie difficilement : j’avais été prise quelques heures plus tôt de douloureux maux de tête, et une mauvaise fièvre montait en moi. Je dormais depuis quelques heures à peine quand une douleur intense avait traversé mon bras droit. On eût dit qu’une lame de rasoir tranchait profondément ma peau. Moins d’une seconde plus tard, c’était le tour de mon bras gauche, tandis qu’au même moment mes entrailles se tordaient en moi dans un enchevêtrement de douleurs diffuses. Je tentai de me lever, en sueur, mais je ne pus que basculer pesamment sur le côté. J’étais brûlante. Je crois que je perdis un instant connaissance, et c’est une intense souffrance à la mâchoire qui me ranima. Je la sentais avancer, s’écarter, comme si tout le bas de mon visage était sur le point d’exploser. Recroquevillée à terre, couchée sur le côté, c’est là que j’ai vu le pelage. Mes bras n’étaient plus mes bras. C’étaient désormais des pattes d’animal, recouvertes de poils gris. Je hurlai. Malheureusement papa et Hector dormaient à ce moment-là dans une autre partie de la maison, au-dessus du garage. Ils y avaient aménagé un petit studio d’enregistrement dans lequel Hector pouvait jouer sa musique, et papa développer ses photos. Je me mis à ramper à terre, ma raison m’échappait. En tentant de rejoindre la porte, je heurtai la table de nuit, qui se renversa sur moi. Hébétée, hagarde, je perdis à nouveau conscience.
Quand je retrouvai mes sens, la fièvre avait disparu, tout comme les maux de tête. J’ouvris alors les yeux, sereine. Pour découvrir que je n’étais pas moi. Mon corps avait disparu, et mon esprit habitait une nouvelle enveloppe, animale. Un nouveau hurlement m’échappa alors, tout aussi inutile que les précédents. J’eus l’idée de me rendre dans la salle de bains pour observer ma transformation dans le miroir. Hélas, la porte était fermée, et je n’avais aucune idée de la façon dont je pouvais l’ouvrir. Je me mis à tourner sur moi-même, dans l’espoir de m’apercevoir. Puis je me mis à renifler, de façon à sentir mon odeur, ma chaleur. Je me rendis soudain compte du grotesque de la situation, et j’arrêtai. Avant de reprendre aussitôt, animée par une pulsion innée. J’avais honte. J’étais maudite, seule. Je me mis à pleurer, mais je ne produisis aucun sanglot. De ma gorge ne sortit qu’un faible mugissement, bestial. Ce jour-là, pour la première fois, je pensai à maman. J’aurais aimé qu’elle soit là, près de moi. Je ne sais combien de temps dura ma métamorphose cette nuit-là, mais cela me parut interminable. Quand je m’éveillai le lendemain matin, j’étais dans mon lit, comme si je n’en étais jamais sortie. Seule la table de nuit renversée attestait de mes péripéties nocturnes. Bien sûr, je crus avoir rêvé. Je tentai même de m’en persuader, et j’y parvins, plus ou moins, pendant plusieurs mois.
Jusqu'à mes treize ans. Nous avions déménagé pour la première fois l’année précédente, peu de temps après ma nuit agitée. Nous avions quitté Paris pour la banlieue bordelaise et vivions désormais dans une petite ville isolée, proche à la fois de la ville et de la campagne. J’avais été déboussolée par ce déménagement. Je n’arrivais pas à me faire d’amis dans mon nouveau collège, et mon entrée au lycée était compromise par des notes de plus en plus mauvaises. J’étais étourdie, dissipée. Je ne parvenais pas à centrer mon attention, cela se ressentait sur mes résultats scolaires. C’était un soir d’hiver. On était samedi, il devait être un peu plus de sept heures du soir. Je courais dans le parc qui jouxtait notre quartier, car je m’étais mis en tête de faire un footing quotidien pour me maintenir en forme. Tout débuta par la sensation d’un coup de poing dans le ventre. Brutal. Je me pliai en deux, le souffle coupé, et m’adossai à un arbre. Oppressée tant par ma course que par la douleur, je tentai de reprendre mes esprits. C’est là que je compris instinctivement ce qui arrivait, en entendant ma respiration, rauque et haletante. Ça recommençait. Je me hâtai vers le sous-bois et attendis. Je sentis alors la transformation opérer. Comme la fois précédente, mes membres se raidirent et se couvrirent d’un pelage grisâtre, tandis que mon corps s’arquait violemment vers l’avant, jusqu'à ce que je me retrouve à quatre pattes. C’est là que j’appris que si je ne lui résistais pas, la métamorphose était bien moins douloureuse. Je dégageai mon cou, il était souple, mobile. Très vite, je me rendis compte que ce n’était plus de l’obscurité qui m’entourait, à peine de la pénombre. Je distinguais maintenant aisément ce que je n’apercevais même pas quelques instants plus tôt. Ce qui me frappa de prime abord, ce furent les odeurs. Je sentais chaque arbre autour de moi, chaque plante, chaque animal. Aucune parcelle de vie présente dans la forêt ne pouvait échapper à mon flair. Et plus que tout, j’avais faim. Je n’arrivais pas à organiser mes pensées, à réfléchir à ma situation, ni même simplement à avoir peur. Mon corps entier n’était tourné que vers un seul objectif, manger. Sans aucune raison, je me mis à renifler puis à déchiqueter violemment mes vêtements qui se trouvaient à terre. Par jeu, je les projetais tout autour de moi et je mordillais la fibre avec rage, projetant çà et là des bouts de tissu rouge. C’était un vieux pull-over que je portais depuis des lustres et que j’adorais. Pourtant je me mis à le lacérer avec la plus grande application, chaque morceau effiloché qui se répandait à terre me ravissait un peu plus. Enfin je me lassai et abandonnai là mon butin. Je devais chasser. Mes tripes brûlaient à l’intérieur de moi, d’un feu aussi inhabituel qu’inavouable. Je voulais une proie. Mon odorat me mit rapidement sur la voie de mon repas. La forêt était truffée de lapins, et je sentais leur doux fumet envahir mes narines à chaque pas. Posément, je me couchai à terre et me mis à guetter les environs, aux abois. Mon attente ne fut pas longue : deux jeunes lapereaux se dégourdissaient les pattes à l’orée de leur terrier, à moins de deux mètres de moi. Je les regardai évoluer et attendis qu’ils soient suffisamment éloignés de leur refuge pour bondir sur eux. D’un coup de pattes, je terrorisai le plus petit, tandis que d’un coup de dents j’égorgeai l’aîné. Le second suivit. Je me délectai alors de leur chair, non sans un certain regret : j’avais assouvi là mon besoin de nourriture, mais pas celui de la chasse. J’étais frustrée. Après mon repas, je lustrai mon pelage, patiemment, à grands coups de langue, pour faire disparaître les traces de sang séché qui maculaient les contours de ma gueule. Je me roulai ensuite en boule dans un coin et m’assoupis, prudemment.
Quand je m’éveillai, j’étais nue. Mes vêtements gisaient à quelques mètres de moi, en lambeaux, et mes mains étaient couvertes d’une poisseuse substance brune. Je sentais dans ma bouche un goût acre, métallique. Paniquée, je me mis à hurler. Je pensai à une agression et tâtai mon corps à la recherche de blessure, avant que les évènements de la nuit ne me reviennent en mémoire, un à un. La chose me terrifia tout à fait. Je crus devenir folle. Pourtant je sentais aussi que chacune des choses que je me rappelais était réelle. Et leur souvenir résonnait en moi comme le plus exceptionnel instant que j’eusse vécu de ma vie. Loin d’être dégoûtée par la façon dont j’avais dépecé le lapin avec application, je revivais la scène comme un moment primitif d’une intense liberté, où rien n’était venu freiner ma vraie nature. Ce soir-là, je rentrai à la maison en catimini. Elle était plongée dans le noir. Quasi-nue sous mes haillons, j’eus la sensation que quelqu’un était là et m’observait. Je sentais une présence, rassurante, bienveillante. J’appelai « papa » doucement, mais personne ne me répondit. J’attendis un instant mais ne distinguai rien. J’avais froid. Je montai me coucher.
Aujourd’hui, c’était différent… Dès que j’ai constaté la chose, je suis sortie rapidement de ma chambre, pour ne pas qu’Hector et papa m’aperçoivent. La forêt n’est qu’à quelques mètres de notre maison, mais j’avançai prudemment, indécise. Le crépuscule venait seulement de tomber, je ne voulais pas prendre le risque d’être aperçue. Les alentours étaient sombres et silencieux, pourtant j’étais sur le qui-vive. Je sentais une présence, une odeur qui, sans m’être familière, me semblait sécurisante. Instinctivement, mes pas se portaient vers ce parfum. Brusquement, je m’arrêtai. Je sentis monter en moi un cri, une sorte de douleur secrète qui enflait dans ma gorge et que je ne pouvais retenir. Un hurlement sortit alors de ma gueule, d’une violence et d’une beauté tels, que même mon sang de bête en était glacé. C’est là que j’entendis sa réponse. Elle était semblable à mon appel, puissante et sonore. Je me mis à courir pour la rejoindre. J’ai goûté sa présence, sa chaleur. La pleine lune conférait à ses yeux jaunes une couleur mordorée, ses crocs luisaient dans la pénombre. En une seule seconde, je compris tout : qui j’étais, qui elle était. Pourquoi nous déménagions sans cesse. Pourquoi elle était partie, et surtout, pour qui elle était revenue.
Maman.
Surface
Célie Guignery
Deux semaines. Cela fait maintenant deux semaines qu’on a été affectés dans ce bouillon verdâtre, à déboucher les filtres des pompes à eau qui relient la Cité à la Centrale Aquatique de Terna. J’ai connu pire comme job, mais sincèrement, je crois que je ne tiendrai pas une semaine de plus.
Les « brosses », c’est comme ça qu’ils nous appellent. Avant que tout devienne un merdier sans nom, on faisait partie des gens « normaux », qui se levaient tôt le matin, rentraient tard le soir, bossaient dur toute la journée pour un salaire de misère. Mais on s’en contentait, on était heureux de se dire qu’on avait la possibilité de fonder une famille, d’avoir un foyer, de récupérer les miettes qui nous tombaient de plus haut… Et quand tout a explosé, que le soleil s’est mis à briller si fort que certains sont morts soufflés par la chaleur comme des tas de cendres, ceux de la « Haute » ont pris les choses en main. Ils ont construit des Cités sous l’eau, pour se protéger, eux, en priorité. Il leur fallait tout de même de la main-d’œuvre pour la basse besogne. Alors ils sont venus avec leurs immenses sous-marins, récupérer ceux qui tenaient encore à peu près debout dans les camps et les hôpitaux.
Faut dire qu’à l’époque on était bien trop contents de partir avec eux et de se dire qu’on avait un espoir de survivre avec nos familles. Mais au final, ce n’était rien de plus que ce qu’ils nous faisaient déjà miroiter avant le cataclysme.
Et voilà, les « brosses », c’est nous, ceux qui pataugent dans la fange, ceux qui font en sorte que les Cités sous-marines tiennent debout. Maintenir les installations en marche, les nettoyer, les réparer, passer des jours dans une eau immonde avec des combinaisons qui datent du siècle dernier. Ça nous connaît bien tout ça ! Je ne me souviens même plus de la dernière fois où j’ai pu respirer une grande bouffée d’oxygène… Je ne me souviens plus de la dernière fois où j’ai pu respirer, en fait. Et tout ça pour que les Bleus puissent barboter tranquillement dans leurs palais en cristal avec vue sur le lagon, comme ils ont toujours eu l’habitude de le faire, que ce soit ici, ou jadis à la surface.
— Hey, Phil ! Lâche ce putain d’écrou ou tu vas tout faire péter, mec !
Et merde, voilà que je me suis encore trop pris la tête avec toute cette histoire. Tu réfléchis, tu cogites, et tu finis par serrer trop fort avec la clé. Et c’est comme ça que les accidents arrivent.
— Désolé, vieux. Je sais pas ce qui me prend en ce moment, j’ai du mal à me concentrer.
Tim me lance un regard noir et se tourne à nouveau vers le tuyau qu’il tente de raccorder à la pompe à amorçage. Je me ferai pardonner ce soir en lui payant un verre d’Hameçon, un alcool local fait à base d’algues qui retourne l’intestin dès la première gorgée.
Le son de la conque retentit et résonne jusqu’à nos oreilles. Douze heures à galérer sur le même tronçon, et le boulot est encore loin d’être fini. Nos superviseurs passent en revue chaque binôme de travail pour noter l’avancement des opérations, et à chaque fin de journée, ils nous remettent une capsule bleue qui nous sert d’oxygène pour le lendemain. Pas la peine de se faire la malle, c’est eux qui nous permettent d’avoir de quoi respirer, c’est eux qui tiennent les rênes. Il est temps de rentrer.
***
Des kilomètres et des kilomètres de rails verticaux pour descendre dans les profondeurs. Le voyage me semble toujours un peu plus long à chaque traversée. Il faut dire qu’on n’a pas droit aux hydrotrams des Bleus qui défilent à toute allure tels des serpents aux écailles argentées. Le mouvement de ces engins flambant neufs me semble presque gracieux quand je les vois passer le long de mon hublot, sur la ligne des « grandes profondeurs ».
Comment survivre à la pression qui règne ici-bas, me direz-vous ? Ça, ils n’ont jamais voulu nous le dire. Paraît qu’on est trop cons pour pouvoir comprendre la technologie qu’ils ont mise au point pour que l’espèce humaine puisse s’adapter à l’environnement des abysses. Quoi qu’il en soit, les Brosses ne descendent à aucun prix aussi bas que les Bleus. On ne sait jamais, si les radiations venaient à toucher quelqu’un, autant que ce soit nous en premier, histoire qu’eux aient le temps de se tirer vite fait.
Il fait désormais tellement sombre que les lumières de notre aquanef ne suffisent plus qu’à éclairer quelques mètres devant nous. Mais bientôt, les éclairages luminescents de la Cité seront là pour prendre le relais. Très franchement, pour vivre ici, mieux vaut ne pas être claustrophobe. D’ailleurs, ceux qui le sont se sont vraiment très mal adaptés. Entre nos moyens de locomotion et nos lieux d’habitation, c’est tout juste si on peut se partager un mètre carré par personne. J’exagère à peine. Ça, plus la sensation d’étouffer tout le temps parce que l’air régénéré en oxygène est réservé à ceux qui en ont les moyens, et vous pouvez vraiment péter un câble en moins de deux.
— Hey les gars ! Je viens d’en voir passer une !
Ça y est, Marc remettait ça avec ses histoires de sirènes. L’ivresse des profondeurs, c’était pas une affaire encore réglée pour tout le monde !
Notre embarcation se pose difficilement le long des quais reliant la station. Un bruit sourd se fait entendre, suivi d’une secousse qui nous remue tous un peu. S’ensuit le sas de décompression, puis les jets de décontamination pour éviter que toute radioactivité ne pénètre l’enceinte, et nous voilà prêts pour rejoindre nos baraquements respectifs.
Tim me balance une frappe amicale dans le dos, qui manque de me faire chuter vers l’avant.
— On se voit demain ?
Pour toute réponse, je lui lance un regard traduisant mon sentiment : comme si on avait le choix… Comme si c’était possible pour nous de décider que, non, demain on ne retournerait pas dans cette boue verdâtre.
— Allez, c’est bon, fais pas ton poisson-lune ! me lance-t-il.
Je déteste quand il utilise des expressions vaseuses en rapport avec notre environnement, mais je ne peux m’empêcher d’esquisser un sourire quant à l’ironie de notre situation.
***
L’habitacle dans lequel ma famille et moi vivons tient beaucoup de la boîte à sardines. Une petite pièce où deux lits peuvent tenir, ainsi qu’une table qui sert de cuisine, de salle à manger et de salle de bain.
Niveau sécurité, les espaces dans le quartier des Brosses sont si petits et étroits qu’ils en deviennent de vrais coupe-gorge. On se déplace en file indienne, et pour se croiser on a appris à se contorsionner. Les journées sont longues, les nuits très courtes, et c’est seulement après vingt-deux heures que je rejoins enfin mon écoutille.
— Papa !
Une petite tête rousse se précipite sur moi et vient se blottir au creux de mes bras. Mathilda, ma fille de sept ans, a un sourire large qui lui monte jusqu’aux oreilles, les yeux brillants de retrouver enfin sa famille réunie, même si ce n’est que pour quelques heures. Elle travaille le reste du temps en apprentissage avec sa mère, dans les cuisines des Bleus. Autant vous dire que nous sommes considérés ici comme des privilégiés.
La plupart des nôtres ne côtoient jamais la « haute société » et vivent dans des dortoirs qu’ils partagent avec d’autres familles. Nous devons cette chance uniquement au fait que j’ai sauvé la vie de Magda, à l’époque où nous vivions encore à la surface. C’est elle qui s’occupe ici de l’attribution des baraquements chez les Brosses. Et aussi parce que ma femme, Hélène, est un cordon bleu exceptionnel, qui sait transformer n’importe quelle nourriture en chef-d’œuvre pour les papilles. Les Bleus raffolent de tous ses mets délicieux.
Bref, jalousie et convoitise se croisent souvent dans les regards de nos pairs. Nous nous contentons de les ignorer la plupart du temps. Après tout, nous ne faisons rien de mal ! Mais c’est ainsi, les conditions de vie imposées sont telles que n’importe quel petit « plus » par rapport aux autres est considéré comme une trahison.
Je chasse ces idées noires de mon esprit en serrant ma fille contre moi et en allant embrasser ma femme. Le repas est prêt : nous mangeons en silence, dégustant chaque bouchée de notre maigre ration, en faisant durer le plaisir d’être ensemble le plus longtemps possible.
Vient le moment d’aller dormir pour pouvoir tenir la journée du lendemain qui nous attend. Mathilda grimpe sur son petit lit de camp. Rapidement, j’entends sa respiration devenir profonde et régulière, cela m’apaise. Ma femme vient se serrer contre moi. Je m’imprègne de son odeur, le nez enfoui dans sa chevelure. Elle a toujours dégagé un parfum de mûres sauvages. Enfin, je crois. Mes sens et ma mémoire me jouent souvent des tours lorsqu’il s’agit de me souvenir des choses terrestres.
***
Au milieu des cauchemars où pieuvres et méduses viennent hanter mon esprit, je sens quelque chose de froid se coller contre ma gorge. J’ai d’abord l’impression que cela se déroule dans mon rêve, qu’une ventouse est venue se poser sur ma peau. La brume de sommeil qui engourdit mon cerveau se dissipe peu à peu et je sens une présence.
« Merde !» est le seul mot qui me vient. J’ai un couteau plaqué contre ma jugulaire, et le poids d’un genou vient appuyer sur mon torse. Je suis bloqué.
Ils sont deux. Dans la pénombre, je parviens à distinguer deux hommes, le premier sur moi, tenant dans sa main gauche un couteau, et bloquant la bouche de ma femme avec sa main droite pour éviter qu’elle ne crie. Le deuxième encercle ma fille dans ses bras, elle se débat de toutes ses forces. Peine perdue.
— Bah alors, Phil, t’as oublié que tu me devais un verre ce soir ? C’est pas gentil ça ! Surtout pour un salaud de privilégié comme toi !
J’écarquille les yeux, car j’ai reconnu la voix. C’est Tim. Tim avec qui je bosse tous les jours depuis maintenant cinq ans, avec qui je partage mes craintes, mes moments de désespoir mais aussi de petit bonheur, au sein de tout ce chaos. On aurait pu croire que l’achèvement de tout aurait pu rapprocher les êtres. Il n’en est rien en fin de compte.
Un ricanement haineux résonne dans la pièce.
— Je crois bien que tu t’attendais pas à celle-là hein ? Allez, je suis sûr qu’un petit gars dans ton genre va pas faire d’histoires. Tu vas me dire où tu caches tes perles d’étain, et moi et mon copain, on s’en ira gentiment.
Je ne comprends pas. Tous les jours dans la même merde, à vivre les mêmes galères, à se serrer les coudes pour survivre. Je le considérais comme un frère. Nous sommes des Brosses, putain ! Pense-t-il réellement que je cache un trésor chez moi ? C’est pour ça que les Bleus n’ont rien à craindre de nous. Au fond, ils ont raison de nous prendre pour des cons : nous le sommes assez pour nous retourner les uns contre les autres.
Ma détresse commence à se transformer en sueur le long de mon dos. Comment faire entendre raison à quelqu’un qui semble avoir perdu tout espoir ? Je savais pertinemment que tout ceci ne pouvait que mal se terminer, la lueur dans les yeux de l’homme qui accompagne Tim me confirme ce que je pressens. Il est là pour ressentir la peur et la douleur, cela le fait vibrer, c’est la seule consolation qu’il a trouvée dans ce monde ayant perdu tout repère.
Tim se met à ricaner, l’autre se tourne vers lui pour l’imiter. Je n’hésite pas, je saisis son bras qui tient le couteau et le fais basculer vers l’arrière au sol. La suite se perd dans ma notion du temps. Je le frappe au visage, encore et encore, jusqu’à ce que mes phalanges me fassent souffrir, que son sang vienne m’éclabousser. Pour qu’il ne se relève pas, jamais. Pour qu’il n’ait jamais la possibilité de blesser ma famille. J’entends ma femme hurler et je sens quelqu’un me tirer violemment vers l’arrière. Je reçois des coups dans mes côtes et au visage. J’essaye de me relever, mais Tim me maintient au sol, les mains serrées autour de ma gorge.
Mathilda est tétanisée sur son lit, les yeux écarquillés et emplis de larmes. Hélène continue de hurler en essayant de tirer Tim en arrière. Elle se prend un violent coup de poing qui vient l’éjecter contre un mur et l’assomme sur le coup. Je tente d’empêcher Tim de m’étrangler mais il est beaucoup plus lourd que moi, et j’étouffe de plus en plus.
Mes sens commencent à s’engourdir. Dans un état second, j’entends l’alarme au loin qui retentit. Le gyrophare rouge produit un étrange halo par intermittence dans le couloir des parties communes. Je sombre dans l’inconscience.
***
Lorsque je m’éveille, ma femme est penchée au-dessus de moi, le visage tuméfié. Elle me secoue. Je vois bien ses lèvres bouger, je sais qu’elle me parle, mais je n’entends rien, hormis un profond sifflement qui résonne dans ma tête.
Tout est plongé dans la pénombre. Lorsque je me tourne vers Mathilda, ses yeux sont illuminés de rouge, puis sombrent à nouveau dans les ténèbres. Le gyrophare continue d’opérer son signal dans le couloir. Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Je sens juste le sol trembler violemment comme s’il allait s’effondrer sous nos pieds.
Aussi vite que me le permet mon corps en piteux état, je me roule sur le côté pour pouvoir me relever sur mes deux jambes. Ma femme me soutient en me passant le bras par-dessus son épaule et je m’adosse difficilement contre le mur. Elle me prend la tête entre ses mains, et je vois à la lueur de son regard que quelque chose ne va pas, qu’il faut faire vite.
Pas besoin de grand discours entre des personnes qui s’aiment et vivent ensemble depuis longtemps. Des personnes qui ont traversé le pire. Je prends deux grandes inspirations, me stabilise, tente un pas en avant, puis un autre. Mathilda vient se loger entre mes bras, et nous sortons tous les trois dans le couloir. De l’eau monte jusqu’à nos chevilles et une marée humaine se presse le long des baraquements en se bousculant. Une terreur sourde monte alors le long de mon échine, tandis que je commence à nouveau à entendre les bruits environnants : l’alarme assourdissante, les cris, les pas dans l’eau provoquant des éclaboussures, et surtout, le métal qui grince autour de nous sous l’assaut des profondeurs.
— Phil ! Phil !
Magda se fraie difficilement un passage jusqu’à nous, en remontant le couloir à contre-courant.
— Bon sang ! Mais qu’est-ce qui se passe, Magda?
— On ne sait pas Phil ! Le quartier des Bleus… il a été rasé, anéanti ! Il y a eu une violente explosion, et puis… plus rien ! Ça remonte des profondeurs, c’est en train de nous tomber dessus. Je vais chercher mes petits et je file vers le port de plongée !
Je n’ai pas le temps de poser une autre question que Magda a déjà filé. Le port de plongée… Vu la panique générale, tout le monde se serra déjà dirigé là-bas et il n’y aura plus aucune embarcation de libre. Je sers Mathilda contre moi et empoigne le bras d’Hélène avec ma main libre. Le bassin des tests pour les machines est la seule issue qui me vient à l’esprit.
Nous réussissons difficilement à nous frayer un chemin parmi tous les autres. Mais au moment de bifurquer au premier croisement vers la gauche et le flot de la foule, je me dirige à l’opposé vers ce que je considère comme notre seul espoir. Appelez ça comme vous voudrez : instinct de survie, sursaut primaire pour garantir la continuité de l’espèce humaine. Foutaises ! Je tiens dans mes bras ce que j’ai de plus précieux au monde, et en cet instant, il n’y a absolument rien qui puisse m’empêcher de sauver ma fille.
J’accélère le pas, mais je sens soudain la main de ma femme glisser entre mes doigts. Elle s’est arrêtée devant un hublot et l’expression de son visage me glace le sang. Je sers Mathilda contre moi et lui enfouis sa tête contre mon épaule. L’horreur à la surface, je connaissais bien, nous l’avions vécue. Mais ce que je vois alors n’est rien de comparable.
Des tentacules gigantesques émergent des profondeurs où elles ont laissé un champ de ruines en lieu et place des quartiers des Bleus. Elles remontent vers nous avec une lenteur qui rend le spectacle encore plus terrifiant. Il est impossible de percevoir la taille de la créature, car le reste de son corps demeure encore dans les ténèbres, mais on peut aisément deviner qu’un seul mouvement des tentacules avait suffi à réduire à néant toute une partie de notre Cité, et que le reste allait suivre dans les abysses sous peu.
Les Bleus… Du haut de leur arrogance, ils étaient tellement persuadés que le danger ne pouvait venir que de la surface, du monde détruit que nous avons fui, qu’ils en ont oublié ce qui pouvait surgir d’en bas.
— Hélène, il faut y aller. Maintenant !
Ma femme parvient à détacher son regard de l’horrible scène qui se joue sous nos yeux. J’entends son souffle court dans mon dos alors que nous parcourons les derniers couloirs qui nous séparent de notre but.
L’idée était bonne, mais certains l’ont eue avant moi. Le bassin des tests tient plus d’un petit hangar dans lequel sont entreposés habituellement plusieurs mini sous-marins permettant aux techniciens de réparer les éventuels dégâts en extérieur.
Au moment d’entrer, une famille venait de monter dans la dernière embarcation disponible. Il s’appelle Neal, je crois, celui qui tient la poignée de l’écoutille entre ses mains, celui qui me regarde avec un mélange de terreur et de pitié.
— Je vous en prie, non ! Prenez au moins notre fille !
Hélène hurle ces mots comme une prière, une supplique. Comme les dernières paroles d’une condamnée. Mais cela ne sert à rien, je le sais, j’ai déjà vu le regard de Neal dans des situations similaires. Un regard qui voudrait bien faire, mais dont les événements empêchent tout retour en arrière. Ma femme tombe à genoux lorsque ce dernier ferme l’écoutille, nous privant de tout espoir de fuite. C’est ainsi, c’est… humain.
Je dépose Mathilda à terre et regarde autour de nous. Impossible de s’avouer vaincu, il y a toujours quelque chose à tenter. Toujours ! À moitié enseveli dans les flots qui montent, un petit engin aquatique qui sert aux tests des combinaisons de plongée se tient dans un coin. Il n’était pas conçu pour les longues distances. Seule une personne pouvait y tenir, et son autonomie ne dépassait pas les huit heures.
Je pose un genou à terre, mes deux mains sur les épaules de ma fille :
— Princesse, c’est à toi de jouer maintenant !
Ses yeux se remplissent de larmes alors qu’elle commence à comprendre ce que je lui demande, ce qui va se passer ensuite. Bien qu’étant constamment entouré d’eau, bien que vivant dans un espace minuscule, je n’avais encore jamais eu la sensation de sombrer. Jusqu’à maintenant. C’était comme si j’envoyais une bouteille à la mer, avec quelque chose d’infiniment plus précieux que ma vie à l’intérieur. Tout l’espoir du monde dans un cylindre de métal ballotté par les flots. J’étais en train de me noyer, oui, dans les yeux de Mathilda. Comme si l’air était violemment expulsé de mes poumons, qu’un étau empoignait ma gorge. Du sel sur une blessure à vif… Voilà ce que cela me faisait ! Mais il ne fallait pas le montrer, surtout pas. Sinon, tout était perdu.
Avec douceur, je la prends dans mes bras et la dépose délicatement dans l’habitacle. Sentir son petit corps secoué de sanglots me met à l’agonie, mais seul un sourire apaisant transparaît sur mon visage. Tout est en train de disparaître autour de nous, et de violentes secousses me poussent à faire vite.
— N’oublie pas, Mathilda, ne regarde pas en arrière, regarde toujours vers la surface !
J’appuie sur le bouton de pilotage automatique et ferme l’écoutille. Et tandis que l’univers s’écroule autour de nous, noyé dans un torrent d’amertume, je serre ma femme contre moi, avec dans le cœur un espoir violent, incisif. Un espoir de fou qui me pousse à me répéter comme un mantra : Mathilda en a fini avec le monde du silence. Mathilda est sauvée !
Fable funèbre
Marielle Ranzini
Il était un domaine, un abîme, une tombe, où régnaient le drame, le tourment. Un endroit ténébreux, aux promesses singulières. Une légende terrifiante enveloppait ce microcosme perdu. Une vie après la vie ou bien une mort après la mort. Qui pouvait le dire dans ce monde ankylosé, lieu d’existences ambiguës ? Cette ville oubliée de tous, bannie de la surface de la terre, se nommait Vikka. Il fut un temps où elle était ville d’un peuple d’érudits. Philosophes, libres-penseurs, humanistes, lettrés, chercheurs, pacifistes, réunis sur l’île D’Intis, avaient bâti Vikka pour servir de nid à leur communauté. Ses murs peints en bleu et or, elle était surnommée la cité de lumière. En effet lorsque le soleil les caressait, chaque rue, chaque recoin, chaque maison paraissaient s’enflammer. Ils l’avaient voulu ainsi pour célébrer ce doux refuge qui abritait leur colonie. Retirés du reste du monde, ils se suffisaient à eux-mêmes, vivant en harmonie, ce qui sur Terre semblait pourtant impossible. Cependant sur cette planète, rien n’est immuable, tout peut basculer en une nuit…
Des êtres à la laideur stupéfiante, des créatures à la mélancolie douloureuse hantaient cette contrée, plus qu'ils ne l'habitaient. Des hommes, des femmes erraient, fatalement, dans une pantomime sans fin. Une ruche engourdie, attachée à un passé poignardé, sans avenir aucun. Leur physique empêchait toute rébellion, toute envie de chercher une échappatoire, un autre exil. De mauvais esprits les avaient dotés d'un crâne chauve, d’un front proéminent sous lequel deux yeux, plus obscurs qu'une nuit sans lune, brillaient sauvagement. Un nez épaté surplombait une large bouche. Cette dernière s’ouvrait sur une mâchoire peuplée de centaines de minuscules dents tranchantes. La peau bistre de ces individus se plissait sur leur cou, de façon peu ragoûtante. Pourtant, l'aspect le plus terrifiant de ces pauvres âmes se révélait être un second visage. Ce faciès s'étirait du côté droit de leur première trogne. Il présentait une façade à l’épluchure crayeuse, des globes oculaires vides, deux trous béants remplaçaient leurs narines, le tout garni d'un suçoir aux crocs acérés, perpétuellement ouvert sur un sifflement sauvage. Quel que soit le sexe des citoyens de ces parages maudits, chacun possédait le même adorable visage poupin (veuillez excuser ce mauvais trait d'humour). Leurs corps gardaient, par contre, apparence tout à fait humaine.
Tous pleuraient leur passé disparu. Jamais ils n’avaient pu savoir le pourquoi de leurs tourments. Seule la douleur lancinante de l’incertitude éternelle les mortifiait. Pour toujours dans les interrogations qui taraudaient leur esprit, leur vie déjà infernale n’était que désespoir permanent. Ils vivaient là, en ces fonds abyssaux, depuis deux siècles. Ils n'avaient nul besoin de se nourrir, de dormir. Ils possédaient aussi une vie d’immortels, mais quel besoin d’éternité pour des individus aux destins abominables ? Un drôle de paroxysme tout de même. Leurs corps desséchés flottaient dans de longues tuniques brunes. Ils se traînaient plus qu’ils ne marchaient, exécutant leurs besognes mécaniquement. La vie les avait oubliés dans leur fosse de morts-vivants. De nébuleux souvenirs les ramenaient de temps à autre sur l'île d'Inti1, nom du dieu soleil Inca. La senteur de l’air, la chaleur du soleil, la douceur de la nuit caressaient parfois leurs consciences. Cela semblait si lointain, si irréel, qu’il leur était possible d'imaginer que leurs existences précédentes n'étaient qu'illusions, rêves fugaces. Pourtant au fond d'eux, au cœur de leurs tripes, ils ressentaient le funeste besoin du retour à leur avant, un nouveau réveil dans leur cité bleue, la belle Vikka. Cela les hantait, les obsédait.
Ce fut lors d'une nuit comme les autres que le sommeil les emporta vers une autre sphère. La seule malédiction des Vikkïens se trouvait être le nom de la petite île sur laquelle ils avaient construit leur magnifique berceau, Vikka. Le dieu Supay 2, un soir de rage envers le dieu Inti, opta pour une vengeance bien puérile et cruelle. Une certaine jalousie envers ce dernier le taraudait souvent. Pourquoi ? Il aurait bien été incapable de répondre à cette question. Teigneux de nature, il voulait simplement satisfaire une envie de mutinerie, voici probablement la seule raison de son courroux. Aidé par certains démons de son affiliation, il décida de faire de l’île Inti, baptisée du nom de son rival, l’objet de sa vengeance. Il fit disparaître l’île de la surface de la planète, l’envoyant au fin fond de l’océan. Il supprima une partie des habitants pour ne garder que les plus robustes, les plus aptes à servir ses desseins, mais en cette soirée, rien ne limitait l’abomination de sa cervelle surchauffée. Il mêla l’absurde au grotesque en faisant de ces êtres des abominations. D'une peuplade pacifique, ils n'étaient plus que troupeau monstrueux. Il supprima la parole à ces pauvres gens, pour la remplacer par un sifflement incessant, qui les épuisait, les usait. Rien ne paraissait assez pervers pour soulager la folie furieuse qui emportait toute raison chez Supay. D’un instant d’emballement contre un des siens, découla un châtiment cruel contre une population paisible. Il ajouta la télépathie à ses nouvelles marionnettes, non pas dans un moment de sympathie, mais parce qu’il lui était utile que son nouveau troupeau puisse communiquer.
Lors de leur réveil, les Vikkïens s’observèrent avec stupéfaction. Chacun constata chez l’autre les mutations physiques subies, ce qui les horrifia. Complètement bouleversés, affolés, ils prirent aussi conscience qu'ils ne pouvaient plus parler, mais qu’il leur était possible d’entendre les pensées de leurs semblables, puis de pouvoir répondre de même façon. Par contre, effrayés, enivrés par les stridulations permanentes qui sortaient de leurs bouches, étourdis par la confusion qui régnait dans leur cerveau, les Vikkïens se trouvaient gagnés par une angoisse terrible. Il allait falloir du temps à ces pauvres gens pour accepter, tant bien que mal, la situation dans laquelle ils se trouvaient. Certes, ils vivaient toujours sur l’île d’Inti, autant qu’ils aient pu le constater. Ce bout de terre se trouvait apparemment sous une espèce de dôme entouré d’eau. Des abysses, aussi noirs que les limbes, enveloppaient ce territoire. Un purgatoire sous les flots, un gouffre pour l'éternité. Quant au dieu Supay, dans sa grande cruauté, il avait décidé de ne pas laisser ses jouets d’un moment devenir inutiles, indolents. Cette gentille populace deviendrait des Veilleurs. Cela pour l'éternité.
Dans le monde des profondeurs, dans les abîmes de l’océan, existaient une centaine de colonies de Veilleurs, administrées par Supay. Le rôle de ces communautés se trouvait être essentiel pour le fonctionnement de l’humanité. Depuis deux cents ans, le maintien de la race humaine passait forcément par le renouvellement de chaque individu, après la mort. En quelques décennies, les humains avaient vu s’effondrer la fertilité. Les scientifiques du monde entier n’avaient jamais réussi à trouver la raison de ce phénomène et par conséquent, aucune solution au problème non plus. La situation de leur espèce les laissait désemparés. C’est à ce moment que les protecteurs de toutes choses en ce bas monde étaient intervenus. Comme il ne naissait plus d’enfants, mais que l’écosystème semblait avoir besoin de l’Homme, aussi bizarre que cela puisse paraître, tant leur côté autodestructeur se révélait incontrôlable, les Dieux, réunis lors d’un conciliabule, se décidèrent à prendre la situation en mains. De cette rencontre résulta la création de vies éternelles pour chaque humain. Ils se verraient accorder une existence infinie, mais renouvelable. Tous vieilliraient, mourraient, puis ils seraient reconstitués pour une nouvelle existence, avec un autre corps, un nouveau visage. Il fut décidé que le nettoyage des corps, avant une régénération humanoïde, se ferait au fond des mers et océans, dans l’invisibilité des vivants. Une centaine de dômes furent alors créés dans les profondeurs des eaux pour le nettoyage des dépouilles. Ils étaient habités par des groupements d’hommes et femmes remplacés toutes les décennies, par une nouvelle équipe. Il y eut une longue discordance sur le fait d’effacer ou non la mémoire des personnes qui réintégraient leur vie à la surface après avoir été Veilleurs. Finalement chacun s’accorda sur l’oubli de ces dix années pour les Veilleurs, chose qui paraissait la plus sage, tant le travail se révélait atroce. Un conseil, rassemblant plusieurs divinités, se réunissait tous les dix ans, pour choisir les nouveaux Veilleurs, troupes dont l’administration revenait au dieu Supay , en tant que Dieu de la mort. Supay se chargeait de remplir les hottes des démons, qui géraient la répartition du travail dans les dômes. Les hommes et femmes, travaillant sous ces coupoles, se devaient d'assurer aux décédés une décomposition complète et parfaite, pour qu'ils puissent accéder à la préparation de leur nouvelle existence, renaissance que les divinités prenaient en charge par la suite, grâce à leurs pouvoirs occultes. D’eux seuls dépendait la réincarnation des individus. Il en était ainsi depuis deux siècles.
Les Vikkïens, quant à eux, vivaient en ces lieux depuis deux cents ans. La malédiction de Supay les maintenait, sans espoir de retour en surface, en ces parages maudits. Les enveloppes humaines atteignaient l'île d'Inti, au beau milieu du monde abyssal, sans que les intéressés sachent trop comment. Des cadavres rejoignaient inlassablement chaque jour la salle de déliquescence, la pièce de la pénitence pour les habitants de ces lieux. Tous les mois, une vingtaine d’habitants de Vikka se trouvaient désignés par Supay pour travailler à la dissolution des trépassés. Chacun appréhendait ce moment, ils auraient tous préféré mourir plutôt que de vivre ce long mois à tour de rôle et ce, depuis beaucoup trop longtemps. Contrairement aux autres coupoles, où il était déjà difficile de tenir dix ans dans la perpétuelle horreur, les Vikkïens devaient non seulement subir leur apparence, leurs conditions de vie, mais aussi leur rôle de teinturiers des corps, tout cela pour l’éternité… Assister à la décomposition d’êtres humains se révélait atroce pour ces pauvres bougres, devenant rapidement intolérable. Pourtant, ils remplissaient leurs tâches avec un automatisme indépendant de leur volonté car, de volonté, ils n’avaient plus. Ils devaient, tout d'abord, procéder au déshabillage de la dépouille, ensuite ils allongeaient le cadavre sur le sol de terre battue, pour que le mécanisme de putréfaction entre en action. Une ouverture dans le plafond de la pièce permettait à l'air de circuler. Des feux d'enfer, alimentés en permanence, s'échappaient de six grandes cheminées pour maintenir la chaleur démentielle, qui assurait la dégénérescence du défunt plus rapidement. Lorsque les dépouilles arrivaient, la fermentation avait déjà commencé, et les bactéries s'attaquaient déjà aux tissus. Au fil du temps, les insectes en tous genres, grignoteurs de macchabées, trouvaient, eux, contrairement à l’humanité, le moyen de se reproduire. Des taches vertes s'étendaient de l'abdomen gonflé au thorax, la peau se décollait ; suivaient ensuite le visage boursouflé, les yeux bouffis, la langue pendante. Les atrocités se succédaient, immuables, irrévocables. Puis venait la besogne des bébêtes, mais heureusement, l'ardeur des feux accélérait le processus de nettoyage. Grâce à l'aération de la chambre mortuaire, les odeurs semblaient moins abominables, mais les sensations olfactives de nos misérables amis s'avéraient quand même maltraitées. Quant à la vision immuable de ces corps pourrissants, il fallait ne plus avoir d'âme et de conscience pour ne pas être choqué. Les Vikkïens possédaient toujours des sentiments, et l'abomination de leur mission les brisait, les anéantissait. Mais ils devaient supporter leur sort la mort dans l’âme, le choix ne leur appartenait pas.
Enfin, quand la chair avait joué la « fille de l'air », qu’il ne restait plus que les os du squelette, ils devaient laver consciencieusement la carcasse nue. La tâche s’avérait extrêmement délicate. Ils ne devaient surtout pas manquer un seul morceau d'os à aucun des candidats à une nouvelle vie. Si cela arrivait, la punition s’avérait terrible, le responsable se trouvait condamné à une année complète dans la pièce de déliquescence. Au bout de six mois à peine, le coupable devenait fou. Cependant, dans sa grande bonté, Supay le bannissait, l’envoyant perfidement se noyer dans les profondeurs de l’océan. Mais revenons à nos problèmes d'ossature. Lorsque le nettoyage se passait comme un charme, que le prétendant à un nouveau destin se trouvait fin prêt, sa charpente disparaissait mystérieusement vers une autre étape, un autre ailleurs.
Vint le jour où un grain de sable s’introduisit dans le fonctionnement bien rodé des Veilleurs Vikkïens. Depuis peu, ils tombaient malades, et aucun d’eux ne survivait à l’affection qui les touchait. Une fièvre délirante les capturait pour les mener vers un rapide trépas. Supay ne comprenait pas ce qu’il arrivait à ses souffre-douleur ; il en avait fait des êtres indestructibles, aussi ce changement attisait fort sa colère. Il lui était impossible de déterminer ce qui les exterminait. Qui se permettait de contrecarrer ses plans ? Il possédait le pouvoir sur tous les Veilleurs et en particulier sur ceux-là. Il ne supportait pas qu’un ou plusieurs de ses congénères s’arrogent le droit de déranger ses décisions. Pourtant, aucune des autres divinités ne suspectait quoi que ce soit des débordements de leur alter ego. Chacun d’eux semblait trop perdu dans ses envahissantes tâches personnelles, trop débordé par le travail supplémentaire que leur donnait le repeuplement de la planète terre pour s’apercevoir des diableries d’un des leurs. Supay ne soupçonna jamais, malgré ses recherches, qui se trouvait être son adversaire. Il ne put donc combattre pour empêcher la fin de ses manigances.
Devant la durée et l'importante souffrance de ces êtres simples, une entité, des plus supérieures, fut prise d'une grande pitié. Gaïa, notre belle Terre. Notre Mère Nature décida de libérer ce peuple persécuté, qui n'espérait que la mort pour apaiser enfin ses esprits. Il en fut de même pour tous les Veilleurs de la planète. Et c'est depuis ce jour que la planète se dépeupla peu à peu, jusqu’à l’extinction de la race humaine.
La légende dit qu'avant de perdre la vie, les Vikkïens élevèrent une statue en l'honneur de leur bienfaitrice. On ne sait comment ils comprirent que Dame la Terre les sauvait enfin d’eux-mêmes. Quant aux Dieux… Mais au plus profond des abysses, se trouve, paraît-il, une île mystérieuse, une île qui se nommait Inti, une ville qu’on appelait Vikka.....
La dame de la taïga
So-Chan
Sœurette entendit alors la source chuchoter : « Qui boit de mon eau devient chevreuil. » Sœurette cria pour mettre en garde Frérot. Mais déjà il s'était agenouillé au bord de l'onde et buvait. Quand les premières gouttes touchèrent ses lèvres, il fut transformé en jeune chevreuil. Sœurette pleura sur le sort de son cadet. Le petit chevreuil s'allongea tristement auprès d'elle. L’aînée finit par dire : « Ne pleure pas, cher petit chevreuil, je ne t'abandonnerai jamais. » Elle se pencha auprès de la source et but de son eau.
Extrait d'un conte populaire scandinave
***
Tommi souffla sur ses doigts gelés. La neige encroûtait ses moufles qu'il avait glissées à sa ceinture le temps de ramener un peu de vie dans ses doigts. Le garçon finit par les suçoter un par un avant de renfiler ses gants. Il savait que si un adulte apprenait qu'il se trouvait dans la taïga, qu'il avait défié les lois humaines, il recevrait plus d'un coup de bâton sur les fesses. Mais Tommi n'en avait cure. Il voulait la revoir, celle qu'aucun adulte ne pouvait approcher : la reine de la taïga.
Se rallongeant sur le sol, Tommi avança, son nez chatouillé par les herbes, levant de temps à autre la tête pour observer les alentours. Il l'avait déjà aperçue, une fois, alors qu'il était parti quérir du bois. Un éclair blanc, une image presque impalpable. Depuis, Tommi voulait la revoir, imprimer une image durable dans son esprit pour narrer son exploit. Même s'il était un enfant, il ne manquait pas de courage et voulait le prouver. Après tout, n'avait-il déjà pas réussi à ramener ses six frères à la maison alors que tous, au village, les pensaient morts de froid et de faim ?
Une branche craqua. Tommi se figea, tendant l'oreille. Poussant sur ses coudes, le garçon leva la tête. Ses yeux s'arrondirent. Elle était là. Plus blanche que la neige, ses grands yeux noirs insondables regardant au loin. Ses jambes semblaient si fines que Tommi avait l'impression que son père aurait pu les briser aussi aisément qu'il maniait la hache pour couper le bois. Tommi vit la dame se tendre et regarder dans sa direction. Les yeux posés sur lui l'obligèrent à se redresser net.
L'enfant trembla. La dame le scrutait et ce regard le glaçait jusqu'aux os. Lorsqu'elle vint à sa rencontre, Tommi ferma les yeux. Et tel un condamné, attendit la sentence.
***
Lorsque Tommi vit l'homme descendre du renne, le garçon eut un haussement de sourcils. L'étranger n'était guère grand – son père le dépassait d'une bonne tête ainsi que l'ensemble des habitants mâles du village. Pourtant, tous courbaient la tête face à cet individu aux cheveux bruns mi-longs flottant sur ses épaules, au regard vert forêt. Les colosses scandinaves donnaient du « Majesté » à cet homme qui, d'apparence, n'avait rien de transcendant. Il était commun aux yeux de Tommi, d'un commun affligeant.
Il ne ressemblait en rien aux empereurs que l'on croisait dans les contes.
Même sa voix n'avait pas l'impétuosité que l'on prête aux grands hommes. Elle chantait, doucereuse comme une berceuse.
— Qui a vu la dame pour la dernière fois ?