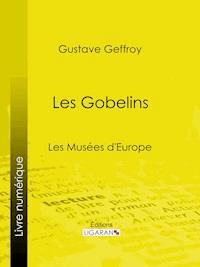Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Extrait : "C'est un recueil d'images, les unes surannées, les autres nouvelles : des aspects de foules; des silhouettes d'individus, portraits en pied ou expressions de visages; des apparitions de femmes, au théâtre, dans le promenoir d'un music-hall, dans la rue, des réalités et des rêves; un défilé d'ecclésiastiques d'hier et d'aujourd'hui; des essais de divination des mystères qui passent; des drames entrevus ou déchiffrés..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335077261
©Ligaran 2015
C’est un recueil d’images, les unes surannées, les autres nouvelles : des aspects de foules ; des silhouettes d’individus, portraits en pied ou expressions de visages ; des apparitions de femmes, au théâtre, dans le promenoir d’un music-hall, dans la rue, des réalités et des rêves ; un défilé d’ecclésiastiques d’hier et d’aujourd’hui ; des essais de divination des mystères qui passent ; des drames entrevus ou déchiffrés ; des comédies sociales qui se jouent sur le pas des portes et dans le décor des boutiques ; des scènes où les animaux ont leurs rôles de malice instinctive et d’inconscience rusée ; des descriptions d’objets qui participent à notre vie comme des petits personnages insensibles, aveugles, muets, et pourtant si éloquents, si frémissants de notre sensibilité ; des fleurs, des fruits, qui nous donnent leur parfum, leur couleur, leur poésie.
Et comme fond à tant d’êtres et de choses, l’immense chaos des éléments auquel sont liés les destins de tous les êtres.
Tout cela m’est apparu à toutes les heures, de l’aube au crépuscule, et du soir au matin, dans le mirage du soleil et le clair-obscur de l’ombre, dans l’éclat doré du jour et l’ombre bleuie et noire de la nuit.
Le premier spectacle offert aux yeux et à l’esprit par la rue de Paris, après quelque absence, est un spectacle de misère et de désolation.
On a encore dans la mémoire les images des routes presque solitaires, des silhouettes espacées, de la vie animale en contact avec la nature, du travail suffisant à nourrir les pauvres. On revoit les chevaux des prairies, libres et forts derrière les haies, la crinière éparse, hennissant dans le vent. On évoque la bergère sous sa cape, la ramasseuse d’épis oubliés, la pêcheuse aux jambes nues, qui s’en va à travers le flot montant, tous ceux qui vivent des résidus de la terre et de la mer. Les paysages parcourus se déploient dans l’espace lumineux.
C’est le décor de l’illusion, la fausse apparence de la paix. La rue de Paris, retrouvée, va redire la perpétuelle bataille.
À la sortie de la gare, au milieu de la nuit, des chevaux-squelettes meurent de faim, tombent de sommeil, entre les brancards. Le fiacre parti en grinçant, le premier regard qui scrute la brume nocturne aperçoit le troupeau dispersé et errant des prostituées, la lente promenade des pierreuses, la tache livide d’un jupon blanc, un visage couleur de brique apparu un instant dans la lumière, puis réenseveli dans l’ombre.
Tel est le premier aspect de la rue, aux heures de nuit. La souffrance animale et la souffrance humaine, c’est la révélation faite tout d’abord par la ville merveilleuse qui élabora tant d’idées, se donna de tant d’ardeur à l’action. Malgré cela, et contre cela, les mêmes forces sont toujours en elle pour continuer l’œuvre commencée, l’œuvre du temps.
À Paris, d’un sixième étage, un paysage étrange apparaît à travers le rideau de mousseline et la vitre. En plein ciel, une plantation de cheminées, de tuyaux, dessine des allées capricieuses et des massifs irréguliers, toute une dure forêt sans feuilles, en brique et en métal.
C’est une seconde ville superposée à la première, le couvercle mis sur l’agitation humaine. L’espace jusqu’à l’horizon est envahi de matériaux aux formes irrégulières dans leur géométrie de lignes droites, de lignes brisées, de cubes, de cônes tronqués, de figures imprévues de plans et de combinaisons. À peine une silhouette de couvreur, le jour, le bondissement d’un chat électrique, le soir, au clair de lune, animent-ils ce désert pétré, hérissé de découpures de zinc.
Au-dessous, c’est le grondement de la ville, et c’est aussi, parfois, le silence, le silence que l’on sent peuplé de toutes les embuscades, de toutes les attentes, de tous les sentiments, de toutes les passions, de tous les amours, de toutes les haines. Et le bouillonnement, la fermentation de ce monde en travail, en décomposition, en stupeur et en fureur, ne se traduit que par l’envolement des fumées légères.
Au soleil d’automne, devant les feuillages rougis, des vieux et des vieilles sont assis sus la rangée de bancs du jardin public.
Ils ne regardent pas le dernier ciel bleu d’octobre, où errent de beaux et massifs nuages, pareils à des blocs de marbre, blancs et fauves. Leur contemplation non plus ne va pas à l’étang où voguent les cygnes de neige et les canards de velours noir et d’émeraude, ni vers la pelouse brûlée où de grandes fleurs se convulsent pour mourir.
Tant que le soleil est haut, ils sont là, en espalier devant la muraille, non pour voir, mais pour se chauffer, immobiles, les yeux mi-clos, comme des chats devant l’âtre.
Ils sont bien cinquante, serrés les uns contre les autres. Les vieux, emmitouflés, vêtus de gros drap, la tête enfouie dans une casquette à oreillettes, des galoches aux pieds, les mains dans les manches, ou appuyées, avec le menton, sur de grosses cannes. Les vieilles, empaquetées dans des jupons, des châles entrecroisés, des fichus, des capelines, le visage encadré d’un serre-tête noir : quelques-unes tricotent, on voit aller et venir leur index gris hors de leurs mitaines noires.
Ce sont les petits rentiers du quartier. Ils ont un air « entre eux » qui ne trompe pas, ils marquent par leur attitude sérieuse qu’ils ont pris possession de la rangée de bancs pour toutes les après-midi de soleil. Dans la vie, ils ont été des commerçants adroits au gain, des petits patrons énergiquement économes. Quelques-uns sont des employés ayant réussi à vivre jusqu’à l’âge de la retraite.
C’est peu, pour tout un quartier, ces quelques existences économisées. D’autres vieux et vieilles sont à l’hôpital, à l’asile. D’autres se dissolvent tristement dans d’abominables chambres. Il n’y a pas un seul ouvrier d’industrie assis sur ces bancs. On se récrie au récit des mœurs de certaines peuplades sauvages qui tuent et mangent leurs vieillards. Les civilisés ne mangent pas leurs ancêtres, mais ils les laissent mourir, ils les tuent par abandon, ils n’ont pas trouvé le moyen, encore, de garantir à tous le repos final dans la lumière et la chaleur du soleil d’automne.
Au long des rues, une ou deux, quelquefois trois par maison, les boutiques offrent leurs vitrines, leurs éventaires aux regards. L’habitude peut nous les faire trouver banales. Nous passons si souvent devant elles, préoccupés, distraits, ou bien nous n’en avons le souci que par la nécessité de la vie, et l’idée qu’elles éveillent en nous est le plus souvent l’idée de la rançon qui nous sera demandée par l’industriel inquiet, le commerçant rusé, embusqué derrière son comptoir.
Mais si nous y réfléchissons, les boutiques, toutes les boutiques, sont des merveilles.
Chacune d’elles présente par son résumé un magnifique spectacle de nature, une prodigieuse histoire de travail. Chacune peut faire songer au long effort tramé par l’humanité depuis les temps que nous apercevons à peine éclairés, sur l’horizon en arrière de nous. Chacune peut nous donner à vivre des sensations d’espace, d’étendue, le sol terrestre, la nuit des mines, la masse d’eau et le fond de l’océan, le paysage fluide de l’air.
Entrons dans n’importe laquelle, la plus humble, la plus pauvre : ce sera toujours un chapitre touchant du récit sans fin du labeur de l’homme, un raccourci imprévu de l’immense univers.
Le premier rôle de la rue est à la boutique du boulanger, à son étalage de pains dorés mis en vitrine, en avant des rangées de pains de quatre livres. Regardez la femme du peuple rentrant chez elle avec son pain dans les bras, qu’elle emporte comme un enfant. C’est l’objet sacré entre tous. Les pommes de terre, les petits pois, les crêpes, les beignets, ne peuvent le suppléer. Le tabac même, que les fumeurs proclament le bien suprême, ne produit pas un mirage de fumée suffisant pour faire oublier la miche, humble et expressif symbole de l’existence. Nul n’est insensible aux souvenirs évoqués par l’aspect et l’odeur du pain. L’homme de la campagne venu à Paris ne saurait oublier le champ et la moisson, le moulin et la farine, le four et la huche. Pour l’homme de Paris, né à Paris, travaillant à Paris, s’il s’arrête et réfléchit devant la boutique du boulanger, l’histoire du grain de blé lui apparaît. C’est pour obtenir ce produit de nature, cette pousse du champ, cette miette de substance faite de la terre, de la sève, de la pluie, du soleil, qu’il a enfermé sa liberté entre les quatre murs d’une chambre, d’un bureau, d’un atelier.
Pour avoir à lui, tous les jours, et pour partager aux siens ce morceau de pain, que d’ennuis, que d’efforts, quel labeur toujours recommencé ! Quelle encre, toi, il te faut user, et combien de journées sans air ! Et toi, quelle fatigue de muscles, quels fardeaux, quelles pierres à remuer, dans quelle atmosphère de charbon, de poussière de cuivre, de limaille de fer, il te faut vivre !
Malgré les rues et les maisons enfumées, malgré l’air noir chargé de misère, le pain est tout de même blanc, et la chanson du meunier là-bas est toujours joyeuse. On le dit, du moins, mais qui sait ? Il faudrait y aller voir, et peut-être trouverait-on l’homme au grand chapeau, l’homme blême comme Pierrot, aussi triste que son frère, l’homme noir des usines, ou gai de la même façon résignée et moqueuse, acceptant le jour tel qu’il vient et le temps comme il est.
L’étal du boucher, avec ses bœufs rouges, ses veaux pâles, ses gigots présentés comme des bouquets, ne donne pas uniquement à songer à l’étendue des pâturages, aux champs verts sillonnés de ruisseaux d’argent, aux bondissements des bêtes, aux lentes promenades, aux immobilités ruminantes. On n’évoque pas seulement les landes tristes où bêlent les troupeaux, où surveille le chien, où se dresse la silhouette de songeux du berger en limousine. Dans la rue de grande ville, parmi les passants réguliers, ce qui s’affirme encore par la boutique aux arrangements symétriques, aux ornementations faites de quartiers de viandes, c’est la persistance de l’instinct carnassier de l’homme.
Les chasses de l’ancêtre, sa lutte farouche pour la subsistance, l’inquiétude grondante de sa faim à l’affût ; des cavernes, se perpétuent et aboutissent aux tablettes de marbre où s’amoncellent les morceaux de cadavres. Les ménagères s’empressent, soupèsent, hésitent, préfèrent, comme autrefois les femelles découpant la pitance et faisant les parts.
La voracité apparaît moins. Aucune des acheteuses ne pense même que ce sont là des débris d’animaux. Ces débris se sont transformés en objets nouveaux, en côtelettes, en beefsteaks, auxquels nulle idée de vie et de mort ne reste attachée. Dans ce charnier sanglant ouvert sur la rue, ne plane pas le souvenir de l’animal encore en mouvement la veille, qui soufflait si fort dans l’herbe, regardait de ses grands yeux incertains, avec dans sa grosse tête dure la stupeur d’une pensée naissante. La pauvre brute est là, pourtant, dépecée, et l’humanité ancienne est là aussi : le boucher au tablier sanglant, le couteau à la main, la femme qui choisit, qui marchande et qui ruse avec aussi rusé, et plus rusé, qu’elle !
De loin, le bureau de tabac arbore son signal ou allume sa flamme pour ses affiliés. Le jour, c’est la « carotte » qui signifie, non seulement, le tabac, mais parfois aussi le papier timbré et les cartes à jouer. Le soir, c’est la lanterne rouge qui troue toutes les obscurités et dont le feu sombre s’aperçoit parmi toutes les lumières. Les adeptes vont vers la carotte et la lanterne comme les croyants vers le tabernacle. Voici l’autel, servi par une prêtresse pénétrée de son sacerdoce, la dame qui ouvre les boîtes à cigares, distribue les paquets de cigarettes et le tabac pour la pipe, qui ramasse les miettes de tabac à priser avec une patte de lièvre.
Les fidèles sont nombreux. Toute la journée, toute la soirée, le défilé est presque ininterrompu. Aucune boutique de friandises n’est plus achalandée. Les cigares sont choisis, par les amateurs, comme des bonbons. Le fumeur de pipe bourre sa bouffarde d’un air sérieux, même soucieux, comme s’il craignait de ne pas la trouver si bonne que la dernière qu’il a fumée. À la première bouffée, sa face anxieuse se rassérène. Le priseur se sauve avec sa tabatière comme un voleur. Que viennent-ils donc tous demander au tabac, consciemment ou inconsciemment ? L’illusion fugitive et inconsistante, le rêve qui a la forme de la fumée, la vraie image de la vie.
Le soir surtout, elle brille de tous ses feux, sous les réflecteurs, elle illumine la chaussée.
Les colliers, les boucles d’oreilles, les bagues, l’or, l’argent, les rubis, les escarboucles, les topazes, les émeraudes, les diamants clairs, à profusion, resplendissent comme les feux du soleil, de la lune et des étoiles. C’est un firmament derrière la vitre, un amas de constellations en écrins. Toutes ces lueurs semblent vivre, frémir, appeler les passantes. Les colliers s’offrent aux gorges, la bague espère le doigt, les pierres précieuses dardent leurs rayons rouges, bleus ou dores, vers les oreilles roses, les chevelures blondes ou brunes. Car voici les passantes, visages contre la vitre, mains qui s’agitent et qui désignent, paroles fiévreuses qui choisissent. Marguerite est éternelle, toujours fera le geste vers les bijoux et le miroir.
Éternels aussi, l’homme qui séduit, le Méphisto qui conseille, le Faust qui attend. Regardez les fillettes traverser la rue, courir vers la vitrine magique, derrière laquelle brillent tous les trésors de l’univers.
Avez-vous parfois fait virer, au milieu d’un champ, le barbare et infaillible miroir aux alouettes ? Avez-vous vu les oiselets venir de tous les horizons vers les facettes brillantes et s’acharner, malgré les coups de fusil, au-dessus du piège mortel ?
La petite fruiterie, avec son étalage qui déborde, envahit le trottoir, est parfumée, le matin, au retour des Halles, des produits délicieux du verger et du potager. Depuis la fraise de mai jusqu’à la poire d’automne, tous les fruits s’y succèdent, en même temps que tous les légumes. Le jardin est souvent présent quand la fruitière ajoute quelques bouquets à son étalage, mais c’est presque un luxe inutile. Fruits et légumes ont des odeurs de fleurs en une variété stupéfiante à défier tous les produits des parfumeurs. C’est une harmonie où le goût des petits pois s’allie au goût des framboises, où la senteur de l’artichaut complète la senteur de la prune. Le monde paisible des choses règne délicieusement par les essences que distillent les arbres et les arbustes, les champs et les bords de ruisseaux, la terre et le fumier.
Ajoutez à la fruiterie ce qui y est souvent, le lait et le fromage, et toute la poésie de la nature fait son entrée, donne à voir les flancs de montagnes couverts d’herbe épaisse, fait entendre les sonnailles des vaches et la chanson des pâtres.
Tous les produits du sol ainsi rassemblés, quand la pomme d’Ève apparaît, la petite fruiterie est un résumé du paradis terrestre.
L’horloger, dans la boutique, fait table à part. Il est protégé des poussières par un paravent, et il travaille, sous le jour de la rue, la loupe vissée à l’œil, fouillant de ses doigts agiles dans les montres et les mouvements de pendules dont il est entouré. Autour de lui, il entend les petites chaînes qui grincent, les aiguilles qui marchent, oh ! si doucement ! qu’il est seul à percevoir leur mouvement. Il entend aussi les pendules qui sonnent, mais qui sonnent, hélas ! l’une après l’autre. Il a beau faire, comme Charles-Quint au monastère de Saint-Just, pour les accorder et les forcer à tinter ensemble, il croit avoir réussi, mais sitôt qu’il a quitté le cadran et la clef, tout se dérange, les mécanismes se hâtent ou s’attardent, les petites voix ironiques lui disent toutes, avec leurs timbres différents : Tu n’y arriveras pas !
Tel quel, l’horloger dans sa boîte ne donne-t-il pas à songer à un bon Dieu installé à son poste central et qui s’applique à faire marcher les mondes avec régularité. Il assigne les rendez-vous aux planètes, trace leurs chemins aux comètes, allume ou éteint les soleils. Tout semble bien ordonné, tous les corps célestes sont en place, tous les mouvements sont prévus. Mais le retard peut se produire, un ressort peut s’user et se détraquer. Alors, les aiguilles s’affolent, le cadran se lézarde, le mécanisme saute, et il y a de la poussière d’univers plein l’espace. Le bon Dieu recommence alors, comme l’horloger, à vouloir mettre les astres à l’heure.
Chez le charbonnier des villes, la vie ancienne et puissante de la terre apparaît. La petite boutique, longue, étroite, obscure, ouverte sur la rue bruyante, est aussi mystérieuse et parlante à l’esprit, qu’une excavation souterraine où l’homme pénétrerait tout à coup, se trouverait en présence du lent et continu phénomène de la transformation.
Ces amas sombres de houille, ces quartiers de rochers noirs, ces éclats brillants, illuminés d’un feu sombre, ces étincellements dans la nuit de la pierre, tout parle de l’éternelle existence des choses. Le végétal devenu minéral se manifeste par cette dureté et cette noirceur de matière. Les forêts se sont effondrées aux marécages. Le végétal, privé d’oxygène et de lumière, noyé, enfoui, décomposé, s’est changé en pierre. Les légères feuilles frissonnantes, les bourgeons près d’éclore, les branches parcourues de sève, tout s’est contracté, concentré, durci, est tombé au sommeil opaque des durs agrégats. Pourtant, la forêt est là, avec ses fleurs, ses insectes, ses oiseaux, ses parfums, ses chants, sa vie multicolore, sa lumière d’émeraude, ses scintillements de pierres précieuses, elle est là, dans ces fragments noirs, à l’odeur de bitume et de soufre.
Elle connaîtra encore la féerie du feu. Ce qui a déjà été consumé brûlera de nouveau. La houille, née du feuillage aérien, enfouie au sol, revivra la vie subtile et rapide de la flamme, la légère cendre retournera à la terre, aidera à refaire la feuille et la fleur.