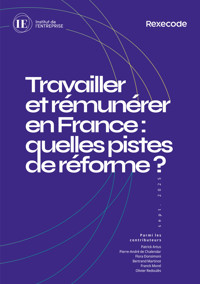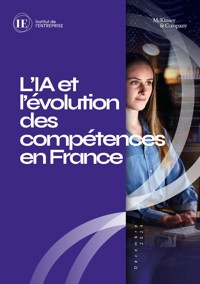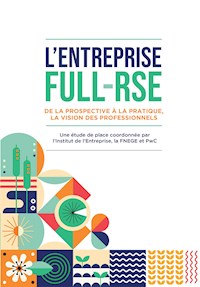Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
Créé en 1975, l’Institut de l’Entreprise est une association à but non lucratif réunissant une centaine d’entreprises de dimension multinationale mais fortement implantées en France.
L’Institut travaille à valoriser le rôle et la place de l’entreprise dans notre société à travers différents programmes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Sommaire
SYNTHÈSE
Repenser le TravailConcilier performance économique et bien-être au travail
Un travail en mutation
Le monde du travail connaît des évolutions profondes sous l’effet des transformations technologiques, sociétales et réglementaires. Télétravail, nouvelles formes d’organisation du travail, intelligence artificielle, évolution des statuts d’emploi, du rapport à l’emploi et à l’employeur, hausse de l’absentéisme et des risques psycho-sociaux. Toutes ces dimensions évoluent en fonction des générations, du territoire, de la taille de l’entreprise. Ces facteurs et leurs conséquences s’interpénètrent et ne se sont pas encore stabilisés. Il convient de les analyser, d’anticiper leurs effets et d’agir pour accompagner ces changements afin de maintenir l’engagement collectif et le sens au travail.
L’Institut de l’Entreprise, à travers les Entretiens du travail, a réuni dirigeants, experts et praticiens pour analyser ces mutations et proposer des solutions adaptées. L’objectif : repenser le travail pour concilier performance économique et bien-être au travail.
Quatre axes majeurs ont fait l’objet de propositions, couvrant la réforme du droit du travail, le dialogue social, le partage de la valeur et la formation tout au long de la vie. Elles dessinent une feuille de route cohérente, visant à renforcer l’agilité des entreprises tout en garantissant des protections adaptées aux nouvelles réalités professionnelles.
Rénover le droit du travail
Si les réformes des dernières décennies ont permis des évolutions significatives, le droit du travail demeure souvent perçu comme un frein à la flexibilité et à l’impératif d’adaptation des entreprises aux mutations.
Pour mieux répondre aux besoins des entreprises et aux aspirations des travailleurs, plusieurs orientations sont préconisées :
—Renforcer le rôle de l’accord d’entreprise pour en faire la pierre angulaire du droit du travail ;
—Libérer le temps de travail en simplifiant et sécurisant son régime (forfait jour, temps partiel, horaires individualisés) ;
—Favoriser l’emploi des travailleurs expérimentés pour en faire une cause majeure ;
—Faire émerger un statut du travailleur en accordant des garanties minimales et des droits portables à tous les travailleurs quel que soit leur statut.
Ces mesures visent à rendre le droit du travail plus modulable et plus adapté à la situation des entreprises, aux mutations du marché et aux aspirations des salariés.
Renforcer le rôle des acteurs de proximité pour un dialogue social efficace
Le dialogue social est un levier clé pour anticiper les mutations du travail et garantir un climat social apaisé.
Pourtant, il reste souvent perçu comme une contrainte plutôt que comme un outil de transformation. Pour le rendre plus efficace :
—Renforcer les compétences des représentants syndicaux et des managers de proximité, en leur offrant des formations adaptées ;
—Prioriser les négociations collectives sur les sujets stratégiques, en évitant les renégociations systématiques sur des accords déjà conclus ;
—Encourager un dialogue de proximité, notamment en redéfinissant le rôle des représentants locaux.
Ces mesures visent à réconcilier dialogue social et performance, en instaurant des discussions constructives et ciblées.
Partager la valeur avec les outils actuels étendus à tous
Le partage de la valeur au sein des entreprises est un enjeu central pour motiver les salariés et renforcer la cohésion sociale. Si des dispositifs existent déjà (intéressement, participation, etc.), leur application reste inégale, notamment dans les PME et TPE.
Les propositions avancées cherchent à démocratiser ces outils et à mieux les adapter aux évolutions économiques :
—Stabiliser le cadre réglementaire existant tout en évaluant les effets des réformes récentes avant d’éventuelles nouvelles modifications ;
—Encourager le partage de la valeur dans les plus petites entreprises, en leur offrant des incitations spécifiques ;
—Améliorer la transparence et la communication sur ces dispositifs, pour mieux informer salariés et employeurs.
L’objectif est de créer un modèle équilibré où la réussite de l’entreprise bénéficie à l’ensemble des parties prenantes.
Former, développer et accompagner tout au long de la vie
Dans un contexte où les métiers évoluent rapidement, il devient essentiel de repenser la formation initiale et continue pour mieux répondre aux besoins du marché du travail. Les propositions mettent l’accent sur quatre priorités :
—Renforcer les liens entre école et entreprise en intégrant davantage les entreprises dans les parcours éducatifs (« bureaux des entreprises », stages d’enseignants, mentorat, immersion professionnelle) ;
—Mobiliser les moyens publics et privés nécessaires à une mise en œuvre efficace de la réforme du lycée professionnel annoncée en septembre 2023 (notamment les « options complémentaires ») ;
—Revaloriser les filières techniques et professionnelles, souvent perçues à tort comme des voies de second choix
—Simplifier l’accès à la formation continue et renforcer son adéquation avec les besoins des entreprises en créant un guichet unique et en assouplissant les critères d’éligibilité des certifications.
L’enjeu est double : donner aux jeunes des perspectives claires et permettre aux travailleurs de s’adapter tout au long de leur carrière.
Un projet global pour un travail réinventé
Les propositions issues des Entretiens du travail ne sont pas une juxtaposition de mesures isolées, mais traduisent bien une vision cohérente et ambitieuse. Elles reposent sur trois principes directeurs :
—Simplifier les règles pour offrir plus d’agilité aux entreprises et aux travailleurs ;
—Adapter le cadre du travail aux nouvelles attentes des salariés et aux évolutions technologiques ;
—Anticiper les mutations du marché pour garantir un emploi durable et inclusif.
Ces recommandations ne constituent pas une fin en soi, mais un point de départ pour un dialogue ouvert entre entreprises, pouvoirs publics et partenaires sociaux. À travers cette démarche, l’Institut de l’Entreprise souhaite faire émerger un modèle de travail plus équilibré, où performance et qualité de vie vont de pair.
Le défi est immense, mais la conviction partagée est claire : un travail repensé est un levier essentiel pour la prospérité collective.
Gouvernance et liste des participants
Présidence
•Pierre-André de Chalendar, président de l’Institut de l’Entreprise et président d’honneur de Saint-Gobain
•Laurent Marquet de Vasselot, directeur général, CMS Francis Lefebvre
Comité stratégique
•Godefroy de Bentzmann, co-fondateur, Devoteam
•Béatrice Kosowski, présidente, IBM France
•Estelle Sauvat, directrice générale, Groupe Alpha
•Christian Schmidt de La Brélie, directeur général, Klesia
Membres des groupes de travail
• Jonathan Amar, dirigeant, Deletec
•Jean-Marc Borello, président, GROUPE SOS
•Marc Bouron, directeur général adjoint, Vinci Autoroutes
•Pierre-André de Chalendar, président d’honneur, Saint Gobain et président de l’Institut de l’Entreprise
•Anne Chaminade, directrice Formation et Compétences, SNCF
•Pierre Coppey, directeur général adjoint, Vinci
•Thierry Déau, directeur général, Meridiam
•Véronique Di Benedetto, vice-présidente, Econocom
•Philippe Dorge, directeur général adjoint, La Poste
•Diane Dufoix-Garnier, directrice des Affaires publiques, IBM France
•Myriam El Khomri, directrice du Conseil et de la Stratégie RSE, Diot-Siaci
•Virginie Fauvel, CEO, Harvest
•Aurélie Feld, présidente, LHH France
•Laurent Gasse, directeur des Ressources humaines, Groupe ADP
•Daniel Harari, président-directeur général, Lectra
•Vincent Harel, président, Mercer France
•Véronique Lacour, directeur exécutif groupe - Transformation et Efficacité opérationnelle, EDF
•Mathilde Le Coz, directrice des Ressources humaines, Forvis Mazars en France
•Helman Le Pas de Sécheval, secrétaire général, Veolia
•Emmanuelle Malecaze-Doublet, directrice générale, PMU
•Soumia Malimbaum, présidente, CCI Paris
•Hervé Navellou, président France, L’Oréal
•Martine Nicolas, directrice des Relations et de l’Innovation sociales du groupe, L’Oréal
•Cécile Pasdeloup, directrice du Développement RH du groupe, La Poste
•Caroline Parot, directrice générale, Technicolor
•Carine Penigault, directrice des Ressources humaines, Rexel France
•Augustin de Romanet, président-directeur général, Groupe ADP
•Olivier Ruthardt, directeur général adjoint, en charge des Ressources humaines, de l’Environnement du travail, de l’Organisation et de l’Expérience collaborateur, Malakoff Humanis
•Valérie Sagnol, directrice Politiques industrielles et Performance sociale, SNCF
•Florence Sautejeau, déléguée générale de l’Union des Transports Publics et Ferroviaires
•François de Saint-Pierre, associé-gérant, Lazard Frères Gestion
•Jean-Dominique Senard, président du Conseil d’administration, Renault Group
•Jérôme Sennelier, directeur général, Monceau Assurances
•Liliane Spiridon, directeur général Human Capital, Aon France
•Arnaud Tirmarche, directeur général, SPIE France
•Jean-Roch Varon, président, EY France
•Pierre de Villeneuve, partner Human Capital, Deloitte
•Alexandre Viros, président, Dialogues
Équipe de l’Institut de l’Entreprise
•Flora Donsimoni, directrice générale
•Pierre-étienne de la Rochefoucauld, directeur des Études
•Nathalie Garroux, responsable de l’Agora
Remerciements
•Samuel Monteil, rapporteur des débats
Liste des propositions
Rénover le droit du travail
Renforcer le rôle de l’accord d’entreprise
— Renforcer le rôle de l’accord d’entreprise pour en faire la pierre angulaire du droit du travail et rendre la loi supplétive de la volonté des parties ;
— Faciliter la conclusion des accords d’entreprise en favorisant leur ratification à la majorité des salariés ;
— Rendre possible la négociation d’entreprise indifféremment avec des élus ou des salariés dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.
Libérer le temps de travail (horaires individualisés, temps partiel assoupli, aménagement du forfait jour)
— Faciliter la mise en place d’horaires individualisés, en supprimant l’exigence d’un avis conforme du CSE ou de l’inspection du travail ;
— Redéfinir et assouplir le régime du temps partiel pour mieux répondre aux besoins des salariés et des entreprises ;
— Aménager le régime du forfait jour pour le sécuriser.
Favoriser l’emploi des travailleurs expérimentés en renforçant le contrat de valorisation de l’expérience
— Faire de l’emploi des salariés expérimentés une cause majeure par la mobilisation des pouvoirs publics et des entreprises ;
— Renforcer l’attractivité du futur contrat de valorisation de l’expérience pour améliorer le retour à l’emploi et renforcer l’incitation à bénéficier du régime de la retraite progressive pour favoriser le maintien dans l’emploi ;
— Procéder à une évaluation du coût économique et social des maladies chroniquesliées aux départs anticipés.
Faire émerger un statut du travailleur : garanties et portabilité des droits pour tous
— Mettre en place un socle de garanties minimales applicables à tous les travailleurs (y compris les indépendants) ;
— Assurer la portabilité des droits sociaux pour tous tout au long de la carrière. Applicable à tous les travailleurs, quel que soit leur statut.
Renforcer le rôle des acteurs de proximité pour un dialogue social efficace
Repenser/Repanser la confiance autour du dialogue social
— Promouvoir une montée en compétences des élus syndicaux et des managers de proximité ;
— Investir dans une meilleure qualité d’anticipation des grandes transformations de l’entreprise, en traitant en concertation leurs conséquences ;
— Sécuriser l’engagement des élus syndicaux dans leurs mandats, en supprimant la limitation à trois mandats pour éviter la fuite des talents représentatifs, comme dans leurs droits et devoirs.
Mieux voir et mieux détecter les situations individuelles
— Redéfinir les missions des représentants de proximité pour garantir leur rôle de relais entre les salariés et la direction ;
— Instaurer un dialogue professionnel de proximité en créant des espaces d’échange directs entre salariés et encadrement.
Rendre plus vertueux le dialogue social dans une logique d’efficacité accrue et d’exigence réciproque
— Prioriser les thèmes de la négociation collective sur les sujets les plus importants pour l’entreprise en priorisant les négociations sur les transformations stratégiques et en remaniant l’agenda social pour limiter la renégociation automatique des accords et se concentrer sur des améliorations concrètes ;
— Encourager les entreprises vertueuses en matière de dialogue social via un système d’incitations et de valorisation.
Partager la valeur avec les outils actuels étendus à tous
Assurer la stabilité du cadre existant, en faisant une « pause normative » pour permettre aux entreprises de bien s’approprier le nouveau cadre en place
— Maintenir un statu quo en matière de réglementation sur le partage de la valeur, afin de tirer les enseignements des réformes passées.
Démocratiser le partage de la valeur, y compris dans les TPE et PME, en poursuivant les travaux de la loi de 2023 et en communiquant autour de ce qu’elle permet
— Inciter les TPE de moins de 11 salariés à négocier des accords de partage de la valeur.
Communiquer et renforcer la connaissance autour des dispositifs existants, y compris pour les ETI et les grands groupes
— Renforcer l’éducation financière du grand public tant en formation initiale que continue ;
— Renforcer la connaissance des entreprises sur ce qui est fait, peut être fait, ou doit être fait en matière de partage de la valeur ;
— Mieux mobiliser l’écosystème des organisations patronales pour diffuser la connaissance sur ces dispositifs.
Former, développer et accompagner tout au long de la vie
Rapprocher école et entreprise pour renforcer la connaissance du milieu entrepreneurial et développer des vocations
— Généraliser les « bureaux des entreprises » dans les lycées professionnels et instaurer la possibilité de les étendre aux lycées généraux ;
— Lancer un grand plan « les entreprises pour l’école » associant ministère de l’éducation nationale, collectivités territoriales et entreprises ;
— Produire un guide à destination des entreprises pour les stages de 3e et 2de ;
— Organiser des stages ou visites d’entreprises pour les enseignants et les parents.
Revaloriser les filières professionnelles et techniques en promouvant leur image et les compétences qu’elles apportent
— Faire évoluer le vocabulaire employé dans la communication interne et externe des entreprises et des pouvoirs publics ;
— Développer des actions de communication spécifiques visant à mettre en valeur certaines filières.
Renforcer l’adéquation entre demande de compétences de la part des entreprises et offre de formation
— Simplifier les dispositifs de formation continue en assouplissant l’inscription au RNCP de nouvelles certifications ;
— Promouvoir les expérimentations en matière de formation continue ;
— Mettre en place un guichet unique de la formation continue.
L’anticipation des métiers : un levier stratégique pour aligner compétences et besoins économiques
— Créer un observatoire dynamique des métiers, accessible à tous, pour faciliter les choix d’orientation et de formation et développer grâce à l’IA des outils numériques de diagnostic personnalisé de l’employabilité, permettant à chacun d’évaluer ses perspectives d’évolution sur le marché du travail.
Renforcer la diversité et l’inclusion de tous les talents dans l’entreprise
— Mieux intégrer les seniors et valoriser leurs compétences ;
— Promouvoir une politique active de diversité au sein de l’entreprise.
Introduction
Pourquoi travaillons-nous ? Le simple fait de poser cette question avait, il y a quelques années encore, un caractère incongru. Qu’on l’ait considéré comme le simple moyen de subvenir à ses besoins ou comme un vecteur d’épanouissement et de réalisation de soi, le travail constituait une forme d’horizon indépassable de la vie sociale et, disons-le, un point central de toute existence individuelle.
Cette question, nous sommes pourtant de plus en plus nombreux à nous la poser. Dans un récent sondage1, 21 % des Français interrogés considéraient leur travail comme « très important », un chiffre qui, s’il ne dit rien à lui seul, interpelle dès lors qu’on prend la peine de se souvenir qu’en 1990, leurs parents étaient quant à eux 60 % à opter pour cette réponse. Il en va de même pour l’accès à des postes à responsabilité, hier encore choisi et désiré comme une marque de réussite personnelle, il fait désormais, et de plus en plus souvent, figure de repoussoir : une seconde étude2, réalisée quant à elle en 2023, révélait ainsi que 51 % des managers interrogés s’estimaient prêts à renoncer à leurs responsabilités hiérarchiques, 21 % d’entre eux, souvent les plus jeunes, allant jusqu’à se déclarer « très intéressés » par cette perspective.
21% des Français considèrent leur travail comme « très important » ; ils étaient 60% en 1990
Que s’est-il donc passé en à peine une génération ?
Il est tentant ici de commencer par le plus récent, c’est-à-dire la pandémie de Covid-19, laquelle aura incontestablement secoué nombre de nos certitudes, tout en remettant au premier plan de l’attention publique la question du sens attaché au travail. Pour ce qui nous concerne, nous y voyons d’abord le signe d’une attente. À rebours de ceux qui voient se nouer au cœur de notre société une fracture irréductible entre partisans de la valeur travail et tenants du droit à l’inactivité, la dernière édition du Baromètre de la confiance politique, réalisée par le CEVIPOF en partenariat avec l’Institut de l’Entreprise, nous a permis de mesurer l’importance des attentes que les Français continuent à placer dans leurs entreprises. Interrogés