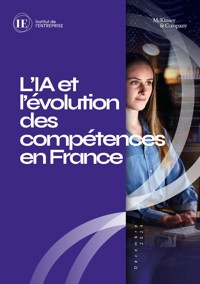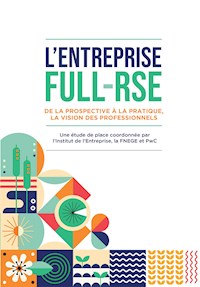Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
La revue Sociétal a pour vocation de proposer des réflexions qui s’inscrivent dans le temps long. La thématique du présent opus a été décidée en octobre 2024 et les articles publiés ont été rédigés avant la prise de nouvelles décisions économiques et commerciales par l’administration américaine. Par conséquent, certaines analyses, données ou conclusions pourraient être remises en cause ou nécessiter des mises à jour à la lumière des évolutions récentes en matière de politique commerciale internationale. Nous encourageons ainsi les lecteurs à confronter ces contenus aux développements récents afin d’en apprécier toute la portée.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
à propos de Sociétal
Créé en 1996, sous l’impulsion de l’économiste Albert Merlin et l’inspiration de Bertrand de Jouvenel, Sociétal est la revue de l’Institut de l’Entreprise, qui a pour vocation d’analyser les grands enjeux économiques et sociaux en rassemblant des réflexions d’universitaires, de praticiens de l’entreprise et de dirigeants.
Il poursuit un triple objectif :
1.Proposer les meilleurs décryptages des enjeux de l’économie et de la société, présents et à venir ;
2.Permettre des échanges nourris entre les mondes académiques et de l’entreprise ;
3.Faire progresser dans le débat public la compréhension d’une économie de marché équilibrée et pragmatique.
Aujourd’hui Sociétal nourrit la mission de l’Institut de l’Entreprise, mieux comprendre et valoriser le rôle de l’entreprise au cœur de la société ; et contribue à sa raison d’être : rapprocher les Français de l’entreprise.
Les opinions exprimées dans la présente publication sont celles des auteurs. Elles ne prétendent pas refléter les positions de l’Institut de l’Entreprise ou de ses adhérents.
La revue Sociétal a pour vocation de proposer des réflexions qui s’inscrivent dans le temps long. La thématique du présent opus a été décidée en octobre 2024 et les articles publiés ont été rédigés avant la prise de nouvelles décisions économiques et commerciales par l’administration américaine. Par conséquent, certaines analyses, données ou conclusions pourraient être remises en cause ou nécessiter des mises à jour à la lumière des évolutions récentes en matière de politique commerciale internationale.
Nous encourageons ainsi les lecteurs à confronter ces contenus aux développements récents afin d’en apprécier toute la portée.
Comité éditorial
Président
Jean-Marc Daniel
Comité
Michel Pébereau
président d’honneur de l’Institut de l’Entreprise et membre de l’Académie des sciences morales et politiques
Hippolyte d’Albis
professeur à l’École d’économie de Paris
Emmanuel Cugny
président de l’AJEF
Flora Donsimoni
directrice générale de l’Institut de l’Entreprise et directrice de la rédaction
Vincenzo Esposito Vinzi
directeur général de l’ESSEC
Louis Lalanne
président de Meet My Mentor et de Connexio
Laurent Marquet de Vasselot
directeur général de CMS Francis Lefebvre
Jean-Luc Placet
administrateur indépendant
Philippe Plassart
vice-président de l’AJEF,rédacteur en chef au Nouvel économiste
Nicolas Tcheng
responsable relations institutionnelles,Projets stratégiques France de Renault Group
Jean-Marc Vittori
éditorialiste, Les Échos
équipe
Pierre-Étienne de La Rochefoucauld
directeur des Études de l’Institut de l’Entreprise
Nathalie Garroux
responsable de l’Agora de l’Institut de l’Entreprise
édito
« Il y a des semaines où des décennies se produisent. » Ces mots, souvent attribués à Lénine, ont retrouvé en 2025 une actualité pour le moins spectaculaire.
Cette fois, pourtant, c’est de l’Ouest que souffle le vent. Alors même que l’Organisation mondiale du commerce fêtait placidement son trentième anniversaire, le retour à la Maison Blanche de Donald Trump a marqué les trois coups d’une ère de radicalité et plus encore d’imprévisibilité économiques. Des décennies de politique internationale se trouvent désormais brutalement revisitées, parfois en l’espace d’à peine quelques heures, aller, retour et temps d’escale compris.
Quoi qu’on puisse penser du personnage ou de sa politique, la lucidité commande cependant de reconnaître que les orientations programmatiques du président Trump, loin de tomber du ciel, plongent en réalité leurs racines dans un sol rendu fertile bien avant lui, et que ses prédécesseurs démocrates avaient eux-mêmes labouré en leur temps, avec d’autres outils. Le président Macron ne l’avait-il pas déclaré lui-même ? Depuis 2022 et l’Inflation Reduction Act de Joe Biden, les deux premières économies mondiales, comprenez les États-Unis et la Chine, se sont, de fait, affranchies des règles de l’OMC.
L’idée de libre-échange a-t-elle dès lors encore un avenir ? Je veux croire que c’est à nous, Européens, qu’il reviendra d’en décider sans pour autant céder à la naïveté. Si les semaines et les mois qui viennent constitueront, à n’en pas douter, un nouveau test grandeur nature pour la capacité des Vingt-sept à maintenir leur cohésion, la manière dont l’Europe parviendra à se positionner face à l’administration américaine s’annonce décisive pour l’avenir d’une idée dont nous sommes désormais bien peu à nous revendiquer.
Car ce débat n’est pas tranché. À ceux qui, à Washington, considèrent désormais le commerce international comme un jeu à somme nulle, la théorie économique oppose un principe selon lequel le libre-échange profite en réalité à l’ensemble de ceux qui le pratiquent. Les chiffres sont aussi là pour en attester : en quelques décennies, ce sont à l’échelle mondiale plus d’un milliard d’hommes et de femmes qui sont sortis de la grande pauvreté du fait de la libéralisation des échanges. Il demeure pourtant que si cette politique profite à tous, tous n’en retirent pas les mêmes gains. De ce simple fait, le libre-échange bouscule et transforme les équilibres, entre les nations, entre les territoires, les secteurs et les acteurs d’une même économie et il va parfois jusqu’à faire naître un conflit entre le travailleur et le consommateur que nous sommes, chacun, à tour de rôle. Il lui faut donc uncadre, des règles et un arbitre mais aussi des formes de redistribution entre ceux qui ont le plus et le moins à y gagner.
C’est désormais une évidence, les outils d’hier ne suffiront pas pour construire demain et l’Europe se devra, elle aussi, d’évoluer vers plus de pragmatisme, dans la négociation comme dans l’application des accords commerciaux. Il lui faudra aussi, alors que les mots d’« autonomie stratégique » semblent avoir retrouvé leurs lettres de noblesse, accepter de changer d’échelle en termes de politique industrielle. Ce débat, plus utile sans doute que rarement par le passé, les contributeurs de ce nouveau numéro de Sociétal ont accepté de le mener sur un terrain, nous l’évoquions, en proie à de très vives secousses, où décisions comme analyses peuvent se trouver démenties en moins de temps qu’il n’en faut pour livrer sa pensée en 280 signes. Qu’ils en soient ici une nouvelle fois remerciés.
Ensemble, ils dressent un premier état des lieux des défis etdes risques de ce monde nouveau que nos entreprises doivent à présent explorer et maîtriser. Dans le prolongement du rapport Draghi, ils en identifient aussi les possibilités, certaines ne sont rien de moins qu’historiques pour l’Europe.
Saisissons-les, avant que d’autres ne s’en emparent !
Pierre-André de Chalendar,
président de l’Institut de l’Entreprise
Sommaire
Sociétal | Libre-échange
Édito
Pierre-André de Chalendar
Le regard de...
Jean-Marc Daniel
Dossier statistiquesDéficit extérieur
Jean-Marc Daniel
Le grand témoin
Pascal Lamy
01
Définition et perspectives
Le libre-échange à l’épreuve de l’histoire de nations européennes
Francis Démier
Le libre-échange selon Jean-Baptiste Say : une leçon oubliée
François de Saint-Pierre
“Doux commerce”, la fin d’une illusion ?
Sébastien Jean
Le retour du protectionnisme
Lionel Fontagné
L’Europe est-elle toujours l’idiot du village global ?
Hubert Védrine
Comprendre et anticiper l’agenda et la politique de Donal Trump sur le commerce : décryptage, dénis, contre-pouvoirs, évolutions à court et moyen terme
Renaud Lassus
Pour une vision pragmatique du multilatéralisme économique
Philippe Varin
02
Biens et services
Ouverture économique et autonomie stratégique ?
Mathias Fekl
Massives ruptures à venir dans les grands équilibres socio-économiques mondiaux
Clarisse Magnin
Nous ne reviendrons pas au libre-échange total et à la mondialisation heureuse des années 90
Gianmarco Monsellato
L’aventure internationale de L’Oréal
Fabrice Megarbane
Les douanes, une administration au cœur du commerce international
Florian Colas
Le commerce international est une matière vivante. Son modèle s’est déjà déformé à de multiples reprises et va sans doute se transformer à nouveau
Marie-Christine Lombard
La logistique : un pilier stratégique essentiel de l’économie mondiale
Anne-Marie Idrac
03
Capitaux
Au secours, le protectionnisme revient !
Christian de Boissieu
Les enjeux de la circulation des capitaux
Philippe d’Arvisenet
La mondialisation “aboie”, les capitaux passeront-ils ?
Hervé Goulletquer
La banque, alliée indispensable des entreprises pour faire face à la fragmentation du monde
Yannick Jung & Jean-Baptiste Giros
La fin du libre-échange ?
Antoine Bouët
La taxe Tobin : une idée simple pour un monde complexe
Gunther Capelle-Blancard
Le regard de
Jean-Marc Daniel
Président de Sociétal
Indispensablelibre-échange
Biographie
Économiste français, professeur émérite à l’ESCP Business School et président de Sociétal. Il se décrit comme étant un libéral classique. Jean-Marc Daniel est chevalier de la Légion d’honneur et titulaire du prix Zerili-Marimo de l’Académie des sciences morales et politiques.
De nos jours, dans le débat public, la défense du libre-échange passe pour incongrue. Elle est stigmatisée comme la traduction d’une incommensurable naïveté, même si les excès du président des États-Unis et la vitesse à laquelle il se renie commencent à montrer les limites, pour ne pas dire les impasses, du protectionnisme. Et donc dans le discours dominant de la classe politique en France, la lucidité est assimilée à des votes contre les traités commerciaux, comme, par exemple, très récemment, celui du Sénat contre le traité CETA avec le Canada ou celui de l’Assemblé nationale contre le traité de libre-échange avec les pays du Mercosur.
Cette situation n’est certes pas nouvelle. En 1863, Michel Chevalier, professeur d’économie au Collège de France et signataire, le 23 janvier 1860, du traité libéralisant le commerce entre la France et le Royaume-Uni, débat avec Victor Cousin. Celui-ci, qui est considéré comme le philosophe français le plus en vue du moment, se présente comme un partisan du libéralisme, du moins sur le plan politique.
Il clôt le débat par une formule devenue célèbre :
« Je comprends qu’un économiste soit partisan du libre-échange, mais un patriote se doit d’être pour la protection » !
Dans cette phrase, ce qui reste incontestable, c’est l’opposition construite et affirmée du monde de la science économique au protectionnisme. C’est ainsi qu’il y a deux cents ans, en 1825, l’université d’Oxford décidait de créer ce qui allait devenir le premier cours d’économie de l’histoire rattaché à un cursus universitaire diplômant. Le premier professeur officiel d’économie a donc été un Anglais du nom de William Nassau Senior, un disciple de David Ricardo, le théoricien connu et reconnu des bienfaits du libre-échange au tra-vers de sa théorie des avantages comparatifs. Senior commença sa toute première leçon qui, eu égard aux lenteurs administratives, n’eut lieu effectivement qu’en décembre 1826, en déclarant :
« Nul n’est économiste s’il est protectionniste. »
Senior, qui vivait dans un monde profondément protectionniste et dont les dirigeants n’hésitaient pas à se déclarer comme tels, ne les accusait pas d’incompétence ou de stupidité. Il disait simplement que l’économiste établit que le libre-échange, en augmentant la concurrence et donc en faisant baisser les prix, améliore le pouvoir d’achat de tous alors que le protectionnisme avantage certains secteurs et leur permet d’accumuler des revenus indus sous forme de rentes. L’économiste conçoit les politiques qui améliorent la situation globale de la population. Le protectionniste, à l’opposé, choisit de favoriser une partie de la population au détriment de l’autre, choix qui, n’étant pas justifiable économiquement, trouve d’autres explications — politiques, éthiques ou religieuses.
La France ne souffre pas d’une concurrence internationale déloyale mais d’une demande excessive par rapport à sa production
Plus près de nous, en septembre 2001, James Tobin, dont on peut rappeler qu’il a obtenu le prix Nobel d’économie en 1981, accorde une interview à la presse allemande. Il est indigné par le dévoiement de ses travaux sur la taxation des flux financiers par une extrême-gauche violente qui se proclame altermondialiste. James Tobin précise : « Les militants antimondialistes détournent mon nom. Je n’ai pas le moindre point commun avec ces casseurs de carreaux. Je suis un partisan du libre commerce. »
Il complète son analyse en indiquant qu’un des grands problèmes des politiques économiques vient de ce que, alors que les économistes sont quasi unanimement favorables au libre-échange, les hommes politiques, eux, sont quasi unanimement protectionnistes…
Quant aux rapports plus spécifiques avec la Chine, devenue aujourd’hui non seulement pour les États-Unis de Donald Trump mais encore pour bien des dirigeants européens le symbole de la duplicité commerciale, il faut se souvenir qu’en inventant l’expression de « péril jaune », certains intellectuels du XIXe siècle finissant réclamaient déjà des mesures de protection contre elle. L’écrivain Paul Bourget résumait ainsi les arguments en faveur de droits de douane élevés sur les produits chinois : « L’ouvrier à 5 sous est naturellement vainqueur de l’ouvrier à 5 francs », sachant que l’ouvrier à 5 sous était chinois et celui à 5 francs français.
Commentant cette phrase, l’économiste Jacques Novicow insistait sur les bienfaits du commerce avec la Chine : « Le bon marché du salaire asiatique a pour résultat une diminution du prix des produits. Or tous les hommes, dans la pratique journalière, affirment à l’unisson que le bon marché est un bien et la cherté un mal. Les doctrinaires et les pessimistes seuls ne sont pas de cet avis. »
Bien que les propos de Novicow restent pertinents, nos dirigeants ne cessent de dénoncer la « concurrence déloyale » chinoise. Ils refusent d’admettre le constat selon lequel l’adhésion de la Chine à l’OMC (l’Organisation mondiale du commerce) a apporté chaque année à chaque ménage français un pouvoir d’achat supplémentaire d’environ 1 000 euros. Quant au bilan en termes d’emplois de cette adhésion qui exigerait selon eux des actions protectionnistes, il est facile de voir que les nouveaux débouchés qui en sont issus ont largement compensé les pertes dues au surcroît de concurrence. En effet, in fine, la suppression nette d’emplois est évaluée à environ cent mille, et ce compte non tenu de ceux créés par ailleurs grâce à l’augmentation du pouvoir d’achat.
Il serait temps de comprendre que les thèses à la Victor Cousin ou à la Paul Bourget, pour séduisantes qu’elles soient sur le plan littéraire, sont fallacieuses. En avril 2017, vingt-cinq Prix Nobel d’économie rappelaient la nocivité de ces thèses déjà portées par un Donald Trump nouvellement élu en écrivant :
« Les politiques isolationnistes et protectionnistes et les dévaluations compétitives, toutes menées au détriment des autres pays, sont de dangereux moyens d’essayer de générer de la croissance. »
Détenir des matières premières rares et stratégiques, avoir une population bien formée, disposer d’ingénieurs de haut niveau, avoir une population jeune, avoir une épargne bien placée : autant d’atouts pour un pays dans la mondialisation qui s’annonce.
En fait, concernant la France, ce que dit la réflexion économique, c’est qu’elle ne souffre pas d’une concurrence internationale déloyale mais d’une demande excessive par rapport à sa production. C’est pour cela qu’elle accumule des déficits extérieurs dont la conséquence la plus immédiate est un transfert de moyens financiers à ses fournisseurs et plus généralement au reste du monde ; c’est-à-dire que, comme elle ne parvient pas à vendre assez pour couvrir le coût de ses importations, elle se vend, ses partenaires commerciaux utilisant le produit de leurs ventes réalisées sur son territoire pour acheter son patrimoine. L’avoir extérieur net de la France, c’est-à-dire la différence entre la valeur de ce que les Français détiennent à l’étranger et celle de ce que les étrangers détiennent en France, ne cesse de se détériorer.
Nos dirigeants qui usent et abusent de deux mots — « souveraineté » et « attractivité » — pour justifier leur politique économique extérieure devraient réfléchir pour mieux évaluer ce que la mondialisation nous a apporté et nous préparer au monde qui vient dont les problèmes ne se résoudront pas par le repli protectionniste. Depuis Ricardo et Senior, les avantages comparatifs ont évolué.
Détenir des matières premières rares et stratégiques, avoir une population bien formée, disposer d’ingénieurs de haut niveau, avoir une population jeune, avoir une épargne bien placée : autant d’atouts pour un pays dans la mondialisation qui s’annonce.
Dossier
Statistiques
réalisé par Jean-Marc Daniel
déficit extérieur...
Quand on analyse les positions fluctuantes du président des États-Unis sur le libre-échange et l’instauration de droits de douane exorbitants, ce serait une erreur de se réfugier dans le langage de la folie à son sujet. En effet, si, sur la forme, sa politique erratique permet de douter de ses intentions et de la cohérence de ses idées ; sur le fond, il soulève un véritable problème : celui du déficit récurrent de la balance des paiements courants des États-Unis.
Il avoisine, au printemps 2025, 1 200 milliards de dollars, au point que les États-Unis surclassent tous les autres pays en la matière. En 2023, leur déficit était de 900 milliards de dollars quand celui des autres pays déficitaires se montait, par exemple, à 75 milliards de dollars pour le Royaume-Uni. L’économie américaine, souvent présentée comme un modèle de performance et d’efficacité productive, vit largement au-dessus de ses moyens du fait notamment d’un déficit budgétaire hors de contrôle.
ce qui assure un revenu aux Américains, ce sont moins les résultats de la Silicon Valley que les quelque 2 500 milliards de dollars de déficit public. Chaque année, pour assurer son train de vie et maintenir un budget militaire de 900 milliards de dollars, l’Amérique emprunte frénétiquement. Elle convertit ce pouvoir d’achat artificiel en importations qui accumulent les dollars chez ses fournisseurs. Ces dollars leur servent à acheter la bourse américaine, l’immobilier de New York ou la dette fédérale.
Celle-ci, qui représente à elle seule 40 % de la dette publique mondiale, rapporte tous les ans 230 milliards de dollars d’intérêt à des investisseurs non américains.
C’est ce que le vice-président J.D. Vance a résumé en déclarant que Washington empruntait l’argent des « paysans chinois » pour leur acheter ensuite le fruit de leur travail. Si les dirigeants chinois ont jugé bon de rappeler que la Chine est désormais plus une nation industrielle qu’un pays rural, il n’en reste pas moins que Vance a décrit la réalité de l’économie mondiale, celle d’une économie totalement déséquilibrée.
La mondialisation, qui a permis une véritable explosion du volume des échanges internationaux — explosion qui a favorisé la croissance mondiale et a sorti des pays comme la Chine de la misère — a fait l’impasse sur ce qui est désormais un problème majeur, à savoir l’incapacité du système de changes flottants en vigueur depuis 1973 de garantir l’équilibre des comptes extérieurs des principales puissances économiques.
Cette incapacité menace le libre-échange dans la mesure où celui-ci est associé de façon fallacieuse par Washington à son déficit extérieur et à la vente progressive de son patrimoine national à ses partenaires commerciaux.
Défendre le libre-échange comme nous le faisons dans ce numéro de Sociétal, c’est faire le double con-stat de ses mérites au travers des statistiques de développement du commerce international et de la menace qui pèse sur lui au travers du déséquilibre mondial des paiements. Faire comprendre que la bonne réponse à ce déséquilibre n’est pas dans le protectionnisme mais dans la réduction du déficit budgétaire américain est un des enjeux les plus cruciaux du moment.
Données statistiques
Fig. — Solde de la balance des paiements courants en 2023
Source : Banque mondiale
Le solde de la balance des paiements courants ajoute au solde commercial, c’est-à-dire au solde des échanges de biens, les services comme le tourisme ou la rémunération des placements effectués par un pays dans un autre pays. Il représente ce que doit financer un pays pour équilibrer ses comptes extérieurs quand il est en déficit ou les moyens que dégage ce pays du fait de ses relations avec ses partenaires commerciaux. Au niveau mondial, les excédents des uns sont égaux aux déficits des autres.
Une équation comptable simple — (S-I)+(T-G)=X-M où S est l’épargne, I l’investissement, T les impôts, G les dépenses publiques et X-M le solde de la balance des paiements courants — permet d’associer un solde négatif à un manque d’épargne.
Un des paradoxes de la situation économique mondiale est que les pays en manque d’épargne, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni ou la France comptent parmi les plus riches de la planète. À eux seuls, les États-Unis représentent 60 % des déficits extérieurs alors qu’ils ne représentent que 25 % du PIB mondial. Sont également en déficit les pays qui ont un effort important d’investissement à réaliser comme le Brésil et l’Inde.
Symétriquement, les pays qui accumulent des excédents sont certains pays riches (Allemagne, Japon, Suisse), des pays en pleine expansion économique réalisant un effort d’épargne significatif (Chine, Singapour, Irlande) et d’autres qui bénéficient d’une rente liée au commerce des matières premières, essentiellement énergétiques (Norvège, Russie, Arabie, Qatar).
Fig. — Évolution comparée du PIB mondial et du commerce mondial en volume
Source : Insee
depuis le milieu des années 1980 jusqu’à la crise financière de 2008, le taux de croissance du commerce mondial est systématiquement supérieur au taux de croissance du PIB mondial. Le commerce mondial se replie fortement en cas de crise, sa décélération est même plus rapide que celle du PIB mondial. De 2012 à la pandémie de Covid-19 qui a débuté en 2020, les taux de croissance du commerce mondial et du PIB mondial sont quasiment identiques ; la mondialisation semble avoir atteint un palier. En 2020, année de crise sanitaire, le commerce mondial se contracte davantage que le PIB mondial puis se redresse plus fortement. En 2023, le commerce mondial augmente de 0,3 % et le PIB mondial de 3,2 %.
En 1980, le commerce mondial des marchandises représentait 34 % du PIB mondial. En 2023, il représente 45,5 %.
Le grand témoin
Je n’utilise jamais l’expression « libre-échange », je parle d’ouverture des échanges
“Il y a dans l’opinion publique française un problème général majeur de compréhension de l’économie et cette incompréhension se retrouve dans l’appréhension du thème du commerce international qui est chez nous un angle mort.”
Pascal Lamy
Ancien directeur général de l’Organisation mondiale du commerce,
Propos recueillis par Philippe Plassart
L’ancien directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) estime que la vision des échanges internationaux de Donald Trump comme un jeu à somme nulle est totalement erronée.
Comment définissez-vous le libre-échange ?
Pour ma part, je n’utilise jamais l’expression « libre-échange », je parle d’ouverture des échanges. Le libre-échange est un concept qui n’existe pas, une fiction. Ceux qui prônent l’ouverture des échanges ne le considèrent pas comme le paradis à atteindre. Même si l’on admet que l’ouverture va dans la bonne direction, il y a toujours de bonnes raisons de ne pas l‘appliquer intégralement. Ce qui compte, c’est de décider si l’on est pour ou contre l’ouverture des échanges.
L’autre raison pour laquelle, lorsque j’étais commissaire européen au Commerce puis directeur général de l’Organisation mondiale du commerce, je n’ai jamais employé ce terme de libre-échange — sans réussir, il est vrai, à convaincre le milieu de me suivre — est qu’il fausse énormément les perceptions publiques. Quand les populations entendent « accord de libre-échange » — par exemple avec leMercosur — ils comprennent qu’il n’y a plus d’obstacles, plus de limites aux échanges. C’est une erreur grossière.
Les grands théoriciens classiques du libre-échange — Smith, Ricardo — sont des théoriciens de l’ouverture des échanges. Leur démonstration est assez simple : si un pays A fait dans un domaine quelque chose de mieux qu’un pays B et si le pays B fait dans un autre domaine mieux que le pays A, les deux pays ont un intérêt rationnel à échanger pour bénéficier réciproquement de leur savoir-faire. À condition de ne pas oublier que ceux qui font moins bien dans le pays A que dans le pays B et que ceux qui font moins bien dans le pays B que dans le pays A vont avoir un problème. Car si l’échange bénéficie aux deux parties, c’est sous l’effet d’une concurrence accrue qui oblige les systèmes productifs à se réajuster dans un processus schumpétérien de « destruction créatrice » inévitablement douloureux. La globalisation — entendue au sens de l’ouverture des échanges et de la multilocalisation des systèmes productifs — est efficace parce qu’elle est pénible et elle est pénible parce qu’elle est efficace. Une équation qui laisse entier le problème politique, notamment les conditions nécessaires pour rendre l’ouverture à la fois bénéfique et supportable.
Pourquoi les bénéfices du libre-échange pourtant démontrés solidement par la théorie économique et par l’histoire sont-ils si difficilement perçus par les opinions publiques ?
Cela tient au fait que la répartition des bénéfices et des coûts de l’ouverture des échanges est souvent mal maîtrisée. Aux États-Unis, c’est évident parce qu’ils ont un système de protection sociale médiocre en proportion de leur revenu par tête, tout particulièrement en comparaison du nôtre. Et quand des usines ferment dans la Rust Belt du nord-est des États-Unis, cela a un impact politico-social fort. Mais ces fermetures sont-elles dues à l’évolution technologique ou aux importations chinoises ? Les études économiques ne tranchent pas nettement. Ces retombées négatives jouent dans une moindre mesure en Europe où le système social est plus protecteur. Mais la France reste une exception, car elle se situe historiquement et idéologiquement de façon très singulière par rapport à l’échange international. Dans son histoire, elle ne s’est ralliée que pendant dix ans sous Napoléon III au mouvement général d’ouverture des échanges et les héros économiques français s’appellent Colbert et Méline. Il y a dans l’opinion publique française un problème général majeur de compréhension de l’économie et cette incompréhension se retrouve dans l’appréhension du thème du commerce international qui est chez nous un angle mort. En témoigne, récemment, la majorité sidérante au Parlement en faveur d’une résolution contre le Mercosur alors que tout démontre que cet accord est, dans l’ensemble, positif. Ou bien le refus du Sénat de ratifier l’accord avec le Canada en vigueur depuis quatre ans qui a pourtant montré qu’il nous était extrêmement favorable. Cet état d’esprit est un problème majeur qu’il faudrait aborder par de la pédagogie. Mais, sur ce terrain, le monde des entreprises et les leaders politiques sont malheureusement généralement aux abonnés absents.
Le cycle d’ouverture sans précédent qu’a connu le monde depuis plusieurs décennies est-il menacé ?
Constatons que l’ouverture des échanges ne recule pas. Il suffit pour s’en convaincre de regarder les chiffres. Le volume du commerce international continue d’augmenter pour la partie que l’on mesure — les marchandises lors de leur passage aux frontières —, et pour la partie que l’on calcule, les services. Il augmente beaucoup plus vite dans la partie que l’on ne me-sure ni ne calcule, notamment les flux de données. Il est vrai cependant que le processus de multi-localisations de la production qui porte en lui-même une multiplication des échanges s’est ralenti ces dernières années. Que ce soit à la suite de catastrophes (tsunami, crise Covid-19) ou en raison de mesures de précaution, qu’elles soient d’ordre sanitaire, de sécurité stratégique ou de résilience. Pour autant, ces nouveaux freins aux échanges n’entraînent pas de recul de la globalisation.
“La globalisation — entendue au sens de l’ouverture des échanges et de la multi-localisation des systèmes productifs — est efficace parce qu’elle est pénible et elle est pénible parce qu’elle est efficace. Une équation qui laisse entier le problème politique, notamment les conditions nécessaires pour rendre l’ouverture à la fois bénéfique et supportable.”
La volonté des entreprises en quête d’une plus grande sécurité de diversifier leurs fournisseurs joue même en sens inverse comme l’a démontré l’économiste Isabelle Méjean. Pour l’avenir, ma conviction est qu’il n’y aura pas de déglobalisation aussi longtemps que les infrastructures du commerce mondial — notamment pour la circulation des marchandises et des données, les ports, les navires, les câbles sous-marins, les satellites, actuellement en pleindéveloppement — ne sont pas physiquement atteintes. C’est de ce côté-là que peut venir la menace.
Les rivalités géostratégiques de plus en plus frontales entre les États ne prennent-elles pas le dessus sur la logique économique des échanges ?
C’est vrai. Après la période précédente durant laquelle la géoéconomie tempérait la géopolitique, nous sommes entrés dans une ère où la géopolitique a repris la main sur la géoéconomie. Mais gardons-nous d’en généraliser l’impact sur les échanges ! Force est de constater que la partie du commerce mondial qui est atteinte par ces précautions stratégiques et autres reste marginale. Nous n’assistons pas à la formation de grands blocs continentaux commerciaux séparés, mais à des mouvements de chaînes de valeur dont la distribution évolue en fonction des prix relatifs et des nouveaux obstacles aux échanges qui apparaissent. Lorsque les États-Unis imposent des droits de douane sur les produits chinois, la Chine transfère, comme elle l’a fait lors du premier mandat de Trump, des éléments de sa chaîne de valeur vers les pays de l’Asie du Sud-Est, voire vers le Canada et le Mexique. Ainsi la chaîne de valeur chinoise se modifie en se répartissant différemment entre la Chine et ses partenaires non américains. Cet impact, jusqu’ici réduit, pourrait cependant prendre des proportions nettement plus amples du fait des mesures à l’emporte-pièces prises par Trump depuis le début de son second mandat, et qui révèlent sa vision aussi erratique qu’erronée des échanges internationaux.
“En tant qu’Européens, il y a tout à la fois de bonnes raisons de riposter par des mesures de rétorsions bien ciblées politiquement et de bonnes raisons de négocier.”
En quoi la vision des échanges internationaux de Donald Trump est-elle erronée ?
Il professe à tort que l’échange commercial est un jeu à somme nulle. Erreur. De même considère-t-il que le déficit commercial des États-Unis traduit une faiblesse économique. Autre erreur puisque ce déficit est au contraire le reflet d’une force. La raison pour laquelle les États-Unis ont depuis cinquante ans un déficit commercial structurel important tient au fait qu’ils peuvent se l’offrir « gratos ». La seule limite à un déficit commercial pour un pays c’est son financement. Or les États-Unis n’ont aucun problème de financement grâce à la suprématie du dollar. Résultat : les Américains peuvent consommer beaucoup plus qu’ils ne produisent. Autre erreur, autre preuve de l’incohérence de son raisonnement : il affirme utiliser ce déficit pour tordre le bras aux pays auxquels il veut extorquer des concessions.
Or, en menaçant d’augmenter les droits de douane pour les empêcher d’accéder au marché américain, il démontre au contraire que ce déficit est une force. Enfin, Donald Trump considère les droits de douane comme la solution miracle pour accroître les recettes fiscales en faisant payer les autres pays. Il entonne une véritable ode aux tarifs douaniers qu’il voit comme une mine d’or à portée de sa main et veut créer un External Revenue Service à côté de l’Internal Revenue Service que les ménages américains connaissent bien. Il est persuadé que ce sont les exportateurs qui paient les droits de douane alors que tout étudiant en première année d’économie sait que ce sont les consommateurs qui les paient par un surcroît d’inflation. Avec en prime une hausse des taux d’intérêt. Tout cela est d’une totale incohérence. L’économie américaine est proche de la surchauffe et tourne au maximum de ses capacités. Il n’y a pas de problème d’emploi aux États-Unis. L’autre menace inflationniste est la politique d’expulsion des immigrés clandestins alors que l’économie a besoin de ces derniers pour tourner.
Le président américain impose une approche « transactionnelle » aux deals commerciaux fondée sur le rapport de forces. Comment déjouer cette pratique si contraire à l’esprit du multilatéralisme ?
En tant qu’Européens, il y a tout à la fois de bonnes raisons de riposter par des mesures de rétorsions bien ciblées politiquement et de bonnes raisons de négocier. Vis-à-vis de l’Europe, Trump va probablement se concentrer sur l’acier, l’aluminium, et surtout sur les exportations de véhicules européens en direction du marché américain qui sont pour les deux tiers d’origine allemande. Son argument : il y a plein de Mercedes à New York et pas de Chevrolet à Berlin. Il est vrai que les Européens ont 10 % de droits de douane sur les voitures importées alors que les Américains ont un droit de douane de 3 %. Mais cette différence, modeste, compte beaucoup moins que les préférences des consommateurs et ces tarifs ont été agréés dans le cadre d’une négociation multilatérale de l’OMC, ils sont « consolidés ». Si bien que les Américains ont des droits plus élevés ailleurs, comme sur le textile. Comment réagir ? On a l’expérience du premier mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche. Une hausse des droits de douane sur les automobiles européennes avait été déjà brandie à l’époque par les Américains. Jean-Claude Juncker, alors président de la Commission européenne, avait proposé un deal à Trump sous la forme d’achats de soja américain, matière qui commençait à faire défaut sur le marché.
Ce fut une bonne négociation très maligne ! Aujourd’hui, il serait sans doute intelligent dans une démarche transactionnelle que l’Europe achète du pétrole et du gaz américain (même si ces achats ne sont pas cohérents avec nos objectifs de décarbonation). Il faut savoir utiliser les marges de négociation pour obtenir un bon deal et il n’est pas interdit de chercher à en tirer un bénéfice aux dépens de la partie adverse. Le transactionnel, cela marche dans les deux sens !
“Il faut savoir utiliser les marges de négociation pour obtenir un bon deal et il n’est pas interdit de chercher à en tirer un bénéfice aux dépens de la partie adverse. Le transactionnel, cela marche dans les deux sens !”
En affichant des records d’exportations, la Chine fait figure de grand gagnant de la mondialisation au point que Xi Jinping se pose en champion du libre-échange. Comment, en tant que partie prenante des négociations d’adhésion de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce, appréciez-vous la situation ?
Je pense de l’excédent chinois la même chose que ce que je pense du déficit américain. C’est un problème d’ordre principalement macroéconomique et non pas commercial. Les Chinois sous-consomment et sur-épargnent pour des raisons politiques qui tien-nent à la faiblesse de leur welfare state. Les ménages chinois sont très mal protégés contre les aléas de l’insécurité sociale (la maladie, la vieillesse, l’éducation). Et l’expérience du Covid-19 a été pour eux terrible enl’absence de soutien. Ils sont trop socialistes économiquement et pas assez socialement d’où cette sous-consommation.
Dans ces conditions, corriger l’excédent commercial chinois n’est pas, du fait de son ampleur, à la portée d’une négociation commerciale, de même symétriquement pour viser une réduction du déficit américain. Cela relèverait, en partie, d’une grande négociation internationale sur les taux de change, du type de celles que l’on a pu mener dans les années 1980, mais on n’en est pas là. Pour autant, c’est un fait qu’il existe des éléments artificiels dans la pénétration par les Chinois des marchés d’exportation tenant à des avantages indus conférés aux producteurs chinois, notamment via les subventions. Or les disciplines OMC sur les subventions sont structurellement faibles. Cela tient en partie à la difficulté intrinsèque d’un sujet qui est très compliqué, mais aussi au fait qu’au moment de la négociation des années 1999/2000 un resserrement général des mailles du filet de la discipline sur les subventions fut écarté pour ne pas déplaire à l’ensemble des parties. Ce fut, je le reconnais, une erreur collective pour laquelle j’ai déjà battu ma coulpe.
La Chine, en entrant à l’OMC, a payé son adhésion beaucoup plus cher que les autres pays en développement à l’époque avec un droit de douane chinois plafond à l’importation autour de 10 %. Plus de vingt ans après, le droit de douane moyen brésilien ou indien est encore à 30 %. Ce faisant, les Chinois ont rejoint un système de discipline qui leur a servi d’assurance antiprotectionniste pour leurs exportations. Et qui est venu à l’appui d’une stratégie consistant à faire croître leur économie par l’utilisation de leurs avantages comparatifs. La Chine s’est ouverte, elle a respecté ses obligations OMC, mais elle a su profiter des « trous dans la raquette » du système pour en maximiser les bénéfices en revenant, avec Xi Jinping, à une forme de léninisme économique.
L’Europe est-elle en mesure de défendre ses intérêts sans sacrifier l’ouverture ?
Elle doit continuer ce qu’elle a fait progressivement depuis dix ans. C’est-à-dire muscler ses instruments de défense commerciale en compatibilité avec les règles de l’OMC (certains instruments récents n’ont pas encore été testés ou font l’objet de contentieux). Par rapport à l’arsenal dont je disposais lorsque j’étais à la Commission — anti-dumping, antisubventions, contrôle des investissements d’importations, etc. — les outils disponibles sont aujourd’hui trois fois plus importants. Cette partie défensive doit être complétée par davantage de politique industrielle, un mot qui a été banni à Bruxelles pendant trop longtemps. Il faut revenir à une approche plus stratégique de la conduite de l’évolution des appareils de production. Un processus lent, compliqué. Autant les outils de politique commerciale sont très forts parce que fédéralisés — le marché commun est une union douanière —, autant les autres instruments sont encore beaucoup trop faibles : le budget européen est minuscule en proportion du PNB, les outils de politique industrielle restent entre les mains des États membres. Les aides publiques sont limitées, sous le contrôle de la commission, pour favoriser la concurrence alors qu’on arrive à un moment où il faut au contraire remettre de l’argent.
“L’efficacité de l’OMC souffre d’un problème de gouvernance, la répartition des attributions et des compétences entre le secrétariat et les membres étant restée trop déséquilibrée.”
Quant aux quelques programmes industriels paneuropéens existants, ils ne sont pas à la hauteur de l’ambition industrielle qu’il faudrait. Ce n’est pas un problème global de moyens — le niveau de richesse de l’Union européenne (UE) l’atteste — mais de dispersion de ces moyens entre les États qui rend très compliqué la mise en œuvre de projets communs. Il y a forcément un biais en faveur de la politique commerciale ou de la fameuse régulation, qui sont des compétences de l’Union par rapport à une stratégie industrielle, ou à la recherche-innovation qui restent conduites au niveau des États. Le dossier des véhicules électriques dont la situation est critique en est une parfaite illustration. Ce n’est qu’après avoir décidé, à juste titre, d’appliquer des droits de douane majorés sur les véhicules chinois importés, en fonction de l’impact des subventions chinoises sur ces véhicules, que l’Europe commence à réfléchir à se doter d’une politique industrielle dans ce secteur. Celle-ci n’est pas simple à définir, car personne n’est d’accord sur rien. Les mesures commerciales sont nécessaires, mais elles ne peuv-ent pas tout. Les Européens doivent faire avec les Chinois ce que les Chinois nous ont fait il y a trente ans. Pour permettre à nos véhicules thermiques d’accéder à leur marché, ils nous ont imposé à l’époque des joint-ventures et des transferts de technologie. À notre tour de leur imposer, après le coup de semonce des droits de douane, nos conditions pour venir produire en Europe des véhicules électriques où ils ont pris une bonne longueur d’avance pour contrôler, à coups de subventions, une grande partie de la chaîne de valeur, dont les batteries.
Pour mener à bien ce type de deals, les Européens ne doivent-ils pas alors sortir de leur « naïveté » et opérer une révolution intellectuelle ?
Cette « naïveté » européenne n’est pas validée par les chiffres. L’Union européenne a un excédent commercial extérieur, certes modeste, mais permanent. Une performance atteinte avec un niveau de consommation et d’épargne correct. En même temps, il faut bien admettre que dans certains secteurs — par exemple le photovoltaïque — l’Europe n’a pas résisté à l’invasion chinoise. Lorsque l’Union européenne passe des accords d’ouverture des échanges, elle fait des transactions avec ses partenaires. Elle peut mettre dans la balance l’accès à son marché, qui est le premier de la planète, ce qui est un levier extrêmement puissant dans la négociation. Il faut néanmoins désormais donner à la démarche une dimension plus stratégique, ce qui passe par un leadership plus affirmé. La vraie réponse est d’approfondir l’intégration européenne, de faire davantage ensemble à commencer par les investissements d’avenir et la défense.
L’Organisation mondiale du commerce est-elle toujours en mesure de réguler le commerce international sachant que les États-Unis en sont quasiment sortis ?
La mission de l’OMC est de réduire, dans un cadre multilatéral négocié, les obstacles à l’échange dans tous les domaines. Pour cela, elle opère dans un continuum législatif, administratif, et judiciaire : l’établissement de règles, la surveillance de leur application et le règlement des contentieux.
La partie législative (le « rulebook ») est actuellement très handicapée par la tension sino-américaine et par des oppositions Nord/Sud si bien qu’elle a très peu avancé ces derniers temps. Elle n’est pas à jour sur divers sujets : articulation entre commerce et environnement, régulation du commerce digital, questions de précaution même si la jurisprudence dans ce domaine permet de combler les trous. La surveillance des règles existantes est opérante — des dizaines comités se tiennent chaque semaine à l’OMC sur l’agriculture, les télécoms, les assurances ou les valeurs en douane, en partie animés par le secrétariat. Enfin la partie contentieuse a été progressivement sabotée par les Américains depuis l’échec du Doha Round en 2008 du fait de leur opposition à des concessions agricoles. Les Européens ont certes mis un système de remplacement qui fonctionne bien, mais il laisse à l’écart les Américains du système de règlement des différends. Par ailleurs, l’efficacité de l’OMC souffre d’un problème de gouvernance, la répartition des attributions et des compétences entre le secrétariat et les membres étant restée trop déséquilibrée, le secrétariat n’ayant, par exemple, pas le droit de faire des propositions.
L’OMC peut-elle vivre sans les Américains ?
Je pense que oui. Le problème est pour les Américains. Ils ne représentent que 15 % des importations mondiales face aux 85 % restants. Si ces derniers se mettent d’accord pour répliquer aux provocations américaines tout en évitant toute contagion entre eux, alors les exportations américaines en pâtiront. Sans compter le fait qu’en sortant de l’OMC, formellement, les États-Unis sortiraient aussi de l’accord sur la propriété intellectuelle si bien que leurs brevets ne seraient plus protégés. Une menace qu’ils devraient prendre très au sérieux.
Pascal Lamy
Ancien directeur général de l’Organisation mondiale du commerce
Biographie
Pascal Lamy (pascallamy.eu) est le coordinateur des Instituts Jacques Delors (Paris, Berlin, Bruxelles). Il est vice-président du Forum de Paris pour la Paix et président de la branche Europe du Groupe Brunswick. De 2005 à 2013, Pascal Lamy a exercé deux mandats consécutifs de directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Il était précédemment commissaire au commerce (1999-2004), directeur général du Crédit Lyonnais (1994-1999), directeur de cabinet du président de la Commission européenne, Jacques Delors ainsi que son sherpa au G7 (1985-1994), directeur adjoint du cabinet du Premier Ministre (1983-1985) et du ministre de l’Économie et des Finances (1981-1983).