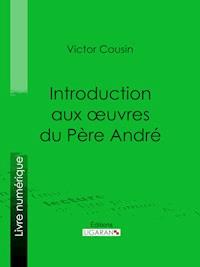
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Nous avons deux Biographies du P. André, l'une de l'abbé Guyot, dans l'Éloge historique que précède les Œuvres posthumes (Paris, 4 vol., 17766), l'autre du P. Tabaraud, ancien oratorien, dans l'article consacré au P. André, tome II de la Biographie universelle. En rapprochant ces deux Biograhies, et en les éclairant l'une par l'autre, on en tire le résumé qui suit : André était du pays de Descartes,, de cette Bretagne qui, depuis Pélage et Abélard, est..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335091779
©Ligaran 2015
Nous avons deux Biographies du P. André, l’une de l’abbé Guyot, dans l’Éloge historique qui précède les Œuvres posthumes (Paris, 4 vol., 1766), l’autre du P. Tabaraud, ancien oratorien, dans l’article consacré au P. André, tome II de la Biographie universelle. En rapprochant ces deux Biographies, et en les éclairant l’une par l’autre, on en tire le résumé qui suit :
André était du pays de Descartes, de cette Bretagne qui, depuis Pélage et Abélard, est accoutumée à fournir à la philosophie et à la théologie des esprits distingués, mais médiocrement disposés à porter le joug des opinions régnantes. Né à Châteaulin, dans la basse Bretagne, en 1675, l’année même de l’arrêt du conseil contre le cartésianisme, il était entré chez les jésuites en 1693, et, dans les premières années du XVIIIe siècle, il faisait sa théologie à Paris, au collège de Clermont, depuis le collège Louis le Grand. Ce fut alors qu’il connut Malebranche, et forma avec l’illustre cartésien une liaison intime, continuée dans une correspondance régulière jusqu’à la mort de Malebranche, en octobre 1715. Le P. André avait l’âme droite et élevée, l’esprit sage, modéré, élégant. La philosophie nouvelle se présentait à lui avec l’attrait d’une doctrine injustement attaquée, s’appuyant d’un côté sur une géométrie profonde et sur une physique claire et ingénieuse, et de l’autre, sur une métaphysique sublime, parée des charmes d’un admirable langage. Mais le cartésianisme avait ses conséquences : on n’est pas indépendant en philosophie sans le devenir un peu en théologie et même en politique, et les cartésiens furent les libéraux de leur temps. On peut donc pressentir, malgré l’absolu silence de l’abbé Guyot, et on voit déjà dans le P. Tabaraud quelle fut la destinée de ce libre penseur parmi les jésuites. Dès que ses opinions percèrent, il fut environné d’ombrages et exposé à l’inquisition la plus tracassière, jusqu’à ce qu’envoyé au collège de Caen, en 1726, sans abjurer ses principes, mais peut-être les contenant davantage, ou peut-être aussi protégé par le progrès toujours croissant de l’esprit philosophique, et par le déclin du crédit des jésuites, le P. André trouva enfin le repos, et vit arriver, au sein de l’estime générale, la suppression de son ordre, en 1762. Il mourut à Caen, en 1764, à l’âge de quatre-vingt-neuf ans. Il avait publié, en 1741, l’Essai sur le Beau, composé de discours lus à l’Académie de Caen dont il était membre. En 1763, il avait donné une seconde édition, fort augmentée, de cet Essai, par les soins de l’abbé Guyot, qui fut aussi, en 1766, l’éditeur de ses Œuvres posthumes.
Voilà tout ce que nous savions sur le P. André d’après le témoignage de ses deux biographes, quand de nouveaux documents vinrent nous apporter des lumières inattendues, et, en ajoutant des détails authentiques et douloureux à ce que nous avait appris le P. Tabaraud, transformer à nos yeux l’auteur estimé de l’Essai sur le Beau en un personnage digne de l’attention et de l’intérêt de l’histoire par les longues disgrâces, absurdes et cruelles, qu’il souffrit dans le sein de sa compagnie comme cartésien à la fois et comme janséniste ; par l’attachement éclairé et courageux qu’il garda toute sa vie à une grande cause proscrite ; par le rare talent d’écrivain ingénieux, délicat, élevé, quelquefois véhément et pathétique, que nous révèlent les pages, jusqu’ici inconnues, échappées à sa plume pendant une persécution de près de cinquante années.
Nos nouveaux documents nous viennent de deux sources différentes.
Vers la fin de l’année 1839, M. Leglay, archiviste du département du Nord, bien connu par son exacte et curieuse érudition, nous communiqua un manuscrit acheté par lui chez un libraire de Lille, et qui contenait des lettres inédites du P. André. Ce manuscrit est un in-4° de cent quatre-vingt-quatorze feuillets, comprenant quatre-vingt-trois lettres, dont plusieurs sont adressées à Malebranche, un plus grand nombre à un jésuite nommé Larchevêque, toutes les autres à M. l’abbé de Marbeuf, de l’Oratoire. Elles commencent en 1707, et se terminent à la fin de 1722 ; elles embrassent donc un espace d’environ quinze années. Ces lettres, il est vrai, ne sont point originales ; ce ne sont que des copies, mais des copies faites avec un grand soin ; l’écriture est certainement de la première moitié du XVIIIe siècle, en sorte que l’authenticité de cette correspondance ne peut pas être révoquée en doute. J’en ai donné des extraits de quelque étendue dans le Journal des Savants (janvier et février 1841) sur deux points intéressants : 1°. la persécution trop peu connue du P. André ; 2°. les matériaux qu’il avait amassés pour composer une vie de Malebranche.
Nos travaux sur le P. André en étaient là, lorsqu’à la fin de 1841 nous reçûmes la lettre suivante :
« Caen, 31 décembre 1841.
Monsieur,
Les deux intéressants articles que vous avez publiés sur le P. André, dans le Journal des Savants des mois de janvier et de février derniers, m’engagent à vous faire part, avant tout autre, de la découverte que je viens de faire, concurremment avec MM. Trébutien et Leflaguais, mes collègues à la bibliothèque de Caen.
Il y a quelques jours, ayant rencontré, en visitant deux immenses ballots de papiers manuscrits et autres qu’on se disposait à vendre à la livre, quelques imprimés relatifs à l’histoire du Calvados pendant la révolution, je fis porter ces ballots à la bibliothèque de la ville, afin de les examiner. Vous jugerez de notre satisfaction lorsque, après avoir jeté les yeux sur les premiers cahiers écrits à la main, nous reconnûmes, au milieu de notes assez curieuses sur notre histoire locale, la majeure partie des manuscrits autographes et inédits de l’auteur de l’Essai sur le Beau, savoir :
1°. La Géométrie pratique, un fort vol in-4° ;
2°. Traité de l’Architecture civile et militaire, in-4° ;
3°. Traité de l’Architecture, etc. (mise au net du précédent), in-fol. ;
4°. L’Art de bien vivre, poème en quatre chants, in-4° ;
5°. Une vingtaine de sermons sur différents sujets, in-4° ;
6°. Un fort volume de notes sur Descartes et Malebranche, in-4° ;
7°. Metaphysica, sive Theologia naturalis, in-fol. ;
8°. Instruction chrétienne pour un enfant qui est dans les études, in-fol. ;
9°. Deux cartons considérables de cahiers et de feuilles volantes, contenant des opuscules en ers ou en prose, des maximes, des pensées, des notes, etc. ;
10°. Enfin, un fragment considérable de la seconde partie de l’Essai sur le Beau, in-4°.
Mais ce qui nous frappa le plus furent trois cahiers contenant :
Le premier, de quarante-six feuillets, la correspondance du P. André avec les jésuites Guimond, Hardouin, Porée et Dutertre, lors de sa persécution comme malebranchiste ;
Le second, de soixante-un feuillets, la correspondance du P. André avec Fontenelle, dont seize lettres autographes de ce dernier, et une dix-septième écrite en son nom par M. de Croismare : elles sont datées des dernières années de la vie de Fontenelle ;
Le troisième, enfin, de cinquante-neuf feuillets, composé de brouillons de dix-sept lettres du P. André à Malebranche, et des réponses autographes de l’illustre philosophe. Plusieurs de ces lettres, entre autres une sur le mensonge, roulent sur des sujets philosophiques ; les autres ont trait à des incidents de la vie intime des deux correspondants : elles n’en ont pas moins une grande valeur, puisque vous nous avez appris que les lettres de Malebranche étaient si rares, que vous n’en connaissiez que deux. Deux ou trois lettres du P. Lamy font aussi partie de ce cahier.
Tous ces manuscrits, que nous nous sommes empressés d’acheter, appartenaient à une demoiselle Peschet, légataire d’une demoiselle de la Boltière, héritière elle-même d’un avocat littérateur de Caen, nommé Charles de Quens. Élève du P. André, M. de Quens paraît, dans ses manuscrits, que nous avons achetés aussi, lui avoir voué une vénération toute particulière. Nous avons trouvé deux volumes entiers de notes de sa main, qui semblent avoir été prises jour par jour et être le résultat de son entretien avec son professeur sur la religion, la philosophie, l’histoire, les auteurs, les hommes et les choses. Malebranche, vous pouvez le croire, n’y est pas oublié. Il s’y trouve, en outre, une foule d’anecdotes qui prouvent que, si le P. André était un savant distingué, il était encore un homme d’esprit et de saillies. Ce même M. de Quens s’associa avec l’abbé Guyot pour faire graver une épitaphe sur la tombe du P. André, dans l’église des chanoines de l’Hôtel-Dieu de Caen. C’est, du moins, ce que nous a appris un manuscrit inédit de l’abbé Guyot, depuis longtemps dans la bibliothèque de Caen, et intitulé le Moréri des Normands.
Voilà, Monsieur, tout ce que nous avons pu remarquer jusqu’ici, après un rapide examen des manuscrits que nous avons eu le bonheur de sauver d’une destruction certaine. Nous allons maintenant nous mettre à les classer et à les étudier. Nous ne doutons pas que ce travail n’aboutisse à quelque heureux résultat.
Je me suis tu sur ce qui peut avoir rapport à la Vie de Malebranche, que vous réclamez, à si juste titre, de son possesseur inconnu. C’est qu’en effet nous l’avons cherchée en vain. Un des exemplaires que vous signalez avait été, à la vérité, dans les mains de M. de Quens, mais il s’en était dessaisi, quelque temps avant de mourir, en faveur d’un M. Hemey-d’Auberive (sans doute l’abbé Hemey-d’Auberive, éditeur des Œuvres de Bossuet, 1815-1819, dont parle Quérard, tom. IV, p. 62, et qui mourut à Paris, à la fin de 1815), à la condition qu’il la publierait, et le signalerait, lui, M. de Quens, dans sa préface. Je vous envoie les pièces à l’appui de ce fait ; ce sont un reçu daté de 1807 et une lettre de M. d’Auberive lui-même, qui, comme vous le verrez, demeurait alors à l’Abbaye-au-Bois. Si vous pouviez maintenant retrouver les héritiers de cet écrivain, ils devraient en conscience, rendre le livre du P. André, puisque les conditions pour lesquelles il avait été donné n’ont pas été remplies ; et, s’ils s’y refusaient, le mandataire de la demoiselle Peschet est disposé à faire toutes les démarches pour le recouvrer. Vous devez bien penser qu’une fois entre nos mains, il ne tarderait pas à être livré à la publicité.
J’ai l’honneur d’être avec respect, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur,
G. MANCEL,
Conservateur de la bibliothèque de Caen. »
À cette lettre sont jointes :
1°. quelques lignes de M. l’abbé Marc, prouvant qu’en 1807 la Vie de Malebranche, par le P. André, était entre ses mains, et formait un volume in-folio de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf pages ;
« J’ai reçu de M. de Guince (sic pour Quens) un volume in-folio commençant par ces mots : La Vie du R.P. Malebranche, prêtre de l’Oratoire, ledit manuscrit contenant neuf cent quatre-vingt-dix-neuf pages, et je m’engage de le remettre aussitôt que j’en serai requis. Caen, le 10 mars 1807.
Signé L. MARC. »
2°. Une lettre de M. l’abbé Hemey-d’Auberive, où il s’engage à remettre aux héritiers de M. de Quens la Vie de Malebranche, qu’il croyait lui avoir été non pas prêtée, mais donnée. M. l’abbé d’Auberive, qui était fort en état d’en bien juger, déclare « qu’il y avait de très bonnes choses et très intéressantes dans cette Vie de Malebranche, mais que ce n’était point un livre achevé, qu’il y avait quantité de lacunes, beaucoup d’articles imparfaits, et qu’il faudrait un temps et un travail assez considérables pour le mettre en état d’être imprimé. » M. d’Auberive avait entrepris cette tâche, et s’en occupait quand le manuscrit lui fut redemandé. Les héritiers de M. de Quens reprirent-ils l’ouvrage du P. André, ou le laissèrent-ils entre les mains de M. d’Auberive ? nous l’ignorons ; tout ce que nous savons, c’est que la Vie de Malebranche ne fait point partie des papiers du P. André provenant de la succession de M. de Quens, et on a bien de la peine à parvenir jusqu’à la famille de M. l’abbé d’Auberive pour en obtenir ce simple renseignement, si parmi les papiers qu’il a dû laisser se trouve la Vie de Malebranche.
Du moins, nous voilà en possession d’un bon nombre de manuscrits du P. André ; ils sont maintenant déposés dans une grande bibliothèque publique, celle de la ville de Caen. Le digne conservateur de cette bibliothèque, M. Mancel, avec ses deux excellents collaborateurs, MM. Trébutien et Leflaguais, les étudie, et s’occupe de reconnaître ce qui mérite d’en être publié. Au premier rang, il faut placer assurément la correspondance du P. André avec Fontenelle et avec Malebranche. C’est presque un point d’honneur pour M. Mancel de donner lui-même les lettres de son illustre compatriote Fontenelle. Déjà l’abbé Guyot, dans sa Notice sur le P. André, a cité quelques traits de ces lettres, où l’on voit quel cas faisait de l’aimable et spirituel jésuite le dernier cartésien, le plus bel esprit du XVIIIe siècle, avant Montesquieu et Voltaire. Nous nous serions offert bien volontiers pour mettre au jour la correspondance du P. André et de Malebranche, où peut-être aurait été de mise quelque connaissance des matières agitées entre les deux métaphysiciens, et surtout de la littérature philosophique de cette époque ; mais nous concevons à merveille qu’on ne remette pas facilement à un autre le soin de faire connaître de nouvelles pages sorties de la plume de l’auteur de la Recherche de la Vérité, quand on est soi-même parfaitement capable de les bien comprendre, et par conséquent de les publier avec exactitude. Nous sommes trop heureux que M. Mancel et ses collaborateurs aient bien voulu nous communiquer, et nous autorisent à employer à notre gré, la correspondance du P. André avec plusieurs de ses confrères et de ses supérieurs de la compagnie de Jésus, pendant le temps qu’il fut persécuté comme partisan de la nouvelle philosophie de Descartes et de Malebranche. Cette correspondance est la suite et le complément nécessaire de celle dont nous avons déjà donné des extraits. Nous allons la faire connaître en détail, et en joignant ces nouveaux extraits aux premiers, tirer du manuscrit de M. Leglay et du manuscrit de Caen réunis toutes les lumières qui peuvent éclairer ce triste et intéressant épisode de l’histoire du cartésianisme.
Marquons d’abord la différence qui distingue la nouvelle correspondance de la première. Dans celle-ci, le P. André écrit à des amis qui pensent comme lui, à Malebranche, à l’oratorien de Marbeuf, disciple de Malebranche, ou à M. Larchevêque, qui paraît avoir partagé ses sentiments ; il leur ouvre son cœur ; il se complaît à leur montrer son goût vif et constant pour la nouvelle philosophie, ses études secrètes et obstinées, son pieux et fidèle attachement à leur commun maître, et son dédain courageux pour leurs communs ennemis. Ici la scène est toute différente. Ce n’est plus le P. André parlant à son aise à des amis et à des hommes étrangers à sa compagnie ; c’est le P. André dans le sein même de cette compagnie, aux prises avec ses supérieurs, entouré d’ombrages, de menaces et de tracasseries, obligé de cacher ses études, de dissimuler ses amitiés et ses opinions sans les trahir ; perpétuellement placé entre une circonspection qui pourrait ressembler à l’artifice et une franchise bien voisine de la révolte, réclamant sans cesse la justice, prodiguant les explications et les apologies, abandonné peu à peu par ceux de ses confrères qui paraissaient d’abord plus ardents que lui dans la même querelle, se débattant en vain contre de sourdes intrigues ou contre une persécution déclarée, gêné et tourmenté dans les plus petits détails de sa vie, renvoyé de ville en ville et de collège en collège, tour à tour accusé de cartésianisme et de jansénisme, en butte à une inquisition qui ne se relâche jamais, une fois même livré au bras séculier, emprisonné à la Bastille, et traînant ainsi une vie inquiète et agitée pendant toute la première moitié du XVIIIe siècle. On voit ici l’intérieur de la compagnie de Jésus, sa forte hiérarchie, le mystère dont s’y enveloppe l’autorité, ses ménagements astucieux ou ses coups d’éclat, des esprits d’une souplesse infinie et des cœurs de fer, une politique toujours la même sous les formes les plus diverses, et, au milieu de tout cela, dans cette nombreuse société, toutes les variétés de la nature humaine : bien des mécontents, quelques hommes excellents, beaucoup de gens faibles, plus d’un lâche, l’empire de l’habitude et de la routine, le monde enfin tel qu’il est et sera toujours. Ajoutez que nous avons ici tous les noms propres, que les masques sont ôtés, et qu’on voit comparaître, dans cette affaire, les principaux personnages du jésuitisme à cette époque. On peut donc se promettre plus d’une révélation inattendue et piquante ; c’est, en quelque sorte, la chronique philosophique de la fameuse compagnie, et comme un chapitre inédit de son histoire intérieure, dans la dernière période de sa domination et de son existence légale en France.
Mais avant de nous engager dans l’exposition des aventures de ce cartésien, égaré parmi les jésuites, il importe de recueillir avec soin tous les renseignements que nos deux manuscrits de Lille et de Caen peuvent nous fournir sur cette Vie de Malebranche qu’André avait entreprise, et qui n’a pu être retrouvée. Sans doute, pour suivre le travail d’André à travers les vicissitudes de sa vie, il nous faudra toucher des temps et des évènements sur lesquels nous devrons revenir ; mais cela vaut encore mieux que d’embarrasser un récit une fois commencé de détails étrangers.
M. l’abbé Guyot, auteur de l’Éloge historique qui précède les ouvrages posthumes du P. André, est, je crois, le premier qui ait parlé de la Vie de l’illustre oratorien composée par notre jésuite. Il s’exprime ainsi, p. 53-54 de l’Éloge historique : « Ce morceau peut être regardé comme un ouvrage d’esprit et de sentiment. Notre auteur y parle en maître de tout ce que la théologie, la métaphysique et la morale du P. Malebranche ont de plus relevé, en écrivain parfaitement instruit des moindres circonstances de sa vie et de ses guerres littéraires. Le cœur s’échappe par mille endroits, surtout lorsqu’il s’agit de quelque trait historique ou de quelques découvertes qui peuvent faire honneur à la religion. » Et il ajoute en note : « Cet ouvrage n’a point encore paru. La copie que nous en avons est trop défectueuse pour qu’il nous soit permis d’en faire usage. Nous avons ouï dire qu’il en existait une autre plus complète ; celui qui en est le possesseur obligerait certainement le public s’il voulait la communiquer. »
Le P. Tabaraud, de l’Oratoire, dans l’article de la Biographie universelle sur le P. André, semble avoir connu cette Vie de Malebranche ; car il déclare qu’elle « a été étrangement mutilée par celui qui en est le dépositaire actuel. » Quel était ce possesseur actuel de la Vie de Malebranche, par le P. André ? le P. Tabaraud n’en dit rien ; il aurait dû le dire : nous saurions aujourd’hui à qui nous adresser, à qui faire entendre d’énergiques réclamations. Mais, dans le silence du P. Tabaraud, tout moyen d’information nous échappe, et nous en sommes réduits à attendre le résultat douteux des démarches de M. Mancel auprès de la famille de M. l’abbé Hemey-d’Auberive. Les extraits que nous allons donner de la partie des lettres du P. André qui se rapporte à cette biographie de Malebranche, montreront combien elle devait contenir de faits curieux et importants pour l’histoire de notre grande philosophie du XVIIe siècle, et combien est coupable celui qui, pour la satisfaction d’une curiosité égoïste ou par un misérable esprit de parti, prive le public d’un écrit qui lui était destiné, et dont la perte ne peut pas même servir le plus violent ennemi des doctrines de Malebranche, puisque désormais rien ne peut abolir les œuvres de ce grand homme.
Le P. André avait fait la connaissance personnelle de Malebranche à Paris, aux conférences que tenait M. l’abbé de Cordemoi. Depuis, il avait entretenu avec lui une correspondance intime et assidue. Il lui avait voué une sorte de culte. La seule nouvelle de sa maladie lui arrache un cri de douleur.
À M. L’ABBÉ DE MARBEUF. – 16 août 1715.
« Ce que vous me mandez de la maladie du R.P. Malebranche m’afflige extrêmement. Et peut-on avoir un amour sincère pour la vérité, sans regretter un homme qui en a été, de nos jours, le plus intrépide et le plus sage défenseur ? J’en ai une raison particulière : j’ai toujours trouvé en lui un ami, un père, un oracle dans mes doutes et un consolateur dans mes peines… Je vous avoue ma faiblesse ; je me sens attendri jusqu’aux larmes ; cela n’est guère philosophe : car ce n’est pas lui (qui va être heureux), c’est vous, c’est moi, c’est tous ses amis que je pleure… »
À M. LARCHEVÊQUE. – 20 octobre 1715.
« … Je recommande à vos prières l’âme du bon P. Malebranche. Il mourut dimanche dernier, âgé de près de soixante et dix-huit ans. Il a écrit presque jusqu’au dernier soupir. Nous verrons apparemment bientôt ses ouvrages posthumes. Peu de temps avant sa mort, il m’a fait assurer de son amitié par un de ses amis qu’il m’a légué pour me tenir sa place (M. l’abbé de Marbeuf). Il le chargea en même temps d’un exemplaire de son dernier livre contre celui de l’Action de Dieu. Je l’ai lu fort attentivement, et j’y ai trouvé toute la force et toute la beauté d’esprit qui brille dans tous les autres. Il y parle partout en maître, quoique toujours avec une modestie qui relève infiniment son mérite. »
C’est immédiatement après la mort de Malebranche que le P. André eut la pensée d’écrire sa Vie, et il s’adressa à M. de Marbeuf pour obtenir des confrères et amis de l’illustre défunt des renseignements et des documents authentiques. Le P. Lelong, un des plus intimes amis de Malebranche, s’empressa de composer un certain nombre de Mémoires à l’usage du P. André. Dès l’année 1716, nous voyons celui-ci mettre la main à l’œuvre, et nous allons suivre dans ses lettres la trace et le progrès de son travail.
À M. L’ABBÉ DE MARBEUF. – D’Alençon, 20 avril 1716.
« Monsieur,
Je viens de lire avec une extrême satisfaction les deux Mémoires que vous m’avez envoyés pour l’histoire du R.P. Malebranche. Ils sont de main de maître, pleins de bon sens et de lumière, en un mot, d’un homme qui possède parfaitement les matières dont il parle. Je vous prie, Monsieur, d’en faire mes très humbles remerciements à l’auteur, et, en le remerciant, de lui demander encore en grâce :
1°. De me donner carte blanche sur l’usage de certains conseils qu’il m’adresse dans ses Mémoires, et que je ne pourrais peut-être pas suivre dans la dernière exactitude, comme d’insérer dans notre histoire les extraits que le P. Malebranche a lui-même faits de quelques-uns de ses livres, etc. Il est, ce me semble, à propos que j’aie là-dessus une pleine liberté ; car il faut sur toutes choses nous garder d’être ennuyeux, ce qui n’est pas aisé dans les citations.
2°. De se donner la peine de faire encore quelques recherches pour nous trouver de quoi égayer la matière. Il y a certains petits faits intéressants, des rencontres, des personnalités, des bons mots, où notre illustre ami était si fécond, des pensées ou des sentiments sur diverses matières humaines, des actions de piété, de générosité, de régularité aux observances de sa congrégation, d’humilité, d’honnêteté, mille petites choses, qui, par la raison même qu’elles sont petites, paraissent quelquefois grandes dans les grands hommes. Ne craignez pas que j’en charge trop notre histoire. Je ferai un choix que je placerai où les choses me paraîtront devoir faire un bon effet pour réveiller l’attention du lecteur.
3°. Je voudrais sur toutes choses avoir un journal exact de sa dernière maladie, de ses derniers sentiments, de ses dernières paroles, enfin de quoi faire une peinture frappante et touchante : visites de ses amis, leurs regrets, les témoignages d’affection de ses confrères, etc. ; son portrait physique, les vers mis au bas ; il faut penser à tout.
4° Ne pourrait-on pas avoir une attestation en bonne forme de Μ. le cardinal de Polignac sur le fait de M. de Cambray au sujet de son livre de l’Existence de Dieu, dont je voudrais bien avoir les deux éditions ? Ce fait me touche personnellement, car je crois avoir été l’occasion de la préface du P. Tournemine, par une lettre que j’avais écrite à notre provincial, et où je défendais les sentiments du R.P. Malebranche sur la nature des idées par l’autorité, si bien reçue chez nous, de cet illustre archevêque ; du moins ne fut-ce qu’après ma lettre que l’on s’avisa de faire une nouvelle préface à son livre.
5°. Je voudrais savoir plus exactement les emplois qu’il a eus chez les pères de l’Oratoire, les lieux où il a vécu, ce qu’il y a fait de particulier, les personnes avec qui ou chez qui il s’est trouvé ; ce que c’est que Barri ou Varvi, l’abbaye de Perseigne, les motifs de son voyage à La Rochelle, etc. ; ce qui le détermina plutôt à l’Oratoire qu’à un autre institut, avec les règles fondamentales de cette illustre congrégation.
En attendant sur tous ces points des éclaircissements, je ne laisserai pas de mettre la main à l’œuvre dès demain. Je commence à jeter sur le papier la suite chronologique des faits et des ouvrages du P. Malebranche, afin d’avoir toujours devant les yeux où je vas et par où je passe. Après quoi, je composerai chaque morceau par ordre, ne lisant les livres qu’à mesure que j’en aurai besoin pour me bien expliquer et pour me rendre, si je puis, intelligible à tout le monde. J’oubliais de vous demander un détail bien circonstancié des brouilleries de l’Université qui donnèrent occasion au roi d’y envoyer M. de Harlay pour en bannir le cartésianisme, et à Boileau de faire cet Arrêt burlesque, qui rend le péripatétisme si ridicule. Lorsque j’étais au collège de Clermont, à Paris, on tâcha de me décartésianiser en me mettant entre les mains une relation vraie ou fausse de ce qui s’était passé à ce sujet. Ne pourrait-on pas l’avoir ? On ne me dit point qui est l’auteur du livre de l’Action de Dieu, ni le nom de certaines personnes citées dans les Mémoires, soit messieurs ou dames, etc. Il me paraît néanmoins à propos que je les connaisse pour les nommer si cela est nécessaire, et pour les désigner s’il n’est pas permis de les nommer ; car je n’aime pas à voir, dans les histoires, de ces messieurs à trois petits points qu’on ne saurait deviner, surtout quand on n’en dit que du bien. Voilà, Monsieur, bien de la peine que je vous donne, mais c’est pour vous faire plaisir, et il est bien juste que nous travaillions à frais communs à la gloire de notre commun père. Je suis, avec respect, en N.-S.J.-C., qui aura, comme il le mérite, la meilleure place dans notre ouvrage, comme il y aura la meilleure part,
Monsieur,
Votre très humble et très obéissant serviteur,
ANDRÉ, J. »
AU MÊME. – 27 avril 1716.
« Monsieur,
Si je vous ai demandé de plus amples informations de la vie du P. Malebranche, ce n’est point que les Mémoires du R.P. Lelong ne soient très exacts et très remplis de belles choses ; ce n’est pas non plus que je veuille faire usage de tout ce que vous m’envoierez ; c’est avarice toute pure de ma part, mais une avarice dont je ne crois pas que vous me blâmiez ni l’un ni l’autre. Je me suis mis dans l’esprit que, lorsqu’on écrit sur une matière, on ne saurait trop avoir à dire, quoiqu’il ne faille pas tout dire ; car, comme dit Boileau dans son chef-d’œuvre de l’Art poétique :
Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire.
En un mot, Monsieur, je veux avoir à choisir, et qu’on ne puisse pas nous reprocher d’avoir omis rien d’important… »
AU MÊME. – Du 6 juin 1716.
« J’en suis au premier volume de la Recherche de la Vérité, dont j’ai fait l’analyse assez longue. Je me suis attaché particulièrement à rassembler dans un discours suivi tous les principes du P. Malebranche qui ont rapport à son dessein, en laissant ses écarts. Ce serait être peu sincère que de vous dire qu’en cela il n’y a point de difficulté, et jamais je n’ai mieux compris la différence qu’il y a entre lire un livre pour l’abréger et le lire simplement pour l’entendre ; mais la méditation éclaircit tout, excepté les faits. En voici quelques-uns sur lesquels je vous prie de m’instruire :
1°. Sous quel général le P. Malebranche fut-il reçu à l’Oratoire ? En deux mots, son caractère.
2°. En quelle année placerons-nous cette grande maladie dont il se guérit en buvant de l’eau, et celle qui fut suivie de ses Entretiens sur la mort ?
3°. Peut-on savoir à peu près quand il commença à lire saint Augustin ou Ambrosius Victor, et en quelle année précisément son Traité de la Nature et de la Grâce fut censuré à Rome ?
4°. Où est située l’abbaye de Perseigne, dont parlent ces Mémoires ? Il y en a une de ce nom à trois lieues d’ici ; serait-ce elle-même ?
5°. Je ne me suis pas bien expliqué sur le fait de M. de Cambray. Le R.P. Lelong a cru que je voulais une attestation de M. de Polignac, qu’il a eu en main une lettre du P. Malebranche à cet archevêque, et qu’il n’a pas jugé à propos de la lui envoyer. Ce n’est point cela que je voulais, mais que l’on fit raconter à son Éminence (de Polignac) tout ce qui s’est passé entre lui et le P. Letellier à ce sujet, et que l’on m’envoyât un témoignage authentique ; autrement, je courrais risque d’être démenti par nos pères, si j’avançais quelque chose d’incertain ou de faux. Ne pourrait-on pas aussi avoir la lettre en question ?
6°. Quel était le caractère de M. de Chevreuse, du docteur Divois, etc.
C’en est assez pour aujourd’hui. Je vous proposerai mes autres doutes à mesure que l’ouvrage avancera… »
AU MÊME. – Sans date.
« Monsieur,
Je vous suis fort obligé de vouloir bien m’envoyer le livre de M. de Cambray, et celui de l’Action de Dieu ; car je crois que, dans une histoire, il faut faire connaître à fond les choses dont on parle. J’entre fort dans ce que vous me dites sur le caractère que doit avoir la nôtre ; mais il est plus facile d’approuver vos pensées que de les exécuter. En tout cas, j’y ferai tout mon possible, et vous me ferez plaisir de m’envoyer vos critiques sur chaque endroit. Ainsi, vos bienfaits vous attireront de ma part de nouvelles peines. Je vous prie encore de m’éclaircir quelques faits :
1°. S’il y avait une préface à la première édition du livre de M. de Cambray. N’en croyez que vos yeux. Le P. Lelong m’a écrit que non ; mais il me paraît qu’il y en avait une ; car le P. Malebranche n’accuse le P. de Tournemine que d’y avoir ajouté une addition.
2°. Qu’est-ce que le chevalier Renaud, qui fut d’avis que le P. Malebranche écrivît à M. de Cambray ?
3°. Qui est ce magistrat qui engagea M. le comte de Polignac de la faire tenir au prélat ?
4°. Est-il vrai que M. de Cambray a désavoué la préface que nos pères avaient mise dans son livre ?
5°. M. le comte de Polignac parla-t-il au P. Letellier ou à quelque autre jésuite pour obtenir une satisfaction du P. de Tournemine ?
6°. Est-il bien vrai que le P. de Tournemine écrivit au P. Malebranche que, s’il écrivait contre sa préface, il se défendrait ?
Je voudrais encore avoir un plus grand détail de sa mort, ses dernières paroles, ses pensées, ses sentiments de piété à la vue des approches de l’éternité, la manière dont il reçut les derniers sacrements, s’il les demanda lui-même, les questions que vous lui fîtes et ses réponses ; s’il y eut bien des personnes qui le regrettèrent, car mon dessein serait de faire de sa mort le plus bel endroit de l’ouvrage. Vous pourrez sans doute là-dessus tirer des lumières de divers pères de l’Oratoire et des autres amis qui le visitèrent dans sa maladie… »
AU MÊME. – Du 27 juillet 1716.
« Monsieur,
J’attendais, pour vous écrire, que j’eusse achevé l’analyse du second volume de la Recherche. Cela est fait, et j’espère que le reste ira un peu plus vite, excepté néanmoins la dispute du P. Malebranche avec M. Arnauld, où je prévois encore de grandes difficultés. Mais quelque grandes qu’elles puissent être, tandis que je serai persuadé, comme je le suis, que le Seigneur me demande cet ouvrage, rien ne me rebutera. Si c’était une chose possible, je ne souhaiterais pas moins ardemment que vous de me voir dans votre hermitage ; car les distractions de mon emploi, la crainte qu’on ne se défie de moi avant que j’aie fini, l’éloignement des sources où je pourrais m’instruire en un moment, ne laissent pas de m’embarrasser ; mais il ne faut pas vouloir servir Dieu où il ne me veut pas. Voici quelques difficultés que je vous prie de m’éclaircir :
1°. Où sont maintenant les parents qui restent au P. Malebranche, neveux, nièces, alliés, etc. ? ne serait-il pas bon de leur écrire pour en avoir quelque instruction sur sa famille ?
2°. Quel était le général de l’Oratoire, en 1675, lorsqu’on ordonna, dans l’assemblée générale de la congrégation, que l’on ferait des remerciements au P. Malebranche pour sa Recherche ?
3°. En quelle année parut le livre de M. Huet, intitulé ; Censura philosophiæ cartesianæ ? Je n’en veux savoir que la date.
4°. En quelle année M. de Harlay, archevêque de Paris, vint-il en Sorbonne, de la part du roi, pour interdire la philosophie de M. Descartes ?
Tout cela me paraît nécessaire pour varier notre histoire, pour la relever, pour la rendre plus intéressante et même plus exacte… »
AU MÊME. – Du 7 novembre 1716.
« Monsieur,
Il y a bien longtemps que je vous dois une réponse, mais il y a six semaines que je me suis si fort appliqué à notre ouvrage, que je n’ai pu vous payer plus tôt. Abréger un auteur comme le P. Malebranche n’est pas une petite affaire, surtout quand on s’applique, en l’abrégeant, à lui donner plus de clarté qu’il n’en a dans toute son étendue. C’est à quoi je m’attache principalement ; car je suis très persuadé qu’on ne peut l’entendre et croire qu’il a tort, du moins sur la plupart des choses qu’il entreprend de prouver, sur la manière dont nous voyons les objets, sur la matière des causes occasionnelles, sur le fond de son système de la prédestination et de la grâce, sur la nature de l’ordre et de la loi éternelle, sur la manière dont nous connaissons notre âme, etc. Aussi je me borne presque toujours, dans mes analyses, à ces grands sujets, sans m’arrêter à le justifier sur certaines propositions incidentes, que je puis abandonner à la critique de nos adversaires sans faire tort à la vérité. Comme vous êtes curieux de savoir où j’en suis, je vais tâcher de vous satisfaire.
J’ai achevé toute l’histoire des Conversations chrétiennes, de ses Petites Méditations, des premiers Éclaircissements qu’il donna sur la Recherche de la Vérité, en 1678, dont je n’ai pourtant pas une liste assez exacte, n’ayant que la dernière édition de cet ouvrage. Je lui ai fait battre M. de La Ville, dos et ventre, le plus honnêtement du monde. J’ai montré assez clairement tout ce qu’il y a de foi sur la matière de la sainte Eucharistie. Enfin, j’ai commencé l’histoire curieuse du Traité de la Nature et de la Grâce, où j’ai fait un caractère de M. Arnauld, dont les premiers traits plairont beaucoup aux jansénistes et les derniers aux jésuites, et tous ensemble aux personnes raisonnables qui ne cherchent que la vérité sans prévention ni pour ni contre. Je fais actuellement l’analyse du Traité dont j’ai fini ce matin la première partie du premier discours. Je vous avoue que rien ne m’a tant coûté, car je tâche, par la seule exposition des principes, de mettre les choses dans une évidence à laquelle un esprit attentif ne puisse rien opposer. J’y tâche, mais y réussirai-je ? c’est la difficulté ; car je ne trouve pas même que le P. Malebranche y ait réussi dans l’abrégé qu’il en a fait à la fin de sa dernière réponse aux lettres posthumes de M. Arnauld. Aussi, je ne m’en sers point du tout, ni d’aucun autre ; car mon dessein est de donner du jour à la lumière même du P. Malebranche, en la rendant plus sensible et proportionnée aux yeux les plus faibles, pourvu seulement qu’ils veuillent s’ouvrir ; et c’est pourquoi je ne puis me contenter des extraits de ses ouvrages que je trouve dans les journaux qui me paraissent trop superficiels. L’auteur des Mémoires de sa vie m’avait pourtant conseillé d’en profiter ; mais je le prie de me dispenser en cela de suivre ses avis. Je gâterais notre ouvrage indubitablement en le rendant ainsi peu instructif et fort ennuyeux. Au reste, je vous y donnerai, à mon tour, un pouvoir despotique, lorsque je vous l’enverrai. Mais, par malheur, voici l’Avent et le Carême qui nous viennent un peu reculer. Ainsi, je ne suis point pressé de recevoir les éclaircissements que je vous avais demandés. Je crois même qu’il suffit que vous me les donniez lorsque j’aurai fini l’ébauche de notre histoire. Alors je vous prierai de me les envoyer rangés par ordre, et des nombres pour les distinguer, afin que j’y fasse plus d’attention. Voici encore quelques difficultés que vous aurez la bonté de me résoudre ; je crains de les oublier :
1°. Les Conversations chrétiennes furent-elles d’abord imprimées à Paris ? Le furent-elles sans privilège ?
2°. En qu’elle année M. Bossuet passa-t-il de l’évêché de Condom à celui de Meaux ?
3°. Combien y avait-il d’Éclaircissements dans l’édition de sa Recherche de 1678, et sur quoi étaient ceux qu’on a retranchés ?
4°. L’abbé Faydit dit-il un mot de vrai en ce qu’il rapporte du P. Malebranche dans ses livres ? Si cela est, il faut m’en envoyer des extraits.
5°. Combien de Méditations chrétiennes (je parle des grandes) le P. Malebranche avait-il composées en 1676 ? Nos Mémoires varient là-dessus.
6°. En quelle année le P. de Lagrange de l’Oratoire fit-il son livre contre les cartésiens ?
7°. Ne pourrions-nous point avoir l’histoire de l’affaire du P. Lami avec l’université d’Angers, pour le crime horrible de cartésianisme, et l’arrêt du conseil d’État porté le 2 août 1675, contre les entreprises de la raison, dame fort inconnue à la cour sous le règne précédent ?
8°. La maison de M. le marquis de Roussy, où se tint la conférence du P. Malebranche avec M. Arnauld, est-ce un hôtel à Paris ou une maison de campagne ? Quel était le caractère et le mérite de ce marquis ? Je sais seulement qu’il était de la maison de la Rochefoucauld.
9°. Qui sont ces auteurs qui ont fait voir la conformité des sentiments du P. Malebranche avec ceux de saint Augustin sur l’efficacité de la grâce ?
10°. Ne pourrait-on point avoir un abrégé de la Vie et des vertus de l’abbé de Saint-Jacques, M. d’Aligre, qui fit imprimer la Recherche ?
11°. Qu’est devenu le petit Traité de la Grâce que le P. Malebranche donna, dit-on, au P. Levasseur, alors professeur de positive à Saint-Magloire ? Ce qu’on en rapporte est-il bien avéré ?
12°. Qui est ce monsieur à qui le P. Malebranche adresse la parole assez brusquement dans une addition du Traité de la Nature et de la Grâce ?
Je veux savoir, Monsieur, tout ce qui appartient à mon sujet, non pas pour tout dire, mais pour être en état de parler juste sur tout ce que je dirai. En un mot, je veux que la vérité règne dans mon ouvrage, dans les moindres choses comme dans les plus grandes… »
AU MÊME. – 10 novembre 1716.
« J’ai fini l’analyse du Traité de la Nature et de la Grâce. Je ne sais si elle vaut quelque chose, mais je puis vous assurer qu’elle m’a beaucoup coûté. Je ne m’arrête qu’à ce qui est essentiel au système, laissant là toutes les propositions incidentes… Toutes mes analyses sont autant de petits traités avec tous leurs principes rapprochés les uns des autres, et les conséquences de leurs principes. Je tâche aussi d’y entremêler quelque ornement pour soutenir l’attention par le plaisir… »
À M. LARCHEVÊQUE. – Du 8 avril 1717.
« … Venons à nos affaires. J’ai repris mon ouvrage, qui me paraît avancer assez vite. J’en suis à l’analyse de la quatorzième des Méditations chrétiennes. J’en fais une par jour assez régulièrement. Ainsi, nous passerons bientôt à un autre livre du P. Malebranche : c’est le Traité de morale qui suit les Méditations, selon l’ordre de la chronologie de mon histoire, après quoi nous entrerons en dispute avec le grand Arnauld, etc. C’est ce qui me coûtera davantage ; car ce n’est pas une petite entreprise que de débrouiller des matières aussi épineuses que la philosophie et la théologie de ces deux fameux adversaires, de tenir toujours la balance égale entre eux, de faire sentir à propos qui a raison, qui a tort, et enfin d’égayer une dispute fort sérieuse de part et d’autre. Priez le Seigneur que j’y réussisse pour la gloire de la vérité et sans blesser en rien ni la justice ni la charité… »
À M. DE MARBEUF. – 3 mai 1717.
« … J’avance toujours dans mon histoire, et me voilà bientôt à la fin de la première partie du Traité de morale. Je tâcherai d’en avoir fait toutes les analyses avant le commencement de juin, où mon emploi me demande une interruption d’un mois. Mais je reprendrai mon travail en juillet jusqu’à nouvel ordre, car on ne sait ce qui peut arriver. Vous pouvez assurer le R.P. Lelong que j’ai reçu la lettre qu’il me fit l’honneur de m’écrire au commencement de cette année, avec quelques éclaircissements pour notre histoire… »
AU MÊME. – Sans date.
« … Pour revenir à notre histoire, je finis hier l’analyse du Traité de morale, qui m’a tenu plus longtemps que je ne l’aurais cru, à cause du peu d’exactitude qui règne dans certains chapitres ou par trop oratoriens ou plutôt trop oratoires pour un philosophe… Je vais décrire ses premières conférences avec M. de Meaux, le célèbre Bossuet, son voyage de Chantilly pour voir et convertir le grand Condé, sa conversation avec M. de Harlay, archevêque de Paris, et pour faire ensuite l’ouverture de la première campagne contre M. Arnauld. J’espère, Dieu aidant, que ce sera le meilleur endroit de l’ouvrage… »
AU MÊME. – 30 août 1717.





























