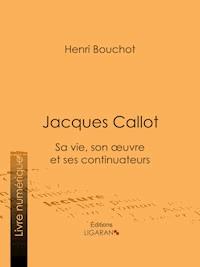
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "La petite cour des ducs de Lorraine avait eu pendant la fin du seizième siècle sa physionomie particulière : Charles III, gendre du roi de France Henri II, l'avait su rendre brillante et joyeuse. Fière de son autonomie, de ses coutumes spéciales, largement dotée de fabriques et d'industries de tous genres, la Lorraine formait un petit royaume où la noblesse trouvait à guerroyer, où les artistes avaient aussi la part assez belle."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CALCOGRAPHUS AQUA FORTI NANCEII IN LOTHARINGIA NOBILIS.
À mon beau-frère
Émile Chevalier
Capitaine de frégate
Ce livre est dédié.
H.B.
Jacques Callot, graveur de Nancy, est une personnalité brillante, un artiste hors de pair, une sympathique et curieuse physionomie. Son nom est populaire à l’égal de celui de Rabelais, et ses grotesques ou ses gueux sont restés dans la langue courante comme le Gargantua ou le Pantagruel. Par une loi bizarre et inexpliquée des réputations, c’est surtout ce moindre côté de son merveilleux talent qui s’est imposé et lui a donné la gloire. Pour beaucoup Callot n’est et ne saurait être que le grand fantaisiste des Gobbi ou des Baroni, l’interprète des bossus hideux ou des mendiants en guenilles. Tout l’œuvre grandiose et pénétrant du maître s’efface devant ces fantoches ; on oublie les conceptions hautaines et philosophiques, les pages les plus admirablement écrites, pour ces épigrammes nerveuses dont le ragoût plaît aux moins délicats. On ravale ainsi à l’état de simple caricaturiste un des tempéraments les plus complets du dix-septième siècle, un esprit original qui vaut surtout par sa manière d’expliquer les banalités, de traduire en son langage imagé les redites conventionnelles de ses devanciers, de faire, en un mot, besogne de grand artiste, œuvre de créateur.
Le temps était loin, à la fin du seizième siècle, des talents personnels. Confinée dans les données hiératiques de l’École italienne, courant par les sentiers battus et rebattus des Bolonais ou des Florentins, la peinture avait perdu la note timide et naïve, sincère et émue des vieux maîtres, pour ne plus admettre que les rééditions oiseuses des copistes de Raphaël. Celui-là était réputé le meilleur et le plus disert qui répétait imperturbablement la leçon apprise, sans autre souci. Et la gravure s’était, elle aussi, attelée à cette imitation chagrine ; les burinistes italiens s’appliquaient à circonscrire ces données dans leurs estampes lamentables. Tout un monde d’interprètes fidèles, mais froids et guindés, de tailleurs de cuivre inébranlables dans leur raideur, s’étaient formés à l’école des peintres. Il en était venu de partout, d’Allemagne, de France, des Flandres, voyageurs partis avec un bagage personnel, artisans diversement doués, qui bientôt s’uniformisaient au contact et se croyaient plus riches d’avoir tout perdu.
Tomber en pleine jeunesse au milieu de ce monde spécial et légèrement perclus, en subir les idées néfastes et vieillies, suivre quelque temps la voie, et tout à coup se redresser, jeter le froc comme on dit, faire de soi, sans exemple, sans guide, s’affirmer à un âge où les autres commencent à peine, c’était tenter bien gros et réussir inespérément. Jacques Callot eut le bonheur de ne point se briser à ce jeu. Il y a plus, sa philosophie, sa hardiesse de conception s’affinèrent au contact de ces médiocres ouvriers du burin. Un vague sentiment le ramena en arrière, il comprit que la vérité n’était plus guère que dans la vie de chaque jour, que la meilleure manière de faire parler ou agir les anciens, c’était encore de prendre ses contemporains pour modèles, à la façon des peintres du vieux temps. Il arriva donc pour lui que déjà touché de la convention il s’en dégagea pour une grande part, oublia du mieux qu’il put les formules toutes faites, et devint lui pour n’avoir été personne.
On s’explique mal aujourd’hui la succession d’évènements qui amenèrent le petit artiste lorrain, voué d’avance aux traductions pénibles du burin, aux copies monotones et insipides, à se faire son chemin à l’écart, sa carrière toute grande. Au temps où il vint en Italie, les graveurs n’aimaient guère les petites histoires, les riens charmants traités à l’eau-forte. Il semblait d’ailleurs que depuis Durer les adeptes de la pointe eussent honte de se mettre en parallèle avec les burinistes. Les plus admirés d’entre ces derniers redisaient les peintures décoratives dans des estampes énormes où l’outil traçait des lignes noires et lourdes, et qui s’appréciaient aux dimensions. Les artistes flamands mettaient au service des éditeurs italiens leur pratique savante et maniérée, et sous l’influence des goûts et des modes ils enchérissaient les uns sur les autres à qui saurait le mieux torturer une figure, et montrer les tailles les plus audacieuses.
Callot voulut les suivre, mais il s’égara. Sa main n’était pas celle d’un copiste habile, et son génie d’invention s’accommodait assez mal de ces mot-à-mot vulgaires. Inconsciente ou volontaire, la réaction se fit en lui. Il abandonna franchement les errements de l’école, et tenta d’écrire ce qu’il ressentait sur le cuivre, comme d’autres jetaient leurs idées sur la toile. Ses premiers essais étonnèrent un peu ; il rompait en visière avec une routine solidement assise. Mais il fut compris parce qu’il parlait le langage vrai, celui de tout le monde ; on admira les merveilleuses finesses de ces compositions intenses, où dans le plus petit espace des populations entières évoluent, où la vie se devine dans les microscopiques figures. Ce fut une révélation soudaine et irrésistible ; comme si les esprits et les yeux eussent été fatigués des conceptions olympiennes des Italiens décadents, l’engouement vint de ces fantaisies joyeuses. On retrouvait dans Callot un peu de la sincérité des primitifs avec quelque chose en plus, et la philosophie du Nord servie par une élégance tout italienne. Une preuve de succès, ce sont les imitations sans nombre que firent naître les estampes de l’artiste lorrain ; à Rome, à Florence, on chercha à parodier sa manière ; des graveurs français le suivirent bientôt, et de si près que leurs œuvres ont parfois causé des méprises.
Un médiocre graveur de l’école flamande, Lœmans, inscrivait au bas d’un portrait du maître : « Il s’adonnoit à l’eau-forte en laquelle il s’a rendu si extrême, qu’il est une merveille de le voir. » Jamais hommage plus vrai ne fut rendu à Jacques Callot. Il n’est point un grand artiste, il est un merveilleux ciseleur, un conteur charmant de choses vues. Ses envolées ne sont point grandioses, il ne conçoit pas à la façon de Michel-Ange ou de Raphaël, il s’en tient aux humbles choses, mais il leur donne un accent d’une pénétration singulière. Et si jamais le mot de merveille s’est appliqué justement aux œuvres de la pensée humaine, c’est bien à ces pages immortelles, synthèse superbe des gloires ou des misères d’une époque résultante de l’esprit qui sait comprendre et de la main qui sait traduire. La merveille, c’est d’être revenu en arrière, c’est d’avoir repris pour son compte un coin de nature et de l’avoir exposé naïvement au monde. C’est d’avoir su rendre dans un trait précis et simple à la fois la tournure vraie des hommes et leurs passions éternelles.
Les origines de Jacques Callot. – Sa noblesse. – Jean Callot, son père, héraut d’armes du duché de Lorraine. – Sa première éducation artistique. – État des arts à la cour de Lorraine au commencement du dix-septième siècle. – Jacques Callot s’enfuit en Italie. – Les bohémiens compagnons de roule de Callot, et leur influence sur son talent. – Séjour à Florence à l’atelier de Canta Gallina. – Retour forcé en Lorraine. – Demange Crock, graveur de la monnaie à Nancy. – Seconde fugue en Italie. – Troisième voyage en compagnie du comte de Tornielle avec l’autorisation de son père Jean Callot. – Arrivée à Rome ; Israël Henriet et Claude Deruet. – Premiers travaux dans l’atelier de Thomassin. – Départ pour Florence.
La petite cour des ducs de Lorraine avait eu pendant la fin du seizième siècle sa physionomie particulière ; Charles III, gendre du roi de France Henri II, l’avait su rendre brillante et joyeuse. Fière de son autonomie, de ses coutumes spéciales, largement dotée de fabriques et d’industries de tous genres, la Lorraine formait un petit royaume où la noblesse trouvait à guerroyer, où les artistes avaient aussi la part assez belle. Au nombre des officiers de la maison ducale, Claude Callot, archer des gardes, s’était fait une situation enviée. Issu d’une famille bourguignonne qu’on disait attachée au Téméraire, marié, suivant une légende, à la petite-nièce de Jeanne d’Arc, Claude de Fricourt, il sut gagner les bonnes grâces de son maître, et, bien que simple aubergiste des Trois Rois, il fut anobli par lettres patentes du 30 juillet 1584, laissant à son fils Jean, en même temps qu’une petite fortune, des prétentions aristocratiques et la survivance de son office. Le grand pas était franchi pour les Callot ; ils prenaient rang dans la haute bourgeoisie nancéienne. Jean ne tarda pas à monter encore dans la hiérarchie, et quand il épousa, en 1587, Renée Brunehaut, il était héraut d’armes du duché de Lorraine sous le nom de guerre de Clermont.
Le héraut d’armes, sans être une puissance, avait une place marquée dans les cérémonies et les tournois. Il réglait certains détails, blasonnait les armes des combattants, portait la parole au nom du prince ; on le revêtait dans les grands jours d’une dalmatique armoriée qui en imposait beaucoup. Jean Callot prenait très au sérieux ses fonctions et, suivant la commune loi, comptait pour beaucoup sa noblesse récente. Il rêvait pour les fils que lui avait donnés sa femme les plus belles situations de l’État ou de l’Église. Malheureusement pour lui, Jacques, le puîné, à peine âgé de dix ou onze ans, dédaignant les belles-lettres grecques ou latines, s’enfermait des journées entières dans l’atelier de Demange Crock, graveur de la monnaie, dans celui du peintre Claude Henriet, mille fois plus attaché par leurs travaux que par les poètes ou les prosateurs d’Athènes ou de Rome. Peintre ! le mot sonnait mal aux oreilles du héraut d’armes ; pour un qui réussissait, pour un Woériot, un Béatrizet, un Bellange, combien se condamnaient à un labeur misérable au fond d’une échoppe mal jointe, confondus avec les gens de métiers, les gagne-petit de toutes les sortes ! Et à ne prendre qu’Henriet, quelle vie était la sienne ! Levé tôt, couché tard, barbouillant du matin au soir les plus infimes choses, portraiturant les uns, peignant les armoiries des autres, il réussissait péniblement à joindre entre eux quelques rixdallers destinés à la pâture quotidienne. Pour la gloire ou l’honneur, rien ou pas grand-chose.
Sans doute il y avait eu en Lorraine Didier de Vic, revenu de Rome et qui « toute sa jeunesse avait fréquenté les Italles, et hanté avec les meilleurs esprits de son art ». On connaissait Raymond Constant, peintre de piétés ; Jean de Wagenbourg, portraitiste en titre du duc Charles III ; Vignolles, dont la maison touchait à l’école des Pères Jésuites et qui exerçait des séductions infinies sur les « apprentifs en grammaire ». On savait même que le prince tenait beaucoup à ce monde d’artistes, qu’il les retenait à prix d’or chez lui. Mais que prouvait cela, sinon que ceux-là avaient du talent, du savoir-faire, au rebours des traîne-misère du même état ? À supposer même que le jeune garçon fût compris dans les libéralités du duc Charles et qu’il partît pour l’Italie avec tant d’autres, n’irait-il pas s’échouer là-bas loin du pays, et ne reviendrait-il pas quelque jour désabusé, dégoûté, sans position possible ?
Et tandis que Jean Callot, le fils aîné, donnait les meilleures satisfactions au héraut d’armes, Jacques demeurait sourd aux remontrances, crayonnait en cachette, courait les routes en compagnie d’Israël Henriet son compagnon, presque du même âge, et s’abîmait dans une idée folle. Comment apprit-il à moins de douze ans, en 1604, le moyen de gagner l’Italie, le chemin à suivre au sortir de Nancy pour passer à Florence, sinon au milieu de ces peintres qui tous parlaient avec admiration de leurs équipées de jeunesse ? Les uns étaient partis en compagnie de marchands, d’autres seuls, sans argent en gens faisant leur tour de France, en courtauds de boutanche, suivant le mot d’argot, mendiant leur vie au nom de l’art sublime, de l’art rêvé. Et Israël Henriet qui venait d’arriver là-bas et qui envoyait de temps à autre au pays des lettres enthousiastes ! Au milieu de quelque mercuriale paternelle, dans la crainte de voir se transformer pour lui le collège en prison, Jacques Callot prit une résolution solennelle, celle de partir, de partir de suite et seul, sans un rouge liard, sans guide pour ne point éveiller les soupçons.
Les routes sont peu sûres, et si tous chemins conduisent à Rome, encore faut-il ne point être arrêté comme vagabond. Le bissac au dos, la canne à la main, le malheureux petit gagne de vitesse les terres de la comté de Bourgogne ; de là il passera à Lyon et atteindra le mont Cenis. Au temps qui nous occupe, les grandes voies de communication étaient singulièrement peuplées. Les seigneurs à cheval, les argonniers ou charretiers de l’Argonne, chargés des transports de marchandises du nord au sud, les piétons, compagnons, mendiants, les courriers de province à province, sillonnaient les routes en tous sens, se prêtant les uns aux autres aide et confort, protection si besoin en était. Le moyen d’abandonner un enfant chétif et pauvre parti pour l’Italie en pareil équipage ! Aujourd’hui dans une ferme isolée, demain sous la tente d’un argonnier, le couvert se trouve que bien que mal, et quant à la provende, les bonnes âmes l’offrent d’elles-mêmes. Et l’on conte son histoire à tous venants, aux bons, aux indifférents, même peut-être à quelques bandits déguenillés voyageant en troupe armée, qu’on a rencontrés sur le chemin d’Italie. Caravane bizarre venue du bout du monde sur des bidets étiques, parlant toutes les langues, connaissant l’univers entier et Nancy par-dessus le marché ; hommes affublés de rapières et de pistolets, femmes couvertes de loques et de verroteries, garçonnets coiffés de marmites, armés de grils et de broches comme les mardis-gras flamands. Et accueillants avec cela, et peu scrupuleux ! Jacques Callot les suit faute d’autres, un peu séduit par leurs allures, et par crainte aussi de leur déplaire. Il les voit dire la bonne aventure aux gens, piller les fermes, assassiner peut-être, mais il ne souffle mot, car ils jettent au voyageur une cuisse de poulet et lui offrent une place au bivouac.
Le fuyard ne s’en doute pas, mais il est sous le charme étrange de ces êtres, il subit à son insu la poésie farouche de ces visages tannés, de ces faces couturées de cicatrices. Sa mémoire d’enfant se peuple de silhouettes invraisemblablement accoutrées, où les manteaux s’accrochent aux colichemardes en verrouil, où les plumes de coq empanachent les feutres défoncés. Longtemps il oubliera cette vision, il la rejettera même comme un cauchemar. Mais vienne la trentième année, le succès qui excuse les escapades, le repos qui met au point les souvenirs, et dans un retour fécond aux années de jeunesse, l’artiste grandi animera superbement ces avatars. Et quelle surprise de rentrer dans son élément, les gueux, les héros borgnes, les soudards empennés, en relisant à vingt ans d’intervalle cette première page de sa vie ! Comme ces bohémiens avaient fait impression sur lui, eux qu’on retrouve dans la plupart de ses œuvres antérieures, dans les démons de la Tentation de saint Antoine, dans les caprices, et jusque dans les tire-laine de la Foire de Florence ! Ils avaient mieux fait, les vagabonds, que de rendre la route plus facile au voyageur ; ils lui avaient inconsciemment dévoilé son génie. Jacques Callot s’essayera à tous les genres ; il montrera les Hébreux bourreaux du Christ, les Florentins courant aux fêtes, les paysans et les seigneurs, les réprouvés ou les saints ; mais toujours apparaîtront ses anciens compagnons de route, à la façon de ces airs de berceuse entendus dans l’enfance, dont Lulli semait les œuvres de son âge mur.
Quand il eut quitté ses amis d’occasion aux portes de Florence, le jeune Lorrain se prit à errer dans les rues, sur les bords de l’Arno, à chercher sa vie. C’est un officier qui, le voyant bayer aux corneilles, les yeux rouges, l’interrogea et connut son odyssée. On dit qu’il en eut compassion et qu’il le recommanda au graveur Canta Gallina, artiste médiocre d’ailleurs, mais dont l’atelier jouissait d’une certaine célébrité. Jacques Callot fut admis par grâce au nombre des élèves, et bénéficia de son courage. Son malheur voulut que des marchands nancéiens le rencontrassent et missent un nom sur sa figure. C’était bien là le fils du héraut d’armes disparu depuis longtemps et que ses parents pleuraient. Un peu de gré, beaucoup par force, ils l’entraînèrent avec eux, le hissèrent sur leurs charrettes et reprirent avec lui la route de Lorraine en passant par le mont Cenis et Lyon. Voilà l’enfant prodigue revenu, et choyé je vous laisse à penser ! Mais quelle sotte idée n’avait-il pas eue ? Tenir ainsi les chemins en compagnie de gens sans aveu, pour une misérable chimère !
Jacques ne répondait pas, car ses illusions n’avaient pas disparu ; pour si peu sa volonté ne s’était point lassée. Il reprenait chez Demange Crock la suite interrompue de ses essais, il se vouait à un labeur incessant dans les instants dérobés à la surveillance active de son père. Celui-ci désespérait un peu, tout en jugeant l’enfant assez puni de son escapade pour ne plus tenter l’aventure. Un matin on ne le trouva plus ; il s’était enfui dans la nuit, et, jouant des jambes, il arrivait à Turin dans les premiers jours de l’année 1606 ; son frère Jean, lancé à sa poursuite, l’y rejoignit, et pour la seconde fois le ramena à leur père.
Que faire contre une vocation aussi prononcée ? On imagina que le temps et les déboires corrigeraient l’enfant, que l’appât d’une place officielle le ferait réfléchir, qu’il oublierait bientôt l’art et les artistes. Et pour ne pas le pousser à bout, on le laissa plus volontiers crayonner ; on le confia à Crock et à Henriet, avec mission de le faire travailler. Déjà le garçonnet s’était essayé au portrait, et sur la demande probable de son père, il avait fait sa cour au souverain en gravant sur le cuivre une médiocre effigie qu’il signa magistralement à la mode des gens arrivés. L’estampe n’a rien de flatteur pour le modèle, elle est lourde, embarrassée ; c’est un bégaiement enfantin. Elle nous est parvenue toutefois, parce qu’on la répandit et qu’on en fit de nombreux tirages. Les courtes leçons de Canta Gallina n’avaient point été perdues d’ailleurs ; Jacques Callot les mit à profit dans une grande planche où, sous l’inspiration de son père, il racontait en plusieurs tableaux la légende de la famille des Porcellets. Les Callot avaient des obligations nombreuses à ces nobles de vieille souche lorraine ; les fantaisies un peu naïves de Jacques servirent de remerciement.
Tout le bien qu’on dit alors de ces productions, des dispositions qu’elles montraient, ouvrit les yeux au héraut d’armes. Quand son fils ne lui servirait plus tard qu’à l’aider dans un projet de livre de blason sur les anciens chevaliers du duché, l’espérance valait bien qu’on le préparât à cette besogne. Sur ces entrefaites le duc Charles III mourut, en mai 1608, et dans le brouhaha des cérémonies préparées, dans les mille démarches nécessitées par sa fonction spéciale, Jean Callot abandonna un peu son fils à lui-même. Pendant deux mois entiers la ville de Nancy fut à l’envers. Le maître des cérémonies, J. de la Ruelle, dessinateur assez habile, décorait les salles du palais, faisait dresser les échafauds et les catafalques, et livrait ses esquisses et ses plans à Jean de La Hière, qui les transcrivait en les mettant au point, en leur donnant la perspective. On chercha vainement à Nancy un graveur capable de reproduire ces croquis sur le cuivre, en vue de l’impression. Les habiles étaient en Italie ou en France. On dut appeler un aquafortiste strasbourgeois, Frédéric Brentel, qui s’acquitta au mieux de ce travail hâtif, bâclé en quelques semaines et bientôt livré au public en album in-folio relatant les moindres circonstances des funérailles. L’art de ces estampes curieuses n’est point à mépriser. J’imagine que leur habileté, que les groupements de milliers de personnages en d’étroits espaces, que la tournure libre et franche des figures firent impression sur Jacques Callot. Son père y avait été représenté dans le cortège, portant la cotte armoriée des grands jours ; il n’en fallait pas plus pour que l’enfant étudiât et conservât dans sa mémoire le détail précis et nerveux du graveur, et en fit son profit.
La disette d’artistes spéciaux constatée par la venue de Brentel laissa-t-elle concevoir à Jean Callot quelque espoir pour la carrière future de son fils ? comprenait-il que la décision de l’enfant était irrévocable et qu’on ne gagnerait rien à la vouloir contrarier ? Je ne saurais affirmer rien ; tout ce qu’on peut dire, c’est que moins de six mois après l’enterrement du duc Charles, quand Henri, son fils et successeur, envoya en ambassadeur à Rome le comte de Tornielle, surintendant de sa maison, pour notifier son avènement au pape, Jacques Callot se joignit au cortège avec l’assentiment de tous les siens. C’était la revanche éclatante, la consécration attendue qu’on n’eût point osé rêver, la marche triomphale après les équipées du bohème. Monté sur son roussin de voyage, la plume au feutre, la tête farcie de projets insensés, le jeune graveur partait à la conquête de Rome, à l’assaut de la gloire.
Si l’on en croit Félibien, qui disait le tenir des amis de Callot, celui-ci eût demandé à Dieu une seule chose, de vivre jusqu’à quarante-trois ans ; ce fut sa constante prière, et exaucée comme on verra. On eût dit qu’il sentait la faiblesse de son corps menacée par l’énergie intense de la volonté et de l’esprit. À Rome il ne se trouvait plus en pays indifférent : c’est là que vivaient Israël Henriet, son camarade, et Claude Deruet, peintre nancéin, tous deux suivant des voies différentes, mais déjà sortis du niveau modeste des apprentis. Ils l’amenèrent à l’atelier d’Antonio Tempesta ; peintre-graveur habile, décorateur du Palais Vieux de Florence, et qui tenait de Stradan, son maître, un goût particulier pour les scènes de mœurs et les chasses. Tempesta avait une réputation acquise ; le patronage du cardinal Granvelle, la mode venue de ses productions, en faisaient un personnage, peut-être un peu dédaigneux des humbles, mais capable de leur donner de temps à autre un conseil profitable. Jacques Callot le vit trousser une eau-forte, et comprit vite le parti à tirer de ce mode primesautier et hardi dans les compositions originales. Son malheur voulut que ses ressources s’épuisassent assez vite, et qu’il ne pût continuer à fréquenter dans la maison du maître. Loin de songer à rendre ses propres idées, à écrire ses pensées, il fallut traduire celles des autres, il fallut échouer misérablement à tailler au burin des images de piété pour en tirer monnaie.
Philippe Thomassin, artiste champenois établi à Rome, tenait fabrique spéciale de ces estampes religieuses, en même temps qu’il fournissait au commerce des pièces d’orfèvrerie. Élève de Corneille Cort pour le burin, Thomassin avait le travail lourd et mesquin, assez clair et défini pourtant : il s’attachait à reproduire les œuvres contemporaines ou les tableaux de Raphaël, l’ancien et le moderne sans accent, sans naïveté, en coulant tout dans un moule uniforme, suivant la formule unique empruntée à la fois aux Italiens et aux Flamands. Les estampes des Sadeler faisaient alors fureur à Rome ; Thomassin employa Callot à les copier par le burin, et c’est ainsi que le jeune homme collabora à une série des Mois de l’année d’après Jacques de Momper où le pastiche apparaît évident et misérable : travail impersonnel, oiseux, triste corvée d’un Pégase attelé à la charrue. Callot eût pu se perdre à ce labeur, égarer sa main dans une recherche précieuse si éloignée de son tempérament d’origine. Par bonheur il se brouilla avec le graveur champenois, on dit par la jalousie que Thomassin ressentit des assiduités de son élève auprès de sa jeune femme, mais peut-être bien plutôt par le vague dépit qu’il eut d’avoir trouvé son maître.
Il faut vivre ! Les contemplations idéales des chefs-d’œuvre, les promenades à travers les merveilles de la Ville éternelle, la fréquentation même des maîtres, n’eussent point tardé à mettre le Lorrain minable sur le pavé. Israël Henriet, son ami, allait quitter Rome, les conseils et les secours lui manqueraient bientôt ; il fallait deux mois pour recevoir de Lorraine la moindre réponse. Son désaccord avec Thomassin n’était point d’ailleurs sans lui nuire auprès des éditeurs romains. Il se résolut à partir pour Florence, où l’art se tenait plus en dehors des mercantis et des tailleurs de planches à la grosse. Jacques Callot se souvenait de Canta Gallina ; on lui parlait de Julio Parigi, à la fois ingénieur, graveur et peintre, ayant reçu des Italiens du seizième siècle l’amour des formes allongées et délicates, des figures grêles qui paraissaient alors la grâce exquise, et que les meilleurs artistes exagéraient de plus en plus. Et puis Florence avait une cour célèbre, des princes alliés à la famille des ducs lorrains, une vie générale plus active. La tournure des esprits n’y était pas bornée aux horizons pieux, les tempéraments les plus divers pouvaient s’y faire la part belle ; Callot, voué depuis deux ans aux reproductions froides et guindées, vivant dans un milieu de gens butés sur les données hiératiques toujours semblables, fut pris de la nostalgie de cette ville à peine entrevue ; Henriet l’ayant quitté, plus rien ne le retenait à Rome : il partit pour Florence.
Les tâtonnements. – Callot grave l’Enfer de Bernard Poccetto. – Gravures au burin d’après les maîtres. – L’album des Funérailles de Marguerite d’Autriche. – Callot à l’atelier de Julio Parigi ; les encouragements et les conseils. – Cosme II, grand-duc de Toscane, et les artistes – Callot grave au burin les Batailles des Médicis. – Callot et les tendances italiennes. – Parigi et les fêtes florentines. – Il grave la Guerre d’Amour, sa première œuvre réellement personnelle.





























