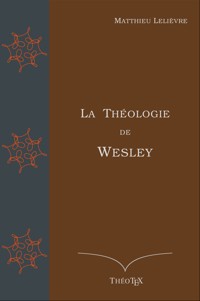Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Évangéliste exceptionnel par son charisme et sa puissance de travail, John Wesley a littéralement réveillé la foi chrétienne en Angleterre au dix-huitième siècle, tandis que le reste de l'Europe, et en particulier la France, sombrait dans l'incrédulité et le rationalisme. On estime à dix fois le tour de la terre la distance parcourue à cheval, et à quarante mille le nombre de sermons prêchés durant la cinquantaine d'années de son ministère itinérant ; perché sur sa monture, le cavalier lisait ou composait, sans perdre une minute. Ajoutant à cela d'innombrables visites pastorales, deux centaines d'ouvrages composés ou abrégés par lui, dont le produit était donné aux nécessiteux, l'organisation d'une société qui comptait à sa mort plus de soixante-dix mille membres, nous obtenons, comme l'a dit Charles de Rémusat, un des plus parfaits modèles de la sainteté dans la vie active. En comparaison d'impact sur l'histoire religieuse d'une nation, Wesley fut en quelque sorte le Luther anglais. La biographie écrite par Matthieu Lelièvre (1890-1930), dont ThéoTeX reproduit ici le texte de la troisième édition, est certainement la meilleure que nous possédions en français du père du méthodisme.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 724
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ce fichier au format EPUB, ou livre numérique, est édité par BoD (Books on Demand) — ISBN : 9782322483136
Auteur Matthieu Lelièvre. Les textes du domaine public contenus ne peuvent faire l'objet d'aucune exclusivité.Les notes, préfaces, descriptions, traductions éventuellement rajoutées restent sous la responsabilité de ThéoTEX, et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation.ThéoTEX
site internet : theotex.orgcourriel : [email protected]L'ouvrage dont nous publions une nouvelle édition n'était plus en librairie depuis longtemps. La première édition, parue en 1868, quoique tirée à 2 500 exemplaires, fut rapidement épuisée. Couronné dans un concours, reçu avec faveur par la presse française et étrangère, présenté dans un grand article aux lecteurs de la Revue des Deux Mondes par M. Charles de Rémusat, traduit en quatre langues, notre livre a prouvé auprès du public un accueil auquel nous étions loin de nous attendre et qui nous a été un précieux encouragement.
Cette bienveillance nous créait l'obligation de rendre notre travail un peu moins indigne de son succès. Nul plus que nous ne connaissait les parties faibles et les lacunes d'une œuvre trop hâtivement composée pour être définitive. Aussi avons nous ajourné la publication, depuis longtemps promise, d'une nouvelle édition jusqu'au moment où il nous serait possible de remettre sur le métier notre livre et de le refondre complètement.
C'est le résultat de ce travail que nous offrons aujourd'hui au public. Tout ce qui était dans la première édition se retrouve dans celle-ci, avec les retouches et les modifications reconnues nécessaires ; mais, de plus, la matière de l'ouvrage s'est étendue, de telle sorte que l'édition de 1883 compte plus de 500 pages, tandis que celle de 1868 n'en avait que 300. Cette extension provient à la fois de l'adjonction de faits laissés d'abord de côté, et d'un élargissement du plan primitif. Notre premier travail était essentiellement une vie populaire de Wesley. Sans lui enlever ce caractère, nous avons voulu cette fois-ci donner satisfaction également aux besoins des hommes d'étude et leur offrir une œuvre plus travaillée. C'est ainsi, par exemple, que la controverse calviniste, à laquelle nous n'avions consacré que quelques lignes, occupe tout un chapitre dans cette nouvelle édition.
Les sources de ce livre sont nombreuses. Aucun ouvrage important concernant le réveil du xviiie siècle n'a été négligé. Nous avons mentionné, dans la première édition, les biographies de Wesley par Moore, Southey, Watson, etc. ; les histoires du méthodisme de Smith et de Stevens ; les ouvrages d'Isaac Taylor, de Thomas Jackson, de John Kirk, les œuvres de Wesley et principalement son journal. Nous devons, cette fois-ci, une mention spéciale au grand ouvrage de M. Luke Tyerman (the Life and Times of John Wesley, 3 vol. 1871), qui, avec une érudition consommée, a recueilli sur Wesley une masse de faits et de documents. Nous avons eu constamment ce savant ouvrage sous les yeux, et nous croyons n'avoir rien omis de ce qu'il renferme d'essentiel.
Nous avons essayé d'être impartial et de faire une œuvre qui ne ressemblât en rien à un panégyrique. Mais nous ne nous défendons pas d'avoir senti grandir en nous, à mesure que nos études se poursuivaient, une vive admiration pour l'éminent serviteur de Dieu dont ce livre raconte la vie. Il fut de ceux qui, en quittant ce monde, le laissent meilleur qu'ils ne l'ont trouvé. Nous avons besoin de tels hommes aujourd'hui, et nous osons espérer que nos lecteurs, après avoir appris à mieux connaître Wesley, s'associeront aux réflexions suivantes, inspirées à un esprit distingué par l'étude de l'histoire morale et religieuse de l'Angleterre du xviiie siècle.
« Quand on voit les tristes malentendus qui aujourd'hui éloignent de l'Évangile tant d'hommes civilisés et de si grandes multitudes, n'est-il pas fortifiant de se dire que d'autres sociétés se sont égarées et qu'elles ont ensuite retrouvé le chemin ? Les grands serviteurs de Dieu ne sont pas la propriété ou le secret de l'Angleterre ; Dieu peut les faire surgir où il veut ; il peut donner à la société française un Wesley français. Oh ! qu'il vienne, et quel que soit le nom de son Église, qu'il soit béni ! »a
Pour bien comprendre le caractère de l'œuvre accomplie par Wesley et ses collaborateurs en Angleterre, il est nécessaire de se rendre compte de l'état moral et religieux de ce pays au moment où ils parurent. Ce sujet mérite d'être traité avec quelques détails.
La tache originelle du protestantisme anglais, ce fut une acceptation incomplète des principes de la Réformation ; il eut le malheur d'avoir pour parrain Henri VIII, et ce roi entendait ne rompre avec le passé que sur la seule question de la suprématie, qu'il enlevait au pape pour se l'attribuer à lui-même. Ce prétendu réformateur brûlait comme hérétiques les partisans des doctrines de Luther et faisait pendre comme traîtres les catholiques fidèles à l'autorité du papeb. Sans le vouloir, il favorisa néanmoins la propagande évangélique, et les doctrines nouvelles firent, à son insu, leur chemin parmi le peuple. Les persécutions que les protestants eurent à subir sous le règne de Marie Tudor, ne servirent qu'à les attacher plus fortement à leur foi.
Avec Elisabeth, l'Église anglicane se fonde définitivement ; elle naît d'un compromis entre les prétentions de l'État à la suprématie et les convictions évangéliques des réformés. Elle conserve une organisation hiérarchique et des formes liturgiques empruntées à l'Église de Rome, mais elle adopte la langue vulgaire et invite les fidèles à joindre leur voix à celle de l'officiant. Sa confession de foi des trente-neuf articles est telle que Calvin et Knox auraient presque pu la signer, mais son rituel conserve des traces de catholicisme qui devaient soulever les protestations des consciences.
Ce fut surtout contre la prétention de la royauté à la suprématie dans l'Église que s'élevèrent les protestations de tous ceux pour qui la Réforme impliquait un retour au christianisme apostolique. Bien qu'Elisabeth eût formellement répudié pour elle-même le caractère sacerdotal que son père avait revendiqué, elle n'en restait pas moins le chef de l'Église d'Angleterre. Cette Église, nourrie et élevée dans les bras du pouvoir royal, dont les embrassements faillirent l'étouffer, resta donc une institution politique plus encore qu'une institution religieuse.
Ses ministres, appelés à remplacer, dans l'esprit du peuple, les superstitions romaines par la pure foi évangélique, étaient absolument insuffisants. Les mêmes hommes continuaient à avoir la direction des mêmes paroisses et passaient avec la plus grande facilité de la foi ancienne à la foi nouvelle, ou de la foi nouvelle à la foi ancienne, suivant les ordres qui leur venaient de la cour. Retombés dans le papisme avec Marie, ils revinrent au protestantisme avec Elisabeth ; il y en eut deux cents à peine sur neuf mille quatre cents qui préférèrent leurs convictions à leurs bénéfices. La plupart savaient peu de chose. La sécularisation des biens ecclésiastiques les avait réduits à une condition misérable. Plusieurs étaient obligés, d'après Southeyc, de se faire, pendant la semaine, tailleurs, menuisiers et même cabaretiers. « Ils gagnaient leur pain quotidien, dit Macaulay, en cultivant leur champ, en élevant des porcs, en chargeant des tombereaux de fumier, et tout leur travail ne les préservait pas toujours de l'ennui de voir vendre leur concordance et leur écritoire par voie de justice. C'était un beau jour dans leur vie que celui où ils étaient admis dans la cuisine d'une bonne maison et régalés de viande froide et de bière par les domestiquesd. »
La réforme anglaise eût été bien compromise si elle n'avait eu d'autres propagateurs que les membres de ce clergé officiel, qui s'étaient bornés à substituer l'anglais au latin dans leurs offices, parce que l'ordre leur en était venu d'en haut. Heureusement qu'à côté de la réforme officielle, qui fut l'œuvre de la royauté, il s'en produisit une autre, qui fut l'œuvre du peuple. Le puritanisme fut, pendant un siècle, une grande école de piété et de liberté, et il ne faut pas que ses exagérations et ses étroitesses nous fassent méconnaître la grandeur des services qu'il rendit au protestantisme. Sous la forme presbytérienne en Ecosse, sous la forme indépendante en Angleterre, il représenta un mouvement religieux d'une intensité extraordinaire et qui a laissé les traces les plus profondes dans l'histoire religieuse de ces pays. L'opposition acharnée que lui fit la royauté l'amena à descendre sur le terrain dangereux des luttes politiques, où il prit parti pour les droits du peuple contre le despotisme royal. Son triomphe politique éphémère avec Cromwell, et les vertus qu'il montra en face des persécutions de la restauration, ne le sauvèrent pas d'une décadence religieuse profonde.
Les agitations politiques du xviie siècle eurent donc un double résultat, également déplorable. En maintenant l'Église anglicane dans une situation d'absolue dépendance à l'égard de l'Etat, elles l'empêchèrent de conquérir la puissance religieuse qui lui avait manqué à l'origine. Et, en faisant du puritanisme un parti politique, elles tarirent presque en lui cette sève spirituelle qui l'avait distingué à ses débuts. Triste résultat des révolutions, qui semblent ne pouvoir fonder la liberté d'un peuple qu'en corrompant sa foi et ses mœurs !
Tous les historiens s'accordent à peindre sous les plus sombres couleurs l'état moral de l'Angleterre sous Guillaume, Anne et les deux premiers Georges (1688-1760). « Jamais, dit un écrivain moderne, un siècle ne s'est levé sur l'Angleterre chrétienne, aussi vide de foi que le siècle qui s'ouvre avec la reine Anne et qui atteint son apogée ténébreux sous le second Georges. Les puritains étaient enterrés, et les méthodistes n'étaient pas encore nés. Le monde avait l'air ennuyé et mécontent d'un viveur au lendemain d'une nuit d'orgie. Le règne de la bouffonnerie était passé, mais le règne de la foi et du zèle n'avait pas commencée. »
La haute société anglaise n'était pas encore sortie de cette longue orgie où l'avaient plongée Charles II et ses courtisans. La famille royale donnait l'exemple du dérèglement des mœurs, et la noblesse l'imitait. Lord Chesterfield, dans ses lettres à son fils, l'instruisait dans l'art de la séduction comme dans l'une des branches de l'éducation d'un homme bien élevé. Le beau monde de Londres était aussi corrompu que celui de Versailles, mais il l'était avec brutalité et manquait de ce vernis que la politesse de la société française jetait sur ses désordres. « On voyait communément, dit Addison, un homme qui s'était enivré en bonne compagnie, ou qui avait passé sa nuit dans les orgies, s'en vanter le lendemain devant des femmes pour lesquelles il affichait le plus grand respect. »
Ce trait donne la mesure de la valeur morale des femmes qui toléraient et encourageaient de tels propos. Comment d'ailleurs eussent-elles mieux valu que les hommes, n'ayant reçu que la plus déplorable éducation au foyer domestique, qui ne ressemblait en rien au home anglais d'aujourd'hui, — ne connaissant en fait de religion qu'un culte sans vie, dont les représentants étaient en général peu recommandables, — et n'ayant à leur disposition, pour se cultiver l'âme, que des romans équivoques et des pièces de théâtre licencieuses.
S'il est vrai que la littérature d'une époque soit le reflet de ses mœurs, le théâtre de Wycherley, de Congreve, de Dryden lui-même, jette une triste lumière sur les générations qui l'applaudirent. Ces écrivains portent sur la scène des mœurs grossières, des situations équivoques et des détails obscènes sans paraître éprouver le moindre scrupule. La pudeur britannique, si caractéristique aujourd'hui, n'était pas encore née.
La vénalité des hommes politiques est l'un des scandales de l'histoire de l'Angleterre à cette époque. Le duc de Marlborough, Russell, Bolingbroke, Shrewsbury, Halifax ne se font pas scrupule de servir à la fois deux maîtres, les Stuarts et la maison de Hanovre, et de recevoir des deux mains. Robert Walpole, premier ministre pendant vingt ans, se vantait de savoir le prix de chaque conscience et dépensait des sommes énormes pour acheter les voix et pour s'assurer dans le Parlement des majorités imposantes.
La passion de l'argent faisait tourner toutes les têtes. On vit des pairs du royaume, des ministres, et le prince de Galles lui-même, s'enrichir dans des spéculations véreuses. Montesquieu, qui visita l'Angleterre à cette époque, pouvait dire : « L'argent est ici souverainement estimé, l'honneur et la vertu peu. » — « Les Anglais, disait-il encore, ne sont plus dignes de leur liberté. Ils la vendent au roi ; et, si le roi la leur redonnait, ils la lui vendraient encoref. »
Il constatait en même temps l'absence de religion : « Point de religion en Angleterre ; quatre ou cinq de la Chambre des communes vont à la messe ou au sermon de la Chambre. Si quelqu'un parle de religion, tout le monde se met à rire. Un homme ayant dit de mon temps : Je crois cela comme article de foi, tout le inonde se mit à rire. » L'état religieux de l'Angleterre lui paraissait inférieur à celui de la France, qui pourtant était alors sous la régence : « Je passe en France, disait-il, pour avoir peu de religion, en Angleterre pour en avoir trop. »
L'historien Lecky constate qu' « un scepticisme latent et une indifférence générale dominaient partout dans les classes cultivées. L'opinion courante était que le christianisme n'était pas vrai, mais qu'il fallait le maintenir comme essentiel à la société. La vieille religion semblait avoir perdu toute prise sur l'esprit des hommes, et souvent elle n'avait pas grande influence, même sur ses défenseursg. »
L'incrédulité des classes cultivées de l'Angleterre eut, pendant plus d'un siècle, ses docteurs et ses philosophes, dont les uns voulaient remplacer le christianisme par la religion naturelle, tandis que les autres glissaient plus ou moins vers l'athéisme. Depuis Hobbes, théoricien du pouvoir absolu et sceptique en religion, jusqu'à Bolingbroke, chef incrédule du parti de la haute Église et ami de Voltaire, l'Angleterre vit se succéder toute une lignée d'écrivains de valeur inégale, qui attaquèrent avec vigueur la révélation chrétienne.
Le superficiel Toland combattit le christianisme par tous les moyens, multipliant ses livres et ses sophismes, et portant ses déclamations dans les cabarets aussi bien que dans les salons. L'élégant comte de Shaftesbury jeta par-dessus bord la révélation, tout en lui accordant d'ironiques hommages. Le peu scrupuleux Collins, avec des prétentions hypocrites à l'impartialité, travailla à ruiner les bases de la foi chrétienne, usant contre elle de toutes les armes, même des moins loyales. Le fanatique Woolston, dans ses Discours sur les miracles, qui se vendirent, dit-on, à trente mille exemplaires, prit violemment à partie l'histoire évangélique, dans laquelle il ne voyait que mythes et légendes, et fut le premier à porter ouvertement l'attaque sur le fait central de la résurrection du Christ. Avec Tindall, Morgan et Chubb, l'école incrédule anglaise baissa de ton et enveloppa prudemment ses négations dans une phraséologie d'une modération affectée. C'était le moment où s'accomplissait une grande révolution morale et religieuse. Le christianisme était défendu par de savants apologistes, tels que les évêques Sherlock, Butler, Warburton, Conybeare et, parmi les laïques, Gilbert West et lord Lyttleton, qui réfutaient victorieusement les écrivains incrédules, tandis que le réveil wesleyen leur opposait, sur le terrain pratique, une réfutation encore plus péremptoire.
Nous renvoyons, pour une étude complète sur les incrédules anglais du xviiie siècle, au bel ouvrage de M. le professeur Edouard Sayous, les Déistes anglais et le Christianisme, principalement depuis Toland jusqu'à Chubb, Paris, 1882. Cet ouvrage, puisé aux sources et fruit de grandes lectures, nous a été utile.
Il est vrai que, par une sorte de compensation, au moment où l'Angleterre cessait de prêter l'oreille à ses philosophes incrédules, la France leur faisait accueil, et Voltaire et les encyclopédistes allaient chercher des armes dans leurs écrits.
Les classes populaires de l'Angleterre au xviiie siècle étaient ignorantes, grossières et désordonnées. Les agitations politiques du siècle précédent leur avaient laissé un penchant très vif pour les émeutes. Elles prenaient parti, avec une égale violence, un jour pour les whigs et le lendemain pour les tories. Toutes les occasions leur étaient bonnes pour faire du bruit et jeter des pierres, et la police, se sentant impuissante devant ces manifestations, les laissait se produire. La populace avait deux haines toujours vivaces : celle des papistes et celle des dissidents.
A l'occasion du procès du docteur Sacheverell, poursuivi pour un sermon contre le gouvernement, il y eut, en 1710, une émeute formidable, et la populace témoigna de ses sympathies pour le docteur en brûlant et en saccageant plusieurs chapelles dissidentes. En 1780, autre insurrection, aux cris de : A bas les papistes ; l'émeute démolit les prisons, mit en liberté les criminels, et pendant trois jours régna dans la capitale, brûlant, pillant et massacrant. « Les tonneaux de gin défoncés faisaient des ruisseaux dans les rues. Enfants et femmes à genoux y buvaient jusqu'à en mourir. Les uns devenaient furieux, les autres s'affaissaient stupides, et l'incendie des maisons croulantes finissait par les brûler ou les engloutirh. » Le couronnement de Georges Ier fut célébré sur divers points de l'Angleterre par des démonstrations hostiles ; ici on buvait à la santé du prétendant, là on brûlait le roi en effigie, ailleurs on pillait quelques chapelles dissidentes, ailleurs encore on rouait de coups les passants qui refusaient de crier : « Vive le roi Jacques ! » Pendant ce temps, les partisans de la maison de Hanovre brûlaient en effigie le pape et le prétendant et se battaient avec les jacobites. Plus d'une fois, le sang arrosa les places publiques.
« Même lorsque les factions se reposaient, dit M. de Witt, la jeunesse turbulente et licencieuse qui vivait dans les cafés était une véritable peste publique. Insulter les honnêtes femmes, chercher querelle aux gens paisibles, coudoyer les passants et les faire descendre dans le ruisseau, tels étaient les plus innocents plaisirs des mauvais sujets qui, sous le nom de Mohocks, faisaient la terreur de Londres. La nuit, après avoir bien bu, ils se précipitaient dans les rues l'épée à la main, renversant et blessant ceux qui avaient le malheur de se trouver sur leur passage. Parvenaient-ils à mettre la main sur une femme, ils la renfermaient dans un tonneau et l'envoyaient rouler en bas d'une colline. Le soleil couché, on ne pouvait se promener avec sécurité dans Londres qu'à condition d'être bien escorté. Echappait-on aux Mohocks, on avait chance de tomber sur des brigands. Du 20 janvier au 10 février 1720, on compte dans les journaux une trentaine d'attaques à main armée, commises à Londres et dans les environsi. »
L'ivrognerie faisait des ravages effrayants dans les basses classes. « Le gin avait été inventé en 1684, et, un demi-siècle après, l'Angleterre en consommait sept millions de gallons. Les marchands, sur leurs enseignes, invitaient les gens à venir s'enivrer pour deux sous ; pour quatre sous, on avait de quoi tomber ivre-mort ; de plus, la paille gratis ; le marchand traînait ceux qui tombaient dans un cellier où ils pouvaient cuver leur eau-de-vie. On ne pouvait traverser les rues de Londres sans rencontrer des misérables, inertes, insensibles, gisant sur le pavé, et que la charité des passants pouvait seule empêcher d'être étouffés dans la boue ou écrasés sous les voituresj. » Une maison sur six dans Londres servait de cabaret en 1736. Le Parlement essaya vainement d'interdire la vente du genièvre ; un commerce clandestin s'organisa dans toutes les parties de l'Angleterre. La populace jeta à la rivière ceux qui dénonçaient ces fraudes, et elle sut, par son attitude menaçante, forcer la Chambre à retirer sa loi.
Les habitants des campagnes, s'ils étaient moins démoralisés, étaient dans un état voisin de la barbarie. Les populations des districts houillers, si intéressantes de nos jours, étaient à peu près sauvages. Partout régnaient l'intempérance et l'immoralité. Plusieurs des superstitions du catholicisme persistaient, deux siècles après la Réforme. Les paysans du Devonshire faisaient encore réciter à leurs enfants certaines invocations aux saints. Dans le pays de Galles, les mœurs conservaient sur bien des points l'empreinte de l'époque druidique. La crédulité populaire continuait à considérer les vieilles maisons comme hantées par des esprits ; les sorciers, les diseurs de bonne aventure, les charlatans de toute espèce pratiquaient au grand jour leurs industries lucratives. Il va sans dire que peu de personnes savaient lire, et, quant à savoir écrire, c'était un luxe de grand seigneur. Ajoutons, pour être juste, que les populations rurales de toute l'Europe n'étaient pas plus avancées à cette époque.
C'est ce peuple, abaissé jusqu'à l'abrutissement dans les basses classes, corrompu jusqu'au cynisme dans les classes élevées, que le méthodisme allait tenter de transformer. Le pays semblait arrivé à cette limite extrême de la dégradation, où une nation n'a plus qu'à mourir, à moins qu'elle ne consente à naître à une vie nouvelle. L'état moral que nous venons de décrire ne justifie que trop l'assertion d'un écrivain, anglican lui-même, qui affirme que l'Angleterre était tombée, lorsque Wesley parut, dans un véritable paganismek, et cette autre assertion d'un historien indépendant qui croit qu'elle ne le cédait en rien pour la corruption au Bas-Empire ou à la vieille monarchie françaisel.
Que faisait la partie saine de la nation pour porter remède à de si grandes misères morales ? Pour répondre à cette question, nous indiquerons d'abord les quelques tentatives qui se produisirent, immédiatement avant l'apparition du réveil méthodiste.
La littérature de l'époque fut généralement complice des défaillances morales de la nation. Une réaction intéressante se produisit toutefois dans ce domaine, et quelques hommes de talent, Steele, Addison, Berkeley, Johnson, tentèrent d'opposer une digue au débordement des mœurs. Dans des écrits périodiques d'une forme vive et satirique, ils attaquèrent les travers et les vices de leur époque, avec une franchise qui les honore. Ces pamphlets eurent un succès immense, et c'est encore à ces pages qu'il faut revenir pour avoir une peinture sincère du temps. Les Essayists, comme on les appela, firent une œuvre excellente, mais superficielle ; en rendant le vice ridicule, ils l'obligèrent à la pudeur, mais ils ne le corrigèrent pas.
Il ne se faisait presque rien pour l'éducation du peuple. En 1715, il n'existait dans tout le royaume que 1 193 écoles primaires, contenant 26 920 élèves. La seule Église wesleyenne reçoit aujourd'hui quatre fois plus d'élèves dans ses écoles en Angleterre.
Pendant les dernières années du dix-septième siècle, quelques membres influents de l'Église anglicane fondèrent une Société pour la réforme des mœurs. La reine Marie accorda son patronage à cette association et ordonna que les lois anciennes pour la suppression des vices scandaleux fussent remises en vigueur. La Société fit fermer à Londres des centaines de lieux de débauche et fit condamner à l'amende, à la prison ou à la flagellation un grand nombre de joueurs, de blasphémateurs, d'ivrognes ou de débauchés. Ces répressions sévères contraignirent le vice, qui jusque-là marchait le front haut, à se cacher ; mais elles furent impuissantes à corriger les mœurs. Si elles atteignaient d'ailleurs les coupables vulgaires, elles épargnaient en général les coupables de haute volée. De Foe compare spirituellement ces lois sur les mœurs aux toiles d'araignée qui prennent les petites mouches et laissent échapper les grosses. Toutefois c'était un heureux indice que ce réveil de la conscience publique, protestant avec énergie contre l'abaissement des mœurs, dont la restauration des Stuarts avait été le signal.
La Société pour la réforme des mœurs fournit une carrière d'une quarantaine d'années ; lorsque le méthodisme parut, elle n'existait plus guère, qu'à l'état de souvenir. Le mouvement méthodiste parait avoir contribué à la ressusciter. John Wesley prêcha devant elle en 1763, comme son père l'avait fait en 1698 ; mais il eut la douleur, en 1766, d'être témoin de sa dissolution définitive.
Une œuvre étroitement associée à celle-là et qui la précéda même de quelques années, ce fut l'organisation de petites sociétés religieuses, fondées par trois pasteurs pieux de l'Église anglicane, Horneck, Smithies et Beveridge. Un grand nombre de jeunes gens s'étant convertis par leur moyen, ils leur conseillèrent « de se réunir une fois par semaine et de s'adonner à de bons entretiens, de façon à s'édifier les uns les autres. » C'est ce qu'ils firent, et de plus ils se cotisèrent pour accomplir en commun quelques œuvres de charité. Ils visitaient les malades et les prisonniers, et s'occupaient des enfants ; on assure que, par leurs efforts persévérants, une centaine d'écoles furent fondées dans Londres et dans sa banlieue. Pendant quelque temps, ces associations formèrent des foyers assez intenses de vie religieuse, bien que leur action au dehors se renfermât dans des bornes trop étroites. Elles auraient pu peut-être avancer d'un demi-siècle le réveil religieux de l'Angleterre, si elles avaient eu un caractère plus entreprenant. Par malheur, elles s'interdisaient presque complètement l'évangélisation proprement dite, de crainte d'empiéter sur les droits du clergé. Wesley les trouva à peu près dissoutes. S'il s'empara de l'idée féconde de Horneck et de ses amis, ce fut pour la développer et lui faire porter tous ses fruits.
Les règles de ces sociétés portaient que tous les membres devaient se rattacher à l'Église établie ; qu'ils devaient se réunir une fois par semaine pour s'encourager réciproquement ; que toute discussion politique ou autre serait soigneusement évitée ; que chaque membre s'imposerait une cotisation hebdomadaire, en vue d'objets charitables ; que ceux qui s'absenteraient pendant quatre réunions consécutives, sans motifs légitimes, seraient considérés comme démissionnaires ; que nul ne serait reçu membre sans qu'une enquête sérieuse fût faite concernant ses motifs et sa conduite ; et enfin que tous les membres prieraient plusieurs fois par jour, jeûneraient et participeraient à la cène au moins une fois par mois, et se souviendraient de la société dans leurs dévotions privées.
Si ces sociétés religieuses ne produisirent pas un réveil général, elles surent lui préparer les voies. Il aurait fallu que le clergé anglican encourageât et développât cet intéressant mouvement. Malheureusement, il n'était guère en état de le faire, comme le prouvera un rapide coup d'œil jeté sur sa situation religieuse.
Assurément, ce clergé s'était bien policé depuis le temps où, d'après Macaulay, ses membres n'étaient guère au-dessus des domestiques de bonne maison. Réintégré dans ses bénéfices et richement doté, il avait vu ses cadres se remplir, et l'élite de la jeunesse anglaise solliciter des postes où l'attendaient la fortune et les honneurs. Mais, si sa condition matérielle s'élevait, sa condition religieuse et morale n'avait pas suivi la même progression. Ne craignant rien d'une discipline tombée en désuétude, les ecclésiastiques s'abandonnaient à leurs penchants ; et les paroisses étaient trop heureuses quand, à la mondanité, ils n'ajoutaient pas la licence des mœurs. Les témoignages contemporains leur sont peu favorables. Voltaire, qui visita l'Angleterre en 1726, trouvait que le clergé anglican avait, tout compté, des mœurs meilleures que le clergé français, et qu'auprès d'un abbé parisien « un théologien anglican était un Caton ». Mais ailleurs il ajoute ce qui suit : « Les prêtres anglicans vont quelquefois au cabaret, parce que l'usage le leur permet, et s'ils s'enivrent, c'est sérieusement et sans scandalem. » Un jour que l'évêque de Londres adressait des reproches à un ministre que l'on accusait de s'enivrer quelquefois, celui-ci s'excusa en alléguant que cela ne lui arrivait jamais lorsqu'il était de service.
Dans les rangs du clergé anglican, il y eut à cette époque un grand nombre d'esprits distingués qui se livraient à la culture des lettres. Ces pasteurs, pamphlétaires, romanciers ou poètes qui, comme Sterne ou Swift, employaient leurs talents à composer des œuvres légères, n'avaient guère souci de porter remède à la maladie morale de la nation. On se demande de quelle nature pouvait être la prédication que donnait le dimanche à ses paroissiens l'homme qui, pendant la semaine, avait écrit Gulliver ou Tristram Shandy.
Cette déchéance du clergé n'était pas partout aussi profonden. La création des sociétés religieuses, que nous avons racontée, prouve suffisamment l'existence de pasteurs pieux et dévoués. Mais ils étaient rares. La plupart se contentaient de soupirer en silence, trop timides pour prendre l'initiative d'une réforme. Cette minorité, d'ailleurs, craignait trop de se compromettre pour applaudir aux généreuses imprudences des jeunes réformateurs qui essayèrent vainement de l'entraîner.
La science et la distinction ne faisaient pas défaut au clergé anglican du xviiie siècle, qui comptait dans ses rangs des théologiens tels que William Sherlock, Daniel Waterland, l'évêque Butler et le doyen Prideaux. Ce qui lui manquait, c'était l'intelligence des besoins religieux du peuple ; c'était surtout cette foi vivante qui ébranle les âmes.
Les sermons n'étaient le plus souvent que de maigres dissertations de morale, lues d'un ton froid et endormant. Quelques prédicateurs, dans les villes surtout, poursuivaient une célébrité éphémère en servant le public selon ses goûts, et délayaient en phrases sentimentales les thèmes faciles de la religion naturelle. D'autres, tels que le docteur Samuel Clarke et William Whiston, prêchaient l'arianisme, et attiraient l'attention de Voltaire qui disait d'eux : « Le parti d'Arius prend très mal son temps de reparaître dans un âge où tout le monde est rassasié de disputes et de sectes. »
La prédication orthodoxe, même dans ses meilleurs représentants, les évêques Burnet, Atterbury, Blackall, Bentley, Waterland, manquait trop de sève évangélique. Les doctrines vitales de l'Évangile n'étaient pas à la base de leur enseignement qui, par suite, avait cessé d'être populaire et incisif.
Cette décadence de l'Église établie frappait depuis longtemps les esprits sérieux et leur causait de vives inquiétudes. Le pieux archevêque Leighton disait, dans son énergique langage, que « l'Église n'était plus qu'un squelette sans âme ». On a souvent cité les éloquentes lamentations de l'évêque Burnet : « Je suis dans ma soixante-dixième année, s'écrie-t-il, et, avant de mourir, je veux parler en toute franchise. C'est avec la plus vive souffrance que j'entrevois la ruine imminente qui menace l'Église. » Il parle ensuite de l'ignorance du clergé, de la légèreté avec laquelle il met de côté l'Écriture, et de la tendance générale à se jeter dans les partis politiques et à négliger la cure d'âmes. L'archevêque Secker et les évêques Gibson et Butler portent un jugement tout aussi sévère sur l'Église et sur le clergé de leur temps.
Les non-conformistes avaient été préservés d'une décadence aussi profonde par leur principe même et par la vigoureuse sève de piété qu'ils avaient conservée. Ce n'étaient pas des Églises mortes que celles qui comptaient dans leur sein des hommes tels qu'Isaac Watts, le célèbre hymnographe ; Nathanaël Lardner, l'apologiste distingué ; Philippe Doddridge, l'auteur de livres de piété pleins d'onction ; Matthieu Henry, l'éminent commentateur, et des prédicateurs tels que Edmund Calamy, James Foster et Samuel Chandler.
Malheureusement, les préoccupations de la lutte, souvent politique, contre l'Église anglicane, ajoutées à d'interminables querelles intérieures, réussirent trop à faire oublier à ces Églises le travail de l'évangélisation extérieure, et elles offrirent souvent au monde le spectacle peu édifiant des dissensions et des déchirements. « Un esprit d'indifférence à l'égard des masses populaires, dit le Dr Stoughton, infectait ces Églises, même les plus respectableso. »
Malgré leur apparent attachement aux doctrines du calvinisme strict, les dissidents n'avaient pas su se préserver de l'arianisme, qui eut des adeptes jusque dans ces chaires qui semblaient si bien gardées. Le déclin de la vie religieuse chez les non-conformistes inspirait à leurs chefs des aveux analogues à ceux que nous avons mentionnés dans l'Église établie. Le docteur Guyse dit : « La religion de la nature est devenue la plus chère préoccupation des hommes de ce siècle, et la religion de Jésus-Christ n'est estimée qu'autant qu'on peut la faire accorder avec cette religion-là. On repousse et on méprise tout ce qui est uniquement chrétien, et tout ce qui est particulier à Jésus-Christ. » Il nous serait facile de trouver chez Isaac Watts, Abraham Taylor, John Hurrion des témoignages analogues.
L'état moral et religieux de la Grande-Bretagne nécessitait, on le voit, une seconde Réforme. Quelques hommes clairvoyants avaient le pressentiment qu'elle se préparait. Voltaire, lui, ne s'en doutait pas et disait : « On est si tiède à présent sur tout cela, qu'il n'y a plus guère de fortune à faire pour une religion nouvelle ou renouveléep. » Les évènements s'apprêtaient à lui donner un éclatant démenti ; car, au moment même où, parcourant l'Angleterre, il annonçait le déclin du christianisme et prédisait son impuissance, quelques étudiants pieux, parmi lesquels était Wesley, organisaient à Oxford une petite association qui allait être le berceau, sinon d'une « religion nouvelle », au moins d'une « religion renouvelée ».
Remarquable coïncidence ! ces deux hommes, qui devaient agir sur leur siècle plus qu'aucuns de leurs contemporains, foulaient au même moment le sol de l'Angleterreq, et, dans le spectacle de cette grande nation rongée par le scepticisme et par le matérialisme, puisaient des résolutions bien contraires. L'un, prenant la licence des esprits pour une liberté enviable, se promettait d'importer en France les principes et les méthodes de l'incrédulité anglaise ; l'autre, au contraire, douloureusement ému des misères de sa patrie, se promettait de travailler à son relèvement par l'Évangile. Ceux qui virent passer alors dans la société anglaise le jeune exilé parisien à la verve mordante et le jeune étudiant d'Oxford au maintien grave, ne se doutèrent pas qu'ils avaient devant eux deux hommes qui allaient ébranler leur siècle, quoique en sens inverse, et dont l'œuvre si opposée devait avoir un retentissement universel. Pour nous, qui jugeons leur œuvre respective par ses conséquences, nous n'hésitons pas à préférer infiniment celle du missionnaire à celle du philosophe : l'un a travaillé à ramener les âmes à Dieu, l'autre à les en éloigner ; l'un a travaillé avec Dieu, l'autre contre Dieu. Et, tandis que chaque jour révèle mieux le caractère funeste de l'œuvre de Voltaire, chaque jour aussi montre mieux l'excellence de celle de Wesley.
Au nord-ouest du Lincolnshire, il existe un petit district d'une superficie d'environ vingt mille hectares, qu'on appelle l'île d'Axholme, parce qu'il est entouré par une ceinture de cours d'eau. Conquis sur les marécages et fécondé par le travail, ce pays est devenu l'un des plus fertiles de l'Angleterre. Il est divisé en sept paroisses, dont la plus importante est Epworth, petite ville de deux mille âmes, irrégulièrement bâtie, mais agréablement située sur le flanc d'une colline. Son église, dédiée à saint André, commande une vue étendue sur une contrée qui ne manque pas de charme.
C'est dans la cure de cette paroisse, dont son père était le recteur ou le ministre, que John Wesley naquit, le 17 juin 1703a. C'est là que s'écoulèrent les premières années de sa vie, sous des influences qui le firent en partie ce qu'il fut. Bien que né dans l'Église anglicane, il appartenait par son père et par sa mère à cette noble lignée religieuse des Puritains qui, au siècle précédent, avait donné à la Grande-Bretagne tant d'hommes à l'âme fortement trempée.
Son arrière grand-père paternel, Barthélemy Wesleyb, avait étudié la théologie et la médecine à l'université. Devenu ministre de l'Église établie, il se rattacha au parti de Cromwell et des Indépendants. Expulsé de sa paroisse à la restauration des Stuarts, il mena la vie troublée d'un proscrit, exerçant la médecine pour subvenir à ses besoins et prêchant quand l'occasion s'en présentait. Le fils de Barthélemy Wesley porta le prénom de John, que son petit-fils devait illustrer. Maître ès-arts de l'université d'Oxford, il exerça le ministère évangélique pendant le protectorat de Cromwell, mais sans recevoir l'ordination, de sorte qu'il fut toute sa vie un évangéliste laïque, pareil à ceux que son petit-fils répandit plus tard sur toute l'Angleterre. Comme son père, il fut l'une des victimes de la réaction religieuse qui suivit l'avènement de Charles II. Banni de l'Église, avec les deux mille ministres qui, le 24 août 1662, préférèrent renoncer à leurs bénéfices que de souscrire aux nouvelles ordonnances ecclésiastiques, il fut plusieurs fois emprisonné et continua à exercer son ministère en cachette. Mais les privations qu'il endura et les périls qu'il courut abrégèrent sa vie, et il mourut à l'âge de trente-trois ans, laissant plusieurs enfants en bas âge, dont l'un, Samuel, fut le père du fondateur du méthodisme.
Samuel Wesley, laissé à lui-même de bonne heure, se détacha des convictions ecclésiastiques de ses parents et entra en qualité d'étudiant pauvre à l'université d'Oxford, où il se prépara pour le ministère de l'Église anglicane, avec les ressources que lui fournissaient la facilité de sa plume et sa position de serviteur d'un étudiant riche. Le patronage de la reine Marie, à laquelle il avait dédié un de ses livres, lui valut, en 1696, la cure d'Epworth, où il resta jusqu'à sa mort, survenue en 1735. Du fond de son presbytère, il prit une part active aux luttes de son temps. Il sut se frayer sa voie au milieu des partis politiques et religieux, très entier dans ses opinions et les défendant avec vigueur. Il mit sa plume au service de toutes les causes qui tentaient son âme ardente et généreuse. Esprit plus étendu que profond, il publia les productions les plus diverses, pamphlets politiques et religieux, articles de journaux, poèmes, commentaires, traités théologiques, sans réussir à créer une œuvre digne de lui survivre. Aucune n'eût sauvé son nom de l'oubli, si ses fils ne se fussent chargés de ce soin. Ils sont restés son plus bel ouvrage auprès de la postérité, qui doit faire honneur au père de quelques-unes des qualités qu'elle admire chez les fils.
Les qualités de Samuel Wesley, comme ses défauts, nous montrent en lui un caractère élevé, mais excessif et peu pondéré. Son courage dégénérait en imprudence, sa largeur d'esprit en versatilité, son ardeur en violence, sa générosité en prodigalité, son attachement à son Église en bigotisme. Animé du désir de faire le bien, il accomplissait avec dévouement ses devoirs pastoraux ; mais la sévérité de ses réprimandes et sa prétention de rétablir la discipline, tombée en désuétude, irritèrent ses paroissiens à tel point qu'ils lui firent subir une vraie persécution. Tel le fit jeter en prison pour une petite dette qu'il ne pouvait acquitter sur-le-champ. Tel autre blessait ses vaches et mutilait son chien de garde. D'autres, comme nous le verrons, poussèrent la méchanceté jusqu'à incendier sa cure.
Le recteur d'Epworth donna à ses enfants l'exemple de toutes les vertus, mais il ne put leur communiquer qu'une vie religieuse bien incomplète. S'il leur recommandait une conduite pure, il ne sut pas leur en montrer la source dans la foi du cœur en Jésus-Christ. Toutefois, vers la fin de sa vie, la lumière paraît s'être faite dans son âme, et ses lettres à ses fils, lorsqu'ils étaient à l'université, indiquent un progrès notable dans ses conceptions religieuses. Il eut comme un pressentiment prophétique de la grande révolution religieuse qui se préparait et dont ses fils allaient être les apôtres. « Soyez ferme, dit-il à Charles peu avant de mourir. La foi chrétienne revivra sûrement dans ce royaume. Je ne serai plus là ; mais vous le verrez. » Il fut l'un des rares chrétiens anglais, qui, dès les premières années du xviiie siècle, rêvèrent pour leur patrie l'honneur des grandes entreprises missionnaires. Vers 1705, il s'offrit au gouvernement pour aller comme missionnaire dans l'Inde. Mais les temps n'étaient pas mûrs, et cette idée, pour aboutir, devait être reprise, non par un gouvernement, mais par l'Église elle-même arrachée à sa torpeur.
Quelque grande qu'ait été l'influence paternelle dans la formation de l'âme et du caractère de John Wesley, on peut affirmer que son développement moral et religieux fut plus redevable encore à sa pieuse mère. On a dit avec raison que Suzanne Wesley ne fut pas seulement la mère de Wesley, mais encore celle du méthodisme. Elle était fille du docteur Annesley, l'un des théologiens les plus distingués du puritanisme et l'un des démissionnaires de 1662. Douée d'une intelligence supérieure, elle avait reçu une culture très complète ; les langues étrangères, la philosophie, la théologie, les questions ecclésiastiques avaient fait l'objet de ses études. Elle avait voulu se faire des convictions personnelles sur les questions qui divisaient les esprits. En théologie, elle traversa une crise pénible de doutes avant d'arriver à asseoir sa foi sur des bases inébranlables. Après un examen sérieux, elle renonça aux vues ecclésiastiques de sa famille pour adhérer à l'anglicanisme. En politique, elle demeura jacobite fervente, tandis que son mari était partisan de la nouvelle dynastie. Aussi savante et aussi pieuse que les femmes de la Réforme, elle put ne demeurer étrangère à aucune partie de l'éducation intellectuelle de ses enfants. Elle alliait dans une juste mesure l'ardeur de progrès d'un esprit éclairé et le ferme bon sens d'un esprit droit. Contrairement à ce qui se produit quelquefois chez les femmes, un développement inusité de l'intelligence n'avait en rien arrêté chez elle celui du cœur. Quelque remarquable qu'elle fût au point de vue de l'esprit, on peut dire que ce fut surtout comme épouse et comme mère que Suzanne Wesley excella. Si elle ressentit dans son âme aimante le contre-coup des épreuves de son mari, elle sut puiser dans sa conscience de viriles résolutions qu'elle fit passer en lui. Mère de dix-neuf enfants, elle eut toutes les vertus de la maternité, en même temps qu'elle en eut les plus lourdes charges. Son affection pour ses enfants n'était pas une sorte de culte égoïste ; elle voyait en eux les germes de l'avenir qu'elle était appelée à cultiver avec un soin jaloux. Et, quand la mort vint moissonner à sa place dans ce champ de ses affections, elle sut s'incliner devant la volonté de Dieu, et elle parut plus forte encore dans sa grande et chrétienne douleur qu'aux jours de la prospérité.
Sous l'humble toit de la cure d'Epworth, la vie de famille avait un charme austère. L'éducation et la première instruction des enfants s'y faisaient sous la direction intelligente de la pieuse mère dont nous venons de parler. C'était elle qui, toujours dominée par le sentiment de sa responsabilité, surveillait le développement physique et moral des douze ou treize enfants qui survécurent aux maladies du premier âge ; c'était elle qui tenait d'une main ferme les rênes de ce petit royaume, ayant l'œil ouvert sur tout et imprimant à chaque chose l'impulsion de son esprit méthodique. Suzanne Wesley se gardait bien en effet d'abandonner au hasard la direction de ses enfants ; après avoir médité sur les meilleures méthodes d'enseignement, elle s'imposa des règles fixes qu'elle suivit avec rigidité. Ce fut dans le moule d'une éducation strictement chrétienne que fut jetée l'âme de John Wesley ; elle reçut là sa meilleure préparation. Il ne sera donc pas superflu de résumer en quelques mots cette méthode.
Dans cette famille modèle, les enfants étaient soumis à la règle dès leurs premières années. Les heures du sommeil et des repas étaient déterminées d'une manière invariable, et les nouveau-nés s'y soumettaient comme les autres. De bonne heure, on leur donnait des habitudes de tranquillité qui sont bien rares dans les familles nombreuses ; les cris étaient interdits. A mesure que la volonté se développait chez les enfants, elle était l'objet d'une surveillance spéciale. « Si vous voulez former l'âme de vos enfants, disait Suzanne Wesley, la première chose à faire est de vaincre leur volonté. » Peu de mères ont réussi aussi bien qu'elle dans cette tâche difficile. Ses moyens ordinaires étaient la douceur et la persuasion ; mais au besoin elle avait recours aux corrections. D'autre part, s'apercevant que « la peur du châtiment poussait souvent les enfants au mensonge », elle avait l'habitude de pardonner toujours une faute confessée. Dans la limite de ces principes, elle avait pour règle de conduite l'exercice d'une autorité absolue, tempérée par l'amour maternel le plus fort.
Pour l'instruction de ses enfants, elle avait des principes tout aussi arrêtés. Sous aucun prétexte, par exemple, un enfant n'avait le droit d'apprendre à lire avant d'avoir accompli sa cinquième année, règle excellente qui avait pour but de ne pas fatiguer trop tôt une intelligence encore débile. Mais le jour qui suivait le cinquième anniversaire était mémorable dans la famille ; ce jour-là commençaient sérieusement les leçons, et le nouvel élève passait dans la salle d'étude six heures, au bout desquelles il devait être maître de son alphabet. Ce court délai fut presque toujours suffisant. A la deuxième leçon, la Bible était ouverte devant l'enfant, et il apprenait à épeler dans le sublime premier chapitre de la Genèse. La mère affirmait qu'au bout de trois mois d'exercice ses enfants pouvaient lire aussi couramment que beaucoup de gens qui passent pour savoir bien lire. Pour atteindre ces résultats, elle n'épargnait aucune peine. « J'admire votre patience, lui dit un jour son mari ; vous avez répété au moins vingt fois la même chose à cet enfant. — J'aurais perdu mon temps, lui répondit-elle, si je ne la lui avais répétée que dix-neuf fois, puisque ce n'est qu'à la vingtième que j'ai réussi. » Par son activité incessante, elle apprenait à ses enfants de quelle valeur est le temps, et ils n'oublièrent jamais cet enseignement.
Suzanne Wesley était une chrétienne vivante ; le développement spirituel de ses enfants lui tenait plus encore à cœur que leurs progrès intellectuels. De bonne heure, elle les forma à la connaissance des saintes Écritures ; elle leur enseigna des prières simples, dès qu'ils commencèrent à pouvoir bégayer quelques mots. Elle voulut se charger elle-même de leur première instruction religieuse, et l'on possède une sorte de manuel qu'elle composa pour lui servir de guide. Elle consacrait régulièrement une heure ou deux par semaine à un entretien particulier avec chacun de ses enfants ; cette petite conférence avait un caractère absolu d'intimité et amenait de leur part une ouverture de cœur qui permettait à la mère de suivre de fort près leur état d'âme. Ces entretiens exercèrent la plus salutaire influence sur son fils John ; vingt ans plus tard, il en parlait avec reconnaissance dans une lettre à sa mère, en la priant de lui consacrer comme autrefois la soirée du jeudi.
Dans l'esquisse rapide que nous avons tracée de cette éducation de famille, on a remarqué sûrement cet amour de l'ordre que Wesley eut plus tard à un si haut degré et qu'il hérita de sa mère. Ou peut dire d'ailleurs qu'il puisa dans cette première école de la famille la plupart des grandes qualités qu'il déploya par la suite dans l'œuvre à laquelle Dieu l'appela. Il y apprit de bonne heure une notion élevée de la vie et de ses devoirs.
L'enfance de Wesley ne fut pas exempte de ces épreuves qui ont un rôle providentiel dans la formation de tout caractère. Plus d'une fois, il vit la pauvreté importune s'asseoir au foyer de sa famille ; son père mourut endetté, malgré les prodiges d'économie accomplis par sa digne femme. La mort vint visiter fréquemment le presbytère et y frappa des coups douloureux. A deux reprises la cure fut incendiée ; la première fois, l'incendie, dû à une cause accidentelle, ne fut que partiel ; mais la seconde, la maison fut tout entière consumée par les flammes, grâce à la malveillance de quelques paroissiens incorrigibles, qui trouvaient plaisant de se venger des répréhensions de leur pasteur, en brûlant sa demeure et en exposant sa famille à une mort affreuse.
Ce fut le 9 février 1709, vers minuit, que le feu se déclara. Une petite fille de douze ans, réveillée par des débris enflammés qui tombaient sur ses pieds, donna l'alarme. Les clameurs du dehors vinrent au même instant mettre tout le monde sur pied. Il était temps ; l'élément destructeur avait déjà fait des progrès considérables et occupait presque toutes les avenues de la maison. Le recteur se précipita dans la chambre où couchaient ses enfants et, avec l'aide d'une domestique, parvint à les faire échapper soit par les fenêtres, soit par une porte donnant sur le jardin. Sa femme, restée en arrière pour veiller au salut des plus jeunes, dut se frayer un chemin à travers les flammes. Trois fois, elle fut forcée de reculer devant leur violence ; mais enfin, réunissant ses forces défaillantes et se confiant en Dieu, elle s'élança au milieu du feu et échappa avec quelques brûlures au visage et aux mains.
Un enfant manquait cependant à l'appel. Le petit John était demeuré endormi au milieu de la détresse générale et avait été oublié dans son lit. Son père, s'apercevant de son absence, s'élança à diverses reprises à son secours, mais dut rebrousser chemin devant la furie du feu. Il se jeta alors à genoux et recommanda à Dieu l'âme de son enfant. Celui-ci s'était enfin éveillé et avait couru à la fenêtre, où l'on ne tarda pas à l'apercevoir. Le temps manquant pour se procurer une échelle, un homme se hissa sur les épaules d'un autre, et l'enfant put être sauvé, au moment même où le toit embrasé s'écroulait avec fracas. Lorsqu'on le déposa sain et sauf dans les bras de son père, celui-ci s'écria : « Venez, voisins ; mettons-nous à genoux, et rendons grâces à Dieu ; il m'a donné mes huit enfants ; laissez brûler la maison ; je suis assez riche ! »
John Wesley conserva toute sa vie le souvenir de cette délivrance providentielle. Sous l'un de ses portraits, il fit graver une maison embrasée, avec cette légende : « N'est-ce pas ici un tison arraché du feu ? »
A partir de ce moment, sa pieuse mère, comme elle nous l'apprend, prit la résolution « de veiller avec une attention toute particulière sur l'âme d'un enfant que Dieu avait protégé avec tant d'amour ». Elle travailla à le pénétrer de la conviction qu'il appartenait, corps et âme, à ce Dieu dont la main paternelle s'était si visiblement étendue sur lui. Ses efforts furent récompensés par la piété précoce de son fils, qui manifestait des sentiments religieux très vifs à l'âge où d'autres ne songent qu'aux amusements de l'enfance. Aussi son père crut-il devoir l'admettre, dès sa neuvième année, à la sainte cène.
Il eut, vers l'âge de neuf ans, une attaque de petite vérole, et il supporta ses souffrances avec un courage auquel sa mère, écrivant à son mari à Londres, rendait ce témoignage : « John a supporté bravement son mal, comme un homme et comme un vrai chrétien, sans proférer une plainte. »
Son caractère d'enfant présentait déjà certains traits que nous retrouverons chez l'homme fait. Le Dr Clarke raconte qu'une fois qu'on lui demandait ce qu'il désirait manger, il répondit : « Merci, j'y réfléchirai. » — « John, disait sa mère, ne fera jamais rien dont il ne puisse donner la raisonc. »
Suzanne Wesley avait été la seule institutrice des premières années de son fils John, comme de ses autres enfants. Mais, à l'âge de dix ans et demi, il fut admis, grâce au patronage du duc de Buckingham, à l'école renommée de Charterhouse, à Londres. On y faisait et l'on y fait encore d'excellentes études, et c'était pour le fils d'un pasteur de campagne un privilège envié que d'être reçu dans un établissement réservé aux enfants des familles riches. Cet avantage, il est vrai, le fils du recteur d'Epworth dut le payer au prix de toutes sortes de petites persécutions de la part de ses camarades plus âgés ou plus riches que lui ; mais il les supporta bravement, et elles ne furent pas sans utilité pour le développement de son caractère. La piété de l'enfant parut subir une éclipse dans ce milieu, qui lui était peu favorable. S'il continuait à lire sa Bible et à dire ses prières matin et soir, il laissa fléchir ses principes de conduite. Les cinq années qu'il passa dans cette école laissèrent cependant une trace agréable dans ses souvenirs, et il aimait plus tard à revenir chaque année visiter le vieux cloître autrefois habité par les chartreux, dont le nom est resté à l'école qui leur a succédé.
L'article de la Biographie universelle (Michaud) sur Wesley raconte qu'à cette époque, « il affectait tellement de ne fréquenter que des sujets médiocres, ou du moins inférieurs à lui, qu'un de ses professeurs ne put s'empêcher de l'en réprimander et de lui conseiller de voir plus souvent ceux qui avaient une réputation de savoir. Wesley lui répondit par un vers que Milton met dans la bouche de Satan, et qui a été traduit ainsi par Delille :
Cette anecdote, que le Dr Tyerman cite également, nous paraît d'une authenticité douteuse. L'écrivain français se montre, en tout cas, fort injuste lorsqu'à l'occasion de cette historiette, se rapportant à un écolier, il ajoute : « On ne peut dissimuler qu'il n'ait manifesté de bonne heure le besoin de commander, et qu'il ne l'ait associé aux pratiques de la piété chrétienne, ou peut-être qu'il ne se soit servi de ce moyen pour parvenir au commandement qui avait pour lui tant d'attrait. » Il se trouve justement que cette bouffée de vanité, à supposer qu'elle soit historique, correspond à une période d'éclipse de la piété de Wesley enfant.
En 1720, Wesley entra au collège de Christ Church, l'un des meilleurs établissements de haute culture parmi ceux qui composent l'université d'Oxford, et il y demeura jusqu'après son ordination en 1725. Son application et son intelligence en firent bientôt l'un des étudiants les plus distingués. Obéissant à une inclination très vive pour les études littéraires, il cultivait surtout les auteurs de l'antiquité classique, et ce commerce habituel avec les maîtres eut pour résultat de lui former un goût d'une rare pureté, une remarquable largeur d'idées et un style à la fois littéraire et personnel. Les vers coulaient de sa plume avec aisance, et il s'essayait à reproduire dans sa langue maternelle les grâces aimables de la muse latine ou les accents sévères de la muse hébraïque.
Pendant les cinq premières années de son séjour à Oxford, Wesley ne paraît pas s'être distingué très sensiblement, au point de vue de la piété, de la masse des jeunes gens qui remplissaient les collèges de cette ville studieuse. Irréprochable dans ses mœurs, doué d'un caractère aimable, il s'en tenait à peu près aux pratiques religieuses qu'exigeaient les règlements. Il répétait les prières d'usage et communiait trois fois par an ; mais il déclare lui-même qu'il n'avait « aucune idée d'une sainteté intérieure et qu'il pratiquait le péché habituellement et même, trop souvent, avec plaisir. » Ses lettres de cette époque sont gaies, spirituelles ; mais on n'y trouve encore aucune trace de luttes intérieures.
Le jeune étudiant d'Oxford n'avait pas encore fait choix d'une vocation. Ce ne fut qu'au commencement de 1725 qu'il exprima, dans une lettre à ses parents, le vœu d'embrasser la carrière du ministère chrétien. Son père lui répondit qu'il ne devait pas entrer dans le ministère, « comme les fils d'Héli, pour avoir un morceau de pain à manger, » mais pour glorifier Dieu et être utile aux hommes. Il lui conseillait de se livrer à l'étude de la Bible dans les langues originales.
La lettre de sa mère mérite d'être citée. Elle est du 23 février 1725 :
« Mon cher Jackyd,