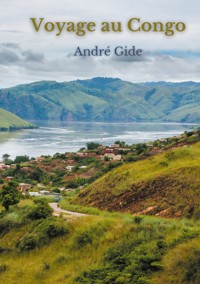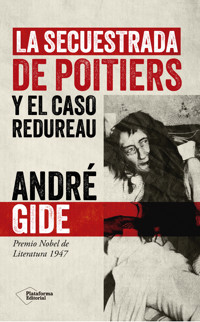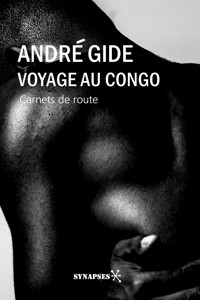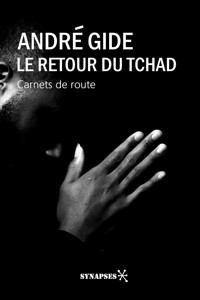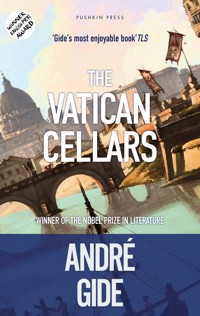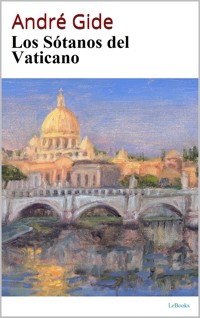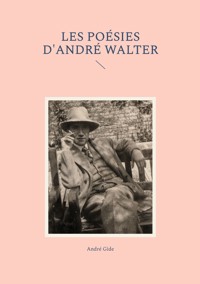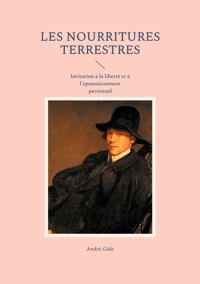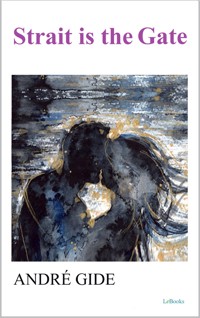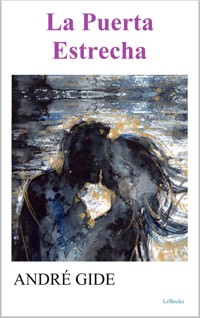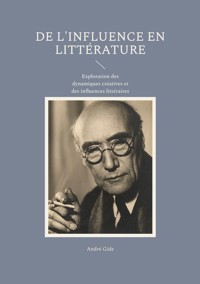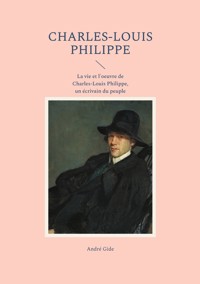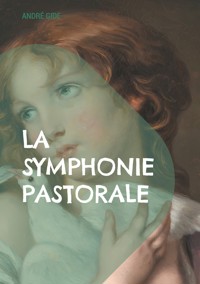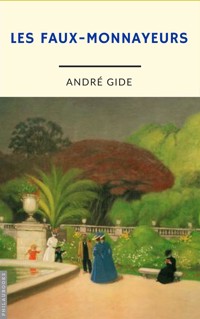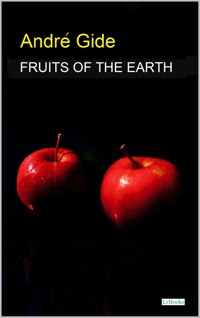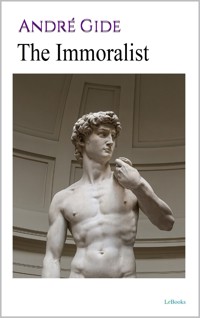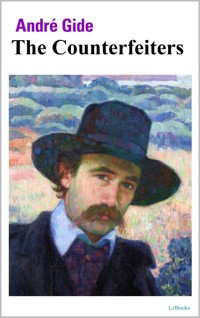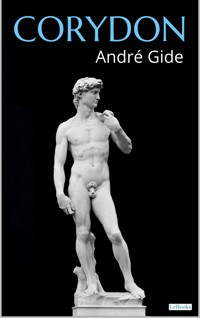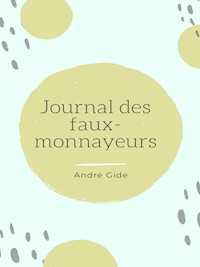
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Rares sont les écrivains qui, parallèlement au roman qu'ils écrivent, tiennent un journal de leur travail et le publient de leur vivant. C'est le cas d'André Gide avec son célèbre roman de l'adolescence perverse, « Les faux-monnayeurs ». Le « Journal des faux-monnayeurs » est le long dialogue de Gide avec ses personnages au fur et à mesure de leur création. C'est ainsi qu'il se familiarise avec l'atmosphère trouble dans laquelle évoluent ses héros : Édouard qui tient son journal, Olivier Molinier, Bernard Profitendieu... Tout au long, Gide apprend à vivre avec eux et il dépasse parfois le cadre du roman proprement dit. Ce Journal, qui est aussi son «cahier d'études», permet de mieux sentir le mécanisme créateur, l'intelligence critique, l'ironie du grand romancier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 76
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Journal des faux-monnayeurs
Journal des faux-monnayeursPréfacePREMIER CAHIERDEUXIÈME CAHIERAPPENDICEJOURNAUXLETTRESPAGES DU JOURNAL DE LAFCADIOIDENTIFICATION DU DÉMONPage de copyrightJournal des faux-monnayeurs
André Gide
Préface
C’est à Paris, le 22 novembre 1869, que naquit André Gide au 19 de la rue Médicis, non loin de la faculté de droit où son père, Paul Gide, allait occuper la chaire de droit romain.
Le grand écrivain était d’ascendance mi-normande mi-méridionale.
C’est en 1891 qu’il publia sans nom d’auteur Les Cahiers de Walter, œuvre posthume. Il les fit d’ailleurs mettre au pilon quelques jours plus tard. La même année, il fit éditer Le Traité du Narcisse, puis, en 1892, les Poésies d’André Walter. La Tentative amoureuse, en 1893, attirait l’attention des lettrés sur les œuvres de ce jeune écrivain tout empreintes d’ironie subtile.
Vers cette époque aussi André Gide commença les nombreux voyages qui, tout au long de sa vie, allaient le mener tour à tour en Afrique du Nord, en Afrique centrale et en Italie, pays latin pour lequel il eut une immense affection ; en U.R.S.S. aussi… On se souvient de la retentissante publication de Retour de l’U.R.S.S. qui marque sa rupture avec le parti communiste.
En 1893, André Gide publiait Le Voyage d’Urien, puis Paludes en 1895. Les Nourritures terrestres sont de 1897, tandis que Le Prométhée mal enchaîné, conte psychologique, est de 1899. André Gide ouvrit le siècle avec ses Lettres à Angèle. Deux ans plus tard paraissait L’Immoraliste, qui fit dire à ses commentateurs qu’André Gide était dans la littérature contemporaine un des plus riches terrains de contradictions et de discussions qu’il soit possible de trouver.
Le 1er février 1909 parut le premier cahier de La Nouvelle Revue Française. Dans cette livraison figuraient des pages de La Porte étroite que Gide avait reprise à la Revue de Paris dans l’intention d’aider le jeune mouvement naissant auquel participaient également Jean Schlumberger, Jacques Copeau, André Ruyters.
En 1909 aussi, André Gide publia Le Retour de l’enfant prodigue, et ses œuvres se succèdent ensuite, presque chaque année : Isabelle paraît en 1911, Nouveaux prétextes quelques mois plus tard. Souvenirs de la cour d’assises en 1913, La Symphonie pastorale en 1919, Si le grain ne meurt en 1921, Souvenirs, Confessions, Corydon de 1911 à 1924, Incidences en 1924, Les Faux-Monnayeurs en 1925, Voyage au Congo en 1928, Retour du Tchad et L’École des femmes en 1929.
On sait qu’André Gide a donné également plusieurs œuvres au théâtre, notamment Saül, Le Roi Candaule et Œdipe…
Ses études sur Dostoïevski, Oscar Wilde et ses traductions de Shakespeare, Conrad, Whitman, Tagore et Blake figurent parmi les meilleures qui aient été faites de ces auteurs.
André Gide, enfin, s’est exprimé dans cette œuvre capitale qu’est son Journal. Il reçut le prix Nobel en 1947, et devait s’éteindre, le 19 février 1951, à son domicile de la rue Vaneau.
J’offre ces cahiers d’exercices et d’études
à mon ami
JACQUES DE LACRETELLE
et à ceux
que les questions de métier intéressent.
PREMIER CAHIER
17 juin 1919.
J’hésite depuis deux jours si je ne ferai pas Lafcadio raconter mon roman. Ce serait un récit d’événements qu’il découvrirait peu à peu et auxquels il prendrait part en curieux, en oisif et en pervertisseur. Je ne suis pas assuré que cela rétrécirait la portée du livre ; mais cela me retiendrait d’aborder certains sujets, d’entrer dans certains milieux, de mouvoir certains personnages… Aussi bien est-ce une folie sans doute de grouper dans un seul roman tout ce que me présente et m’enseigne la vie. Si touffu que je souhaite ce livre, je ne puis songer à tout y faire entrer. Et c’est pourtant ce désir qui m’embarrasse encore. Je suis comme un musicien qui cherche à juxtaposer et imbriquer, à la manière de César Franck, un motif d’andante et un motif d’allegro.
Je crois qu’il y a matière à deux livres et je commence ce carnet pour tâcher d’en démêler les éléments de tonalité trop différente.
Le roman des deux sœurs. L’aînée qui épouse, contre le gré de ses parents (elle se fait enlever) un être vain, sans valeur, mais d’assez de vernis pour séduire la famille après avoir séduit la jeune fille. Celle-ci, cependant, tandis que la famille lui donne raison et fait amende honorable, reconnaissant dans le gendre des tas de vertus dont il n’a que l’apparence, celle-ci découvre peu à peu la médiocrité foncière de cet être auquel elle a lié sa vie. Elle cache aux yeux de tous le mépris et le dégoût qu’elle éprouve, prend à cœur et tient à honneur de faire briller son mari, de couvrir son insuffisance, de réparer ses maladresses, de sorte qu’elle est seule à connaître sur quel néant repose son « bonheur ». Partout on cite ce ménage comme un ménage modèle, et le jour où, excédée, elle voudra se séparer de ce fantoche, vivre à part, c’est à elle que tout le monde donnera tort. (La question des enfants à étudier à part.)
J’ai noté ailleurs (cahier gris) le cas du séducteur – qui finit par être captif de l’acte qu’il a résolu d’accomplir – et dont il a épuisé par avance et en imagination tout l’attrait.
Il n’est pas nécessaire qu’il y ait deux sœurs. Il n’est pas bon d’opposer un personnage à un autre, ou de faire des pendants (déplorables procédés des romantiques).
Ne jamais exposer d’idées qu’en fonction des tempéraments et des caractères. Il faudrait du reste faire exprimer cela par un de mes personnages (le romancier). – « Persuade-toi que les opinions n’existent pas en dehors des individus. Ce qu’il y a d’irritant avec la plupart d’entre eux, c’est que ces opinions dont ils font profession, ils les croient librement acceptées, ou choisies, tandis qu’elles leur sont aussi fatales, aussi prescrites, que la couleur de leurs cheveux ou que l’odeur de leur haleine… »
Exposer pourquoi, en regard des jeunes gens, ceux de la génération qui les a précédés, paraissent à ce point rassis, résignés, raisonnables, qu’on se prend à douter si, du temps de leur propre jeunesse, ils ont jamais été tourmentés des mêmes aspirations, des mêmes fièvres, s’ils ont nourri les mêmes ambitions, caché les mêmes désirs.
Réprobation de ceux qui « se rangent » contre celui qui reste fidèle à sa jeunesse et ne renonce pas. Il semble que ce soit lui qui soit dans l’erreur.
J’inscris sur une feuille à part les premiers et informes linéaments de l’intrigue (d’une des intrigues possibles).
Les personnages demeurent inexistants aussi longtemps qu’ils ne sont pas baptisés.
Il arrive toujours un moment, et qui précède d’assez près celui de l’exécution, où le sujet semble se dépouiller de tout attrait, de tout charme, de toute atmosphère ; même il se vide de toute signification, au point que, désépris de lui, l’on maudit cette sorte de pacte secret par quoi l’on a partie liée, et qui fait que l’on ne peut plus sans reniement s’en dédire. N’importe ! on voudrait lâcher la partie…
Je dis : « on » mais après tout, je ne sais si d’autres éprouvent cela. État comparable sans doute à celui du catéchumène, qui, les derniers jours, et sur le point d’approcher de la table sainte, sent tout à coup sa foi défaillir et s’épouvante du vide et de la sécheresse de son cœur.
19 juin.
Il n’est sans doute pas adroit de situer l’action de ce livre avant la guerre, et d’y faire entrer des préoccupations historiques ; je ne puis tout à la fois être rétrospectif et actuel. Actuel, à vrai dire je ne cherche pas à l’être, et, me laissant aller à moi-même, c’est plutôt futur que je serais.
« Une peinture exacte de l’état des esprits avant la guerre » – non ; quand bien même je la pourrais réussir, ce n’est point là ma tâche ; l’avenir m’intéresse plus que le passé, et plus encore ce qui n’est non plus de demain que d’hier, mais qu’en tout temps l’on puisse dire : d’aujourd’hui.
Cuverville, 20 juin.
Journée de torpeur abominable, comme, hélas, je crois que je n’en ai connu de semblables qu’ici. Influence du temps, du climat ? Je ne sais ; je me traîne d’une occupation à l’autre, incapable d’écrire la moindre lettre, de comprendre ce que je lis, ou même, au piano, de faire correctement une simple gamme ; incapable même de dormir lorsque, par désespoir et désireux de m’évader, je m’étends sur mon lit.
Par contre, au moment d’aller me coucher, je sens que ma pensée se ranime, et, confus d’avoir si mal occupé ma journée, je prolonge jusqu’à minuit la lecture de Browning : « Death in the desert », où bien des détails m’échappent, mais qui met en fermentation ma cervelle comme les plus capiteux des vins.
I say that man was made to grow, not stop ;
That help, he needed once, and needs no more
Having grown but an inch by, is withdrawn,
Fort he hath new needs, and new helps to these
etc. V. 425.
que je copie pour l’usage de Lafcadio.
6 juillet 1919.
Travail coupé par l’arrivée de Copeau à Cuverville, retour d’Amérique et que je vais chercher au Havre.
Je lui ai lu le début encore incertain du livre ; pris conscience assez nette du parti que je pouvais et devais tirer de cette forme nouvelle.
Le plus sage est de ne point trop se désoler des temps d’arrêt. Ils aèrent le sujet et le pénètrent de vie réelle.
Cette conversation d’ordre général sur quoi je souhaiterais ouvrir le livre, je crois que je peux trouver mieux qu’un café pour lui servir de décor. La banalité même du lieu m’a tenté. Mais mieux vaut ne recourir à aucun décor indifférent à l’action. Tout ce qui ne peut servir alourdit. Et ce matin, je me demande pourquoi pas le jardin du Luxembourg, et précisément ce lieu du jardin où se fait le trafic des fausses pièces d’or, derrière le dos de Lafcadio, et sans qu’il s’en doute, et tandis qu’il écoute et note cette conversation d’ordre général, et si grave, mais que du même coup, le petit fait précis va réduire à l’insignifiance. Édouard, qui l’envoyait là-bas pour épier, lui dira :