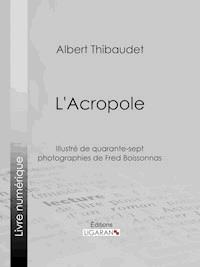
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Un olivier au large feuillage était planté dans ma cour, vigoureux, fleurissant, épais et pareil à une colonne. Autour de lui je construisis ma chambre nuptiale, j'entassai les fortes pierres, je mis un toit, je posai les portes compactes et solides. Puis je retranchai sa chevelure large de rameaux ; je coupai le tronc au-dessus des racines, je le polis soigneusement avec l'airain, et, travaillé au cordeau, je fis de lui le gros support."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Un olivier au large feuillage était planté dans ma cour, vigoureux, fleurissant, épais et pareil à une colonne. Autour de lui je construisis ma chambre nuptiale, j’entassai les fortes pierres, je mis un toit, je posai les portes compactes et solides. Puis je retranchai sa chevelure large de rameaux ; je coupai le tronc au-dessus des racines, je le polis soigneusement avec l’airain, et, travaillé au cordeau, je fis de lui le gros support ; je perçai à la tarière lui et les branches qui s’en échappaient. Sur ce châssis je façonnai ma couche ; je l’ornai d’or, d’argent, d’ivoire, et je tendis à l’intérieur, des sangles en cuir de bœuf, luisantes de pourpre ».
Ces vers de l’Odyssée me venaient parfois à l’intelligence quand je montais, après les Propylées, le chemin de l’Acropole : sentier de montagne, égalisé par le fer, rayé de stries pour que le pied n’y glisse, et dont le calcaire rosé conserve comme un beau bois noueux sa substance et sa vie ; chemin qui marchait avec moi et suivait le pas comme un enfant donne la main. Il ajoute à l’Acropole, exactement, sa Voie Sacrée, sa nervure fine et rustique ; et la colline taillée, la table de roc, mieux que le Sphinx d’Égypte humanisée et polie, où l’arasement pélasgique, les terrassements des remparts, en la disciplinant ne séchèrent, ne mutilèrent rien, il nous prépare à voir en elle ce lit d’Ulysse, bâti dans l’arbre de Pallas par le héros industrieux que la déesse surveille.
Ainsi le chemin qui menait vers l’autel oriental le cortège des Panathénées sait encore délicatement nous conduire à l’endroit exact où nos pensées d’abord organiseront le mieux leur procession souple. La montée est, sous le ciel de mai, chaude, et tout de suite nous arrivons au nord du Parthénon, là où le soleil qui ne glisse qu’obliquement n’a pas, de lumière, roussi les colonnes, où, restées blanches, elles se sont, comme des bouleaux, mouchetées de mousses vertes. Les fondations et le soubassement sont noirs ainsi qu’un terreau humide ; la brise met sur le marbre un glissement de source ; le front rafraîchi se dispose à fleurir dans le commerce de la beauté, et voici que les yeux rencontrent une inscription gravée sur le roc, qu’entoure une grille, et que coquelicots et camomilles recouvrent. Elle consacre l’endroit à la « Terre porteuse de fruits ».
Sur cette pierre nue les yeux sont tentés de prendre ironiquement cette dédicace ; mais comme elle éclate aux esprits ! Porteuse de fruits… Tout le rocher fructifie en marbre, et, droit en face de la pierre inscrite, ces fruits poussent leur forme suprême, sous la draperie ionique, dans le sein jeune des Cariatides. Le Parthénon autour de nous incorpore à sa ruine la maturité de l’or séculaire ; éclatements et trouées y sont comme les percées que les guêpes ont faites aux fruits d’automne, marquent une place de miel qui laisse la chair et le cœur intacts. Et cette jonchée, à nos pieds, de fûts brisés, la terre comme des graines tombées les reprend pour qu’elles développent en nous la ligne de leur aile renouvelée.
Les monuments tiennent au rocher, qui lui-même est déjà un monument. Avant de sculpter des hommes, les fils d’Érechthée ont sculpté leur terre, l’ont ajustée à eux : l’Acropole, l’Aréopage, la Pnyx, trois autels qu’ils ont rabotés, où devaient s’édifier la religion, la justice et la parole ; trois socles que les Pélasges préparent à la statuaire de Phidias, à l’Orestie d’Eschyle, au discours de Démosthène. Comme des muscles forts sous la grâce de ses éphèbes, comme une anatomie experte, une charpente juste sous les contours de ses statues, au-dessous de la beauté d’Athènes gît une patiente énergie cyclopéenne. De la plaine, à l’est, on voit l’Acropole relevée par deux énormes volutes de pierre rougeâtre : ce plateau égalisé, ce rempart à pic, la terre, d’un mouvement des reins visible, comme un Atlante les soutient haut, les maintient droit. Au nord, les grottes élargissent les voûtes humides où l’homme, qui les creusa davantage, les aménageant en sanctuaires, continua par le fer le travail de l’eau. Les collines autour de la colline ouvrent du paysage la corolle indéfinie. De partout il est fait à coups d’un ciseau dont les carrières blanches du Pentélique montrent, en un point, la trace toute fraîche. Et si les lignes, parfois, coulantes dans l’espace qui les éloigne, paraissent flotter et défaillir, près de nous la forte et fière masse du Lycabette les saisit et les resserre, comme par une main, du même geste gracieux et net dont les Korai peintes, au Musée de l’Acropole, arrêtent et relèvent les plis de leur tunique ionienne.
L’aire, construite et vivante, restait présente sous les édifices comme une branche sous les fruits. La forme du temple d’Athéna Nikè était commandée par l’aspect ailé de l’angle qu’avançait le rempart ; les Propylées devaient amplifier, nourrir et cristalliser le pli qui fait charnière entre la montée et le plateau ; l’Érechthéion se moulait de près et précieusement sur de petits sanctuaires et des lieux sacrés ; le développement de la droite terrasse méridionale remblayée par Cimon appelait la ligne du Parthénon, et la courbure du plateau sollicitait déjà celle du soubassement ; au point le plus haut du rocher, il fallait que prît place le grand autel d’Athéna, qui, au jour des sacrifices, posait sur la colline la flamme et la fumée comme le casque doré sur le front de la déesse.
L’Acropole dit la dernière et la plus haute strophe d’un chant que sous vos yeux se transmettent six voix entrelacées de l’Attique. Elle est, comme la Tribune de l’Érechthéion, portée par six figures de vierges robustes et calmes, et toutes six, comme l’Acropole, diversifient le visage de la matière où s’éveille l’esprit.
L’argile. De cette terre attique il est un lambeau, Cendrillon restée nue, et, dans le sous-sol obscur, non prédestinée aux fruits. Humble, elle n’eût été que la servante des eaux souterraines, si la déesse de l’industrie, si l’intelligente Erganè, ne l’avait prise en faveur et conduite à la lumière. C’est l’argile à potier d’Athènes, une argile toute fine et pure. Ne produisant pas de fruits, elle-même est modelée aux mains de l’homme, mûrie à son feu, en les fruits les plus délicats et les plus durables, ceux que les morts, les ayant gardés dans leur voyage, laissent aujourd’hui, par milliers, glisser de leurs mains ouvertes, exhaler leur image aux vivants.
Les céramistes, qui firent les vases du musée d’Athènes trouvés au Dipylon, furent ici les premiers artistes, et, dans cette inépuisable terre à potier, l’Acropole de Périclès nourrit sa première racine. Nous n’imaginons pas une Athènes homérique, comme Mycènes, riche d’or, et de l’or étranger ; mais son art d’abord fut, comme se voulait son peuple, autochtone, né de sa terre, et riche seulement de travail et d’invention. On reconnaît, selon Gautier, que les hommes sont civilisés quand ils ne savent plus faire ni un vase ni une corbeille. Mais la fraîcheur de la culture athénienne vint, dirait-on, de ce qu’on y discerne jusqu’au bout le coup de pouce du potier et du vannier. L’homme, selon Anaxagore, est intelligent parce qu’il a une main ; la plasticité de l’intelligence paraît suivre chez les Athéniens la souplesse de la main. Dans la maison sans meubles, les vases mettaient des formes pures auxquelles les yeux s’accoutumaient ; ils en humanisaient, par leurs contours de hanche ou de sein, l’ombre. Sur cette terre à potier les artisans d’Athènes se sont fait des doigts assez délicats pour toucher dignement au marbre, au bronze, à l’ivoire, à l’or, et l’opulence de la matière vint tard s’offrir, comme une consécration dernière, à l’art devenu capable d’en jouer librement. Par le soubassement incurvé du Parthénon, une main épousa le rocher, comme, en palpant le flanc d’un vase, elle se fût courbée ; ainsi que l’ivoire s’amollit pour la statue de la déesse, le marbre s’infléchit dans une ductilité transmise par l’habitude de l’argile ; les colonnes du temple et toutes ses lignes sont flexibles comme l’osier dont une corbeille se tresse ; et dans la plus pesante matière, ainsi, s’est insinuée sans défaut Pâme des choses les plus légères.
Le marbre. Levant les yeux de cette place où la Terre était vénérée, voyez dans le soir l’horizon porteur, aussi, des fruits les plus lumineux, et les montagnes comme des pommes et des grenades mûres. Sous le fronton du Pentélique, éclatent les brèches blanches des carrières. La matière maternelle, de là, se soulève à demi, pour voir, sur l’Acropole, sa forme, sa fleur ouverte et mutilée.
Au bas des Propylées, par la pente de la colline, était déposé, tout à l’heure, par grands blocs, pour les restaurations, du pentélique neuf. Et je les voyais, ces blocs, troupeau brut, massif et majestueux, en route vers les portes de Mnésiclès, et vers l’ordre et vers la beauté. J’ai lu qu’un voyageur en Asie Centrale, ayant aperçu de grosses pierres étrangement semées sur une piste de désert, s’enquit auprès de son guide, qui lui dit : « Elles vont en pèlerinage ! » – et qui disait vrai. On était sur la route d’un sanctuaire vénéré ; chaque troupe de pèlerins qui passait donnait à l’une des pierres une petite poussée, pour qu’elle aussi avançât et fît un pas vers le lieu de paix. Comme cette impulsion obscure d’Orientaux se met sur la ligne où pensent Aristote et Leibnitz ! En lisant ce numéro du Tour du Monde, ma pensée se reportait à cette belle musique métaphysique qu’inspire à Ravaisson, sur la fin de son Rapport, la méditation du Stagyrite : « Si les pierres de la Fable obéissent à une mélodie qui les appelle, c’est qu’en ces pierres il y a quelque chose qui est mélodie aussi, quoique sourde et secrète, et que, prononcée, exprimée, elle fait passer de la puissance à l’acte. » L’intelligence, par ses chemins, attire la matière, et peu à peu, comme sous les doigts lents d’une aube, l’esprit éteint s’allume. Ces blocs qui montaient à l’Acropole, je voudrais toujours ici les voir figurer nue une basse fondamentale de l’harmonie qui nous conduit à penser.
Le marbre attique qui cheminait par la plaine croisait, à l’Acropole, un marbre plus exquis, tribut de la mer et de Paros. Sur le vaisseau d’Ionie, chargé de la matière précieuse, vint peut-être le jeune Parien qu’aima Phidias et dont il fit un grand sculpteur, Agoracrite. La violence démesurée des pressions subies dans la terre par les calcaires métamorphosés a mis au cœur de l’Archipel ce marbre le plus pur du monde. La lumière, qui ne pénètre qu’à quinze millimètres dans le Pentélique et à vingt-cinq dans le Carrare, fait au Paros une peau transparente de trois centimètres et demi. Cette fleur adolescente de sa pulpe désigne la seule matière où l’esprit puisse en toute fraîcheur créer sa chair de pierre idéalisée. J’aime qu’André Chénier dans son poème de l’Invention l’ait prise pour symbole de la matière poétique.
Dieu tout entier habite en ce marbre penseur !
C’est la première démarche de notre intelligence et de notre goût que de sentir des mains, dans ce marbre pentélique, un corps. Dur, doré, tiède, il vit. Sa substance a pour sœur exacte une chair méditerranéenne, les bras de Charmide ou le sein calme d’une fille d’Arles. Il se repose, comme eux, dans l’amitié de la lumière, et déclare par un même langage l’énergie du soleil. Il m’est plus clair encore quand j’évoque sur lui quelque contraste. Je songe à une chair du Nord, blanche, douce de lait opulent, cœur de fruit, qui roule, en traînant des roses, sous le pinceau d’un Rubens, d’un Greuze, d’un Lawrence, et je pense à sa matière fraternelle aussi : le calcaire de ces églises gothiques flamboyantes, en Picardie, aux contours par la pluie émoussés, aux statues imbibées de mousse, effritées sous le ciel gris et l’ondée ; une caresse veloutée et fuyante, une main qui ne résiste pas et qui se fond, l’acte de la terre passive, inépuisée, la pierre molle qui s’est incorporé l’eau du ciel comme le marbre, ici, s’est nourri de sa lumière.
De la lumière, toutes les formes et les intensités occupent sur lui des places harmonieuses, comme un chœur. On en suit, autour du Parthénon, le voyage et l’histoire. Le marbre au nord est resté froid, blanc et comme nocturne encore ; ici nos yeux reconnaissent sur la ruine les soleils frais de printemps ; là-bas ils vont cueillir les soleils longs et rêveurs d’automne ; et, par places, le pentélique n’est plus doré, mais violemment roussi comme sous les jours torrides d’été. Le temple paraît garder ainsi les pas inégaux de l’année, et, de même que ses sculpteurs avaient, à ses quatre flancs, fait tourner la procession d’Athènes sous le voile des Panathénées, voici que se développe, sur sa ruine et de sa ruine le poème des saisons, sur son marbre et de son marbre le cortège ordonné des Heures.
Le blé. Mais, tige de l’Acropole, chaume qui en lève l’épi fauve, voyez du Céramique, dans les oliviers et les moissons, la Voie Sacrée qui va vers Éleusis, et, dans le souvenir qui la suit, suivez le mystère attique du blé.
Au printemps, le cercle des montagnes plonge dans un calice de fraîche verdure, et l’Athènes agricole, celle qu’Aristophane aimait, s’épanouit comme la nourrice du paysage. Ainsi que les deux sandales que posent alternativement, le soir, les pieds dorés de la lumière qui décline, côte à côte s’étendent la bande tendre du blé nouveau, la bande foncée du bois d’oliviers.
Au musée d’Athènes, le bas-relief illustre d’Éleusis peut-il ne pas éveiller chez l’Européen un émoi religieux ? Devant Nausicaa la première pensée d’Ulysse la compare au palmier de Délos ; mais l’adolescent Triptolème n’est-il pas ici ce long épi sacré que chaque initié avait vu aux mains du prêtre éleusinien ? Lui qui reçoit de Déméter le grain, il a les formes flexibles et pleines du blé mûr ; et sa jeune tête sérieuse, chargée d’intelligence et de confiance, comme l’épi dépasse les coquelicots stériles et les bleuets sans lendemain, se lève au-dessus de l’Athènes ionienne, et de ce qui, dans le parterre des Korai peintes, fleurissait à l’Acropole. Épi poussé à l’air, corps bruni de soleil, il a la couleur et la densité du pain.
Au mois de mai, sur l’Acropole, ne triomphent que vastes pavots, d’un rouge grenat, au fond desquels une croix grecque, de velours noir aux bords violets, étend un cœur de ténèbre chaude. Sous eux dévale l’épaisse végétation, bruissante d’abeilles et de bourdons ; les mauves, les orties blanches, les camomilles ondulent par toutes les pierres comme une eau dense, intarissable, sonore. Cette floraison des pavots met sur le champ de pentélique la figure de guérets mûrs, où la pensée à brassées moissonne, engrange en chantant ; par la couleur vive et fougueuse, remontent sur la pierre dorée le sang des victimes, la flamme des autels, le fond de pourpre où les reliefs des métopes vivaient. Une gloire poétique, un chant de lyre, touchent ce blé de soleil, et toute la colline des temples collabore pour que l’instant, ne passant plus, soit tendu hors la durée, comme l’épi d’Éleusis.
La vigne. À l’automne, l’Acropole brûlée a séché sur la pierre inscrite toutes ses herbes, et les treize lettres maintenant dévoilées éclatent comme un cachet : ϒῆς ϰαρποφόρου. C’est alors que sur les routes les raisins blancs vont au pressoir. Ils donnent un vin médiocre, et que les Grecs suffoquent terriblement de résine ; mais nous ne lui demandons d’autre qualité que celle de la mémoire qu’il évoque, et ne songeons dans ces vendanges qu’au Dionysos d’Athènes.
Le même rythme qui mène ici vers sa densité, sa plénitude et sa clarté et transfigure en âme humanisée toute nourriture de la terre, a pris les forces aveugles du vin et les fureurs dionysiaques pour les conduire, ainsi que l’argile à la ligne assouplie, que le marbre au contour vivant, et que le grain à l’espoir d’immortalité, vers le lieu géométrique et purifié de la seconde naissance. Aux racines de l’Acropole, voici le Théâtre, aussi ; les gradins de bois où se célébrèrent longtemps les jeux de Dionysos ont fait place à la substance dure par laquelle s’inscrit, dans la montagne, un siège, une station pour l’Esprit de la terre, pour le miroir qu’il porte.
« Il y a de la géométrie partout et de la morale partout, » dira Leibnitz. De la morale, c’est-à-dire de l’âme en tant qu’elle se connaît, qu’elle lutte et qu’elle dure. Et le théâtre, figure géométrique, épure de pierre, théorème et non idéal cristallisé en marbre, le voici qui donne à l’âme, à l’intensité réglée de la vie, à la passion purifiée, son aire substantielle.
Le cheval. Mais l’Acropole même atteste deux autres présents des dieux : de la place que frappa le trident de Poséidon et qui en garde l’empreinte, avait jailli le cheval, – et tout à côté le Pandrosion abritait l’olivier par lequel Athéna vainquit.
Il me semble bien que la première fois que j’entendis prononcer le nom d’Athènes, ce fut dans une de ces historiettes inventées pour l’édification des enfants : celle du cheval qui, abandonné dans sa vieillesse par son maître, prit, parmi l’herbe qu’il broutait dans la rue, une corde de sonnette, celle de l’Aréopage, et fut par les juges reçu comme partie dans un procès d’ingratitude. La sonnette de l’Aréopage se trouve chez le même marchand que la clef du champ de manœuvres.
Les Athéniens avaient le goût passionné des chevaux, et, comme en Angleterre, les riches mettaient leur honneur à en élever beaucoup, à les monter souplement, à voir leurs attelages triompher aux jeux Olympiques. Les cavaliers qui se déroulent sur la frise des Panathénées naissent ainsi, avec grâce et sans effort, de la plaine, de la vie, de l’habitude attiques. Dans ces jeunes gens que leurs traits ne différencient pas, de beauté, de santé, de vigueur tous pareils, et précisément parce qu’ils monnayent la même figure idéale, je reconnais le jeune Athénien de culture moyenne, harmonieuse et forte, Xénophon, qui devait avoir de quinze à vingt ans quand les plaques de marbre prirent place. Ce mouvement que, depuis le premier pas des statues dédaliennes, la sculpture grecque réalisait peu à peu, avec patience et passion, il épouse dans la procession l’allure du cheval, il va avec lui vers l’aisance, l’ampleur et la grâce. Il mène par sa ligne le chœur des hommes et celui des monuments, et comme, sous les vents étésiens, la mer ses vaisseaux, il porte toute la cité vers sa fleur de l’Acropole.
L’olivier. Sur l’Acropole, il n’y avait qu’un seul arbre, et, de la pierre dédiée à la terre frugifère, vous voyez, à côté de l’Érechthéion, l’emplacement de son enceinte. C’était l’olivier sacré, celui dont la naissance fit de Pallas la déesse de l’Attique, et qui, coupé par les Perses, dans la nuit même repoussa de deux coudées, – symbole du vivace génie athénien. Un olivier de marbre florissait au fronton occidental du Parthénon ; mais, sur la plaine, là-bas, la même âme faisait, de la maigre terre, surgir les oliviers de Colone.
Quand on sort de ces oliviers, on voit, à gauche de sa route, une butte. Elle est celle-là même où Œdipe vint s’asseoir, d’où il n’alla pas plus loin, et fut salué par le chœur athénien. « Tu es, ici, étranger, au plus beau de ce pays riche en chevaux, dans la blanche Colone : par ses vertes vallées le rossignol abonde et chante. Il y habite le lierre sombre et l’inviolable forêt au feuillage serré, aux innombrables fruits, inaccessible aux rayons du soleil comme à la violence des tempêtes. Toujours y va Dionysos, accompagné des déesses qui l’ont nourri. Sous la rosée du ciel sans cesse y fleurissent le narcisse aux belles touffes, couronne antique des Grandes Déesses, et le crocus doré ; les sources courantes du Céphise jamais n’y dorment ni ne défaillent… et ce vallon les chœurs des Muses ne l’ignorent pas, non plus qu’Aphrodite aux rênes d’or. »
Prenez-y place. L’Attique d’ici se développe ; l’Acropole étend au milieu des montagnes irrégulières son piédestal humanisé ; ses marbres, comme ils feraient sous de surabondantes fleurs, écartent le feu rose dont le soir les presse. Et ne sentez-vous pas à votre pensée la forme de fruit que pousse pour vous la dernière et l’invisible branche du bois qui vous occupait ?
Mais le tertre de Sophocle n’est pas vide, et deux tombes le surmontent. Un Français, un Allemand, studieux des livres et des monuments grecs, Charles Lenormand, Otfried Muller. On verra ici, à la place où Œdipe vint chercher le repos, où nous cherchons l’intelligence, deux stèles, deux pierres en pèlerinage, deux frères sur le chemin qui nous conduit. Une heure du soir, ici, par nous passée, approche de nous le rameau d’olives, répand l’huile sur notre pensée qui s’exerce, dispose, dans la chambre d’une nuit attique, comme une lampe d’étude, la première étoile qui point.
Six figures, ainsi, de la Terre porteuse de fruits, montent pour éclairer notre patience et nous guider sur l’Acropole. Et toutes puisent dans leur loi, toutes retrouvent aux mains de l’homme, le même signe qui fait d’elles six jeunes Heures associées, six Cariatides sous le même fardeau. La matière, la vie du sol, aux sens avisés et fins d’Athènes apportent nourriture et joie. Mais comme, au bout de la tige, une feuille privilégiée devient fleur, un ordre nouveau germe aux pointes de l’ordre ancien, le transpose dans une plus fine harmonie et le propose à une pensée.
L’olivier, dans sa passion de clarté, se tend pour que ses racines ne soient pas toutes enfouies, mais, élevées au-dessus du sol, à demi paraissent et s’ensoleillent : sous nos yeux, l’Acropole se construit, de six racines que traîne à la lumière son tronc plein de force, écheveaux toujours recomposés, qu’en croissant elle démêle et tisse.
Nulle beauté, sur l’Acropole, qui soit plus cruellement lésée et meurtrie que celle des Propylées. Coupés par le milieu, ils gardent encore l’Aspect pitoyable d’une amputation fraîche. Le premier coup de cognée leur fut donné – et il se continue devant nous – par l’escalier romain, les portes romaines, toute cette lourdeur, cette symétrie qui les délayent en les faisant commencer au pied même de l’Acropole, les diminuent en nivelant sous une diffusion de marbre le roc nu d’où jaillissaient nativement leurs sources. Devenus sous les Turcs un magasin à poudre, la foudre les disloqua, leur crête peu à peu tomba. Et cette chute de leurs frontons, cet écroulement de la structure supérieure, paraissent prolonger dans les âges le style de l’escalier romain. Leurs formes cubiques et coupées les mettent à l’unisson du piédestal d’Agrippa. Si le Romain a disparu de ce socle, le bloc qu’il occupait donne, comme un bâton de chef d’orchestre, autour de lui le ton horizontal, massif, glacé. Construction et mutilations collaborent pour créer un ordre latin, réduit à des racines. Mais le temple de la Victoire, bien que lui aussi ait perdu son fronton et qu’il soit aspiré par cette impérieuse autorité de lignes droites, voyez comme, isolé sur son angle à pic, dans l’air bleu, rompant la pesante ordonnance imposée par la ruine, il se détourne, échappe à l’emprise. Cet ordre de Rome, les fines colonnes ioniques imperceptiblement lui disent non. Et dès notre premier regard, la montée de l’Acropole nous demande de calmer un conflit entre une règle née peut-être de la mutilation, et la vive, la fragile souplesse d’un génie libre.
Pour le calmer, il nous suffit de nous élever, de nous asseoir dans le portique même de Mnésiclès, et de laisser la parole aux images athéniennes. Nous sommes à même la chair, la masse et le poids de cette moitié inférieure intacte ; nous lui donnons dans l’architecture la place qu’occupe dans la sculpture le Torse du Belvédère. C’est une force qui se ramasse, et qui prend une tristesse tragique de n’avoir plus de membres à mouvoir ni de destinée à porter ; une carrière qui attend que la pensée refasse d’elle un fronton, et que le regard relève comme une fière suppliante l’architrave tombée de marbre.
Les gens du métier considéraient les Propylées comme le chef-d’œuvre de l’architecture ; il s’agissait là non d’une voix populaire comme celle qui nommait les sept merveilles du monde, choisies pour leur énormité, mais d’une opinion compétente et professionnelle. Comme la chapelle des Brancacci, comme les cartons de la Guerre Pisane, par leur perfection robuste, rayonnante, ils conduisirent ou confirmèrent une génération dans les voies droites du métier. Morceau des connaisseurs ainsi que le Clocher Vieux de Chartres, ils étaient loués pour les mêmes réussites : une solidité qui garantit la durée jusqu’aux limites possibles, la probité de l’appareil unie à la perfection du travail, une pondération précise de tous les membres, et, sur les niveaux différents d’un terrain inégal, cet art souverain des transitions que Boileau enviait à juste titre, puisqu’il transcrit dans l’art l’image la plus exacte de la vie.
Ainsi l’entrée de l’Acropole ouvrait une école d’architecture, comme les promenades par lesquelles on abordait Athènes, l’Académie ou le Lycée, allaient devenir des écoles de philosophie. Cette aire bienfaisante de marbre solidifiait sous les pas la clarté de l’intelligence. Les Propylées n’étaient pas un temple, bien qu’ils en gardassent les formes, mais le chemin logique des temples, comme la dialectique de Platon est le chemin de l’intuition et du mythe. Pensée non encore froide, scolastique, stylisée, vitruvienne, mais, toute, à sa fraîcheur de source, et, miel attique, à son odeur de ruche.
Dépourvus de sculptures, et laissant jouer les seuls motifs architecturaux, les Propylées, mieux qu’un temple, cristallisaient, nus, le monument pur. Nulle religion, nulle présence divine ne venait compliquer leur notion harmonieuse. Nulle invention qu’ici une fantaisie eût inspirée, mais toutes trouvailles avaient, comme l’olivier d’Athéna, leur racine en ce lieu préfixe, et chacune, donnée dans la forme du roc, imposée par la nature, semblait, sous la main de Mnésiclès, proposée par la raison. Les Propylées furent conçus, dans l’espace, comme l’entrée de l’Acropole ; mais ils en furent, dans le temps, la clôture, la conclusion, le sceau. Ils marquèrent que la colline formait un tout vivant. La vanité un peu lourde des Romains dédiait partout, et même ici, des temples à la déesse Rome. Athènes n’eût pas voulu diviniser sa citadelle ; mais les Propylées vides paraissent personnifier sur elle la descente définitive et le siège exact de la perfection. Comme le Parthénon celui d’Athéna, ils sont le temple de l’Acropole. Ils achèvent par la conscience claire cette construction patiente, cette sculpture du rocher qu’avaient commencé les Pélasges. Ils sont dédiés à cet esprit d’accueil hospitalier et aussi d’enracinement, à cette maturité d’où pèsent également, comme d’un fléau, l’heure des fleurs ouvertes et l’époque des graines tombées. Ils font passer l’Acropole, de sa nature locale, de son rôle athénien, à une nature et un rôle humains. Ils l’y font passer doucement et d’elle-même, comme si c’était nous qui divisions en deux moments, exprimions par deux signes, une seule et pure nature. Par cette entrée où les processions montent, il semble aussi que vont descendre les dieux : « Nous appelons Grecs moins ceux qui partagent notre origine que ceux qui participent à notre culture. » Cette phrase d’Isocrate, l’architrave de marbre où je suis assis me la rend dans son ampleur et son équilibre, elle a le grain de l’indestructible poutre, et c’est d’elle que le Panégyrique d’Athènes descend vers nous par l’hellénisme ouvert d’Alexandre et d’Aristote.
Ramassés en ailes, sans ampleur de façade, les Propylées gardent tout l’accent sur leur nature de portes ; ils encadrent de marbre le chemin qui conduisait à ces immenses vantaux cuirassés de bronze, et les cinq entrées demeuraient claires au bout des avenues courtes. Mais, remplissant toute leur fonction de portes, ils ne l’outrepassaient point. Le Grec ne songe pas, comme le Byzantin ou l’Italien, à ces précieuses portes sculptées qui vous arrêtent au lieu de vous conduire. Il lui eût déplu de reconnaître au Baptistère de Florence, dans l’œuvre de Ghiberti, les équivalents de métopes entassées. Il eût été moins choqué par l’idée romane et gothique, où la porte ne présente qu’une œuvre de menuiserie et de serrurerie, tandis que l’ébrasement, avec ses statues enseignantes incorporées à la pierre de l’édifice, dispose, d’un doigt levé, l’âme à la présence, à la parole de Dieu. Et puis, dans une décoration de tableaux ou de registres superposés, l’œil ne voit pas ceux du bas avec les mêmes dimensions que ceux du haut, dont le détail lui échappe ; Michel-Ange trouvait les portes de Florence dignes de fermer le Paradis, mais Héphaistos, s’il avait reçu une commande pour celles de l’Olympe, les aurait conçues différemment.
Dans le temple grec, l’intérieur et l’extérieur sont pour le regard à peu près indépendants, et ni l’enveloppe de colonnes ni la décoration ne désignent l’ordre ou la nature des salles. Au contraire, les nécessités de leur construction et le goût qui s’en développa conduisirent les architectes du Moyen Âge à faire du dehors le repoussé du dedans, et les mêmes nécessités inclinèrent les Propylées vers la même idée architecturale. Ils annonçaient, indiquaient l’Acropole, ainsi que fait des trois nefs le triple porche gothique. Les deux ailes esquissaient cette distribution de la colline en deux moitiés souples, comme les deux parts du corps humain, gouvernées par l’épine dorsale de la Voie Sacrée, et dont l’une portait le Parthénon, l’autre l’Érechthéion.
Placés à la charnière de l’Acropole, sur une croupe, ils épousaient les formes du terrain, ils acceptaient, ils accusaient, ils utilisaient la différence des niveaux. Ils transportaient dans le comble le rythme de l’escalier. En avant, le temple de la Victoire ouvrait légèrement son mince fronton, premier degré d’une ligne où d’autres frontons s’élevaient en hauteur croissante, se développaient aux yeux comme des degrés sous la marche : le toit incliné de l’aile Sud, les deux frontons du Propylée central, peut-être celui d’un petit temple ou trésor d’Athéna Erganè, et le tout menant au quatrième (ou cinquième) et définitif triangle du Parthénon. Ainsi, la face Ouest du grand temple, qui de près, était encombrée un peu, de loin prenait sa pleine valeur, apparaissait après des transitions claires, et préparée par un piédestal vivant. Tandis que le soubassement des Propylées ne comportait pas de courbure (les changements de direction l’eussent brouillée et brisée), la courbure modelait au contraire l’entablement, en harmonisait les lignes avec celles du Parthénon. Mais seul le dernier et le plus haut fronton, celui du grand temple d’Athéna, étendait avec gloire un champ peuplé de statues. Les autres, vers lui marchant et progressant, allaient à la forme parfaite et pensante, et lui proposaient, dans la troisième dimension, ces mêmes degrés transitoires, raisonnables et justes, qui, de la racine au faîte, conduisent l’œil sur la hauteur d’une façade dorique.
Nous savons aujourd’hui que les Propylées ne furent jamais terminés. Certaines amorces, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’enceinte, ont permis à M. Dorpfeld de préciser, avec une certitude que quelques hypothèses allongent, le plan primitif de Mnésiclès. À l’intérieur, les deux angles que forment les ailes avec le Propylée central devaient être bâtis, occupés par de grandes salles ; – à l’extérieur l’aile Sud devait avoir la même étendue que l’aile Nord, et le pilier d’ante isolé devant elle indiquait le sens de l’extension projetée. M. Dorpfeld ajoute – mais ce n’est plus là qu’une impression – que les ailes avaient probablement une destination religieuse, que la Pinacothèque, avec ses fresques analogues à celles de l’Érechthéion, devait être prévue comme chambre de culte, et que son plan est celui d’un temple, dont les titulaires auraient pu être Hécate, ou les Grâces…
La raison de l’inachèvement est peut-être dans le manque de ressources quand la guerre de Péloponnèse eut éclaté, mais aussi et certainement dans l’opposition de ceux qui gouvernaient les enceintes sacrées, sur lesquelles il fallait que l’aile Sud empiétât pour se développer. Conçu avec l’espoir d’amener à composition les deux divinités voisines, d’Athéna Nikè et d’Artémis Brauronia, le projet de Mnésiclès fut barré finalement par leur attitude intraitable ; de sorte que les vicissitudes des Propylées nous ouvrent un jour curieux sur les origines de l’Acropole péricléenne. Il y avait de la politique là-dedans, et plus de politique que de religion. Selon Furtwangler, les Propylées et le Parthénon étaient les monuments des démocrates, les vieux sanctuaires étaient ceux des conservateurs. Les Propylées surtout, innovation somptueuse qui ne s’élevait pas sur un emplacement consacré, étaient mal vus du parti qui tenait pour les traditions ; les contrecarrant, il pensait humilier, par la voie d’un détour, le prestige et l’œuvre de Périclés. Et comme ce parti était puissant, Périclès conciliait le peuple au Parthénon et aux Propylées, sous un prétexte grandiloquent, en faisant, de ces chantiers, des ateliers nationaux, où les travailleurs libres, les « électeurs » étaient seuls admis, où les salaires étaient élevés. Une racine (oh ! petite et négligeable et que doit désigner seulement un sourire) de cette beauté sur l’Acropole, plonge dans une petite mare, en tire peut-être quelque fraîcheur : « Monsieur, me disait à une table d’hôte de chez nous un voyageur de commerce, dans ma commune il y avait autrefois vingt musiciens. Au temps du père Combes, quand la bataille politique marchait, on a fait deux fanfares rivales qui en comptaient quatre-vingts. Puis, l’apaisement venu, elles se sont dissoutes, et de leurs morceaux on a eu bien de la peine à former celle d’aujourd’hui, qui a quinze membres, pas de trombone, et qui végète. » Aux Propylées, l’angle sud-ouest des murs, biseauté pour ne pas mordre sur la clôture pélasgique d’Artémis Brauronia, me fait bien voir ce que l’Acropole a perdu aux petites passes de la politique ; mais elle a perdu aux petites parce qu’elle était née des grandes, et c’est d’ailleurs à la mesure de l’Acropole qu’elles nous paraissent petites ou grandes.
Les Propylées, faits pour achever l’Acropole, eux-mêmes ne furent donc pas achevés, et dans leur détail encore ils l’attestent. Les rainures, les tenons, les refends, laissés par les constructeurs en vue d’une mise au point définitive qui n’eut pas lieu, maintenaient au marbre, avec les marques de la croissance, un élan de poussée juvénile, un débris de cire qui s’attache au miel pour le relier à la ruche. Le génie du lieu, peut-être, avait pesé doucement pour qu’on ne les effaçât pas, et que persistât sur l’édifice, avec une beauté plus fraîche, comme aux visages des dieux adolescents, le duvet de la jeunesse. Le goût attique paraît l’avoir senti. Après Périclès, quand il eût été si facile de mettre le monument au net, on laissa pourtant, sans y toucher, ces amorces. Sur le seuil de monuments qui signifient, patiente, sûre et par degrés, la libération de l’esprit, j’aime, et peut-être les Athéniens aimèrent, qu’un peu de matière, comme signe retenue, demeure, hors laquelle se font un mouvement, un progrès, pareils aux pas qui sur ces degrés montent. Ces refends paraissent, dès le stylobate, annoncer imperceptiblement les cannelures des colonnes, penser confusément à même les marches ce qui deviendra les triglyphes nets de la frise. Il y eut là comme dans l’évolution de la vie un accident heureux, qu’après coup l’on garda, et que l’appareil à bossages reproduisit. La légende faisait fleurir d’un tel hasard le chapiteau corinthien, et l’ordre dorique lui-même, en tant qu’il se rattache à l’architecture de bois, était né de pareilles rencontres, retenues, fixées, ordonnées.
Je ne sais non plus si, de même que cet inachèvement des pierres, celui des ailes ne fut pas, tout compte fait, accepté comme juste, et cela, peut-être, déjà, par Mnésiclès.





























