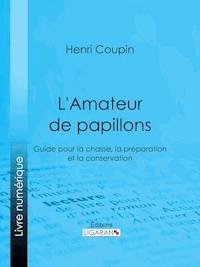
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Les Papillons (fig. 1 à 7) partagent avec les Plantes et les Coléoptères le privilège rare d'intéresser à la fois les savants et les gens du monde, depuis les enfants jusqu'aux grandes personnes. Cette faveur est d'ailleurs toute méritée par l'élégance de leur forme et l'éclat de leur couleur. La difficulté même de leur récolte et de leur préparation ajoute un charme et un attrait de plus à la possession des espèces, et leur donne une plus grande valeur."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le succès obtenu par notre précédent ouvrage, l’Amateur de Coléoptères, nous a engagé à en publier un analogue sur les papillons ; conçu dans le même esprit pratique, nous espérons qu’il recevra un accueil aussi favorable.
Après un coup d’œil général sur l’organisation des papillons, au cours duquel on trouvera un long passage sur le mimétisme, nous traitons de la classification et des habitats de ces jolis pastels aériens.
Tout de suite après, nous entrons dans le vif de la question en traitant de la manière de chasser les papillons adultes, et en décrivant les engins que l’on peut employer à cette récolte.
Ensuite, nous abordons la récolte des chenilles, question assez complexe, en raison des habitats variés de ces larves.
C’est ainsi que nous passons en revue la chasse des chenilles sur les plantes basses, la chasse aux chenilles sociales, la chasse sur les arbres, la chasse aux chenilles rouleuses de feuilles, la chasse aux chenilles mineuses, la chasse aux chenilles vivant dans les fruits et les graines, la chasse aux chenilles dissimulées, la chasse aux chenilles aquatiques, la chasse dans la maison.
On voit par cette énumération combien ces modes de récolte sont variés ; ils n’en sont que plus intéressants pour le collectionneur.
Nous donnons des renseignements pratiques sur l’élevage des chenilles.
La chasse des chrysalides et la récolte des œufs font l’objet de deux chapitres, contenant des détails circonstanciés sur les endroits où on les trouve, et les diverses formes sous lesquelles ils se présentent.
Enfin, nous terminons par des renseignements très complets sur la manière d’apprêter les papillons et les chenilles et de les mettre en collection.
De nombreuses et très belles figures illustrent le texte et l’éclairent agréablement : utile dulci.
Henri COUPIN.
Paris, décembre 1894.
Les joies du chasseur de Papillons. – Définition des Papillons. – Tête. – Bouche. – Pièces buccales. – Thorax. – Ailes. – Écailles. – Pattes. – Abdomen. – Couleur. – Mimétisme. – Polymorphisme. – Différences sexuelles. – Hermaphroditisme. – Hybrides. – Parthénogénèse. – Tératologie. – Accouplement. – Ponte.
Les Papillons (fig. 1 à 7) partagent avec les Plantes et les Coléoptères le privilège rare d’intéresser à la fois les savants et les gens du monde, depuis les enfants jusqu’aux grandes personnes. Cette faveur est d’ailleurs toute méritée par l’élégance de leur forme et l’éclat de leur couleur. La difficulté même de leur récolte et de leur préparation ajoute un charme et un attrait de plus à la possession des espèces, et leur donne une plus grande valeur.
En effet, beaucoup de personnes, de par leurs occupations, ne peuvent aller à la campagne qu’une fois par semaine.
Si, comme le font tant de gens, ils se contentent d’aller manger une friture à Meudon ou de prendre un bain de soleil sur le plateau de Gravelle, le plaisir ne dure qu’un jour et combien il est vite passé !
Au contraire, supposons que notre homme ait du goût pour l’entomologie. Toute la journée du dimanche, il court par forêts et par plaines, récolte moult papillons, moult chenilles, moult chrysalides, et se donne ainsi un but à sa promenade hygiénique. Admettons, ce qui d’ailleurs n’est pas prouvé, que les plaisirs qu’il éprouve dans cette journée ne sont pas supérieurs à ceux du personnage dont nous parlons plus haut.
Mais, c’est le lendemain et les jours suivants qu’il prend sa revanche ! Étaler les papillons, élever les chenilles, voir éclore des chrysalides, déterminer les espèces, les mettre en collection, voilà de quoi occuper largement toutes les soirées et reposer du labeur de la journée. C’est étonnant comme les souvenirs s’accrochent facilement aux objets que l’on a récoltés soi-même.
1, Hespérie comma ; 2, Nemeobius Lucino ; 3, Nymphale du Peuplier.
Il me suffit de prendre un insecte, dans ma collection, pour revoir la plupart des scènes qui se sont passées à cette époque, au moment de la capture.
La plus petite bestiole, le moins joli des papillons suffit à évoquer en moi toute une série de souvenirs qui, au moins pendant un instant, me font revivre les années écoulées, dépouillées de ce qu’elles ont pu présenter de mauvais pour ne laisser subsister que ce qu’elles ont eu de bon. Vivre de bons souvenirs n’est-ce pas l’idéal de l’existence ?
Les plaisirs du collectionneur de papillons ne se bornent donc pas au jour où s’est faite la récolte, mais s’étendent encore à la semaine, à l’année, aux années, à toute la vie entière. Et quand les ennuis et les tracas viennent vous assaillir, votre collection reste pour vous un ami fidèle qui ne trompe jamais, au sein duquel on vient se réfugier, toujours sûr d’y rencontrer le calme et les joies nécessaires au bonheur. La capture d’un insecte que l’on ne possède pas suffit à vous consoler des misères de la vie.
Ce que nous venons de dire n’est qu’une partie de la question. Le plaisir du collectionneur de papillons ne consiste pas seulement en effet à réunir des insectes dans des boîtes vitrées et à savoir leur nom, mais encore à se rendre compte des mœurs des insectes, de leur mode de vie, de leur physiologie, etc. Aux plaisirs « matériels », si j’ose m’exprimer ainsi, il joint les plaisirs intellectuels, source de bonheur inépuisable.
4, Polyommate Phléas ; 5, Lycene adonis ; 6, 7, Polyommate de la verge d’or, mâle et femelle.
Allons, chasseur, le soleil brille. Viens avec moi chercher le papillon sur les fleurs, la chenille sur les feuilles, la chrysalide dans la terre. Nous allons faire une ample moisson de bijoux vivants, qui feraient pâlir le plus beau joyau.
Définition des papillons. – Les papillons constituent parmi les insectes, l’ordre des Lépidoptères, ce qui veut dire insectes à ailes farineuses ; autrefois on les appelait des Glossates, par allusion à la trompe que porte leur bouche.
On peut les définir ainsi : Insectes à pièces buccales transformées en une trompe roulée en spirale, munis de quatre ailes semblables, en général complètement recouvertes d’écailles, à prothorax soudé et à métamorphoses complètes (fig. 8 et 9).
Leur aspect extérieur suffit d’ailleurs à les distinguer de tous les autres groupes d’insectes.
Tête. – La tête des papillons est remarquable par sa grosseur et sa grande mobilité.
Elle est recouverte de poils, souvent très serrés les uns contre les autres, et présente latéralement deux gros yeux.
En avant des yeux, on voit deux antennes qui se font remarquer par leur grande longueur ; elles ne sont jamais coudées et toujours formées d’une série d’articles placés les uns à la file des autres. Elles affectent généralement la forme d’un fil ou d’une massue (fig. 10 et 11) ; quelquefois, elles sont dentées ou pectinées (fig. 12 à 15). Il est à noter que souvent les barbules n’existent que chez les mâles, alors que les femelles ont des antennes filiformes.
Bouche. – Nous devons, à propos des papillons, jeter un coup d’œil sur la bouche des insectes en général.
10, Vanessa Atalanta ; 11, Papilio Machaon ; 12, Macroglossa Stellarum.
Pièces buccales. – La bouche des Insectes, ainsi que celle des autres Arthropodes, est garnie de pièces masticatrices articulées, qui varient énormément suivant le régime alimentaire. Malgré cette complexité, un naturaliste de beaucoup de valeur, Savigny, démontra que la bouche des insectes était construite sur un seul et même plan. Ce type comprend six pièces, qui sont d’avant en arrière :
1° Un labre ou lèvre inférieure ;
2° Deux mandibules ;
3° Deux mâchoires, pourvues de palpes maxillaires ;
4° Un labium ou lèvre supérieure, pourvu de palpes labiaux.
13, Sphinx Ligustri ; 14, Saturnia Pyri ; 15, Saturnia Cecropia.
Les deux lèvres sont formées chacune par la fusion de deux pièces latérales.
On peut considérer quatre types principaux dans la manière dont ces six pièces se comportent les unes par rapport aux autres.
1° Type broyeur. – Les Coléoptères, les Orthoptères et les Névroptères, qui se nourrissent de substances dures, ont une bouche construite sur le type décrit plus haut : les six pièces sont à peu près d’égal volume et ont chacune leur importance. La lèvre supérieure est une petite lamelle médiane, à peine mobile. Les mandibules sont fortes et résistantes, arquées l’une vers l’autre et armées de dents. Les mâchoires sont formées chacune de quatre pièces : une pièce basilaire, portant de dehors en dedans le palpe, le galéa et l’intermaxillaire ; cette dernière pièce seule sert à la mastication. Quant à la lèvre inférieure qui vient terminer en bas le cadre qui entoure la bouche, c’est une petite lamelle médiane formée d’une pièce mobile, la languette supportée par le menton, pièce qui porte latéralement deux palpes.
2° Type lécheur. – Les Hyménoptères ont une bouche à la fois broyeuse et lécheuse. À cet effet, les pièces buccales sont modifiées de deux façons différentes, dans la partie antérieure et dans la partie postérieure. La labre et les deux mandibules sont identiques à ce qu’elles étaient chez les insectes broyeurs proprement dits. Les deux mâchoires se sont allongées en deux lames grêles, munies de dents ou de soies, mais où l’on reconnaît encore la présence de deux palpes. La lèvre inférieure est encore plus modifiée : c’est une longue tige barbelée qui sert à l’animal à récolter le nectar des fleurs ; sur ses côtés, il y a deux forts palpes labiaux.
3° Type suceur. – Ce type se rencontre chez tous les Lépidoptères et chez les Diptères qui ne piquent pas.
La bouche des papillons (fig. 16 à 22) est, on le sait, armée d’une longue trompe, que l’animal déroule de temps à autre pour aller puiser le nectar dans les corolles. Cette trompe est formée de deux parties creusées en gouttière sur leur face interne et s’affrontant par leur bord ; ce sont deux mâchoires, à la base desquelles on peut reconnaître la présence de deux petits palpes. Les autres pièces de la bouche sont réduites à de petites écailles difficiles à voir ; les parties les plus importantes de celles-ci sont les palpes labiaux, que l’on voit à droite et à gauche de la base de la trompe, et qu’on appelle les barbillons.
Chez les Mouches, la trompe est surtout formée par la lèvre inférieure, plus ou moins soudée avec les autres pièces.
16, Labre et mandibules rudimentaires de la Zygœna Scabiosæ ; 17, Épistome, mandibules et labre du Deilephila celerio, vus en dessous ; 18, Tête de la Zygène de la Scabieuse, vue de profil montrant la trompe déroulée ; 19, Tête de la Paphia inachus, vue en dessous et montrant la trompe enroulée ; 20, Mâchoire du même Insecte avec son palpe ; 21, Coupe de la trompe du Deilephila celerio, vue en dessus, montrant l’accolement des deux mâchoires ; 22, Lèvre inférieure, très grossie, chez le même Insecte, avec ses palpes, dont l’un est dénudé.
4° Type piqueur. – Chez les Hémiptères, la lèvre supérieure se transforme en deux gouttières ; en s’appliquant l’une sur l’autre, elles délimitent un canal dans lequel glisse un certain nombre de stylets, qui ne sont autres que les mandibules et les mâchoires modifiées.
La bouche des papillons est donc essentiellement organisée pour la succion des liquides, soit que, comme la majorité d’entre eux, ils puisent ceux-ci dans les corolles des fleurs, soit que, comme les Lycènes (fig. 23) et les Polyommates, ils lèchent l’eau qui suinte sur la terre humide.
24, Vue de profil ; 25, Vue en dessous : o, ouverture du canal ; t, canal interne 26, Vue en dessus.
Une exception très remarquable se rencontre dans le genre Ophideres d’Australie. Chez ce papillon, la trompe (fig. 24 à 26) est dure, aiguë et pourvue latéralement de dentelures pointues ; il s’en sert pour perforer les bananes et les oranges et puiser ainsi les sucs dont il fait sa nourriture. Par suite, les Ophidères causent aux plantations des dégâts parfois considérables : c’est un des rares exemples de papillons nuisibles à l’état adulte.
La spiritrompe est enroulée sur elle-même à l’état de repos ; elle ne se déploie qu’au moment où l’insecte veut s’en servir : elle atteint alors à peu près la longueur de l’animal.
Chez certains Sphinx, elle peut atteindre deux ou trois fois la longueur totale.
Enfin, elle devient très rudimentaire chez certains Bombyciens, qui ne prennent aucune nourriture à l’état adulte : c’est ce qui arrive par exemple, chez le papillon du Ver à soie, ou Bombyx du mûrier.
Thorax. – Le thorax est, comme chez tous les Insectes, formé de trois anneaux et porte les ailes et les pattes. Tandis que, chez les Coléoptères, une partie est soudée à l’abdomen, ici, les trois anneaux sont réunis en un seul et unique organe, qui porte le nom de corselet : c’est lui qui renferme les muscles destinés à faire mouvoir les ailes et les pattes.
C’est au milieu de ce corselet que doit passer l’épingle destinée à fixer le Papillon.
Ailes. – Les ailes sont normalement au nombre de quatre, les antérieures étant toujours plus grandes et plus développées que les postérieures.
Chez les Rhopalocères, ces ailes sont absolument distinctes les unes des autres.
Mais, chez les Hétérocères, sur le bord antérieur de la paire postérieure, il y a des crochets en forme d’hameçon qui la réunissent physiologiquement à la paire antérieure ; les rames aériennes ne sont donc alors qu’au nombre de deux de chaque côté ; la paire postérieure n’a d’ailleurs qu’un rôle accessoire dans le vol : on peut la couper sans nuire à la progression.
Les ailes antérieures sont généralement triangulaires, tandis que les postérieures sont plutôt ovales.
Le bord extérieur de chaque aile est bordé par une frange de petits poils, très serrés les uns contre les autres, qui sont d’une fragilité extrême.
Chez quelques papillons, les ailes postérieures se prolongent en arrière en une sorte de queue (fig. 27).
La plupart des papillons de jour, au repos, tiennent leurs ailes relevées verticalement sur le dos. Au contraire, la plupart des papillons de nuit les tiennent étalées à plat sur l’abdomen (fig. 28).
À noter que, chez les Ptérophoriens, les ailes se fendent en lanières et prennent un aspect plumeux.
Les ailes sont rudimentaires et manquent complètement chez certaines femelles (fig. 29).
Les ailes sont formées d’une membrane mince, renforcée de plus en plus par des nervures saillantes contenant des trachées et des nerfs.
Nous empruntons à Maurice Girard les renseignements qui suivent sur les nervures.
1. La Nonne, Liparis monacha, mâle ; – 2 à 5. Femelles dans différentes attitudes ; – 6, Amas de chenilles nouvellement écloses. – 7 à 9, Chenilles de divers âges. – 10, Chrysalide.
1, L’Hibernie défeuillée, mâle ; 2, femelle 3, chenille. – 4, L’Hibernie orangée, mâle ; 5, femelle. – 6, La Chématobie hiémale, mâle ; 7, femelle ; 8, chenille.
« La nervulation et les cellules des ailes des Lépidoptères sont en grande partie dissimulées par les écailles qui les recouvrent, et il faut enlever celles-ci pour les rendre visibles. On y parvient, soit en appliquant les ailes sur un papier gommé qui retient les écailles, comme on le fait pour décalquer ces ailes, soit, plus simplement, en brossant l’aile avec un pinceau plus ou moins dur, suivant la résistance des écailles.
Il arrive ici malheureusement, comme pour les autres ordres, que les auteurs n’ont pu se mettre d’accord pour une nomenclature uniforme : ainsi Al. Lefebvre, Rambur, le Dr Boisduval, A. Guénée, ne s’accordent pas pour des désignations identiques. Le système le plus simple paraît être celui de Rambur, modifié par M. P. Mabille.
L’aile supérieure est traversée par quatre nervures :
La première suit la côte ; c’est la nervure simple antérieure. Elle peut être soudée à la suivante, déviée, très rarement absorbée par le bourrelet costal.
La seconde nervure est la nervure composée antérieure ; elle part presque du même point que la précédente, et, sur l’extrémité de la cellule, aux deux tiers de l’aile, elle se divise en rameaux de nombre variable. Ordinairement il y en a six, trois aboutissant à la côte, les rameaux costaux, ou apicaux, ou supérieurs, et trois aboutissant au bord externe, qui sont les rameaux inférieurs. Le nombre de ces rameaux peut varier selon les familles.
La troisième nervure, ou composée postérieure, traverse à peu près le milieu de l’aile et produit trois ou quatre rameaux ; c’est le quatrième de ces rameaux, que Guénée appelle nervure indépendante.
La quatrième nervure est la simple postérieure ; sa direction est variable et n’est modifiée que rarement dans chaque famille. M. P. Mabille compte tous les rameaux par en bas, considérant la côte comme la partie antérieure, le haut de l’aile ;
L’espace compris entre les deux nervures composées, ordinairement jusqu’à la naissance des rameaux, est la cellule discoïdale. Cette cellule est fermée le plus souvent par une petite nervure transversale, à laquelle les auteurs ont attribué beaucoup d’importance en raison des caractères qu’elle fournit. Il semble à M. P. Mabille que cette nervure n’ait pas d’existence propre, et il est porté à la considérer comme un prolongement de la composée antérieure et de la composée postérieure : ce sont en effet deux parties le plus souvent distinctes et qui se soudent par approche ; mais ordinairement la partie inférieure est la plus faible. Lorsque les deux parties de cette nervure, qui est connue sous le nom de disco-cellulaire (Guénée) ou de nervule (Rambur), s’affaiblissent ou disparaissent, la cellule est ouverte. Quand elles sont soudées l’une à l’autre et sont visibles, au moins à la loupe, la cellule est fermée.
Les plis de l’aile ont une importance relative, mais souvent considérable. Celui qui traverse la cellule discoïdale a été pris par Al. Lefebvre comme point de repère pour compter les nervures et leurs rameaux, d’après le système qu’il avait établi. Ils n’ont heureusement reçu aucun nom, et il est toujours facile de les désigner par le nom du rameau voisin.
Les nervures de l’aile inférieure se comptent de la même manière ; mais elles subissent d’assez graves modifications. La composée antérieure n’émet que trois rameaux, la postérieure peut en avoir quatre. L’espace abdominal, c’est-à-dire la partie de l’aile qui suit le bord abdominal, jusqu’à l’angle anal, peut, dans certains genres, présenter une ou deux nervures simples en plus, que M. P. Mabille nomme nervures abdominales, et elles se comptent à partir du bord. Il n’y a donc que les deux nervures composées qui se ramifient. Il est très rare de voir les deux autres former une cellule par dédoublement avec un commencement de rameau (Castnies, quelques Phaléniens, etc.).
Aux ailes supérieures, les rameaux de la composée antérieure peuvent être réunis par des ramifications transversales, et il se forme ainsi des cellules accessoires complètement fermées. Ces cellules, appelées aréoles, se voient aussi à la base de quelques autres nervures ou même sur leur trajet ; l’aréole qui est placée à l’angle supérieur de la cellule discoïdale, entre le deuxième et le troisième rameau de la composée antérieure, a été appelée aréole sus-cellulaire ou accessoire. Elle se trouve chez les Chélonides, les Euchélides, les Callimorphes, beaucoup de Noctuelles, certains Phaléniens. Chez les Castnies, il y a dédoublement de la composée postérieure, qui est divisée en trois nervures, et il y a trois aréoles ; la nervure simple postérieure est bifide. Chez les Zeuzères, il y a quatre aréoles à l’aile supérieure ; chez les Attacides (Attacus Cynthia, etc.), la disco-cellulaire a disparu, etc. On pourrait multiplier beaucoup ce genre d’exemples. »
Écailles. – Ce sont les écailles qui donnent aux papillons ces magnifiques couleurs, que tout le monde admire.
a dit Victor Hugo ; combien juste est cette expression !
Les écailles, avons-nous dit, sont caractéristiques des papillons : chez certains d’entre eux, elles paraissent cependant manquer. Ce n’est là qu’une apparence, et, en cherchant avec soin, on en trouve toujours quelques-unes, surtout quand l’animal vient d’éclore.
30, Portion de l’aile supérieure de la Vanesse Atalante (le Vulcain), sur laquelle on aperçoit le trait des tuyaux d’implantation des écailles vues comme corps opaques, ainsi qu’une écaille engagée dans son tuyau. La trace des sillons qui sont sur la membrane de l’aile s’y trouve indiquée. Grossissement, 480 ;
31, Portion de l’aile supérieure de la Piéride de la Rave, chargée de ses écailles, entre lesquelles se voient les extrémités frangées des écailles en forme de plumule. Grossissement, 84 ;
32, Écaille en cœur de la Piéride de la Rave (le petit Papillon du Chou). Grossissement, 480 ;
33, Variété de cette écaille ;
34, Écaille de la Piéride de l’Aubépine (le Gazé). Grossissement, 480 ;
35, Écaille de la Piéride Daphdice. Grossissement, 480 ;
36, Écaille de la Piéride Leucippe. Grossissement, 430 ;
37, Écaille de l’Argynne Paphia (Tabac d’Espagne). Grossissement, 300 ;
38, Écaille du Satyre Morea (l’Ariane). Grossissement, 300 ;
39, Écaille du Polyommate Argiolus (l’Argus bleu à bandes brunes). Grossissement, 300 ;
40, Écaille du Polyommate Adonis (l’Argus bleu céleste). Grossissement, 480 ;
41, Écaille extraordinaire du Polyommate Boeticus (le Porte-queue bleu strié). Grossissement, 300.
Les écailles (fig. 30 à 41) sont des poils aplatis ; leur forme est extrêmement variable, mais peut toujours se ramener à une lame aplatie qui s’insère par un très fin pédicule. Ce mode de fixation est extrêmement peu solide et le plus novice des chasseurs de papillons sait avec quelle facilité désespérante la poussière farineuse des ailes adhère aux doigts. Elles se recouvrent comme les tuiles d’un toit.
La lame des écailles est très mince ; elle est parcourue généralement de stries longitudinales.
Il ne faudrait pas croire que la couleur des écailles provient d’une matière colorante qui les imprègne : les teintes sont surtout dues aux jeux de lumière qui s’opèrent dans les stries et qui sont analogues à celles des lames minces, des bulles de savon, par exemple.
Les dessins des ailes de papillons ne sont jamais limités par une ligne parfaitement droite, parce qu’à cet endroit, les écailles voisines s’enchevêtrent ; ces dessins sont très utiles dans la détermination des espèces.
Nous représentons (fig. 30 à 41) un certain nombre d’écailles vues à un fort grossissement ; on peut les voir, et c’est un très joli spectacle, avec le plus petit des microscopes.
Pattes. – Les papillons volent presque tout le temps ou restent au repos, sans marcher, pendant une partie de la journée ; aussi les pattes, chez eux, sont-elles excessivement grêles, souvent terminées par des crochets.
Chez un assez grand nombre de papillons (Vanessa Satyrus, Argynnis (fig. 42), Limenitis), des six pattes normales il n’en reste que quatre, par suite de l’atrophie ou de la disparition complète de la paire antérieure : les papillons qui n’ont que ces deux paires de pattes sont dits tétrapodes.
Quand on veut saisir un papillon par les pattes, ou quand on le pince brusquement, il est fréquent de voir les pattes tomber d’elles-mêmes, comme si elles étaient très fragiles. En réalité, c’est l’animal lui-même qui, pour essayer d’échapper à son ravisseur, s’est cassé les pattes : c’est un phénomène d’autotomie.
Abdomen. – L’abdomen est formé de sept anneaux. Chaque anneau est renforcé de deux pièces chitineuses, l’une supérieure, l’autre inférieure. La première déborde la seconde, de telle sorte que l’abdomen forme une sorte de gouttière. Les deux pièces chitineuses ne sont pas réunies l’une à l’autre, ce qui permet à l’abdomen de se distendre énormément : c’est ce qui a lieu surtout au moment où les œufs s’accumulent chez la femelle.
Couleur. – La couleur des papillons est caractéristique pour chaque espèce, mais ici, plus que dans tout autre groupe du règne animal, les aberrations sont fréquentes. Les espèces atteintes d’albinisme ou de mélanisme sont fort communes.
La couleur paraît d’ailleurs tenir beaucoup aux influences qui se sont exercées sur la chrysalide et à la nourriture qui a été donnée à la chenille.
C’est ainsi que la Chelona Caja a des ailes inférieures brunes, quand on nourrit la chenille avec des feuilles de noyer.
De même, en donnant à la chenille du Cheloniavillica des feuilles de Raifort, les ailes inférieures deviennent plus ou moins noires.
Mimétisme. – Dans la lutte pour l’existence, le fameux struggle for life de Darwin, les êtres les plus forts et les plus habiles semblent, à première vue, avoir toutes les chances de triompher de leurs ennemis ou de leurs concurrents ; et pourtant il y a bien des espèces faibles et inhabiles qui survivent, il y en a même qui prospèrent. C’est que la force et l’habileté, ces deux facteurs du succès dans les sociétés humaines, ne sont pas, si l’on prend les mots dans leur véritable acception, les seules ressources dont dispose la nature. La multiplicité des espèces qui ont échappé à la destruction est en rapport avec la variété des moyens de protection mis en œuvre par elle.
Parmi les moyens de protection naturels, on désigne aujourd’hui universellement, sous le nom collectif de mimétisme, des phénomènes qui se rapportent à cette faculté que possèdent certains êtres vivants d’échapper à leurs ennemis soit par leur ressemblance avec les objets qui les environnent, soit par des apparences extérieures qui les font confondre avec d’autres êtres dangereux, soit enfin par une couleur analogue à celle du milieu où ils se trouvent et qui les dissimule aux regards. Le mot de mimétisme, mimicry en anglais, a été créé par Bates pour les animaux qui copient un autre animal dangereux. Mais aujourd’hui on lui attribue un sens beaucoup plus large, il s’applique à tout phénomène de mimique protectrice ou utile à un autre point de vue.
Le mimétisme a surtout été étudié par Bates, Wallace, Fritz Müller, Kirby, Spence, Pouchet, Fréderick, Lubbock, etc.
Ressemblances avec objets extérieurs – Beaucoup de papillons ressemblent à des feuilles mortes ou vivantes, soit qu’ils tiennent les ailes étalées, soit que celles-ci soient relevées sur le dos.
C’est le cas, par exemple, des Lasiocampa qui, pour cette raison, ont reçu le nom de Feuilles mortes (fig. 43).
Les uns ont la couleur des plantes, les autres des murs, des rochers, des troncs, des lichens, etc.
Phyllie. – L’un des exemples les plus remarquables du mode de défense nous est fourni par un insecte de l’ordre des Orthoptères, le Phyllium ou Phyllie feuille-sèche (fig. 44), habitant les régions tropicales. Cet insecte, qui vit sur les arbres, a une forme aplatie et ovalaire. Les ailes, étalées à plat sur le dos, figurent absolument une feuille, portant comme celle-ci, une nervure médiane longitudinale et des nervures latérales ramifiées et anastomosées. Lorsque l’animal est posé sur l’arbre, on ne peut, paraît-il, le distinguer du feuillage.
Callima. – Non moins curieux que la Phyllie est le Callima, papillon de Sumatra (fig. 44). Wallace qui s’est occupé d’une manière toute spéciale du mimétisme, en donne la description suivante :
« Les ailes sont, en-dessus, d’une riche couleur pourprée, variée de cendré. En travers des ailes supérieures s’étale une large bande d’un orangé éclatant, ce qui rend cette espèce très apparente quand elle vole. Cette espèce n’est pas rare dans les bois secs et fourrés, et je me suis souvent efforcé d’en capturer sans succès ; car après avoir parcouru en volant une courte distance, le papillon entrait dans un buisson, parmi les feuilles mortes, et, quel que fût mon soin à trouver sa place, je ne pouvais jamais la découvrir, à moins qu’il ne partît à nouveau pour disparaître bientôt dans un endroit semblable. À la fin, je fus assez heureux pour voir l’endroit exact où s’était posé le papillon ; et, bien que je l’eusse perdu de vue pendant quelque temps, je découvris qu’il était fermé devant mes yeux, mais que, dans cette position de repos, les ailes ainsi il ressemblait à une feuille morte attachée à une petite branche, de façon à tromper certainement même des yeux attentivement fixés sur lui. J’en ai capturé plusieurs spécimens au vol, et j’ai été à même de comprendre comment cette merveilleuse ressemblance se produisait. Les ailes supérieures sont terminées à leur extrémité par une fine pointe exactement comme celle des feuilles de beaucoup d’arbres et d’arbustes des tropiques ; les ailes inférieures, au contraire, sont plus larges et terminées par une queue large et courte.
Entre ces deux pointes court une ligne courbe et sombre, qui représente exactement la nervure médiane de la feuille, et d’où rayonnent de chaque côté des lignes légèrement obliques qui imitent fort bien les nervures latérales. Ces lignes se voient plus clairement sur la partie externe de la base des ailes, et sur le côté interne vers le sommet et vers le milieu. Elles sont produites par des stries et des marques très communes chez des espèces voisines, mais qui sont modifiées et renforcées, de manière à imiter plus exactement la nervulation des feuilles. La teinte de la face inférieure varie beaucoup, mais elle est toujours de couleur grisâtre ou rouge comme celle des feuilles mortes. Cette espèce a l’habitude de rester toujours sur une petite branche, sur des feuilles mortes ou roulées, et, dans cette position, les ailes fermées et pressées l’une contre l’autre, elle présente exactement l’aspect d’une feuille de grandeur ordinaire, légèrement arrondie et dentée. La queue des ailes forme une tige parfaite et touche la branche, pendant que l’insecte est supporté par les parties du milieu que l’on ne peut remarquer parmi les brindilles qui l’entourent. La tête et les antennes sont disposées entre les ailes de façon à être cachées complètement ; et une petite entaille, pratiquée à la base des ailes, permet à la tête de se retirer suffisamment. Ces divers détails se combinent pour produire un déguisement si complet et si merveilleux, que tous ceux qui l’observent en sont étonnés et les habitudes de l’insecte sont telles, qu’elles utilisent toutes ces particularités en les rendant profitables, et cela de manière à ne laisser aucun doute sur ce singulier cas d’imitation qui est certainement une protection pour l’insecte. La fuite rapide est suffisante pour le sauver des ennemis qu’il rencontre dans son vol, mais s’il était aussi visible lorsqu’il s’arrête, il n’échapperait pas longtemps à la destruction à cause des attaques des reptiles et des oiseaux insectivores qui abondent dans les forêts des tropiques. »
Personne ne pourra nier, après cette description, que le mimétisme du Callima ne soit grandement favorable à sa conservation.
Chenille arpenteuse. – Cette ressemblance entre les ailes et les feuilles se rencontre aussi d’une manière très évidente chez les Ptérochroses.
Dans nos pays, on trouve fréquemment, sur les buissons, une chenille de couleur brune, munie de pattes seulement à l’extrémité antérieure (vraies pattes), et à l’extrémité postérieure (pattes membraneuses). Lorsqu’elle marche, cette chenille se fixe par les pattes de devant, et, recourbant son corps elle amène près de celles-ci ses pattes de derrière. Les pattes membraneuses s’accrochent au support le corps s’allonge et va de nouveau fixer un peu plus loin ses pattes antérieures pour recommencer le même manège. La chenille a ainsi l’air de mesurer le terrain qu’elle parcourt ; c’est pour cela qu’on lui a donné le nom de





























