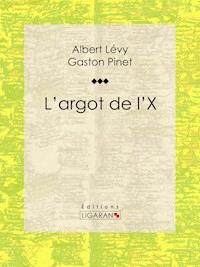
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Absorption. - L'absorption, par abréviation l'absorb, est la série des épreuves auxquelles l'ancien soumet le nouveau polytechnicien. C'est une sorte de baptême dont l'origine remonte aux premières années de la fondation de l'école."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335038408
©Ligaran 2015
L’École Polytechnique célébrant cette année (1894) le centième anniversaire de sa fondation, devra au Comité du Centenaire, présidé par M. Faye, le savant astronome, sa véritable histoire, celle des hommes considérables formés par elle : officiers de terre et de mer, ingénieurs des services publics, industriels, administrateurs, magistrats, membres du clergé, savants, hommes politiques et hommes d’État qui lui ont conquis la célébrité. Le récit ayant été fait déjà de la participation des polytechniciens aux grandes manifestations nationales, des souvenirs et des traditions auxquels elle doit sa popularité, son histoire est maintenant complète.
Mais le sujet n’est point épuisé pour ceux qui, répudiant, comme nous, toute prétention à la gravité de l’historien, cherchent simplement dans le passé de l’École, ce qui peut distraire et amuser les nouvelles générations d’élèves. C’est ainsi qu’essayant de revivre, pour ainsi dire, les deux années de notre jeunesse, les scènes curieuses de la vie journalière nous sont revenues à la mémoire, avec « cette façon de langage maçonnique » qui servait à nous reconnaître et dont certaines locutions ont franchi les murs de la rue Descartes. Il nous a paru alors que nos camarades pourraient prendre plaisir à retrouver les jeux, les fêtes, les cérémonies, les airs, les chansons, les poésies, tout ce qui avait distrait le temps des études laborieuses, dans un vocabulaire de l’Argot original, à l’aide duquel se sont transmis les souvenirs et perpétuées les traditions. Beaucoup nous ont approuvés et encouragés. De toutes les promotions, soit anciennes, soit récentes ; de tout le personnel attaché à l’École, officiers, professeurs, répétiteurs, élèves et agents, nous sont parvenus des renseignements précieux, des notes, des anecdotes, des croquis, des caricatures, des chansons, et notre livre est né de cette collaboration généreuse.
Nous voulons donc remercier ici publiquement tous ceux qui ont été ainsi nos collaborateurs, et parmi eux :
Les camarades : Laussédat, Catalan, Moutard, Mercadier, de Rochas, de Lapparent, Kérviler, Picquet, Saraz, Lemoine, Chéguillaume qui nous ont communiqué leurs documents, – Armand. Silvestre, à qui son affection pour tout ce qui touche à l’École a inspiré la préface émue qu’on va lire, – Marcel Prévost, qui nous a donné son premier sonnet inédit composé à l’École même, – G. Moch, l’auteur de l’amusante saynette de Chambergeot, – Doigneau, Leblond, Voillaume, Olive, Helbronner, Ernst, et avec eux M. Ragut, attaché à la direction des études, artistes dont l’habile crayon a saisi sur le vif toutes les manifestations de la vie polytechnicienne, – les majors et les caissiers présents à l’École qui ont mis à notre disposition les volumineuses archives accumulées par les promotions successives.
Nous remercions enfin particulièrement notre ami, l’éminent graveur Bracquemond, de sa superbe composition offerte pour être mise en frontispice, et notre aimable éditeur de s’être appliqué à parer avec art ce petit livre pour le présenter au public.
ALBERT-LÉVY – G. PINET.
11 mars 1894.
En me faisant l’honneur de me demander quelques lignes d’« Avant-Propos » pour leur livre tout à la fois si fantaisiste et si documentaire, mes camarades, ses auteurs, m’ont, en même temps, causé une grande joie. Car je n’en ai pas de meilleure et de plus vive que de reporter mon souvenir vers ces deux années d’École d’où je tirai l’optimisme de toute ma vie.
J’y connus, en effet, une société toute de sélection intellectuelle, ardente vers un même idéal de vérité et de justice, où l’intrigue et la basse envie étaient inconnues, où la fraternité n’est pas un mot banal ; et, bien que tout ce que j’ai rencontré depuis dans le monde en ait prodigieusement différé, j’y ai puisé une confiance dans la vie qui m’a constamment soutenu. Et j’imagine que beaucoup, de ceux qui y ont passé, en ont emporté la même impression consolatrice.
À l’École, cette camaraderie, qui, dans nos mœurs actuelles, n’est pas même pour la plupart et partout ailleurs, une menue monnaie de l’amitié, est, pour le monde polytechnicien, une chose aussi sacrée que naturelle, parce qu’elle s’exerce entre gens de même éducation et d’égales traditions d’honneur, parce qu’elle ne risque pas de s’égarer sur des indignes, à une époque où, par une certaine indifférence morale tout à fait blâmable, les hommes regardent beaucoup plus où ils mettent leurs pieds qu’où ils mettent leur main. Notre tutoiement traditionnel ne risque jamais d’être compromettant. Aussi gardai-je cette formule d’intimité à quelques amis de première enfance, puis pour nos camarades d’École exclusivement. Mais combien elle m’est douce avec eux !
L’« argot de l’X », comme l’ont appelé les auteurs de cet aimable Dictionnaire, est aussi, entré nous qui avons quitté depuis longtemps l’École, un signe de ralliement, une façon de langage maçonnique. Il a le grand avantage d’avoir varié avec le temps, ou plutôt de s’être constamment enrichi, ce qui lui permet de donner un moyen immédiat de se reconnaître aux élèves des promotions voisines. Il indique des dates et est documentairement historique au premier chef. Car chaque mot a sa légende et son origine nettement constatées. Il équivaut au millésime d’une année. L’orthographe en est, de plus, si parfaitement rationnelle et rudimentaire que Messieurs les réformateurs de l’Académie eux-mêmes n’oseraient en proposer la simplification. Nous avons réalisé le rêve de ces audacieux écrivains : une langue où l’on écrit comme l’on parle.
Ah ! comme, dès qu’ils se rencontrent, deux polytechniciens ont vite, sur les lèvres, ces mots qu’évoquent, dans leur mémoire, toute une évolution de leur esprit en même temps que les plus belles années de leur jeunesse ! Il me suffirait, en pareil cas, de fermer les yeux pour que fût évoqué, dans mon cerveau, tout un monde lointain auquel je suis demeuré fidèle, tout un monde d’images que je n’ai jamais oubliées, comme si l’album en était dans mon cœur même : la grande cour plantée d’arbres rares et poudreux, par les beaux soirs d’été où s’exaspérait dans la captivité ma virile adolescence, s’exhalant dans l’air tiède et poursuivant, par-delà les hautes murailles, les doux fantômes féminins qui promenaient, dans la rue, sans doute, des fleurs fanées dans leurs cheveux ; mes premières veillées poétiques pendant le cours d’allemand dont, religieusement, je n’écoutais pas un mot, acharné que j’étais à quelque sonnet que je dirais, le mercredi suivant, à ma première amoureuse, laquelle se moquerait de moi sans me décourager ; mes deux salles avec leur orientation différente dans l’uniformité du grand bâtiment géométrique et monotone, avec, à leur place, chacun de mes compagnons de deux années d’études. – Hélas ! tous maintenant ne pourraient venir s’y rasseoir dans le rayonnement de la lampe studieuse sous lequel on faisait de si bons sommes, les lendemains de prolonge ! – la petite salle de la bibliothèque, où les amateurs de musique passaient une bonne partie de la récréation, Mercadier, son violon à la main, et Sarrau derrière sa contrebasse ; les soupers joyeux dont je n’ai jamais retrouvé l’appétit et, après le déjeuner de deux heures, les pyramides de frites dans les polices luisants d’un philocome comestible : tout ce qui s’enfermait de joies et d’espérances dans cet horizon si restreint, mais où la vie se resserrait, par cela même et pour ainsi parler, dans une plus grande intensité.
Car vraiment nous vivions dix ans dans ces deux années, dix ans de travail et d’activité cérébrale, avec des émulations enfiévrées, mais aussi avec de divines paresses où le rêve reprenait ses droits, où se conservaient les ardeurs contenues de notre jeunesse. C’était quelque chose de tout à fait moderne et monacal tout ensemble, avec de rapides révoltes, mais aussi avec de grands élans vers la science et vers le progrès. Et comme la moindre étincelle venait mettre le feu à ces poudres endormies ! Nous étions là pendant les victoires d’Italie et j’ai vu l’École, dans un hourra indescriptible, avec l’alcool des lampes brûlant dans des godets à lavis, cependant que des bombes, venues là on ne sait comment, soulevaient de grands jets de sable dans la cour, et que tout autour, dans les rues sordides, aux fenêtres bruyantes, on criait : « Vive l’École ! Vive la Patrie ! »
C’est que ces deux mots sacrés n’ont jamais été désunis.
Ah ! si je me laissais aller à ce beau fleuve de souvenirs, sur lequel cette courte préface demandée m’a lancé comme une barque que j’aimerais abandonner à la dérive !
À l’École j’ai eu mes premiers orgueils de penseur et j’ai versé mes premières larmes d’amour. Séparé cinq jours sur sept d’une infidèle, j’ai connu les consolations, qui viennent de la double pitié de la Muse et de l’Analyse. Je soupirais en vers comme Ovide, à moins que je ne m’acharnasse à des formules. Remarquez qu’il n’est pas deux occupations qui se ressemblent davantage que celles-là. C’est la même recherche du rythme et de la symétrie. Car le Vrai comme le Beau s’expriment toujours par le rythme et par la symétrie, par une harmonie des caractères et des lignes. Cauchy et Hermite, qu’ils le veuillent ou non, sont des poètes comme Homère. Mais par quelle école buissonnière, toutefois bordée de fleurs qui me sont chères, j’en viens à mon sujet, ce Dictionnaire de l’argot polytechnicien, que j’ai promis de présenter au public. Il faut y arriver, cependant !
Eh bien, nous nous occuperons d’abord de définir ses origines.
Il ne vient pas, du tout, des écoles préparatoires à l’École, et la preuve c’est qu’il est inconnu en province. Il est bel et bien natif de l’École même, d’où il rayonne, au contraire, sur les lycées et je ne dirai même sur le monde. Car nous pourrions revendiquer la paternité de mots passés aujourd’hui dans d’autres argots, et, pour citer un exemple, je ferai observer respectueusement au chansonnier Bruant que ce beau vocable de rouspétance, dont il fait un si noble usage, a roulé de la Montagne-Sainte-Geneviève jusqu’à Montmartre, en traversant Paris.
J’en pourrais citer d’autres encore, qui font honneur au langage usuel de nos contemporains.
Son berceau est donc bien à l’École. Abréviatif avant tout, par essence, il est la langue de gens qui, ayant fort peu de temps à perdre, suppriment volontiers la première ou la dernière syllabe des mots, quelquefois même plusieurs syllabes dans les mots un peu longs, comme « amphithéâtre » qui devient amphi. Ces vocables, ainsi ramenés à leur rudiment, sont immédiatement promus à la dignité déracinés dont on pourrait faire, comme le bon Lancelot, un jardin, et qui servent à la composition d’autres mots. Amphi et hypo sont précisément dans ce cas.
Bien que d’apparence enfantine à la prononciation, ce vocabulaire diffère essentiellement de celui des enfants qui procèdent, au contraire, par répétition et disent, par exemple : « popo » pour pot. Ah ! nous avons bien le temps de nous amuser à ces redoublements ! C’est l’opposé. L’habitude de l’algèbre est, au contraire, visible dans l’argot de l’École. C’est une formule constante de généralisation, et si, au lieu de se parler seulement, il avait l’occasion de s’écrire, vous verriez que les lettres y auraient remplacé les mots, absolument comme dans la convention cartésienne.
Innocemment d’ailleurs ou naïvement reconnaissant, il perpétue le souvenir des supérieurs et des maîtres qui se sont succédé dans l’administration de l’École et dans les cours. Rosto, Merca, Corio sont les commencements de noms, lesquels, par cette simple faveur, demeureront immortels. Car si de nouveaux mots prennent droit de cité dans le Livre d’or de la fantaisie polytechnicienne, les mots anciens en sont rarement exclus. Nous l’avons bien vu dans notre promotion, où nous avons tenté de remplacer, par le nom d’un de nos camarades entré dans les mêmes conditions, le vieux mot de gigon désignant le supplément en toutes choses, et dont s’appelait un élève entré supplémentairement vingt ans auparavant.
Cette fidélité à l’héritage parlé des anciens est un signe de plus de l’esprit traditionnel de l’École.
Cette filiation avec des noms de personnes constitue l’élément originel d’un grand nombre de mots de notre argot. L’association bizarre des idées, de cocasses rapprochements et quelque peu tintamarresques en ont enfanté d’autres qui ne sont pas les plus mauvais. Tel le mot crotale, pour serpent, employé lui-même pour « sergent ». Il y a là vraiment carambolage d’idées. Tel encore celui d’ossian pour « bonnet », en souvenir du célèbre géomètre, à la fois poète et coiffeur par le nom. Comme toujours, le caprice se mêle, à l’occasion, d’une certaine poésie. L’image supprimée mais vivante dans la désignation de pitaine Printemps pour le tapin qui apporte les feuilles en est, je crois, le plus joli exemple. La métaphore resserrée dans un seul mot s’y trouve aussi souvent, comme dans la désignation de l’épée par le mot tangente.
Abréger et généraliser tout à la fois, transformer en radicaux les mots ainsi tronqués qui reviennent le plus souvent dans la conversation, voilà donc en quoi se résume le travail constant et ininterrompu d’esprit qui grandira indéfiniment ce Dictionnaire. Il nous faudra donc – et c’est d’un heureux présage pour les auteurs de ce livre – de nouvelles éditions dans l’avenir, non pas revues et corrigées, – car celle-ci n’en a pas besoin, – mais considérablement augmentées.
Et cette modeste préface aussi, où mes souvenirs s’en sont donné à cœur joie, aura besoin d’être remplacée par une autre. Car l’histoire de l’École aura conquis de nouveaux et glorieux chapitres. Car elle aura enfanté de nouveaux grands hommes et élargi encore, à travers le monde, son sillon civilisateur.
Que ceux qui viendront après nous l’aiment autant que nous l’avons aimée nous-mêmes, et que nous l’aimons encore, cette Alma Parens de notre esprit, ce noble berceau où nous avons bu, comme un lait généreux et toujours fécond, l’amour de la justice, le culte du progrès, le courage du travail ; cette éducatrice de nos âmes à qui nous devons, à travers les dégoûts d’un monde mieux pourvu d’appétits que d’idéal, la notion et la mémoire d’un monde où rien n’était fait ni rêvé que d’équitable et de fraternel !
Que l’argot de l’École soit immortel comme l’École elle-même ! Car c’est le doux et joyeux langage qu’a parlé notre jeunesse au temps des amitiés vigoureuses, des impressions tenaces et des sublimes désintéressements.
27-28 octobre 1893.
ARMAND SILVESTRE.
L’absorption, par abréviation l’absorb, est la série des épreuves auxquelles l’ancien soumet le nouveau polytechnicien. C’est une sorte de baptême dont l’origine remonte aux premières années de la fondation de l’École.
Au palais Bourbon, où l’École était organisée en externat (1794-1804), les élèves n’ayant pas entre eux de rapports très fréquents, de relations bien intimes, la cérémonie se bornait le plus souvent à une sorte d’examen burlesque qu’on faisait passer aux nouveaux. On leur demandait de démontrer que le carré d’une vache est un cheval ; de trouver l’âge d’un capitaine de navire, connaissant la hauteur du mât et la vitesse de son bateau ; de deviner le nom d’un grand physicien représenté par une raie tracée sur le mur, et mille autres facéties et calembredaines analogues. Mais, dès que l’École fut casernée et soumise au régime militaire, il s’organisa immédiatement entre les élèves, sous l’apparence de jeux, une sorte dissociation dont le but fut d’échapper à la surveillance dont ils étaient l’objet et de résister à l’administration de l’École.
Pour absorber les nouveaux (les conscrits comme on se mit à les appeler), les anciens commencèrent à exiger des témoignages de respect et à s’arroger sur eux, pendant un certain temps, une véritable autorité. Aux problèmes baroques qu’ils continuaient à leur poser, ils ajoutèrent une série de vexations, telles que les huées, les arrosements, l’enlèvement et la destruction des effets de casernement, d’habillement ou d’étude, l’infection des chambrées, et quelquefois la bascule et les postes (Voy. ces mots). Ces initiations duraient ordinairement deux mois, de novembre à janvier, époque à laquelle, le temps d’épreuve étant considéré comme terminé, les anciens consentaient à traiter de pair avec les nouveaux.
Voici l’ordre qui était affiché dans chaque brigade, dès l’entrée de la nouvelle promotion :
L’usage des bascules subsistait encore en 1824 ; un élève de cette promotion, se moquant de l’exagération des pratiques religieuses introduites un peu plus tard par le gouvernement de la Restauration, chantait ce couplet :
La bascule disparut et fut remplacée par d’autres épreuves assez anodines, dont les parents cependant se plaignirent à plusieurs reprises, mais sans succès.
Sous le premier empire, les brimades causèrent parfois de véritables désordres et amenèrent des voies de fait et des duels. Sous le régime beaucoup plus doux établi par la Restauration, en 1826, l’autorité s’étant relâchée, le système des initiations ne fit que se développer, s’étalant ouvertement et se terminant chaque année par une représentation grotesque des autorités. Ce fût là l’origine de la séance des Ombres (Voy. ce mot).
Il arrivait quelquefois que des conscrits résistaient, refusaient de se laisser absorber, faisaient de la rouspétance, comme on dit aujourd’hui. Ceux qui avaient de l’entrain, de la vigueur, parvenaient à échapper à tous les bras qui cherchaient à les saisir ; quelques-uns payaient d’audace et d’esprit et faisaient rire aux dépens des anciens ; mais le jeu n’était pas sans danger. Johanneau, pour l’avoir joué avec succès en 1845, fut la cause d’un bran fameux à la suite duquel il fut définitivement renvoyé de l’École, et dix-sept de ses camarades furent enfermés à l’Abbaye.
Le plus souvent, les brimades n’étaient que jeux, facéties, plaisanteries, cérémonies toujours drôles et parfois spirituelles. Ainsi, le premier jour, quand il revenait de la bibliothèque après avoir passé par la lingerie, le conscrit était contraint de passer une chemise par-dessus ses habits et de chanter sur un air connu un passage quelconque d’un livre, ouvert à la première page venue. Ceux qui avaient de la voix entonnaient un air d’opéra aux applaudissements de la promotion. Les taupins à qui l’on connaissait quelque talent ou qui s’étaient fait remarquer par quelques travers étaient signalés pour être l’objet de vexations particulières. C’est ainsi qu’en 1839, Léorat et Larochefoucauld, qui s’étaient acquis au collège une certaine célébrité par leurs exploits chorégraphiques au bal de la Chaumière, durent exécuter devant les deux promotions le pas du grand Chahut pendant que, sur l’air de Larifla, anciens et conscrits chantaient à tue-tête la complainte du maréchal Gérard :
Après 1840, l’absorption se fit au Palais-Royal, au café Hollandais, au Holl, devenu le café des élèves. Elle consistait en un déjeuner froid composé d’huîtres et de pâté et arrosé de champagne, déjeuner que les conscrits diraient aux anciens et qui était précédé de brimades inoffensives. Chaque conscrit, débarrassé de son épée, coiffé du claque placé en bataille, à la gendarme, était saisi, enlevé de terre par deux bras vigoureux et transporté dans les airs d’un bout à l’autre de la grande salle. Pendant qu’il était soumis à un double mouvement de translation et de rotation, le conscrit était marqué d’un numéro à la craie sur la partie la plus large de son pantalon et recevait au passage nombre de taloches sur son… numéro. Les conscrits restaient groupés dans une petite salle, appelée le parc aux huîtres, jusqu’au moment où ils étaient admis au festin.
Supprimée en 1865, au moment de l’épidémie de choléra, et sévèrement interdite l’année suivante, l’absorption n’a pas tardé à reparaître à l’intérieur de l’École, malgré les défenses, les menaces, les répressions les plus sévères. Elle se résume aujourd’hui en une série de brimades (Voy. Bahutage), pour la plupart fort innocentes.
L’absorption, avec ses initiations et sous l’apparence de jeux, a pour but de fusionner les deux promotions qui se succèdent, de plier les caractères, de faire prévaloir l’idée généreuse du sacrifice de l’intérêt particulier à l’intérêt général. C’est ce que dit l’ancien aux conscrits, en présence des deux promotions réunies, à la fin des épreuves : « Malgré les punitions qui ont plu sur vos anciens, ceux-ci ont continué, fermes et calmes, leur initiation. Vous ferez de même l’an prochain. Opposez à l’autorité le lien solide de la camaraderie : les géné passent et le Code X reste. Vous avez subi les épreuves nécessaires ; maintenant soyez nos camarades. » Cette tradition, transmise de promotion en promotion, a certainement contribué, dans une large mesure, à développer un puissant esprit de corps entre les élèves.
Abréviation d’admission. On dit les examens d’admiss’, ou même simplement l’admiss’.
Ce serait une curieuse histoire que celle du programme des examens d’entrée : toujours grossi, surchargé, exigeant de plus en plus un effroyable surmenage. Que de changements depuis les premières années, où l’on n’exigeait que des éléments d’arithmétique, d’algèbre et de géométrie, où l’on tenait compte surtout de l’intelligence, préférant « ceux qui savaient le mieux à ceux qui savaient le plus », et aussi « ceux qui avaient constamment manifesté l’amour de la liberté et la haine des tyrans » ! Les épreuves, uniquement orales à l’origine, sont augmentées en 1800 d’épreuves écrites : d’abord une simple dictée de quelques phrases françaises ; puis une version latine, bien vite supprimée ; puis une composition d’analytique, une épure, des dessins lavis et d’imitation, un calcul trigonométrique, une composition de physique et de chimie. Pour l’oral, chaque branche des connaissances exigées est successivement étendue puis diminuée ; la mécanique apparaît, disparaît, reparaît. L’importance relative des différentes épreuves ne cesse de varier.
Le mode d’examen change presque aussi souvent que les programmes : les interrogations sont confiées tantôt à un seul examinateur, tantôt à quatre ou même à deux, qui se partagent les candidats et dressent chacun leur liste, tantôt à une commission unique qui se transporte dans les principales villes de France, comme cela a lieu aujourd’hui. Ces changements successifs ont toujours pour but de donner au concours une sévérité plus grande, une justice plus complète, une égalité plus parfaite, une solennité plus imposante.
Aujourd’hui les épreuves de l’admission comportent :
1° Une série de compositions écrites, après lesquelles on dresse une liste d’hypo-admissibilité.
2° Deux examens oraux portant sur les mathématiques et qui servent à dresser une liste, dite d’admissibilité.
3° Quatre examens oraux, deux de mathématiques, un de physique et un de chimie, permettant de constituer, avec les notes des premiers examens et celles des épreuves écrites la liste définitive de classement.
Un examen d’escrime et d’équitation peut donner aux candidats de 1 à 15 points.
Le baccalauréat ès lettres ou simplement le certificat de la première partie de ce baccalauréat donne un avantage de 15 points. Sur la liste par ordre de mérite, on prend le nombre d’élèves fixé chaque année par le ministre de la guerre.
Pour entrer à l’X il ne suffit pas d’être Français, d’avoir moins de vingt et un ans, et d’être ferré sur les mathématiques (trapu en X comme on dit à l’école) ; il faut avant tout être vacciné.
Dès l’origine de l’École, un certificat de vaccine a été nécessaire. Nous donnons, page 7, le curieux fac-similé d’un certificat produit en 1818.
Vacciné, déclaré bon pour les services qui se recrutent à l’École par un conseil de révision spécial, le taupin est alors autorisé à se présenter devant les examinateurs.
Les candidats les redoutent, ces examinateurs féroces, qui, pendant une heure, les tournent et les retournent comme les martyrs sur leurs brasiers.
Aussi comme on se venge à l’École, le jour de la séance des Ombres, en mettant en lumière leurs tics, leurs travers, leur manière d’interroger, les tours de phrases qu’ils affectionnent.
Celui-ci hirsute, lourd, le dos voûté, critique en grommelant toutes les expressions échappées au candidat :
– Heu ! heu ! « le sens des aiguilles d’une montre ! » mais, monsieur, si vous n’avez pas de montre ? – Et puis, vous dites « ce qui satisfait à l’équation » ; vous a-t-elle dit ce qui lui fait plaisir ? Heu ! heu ! Quand on parle comme vous, on apporte un dictionnaire de locutions ! – Vous ne comprenez pas ?… C’est malheureux pour l’un de nous deux, monsieur ! heu ! heu ! – Effacez !
Celui-là, moins gouailleur mais plus nerveux :
– Ah ! vous ajoutez !… Eh bien, dites-le, monsieur, parlez ! Bon, vous retranchez, maintenant ! mais dites-le, monsieur, dites-le donc ! – Cela me fait beaucoup de peine, monsieur ; j’ai pleuré pendant tout l’examen de votre prédécesseur, j’en ai assez… Je vous remercie.
Cet autre, physicien très distingué d’ailleurs, promène une longue règle de bois de sa chaussette à sa bouche, cache son visage derrière une pile de livres, afin d’éviter la poussière de craie, et demande :
– M’sieu, pas de détails, pas de figures. – Tournez le dos à la planche et tâchez de me comprendre ; c’est pas si facile que ça. – M’sieu, si je place une mouche dans un verre plein d’air, et que cette mouche vole, le verre en sera-t-il plus lourd ?
Il y a l’examinateur nerveux, ne cotant que l’intelligence, et posant au candidat des problèmes dont il ne connaît pas lui-même la solution. Il s’échauffe, dirige l’élève, cherche avec lui et donné comme note un 5 ou un 18 suivant l’inspiration du moment.
De tout temps, il s’est rencontré des examinateurs grincheux et même tant soit peu impertinents. Écoutez plutôt Arago racontant son examen d’entrée à l’École :
L’EXAMINATEUR.– Si vous devez répondre comme votre camarade, il est inutile que je vous interroge.
ARAGO.– Monsieur, mon camarade en sait plus qu’il ne l’a montré ; j’espère être plus heureux que lui : mais ce que vous venez de me dire pourrait bien m’intimider et me priver de tous mes moyens.
L’EXAMINATEUR.– La timidité est toujours l’excuse des ignorants ; c’est pour vous éviter la honte d’un échec que je vous fais la proposition de ne pas vous examiner.
ARAGO.– Je ne connais pas de honte plus grande que celle que vous m’infligez en ce moment. Veuillez m’interroger, c’est votre devoir.
L’EXAMINATEUR.– Vous le prenez de bien haut monsieur ! Nous allons voir tout à l’heure si cette fierté est légitime.
ARAGO.– Allez, monsieur ! je vous attends.
Les réponses du candidat furent si remarquables que, passant d’un extrême à l’autre, l’examinateur, Monge le jeune, se leva, vint embrasser Arago et lui déclara qu’il occuperait le premier rang sur sa liste.
Vers 1860, l’un des examinateurs de math était un ancien saint-simonien, devenu catholique ultra. Lorsque la famille s’était retirée au monastère de Ménilmontant, il avait eu pour fonction de cirer les bottes d’Enfantin et de ses compagnons. Affligé d’un mal qui le faisait se tortiller sur sa chaise, il variait à chaque instant son humeur au grand effroi du candidat.
Que de générations ont maudit le célèbre Lefébure de Fourcy, toujours grognant, toujours caustique, s’attirant parfois de vives répliques. Un élève ayant ânonné sa réponse, Lefébure s’adresse à l’appariteur :
– Garçon, apportez une botte de foin pour le déjeuner de monsieur !
– Garçon, répond le candidat, apportez-en deux ; – monsieur l’examinateur déjeune avec moi !
Nous retrouverons un peu plus loin plusieurs autres examinateurs de l’admiss’.
C’est la Société amicale de secours, instituée dans le but de venir en aide aux camarades malheureux : et à leurs familles. Née du même esprit de corps et de camaraderie qui a présidé à l’Association mutuelle des élèves et, plus tard, à l’institution des caissiers (Voy. ce mot), cette Société, fondée par les promotions 1863 et 1864, n’a pas tardé à être déclarée d’utilité publique et à prendre un développement rapide. Ses ressources, consistant en dons, legs, souscriptions perpétuelles, cotisations et dans le produit d’un bal annuel, sont arrivées à constituer un capital social de près d’un million.
Tous les élèves tiennent à honneur de figurer sur la liste des souscripteurs, qui est un véritable Annuaire de l’École.
L’Amicale organise tous les ans, dans les salons de la Légion d’honneur, du ministère de la guerre, ou d’un grand hôtel de Paris, un bal où se donnent rendez-vous toutes les familles polytechniciennes. C’est le bal de l’X.
Tous les ans, au mois de janvier, les membres de l’Association se réunissent à l’École, sous la présidence d’un d’entre eux, pour entendre la lecture du rapport sur les actes de la Société.
Jadis, la réunion avait lieu dans le pavillon même des élèves ; jeunes et vieux fraternisaient, quelquefois bruyamment.
La séance se tient aujourd’hui dans le grand amphi de physique.
Abréviation du mot amphithéâtre.
Le premier amphithéâtre avait été construit dans l’hôtel Lassay, contigu au palais Bourbon, sur la terrasse du quai ; il contenait quatre cents places. Pendant l’hiver rigoureux de 1794-95, les élèves, alors externes, avaient pris l’habitude de venir y déjeuner le matin, puis de chanter et de faire le plus grand vacarme jusqu’à l’heure de la leçon.
Dès le principe il fut le lieu désigné de toutes les réunions tumultueuses.
Des étrangers s’y glissaient tous les jours, particulièrement les élèves de l’École des mines et ceux de l’École normale.
C’est pour cela qu’on fit délivrer à chaque polytechnicien une carte qu’il devait présenter à la sentinelle du poste d’entrée de la rue de l’Université ; cette carte servait également de carte de sûreté pour circuler librement dans Paris.
Quand l’École fut transportée au collège de Navarre, on construisit, à chacune des ailes du pavillon destiné aux élèves ; un amphithéâtre particulier à chaque division.
Ces deux amphithéâtres disparurent en 1871, lors des agrandissements de l’École, et furent remplacés par un seul, construit dans un bâtiment annexe, qu’on éleva au milieu de la cour de gymnastique, dite autrefois cour des Acacias.
L’amphithéâtre de chimie fut construit en même temps que les laboratoires, par le général Tholozé, en 1842. C’est dans cette vaste salle semi-circulaire que les deux promotions se réunissaient jusqu’à ces derniers temps. Le grand amphithéâtre de physique, dans la construction duquel on a introduit tous les perfectionnements de l’art moderne, a été élevé de 1879 à 1883, en même temps qu’un groupe de bâtiments spécialement destinés à la physique, sur la rue d’Arras et la rue du Cardinal-Lemoine ; il contient 700 places.
À l’amphithéâtre le professeur, presque toujours en habit noir, expose la leçon ; il est écouté religieusement. Toute manifestation est interdite ; les élèves se lèvent à la première et à la dernière leçon ; il n’y a généralement d’applaudissements qu’à la fin du cours. Les élèves, assis sur les gradins, prennent des notes sur leurs genoux, le papier appuyé sur le carton Pierre.
La surveillance est faite par un capitaine de service qui, les yeux sur le plan de la salle, peut immédiatement repérer l’élève qui troublerait l’ordre. La mesure n’est pas toujours inutile car il peut arriver que quelques, élèves fatigués se laissent aller au sommeil ou même, si la leçon est trop ardue, qu’ils se livrent assis à terre ; entre les bancs, aux émotions du whist à trois.
Le mot amphi ne désigne pas seulement l’amphithéâtre ; il a reçu, par extension, plusieurs autres acceptions. Amphi signifie aussi la leçon du professeur. C’est dans ce sens qu’on dit : « Je n’ai pas compris un traître mot de l’amphi d’aujourd’hui, » ce qu’on exprime plus couramment en disant – J’ai pigé zéral à l’amphi.
Les élèves savent que « les interrogations portent sur les quatre derniers amphis ».
On dit encore « faire un amphi a un camarade », c’est-à-dire « lui expliquer une leçon ».
Dans les salles d’étude, le crotale fait souvent un amphi préparatoire à ceux qui doivent subir une interrogation.
Sur la demande des élèves d’une salle, un répétiteur vient faire un amphi supplémentaire ; c’est un droit dont les élèves usent peu souvent.
Lorsqu’on veut avoir sur un point particulier des renseignements intéressants, des tuyaux, on demande un amphi-tuyaux.
Par extension encore, on appelle amphi la réunion de plusieurs personnes, de plusieurs objets : on dira un amphi de généraux, un amphi de claques, etc.
Le matin, après l’appel, certains élèves remontent dans les casernements, terminent leurs ablutions ou se couchent sur le pieu (le lit) et continuent le somme interrompu par la diane : c’est l’amphi-pieu.
Depuis plus de trente ans, un enseignement musical, facultatif du reste, est donné à l’École d’après la méthode Galin-Paris-Chevé. Émile Chevé, puis Armand Chevé ont successivement professé avec le désintéressement le plus absolu. Ils ont obtenu de merveilleux résultats constatés tous les ans dans une grande séance musicale offerte au général. Les élèves se passionnent à ce point pour les ta fa té ré lé ti fi du maître, que quelques-uns, assure-t-on, transforment en mélopée les chiffres de leur table de logarithmes.
C’est le cours de danse.
Dans une salle basse, où le jour ne pénètre que par deux portes vitrées donnant sur une cour, le père Fischer donne la leçon de danse. Le gros homme, à la mine réjouie, à la démarche sautillante, debout sur la pointe des pieds, exécute la ritournelle avec un violon, en indiquait le pas.
Les élèves qui doivent faire la dame ôtent leur herry, le retournent et le mettent à l’envers : ils se coiffent de leurs képis, la visière sur le cou ; ils font des mines et prennent des poses.
Dans une affreuse poussière jaune, les groupes s’animent, tournent, se culbutent ; des cavaliers seuls battent des entrechats.
– Allons, messieurs, dit mélodieusement le père Fischer, si vous voulez bien, pied droit, pied gauche et assemblez ; droit qui recule, gauche qui avance (violon) : 1, 2, 3, 4, messieurs, mon quatrième temps, je vous recommande ! Mesdemoiselles, veuillez mettre vos couronnes de roses, c’est ainsi que nous appelons ici les képis. Soyez dame, soyez cavalier, c’est absolument la même chose.
Avant le père Fischer, le professeur de danse était le fameux Cellarius. Bien avant lui, Beaupré, ancien danseur de l’Opéra, donnait depuis 1824 des leçons de danse et de maintien. Il faisait presque sérieusement une sorte de cours sur le port de l’épée et du chapeau, sur la manière de se présenter, sur certaines attitudes de la vie civile et de la vie militaire. Toujours sur la pointe des pieds, le mollet tendu ; le corps légèrement incline, plein de grâce malgré ses quatre-vingts ans, Beaupré donnait des exemples des faux pas, des entortillements, en un mot de toutes les catastrophes pouvant être causées par une épée mal gouvernée ; puis, subitement, il marchait sans embarras avec la plus grande élégance (Voy. le mot Frégate).
L’amphi de Beaupré n’a pas manqué d’être tourné en ridicule, en ce temps-là, au moment de l’absorption : « Tu n’as pas rédigé ton cours de beaupré, disait l’ancien au conscrit embarrassé par sa tangente ; rédige, mon ami, et aie toujours ton cahier dans ta poche, pour montrer que tu as compris et donner des espérances d’un meilleur avenir. »
Dans le buen-retiro baptisé gog ou longchapips (Voy. ces mots), où l’on est à l’abri de toute surveillance importune, bon nombre d’élèves se trouvent souvent réunis, grillant une cigarette et bavardant, sans se soucier des odeurs fétides. C’est l’amphi-gog.
Lorsque, par hasard, on veut parler de politique ou de religion lorsqu’on veut régler bien en secret certaines petites affaires de famille, c’est à l’amphi-gog qu’on se réunit.
Certains joueurs acharnés qui ne se sentent pas suffisamment à l’aise dans les salles ou à l’amphi, vont tenir un amphi-gog. D’abord tolérés par leurs cocons dont ils gênent les promenades, ils ne tardent pas à se rendre maîtres absolus de la place, s’enferment et se barricadent. C’est alors qu’un topo sérieux est lancé dans la promotion, demandant la liberté des gogs ! Nous renonçons à donner des extraits d’un topo de ce genre que nous avons sous les yeux : toutes les raisons qui militent en faveur de cette liberté étant exposées, les joueurs sont invités à… vider les lieux.
À l’époque de l’élection des caissiers (Voy. ce mot), c’est là que le candidat loustic va, comme au club, débiter sa profession de foi. « S’il est nommé, affirme-t-il, le coffre-fort qui logeait des souris regorgera d’or et de billets ; les basoffs deviendront humbles et soumis ; la rue Tournefort sera pavée ; un funiculaire permettra aux élèves de gravir sans fatigue la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève ; l’exer sera supprimé ; le truffin fera enfin connaissance avec l’eau et le savon !… »
Les murs des gogs sont alors couverts d’affiches, parodies, comme celle que nous reproduisons ci-contre, des affiches qu’on voit quelquefois sur les murs de Paris avant les élections :
COMITÉ ÉLECTIVISTO-ANARCHISTO-SOCIALISTO-TERRORISTO-RÉVOLUTIONNAIRE.
COCONS ! ! !
Vu l’importance des élections, le Comité électivisto-anarchisto - socialisto - terroristo-révolutionnaire s’est réuni dans le bocal affecté à ses délibérations pour choisir un candidat digne de représenter et de défendre les grands principes de la révolution sociale.
COCONS ! ! !
L’heure de la revendication a sonné ; nous sommes, nous aussi, de la grande cohorte des travailleurs, car, comme eux, nous avons les mains sales ! Assez et trop longtemps nous avons fléchi sous le joug d’une administration despotique qui nous inflige des collés instantanées et de la chicorée au jus ! ! Pour nous affranchir, il faut un bras énergique, un homme convaincu.
Votez avec nous ! ! !
Le Comité propose un candidat, un vrai, un PUR qui a signé le programme suivant et un second candidat, également vrai, également PUR qui l’a signé aussi.
PROGRAMME
ART.Ier. – Tout est supprimé, sauf l’X.
ART. II.– Tout est supprimé à l’X, sauf les frites et les sorties.
ART. III.– Vote d’un crédit destiné à affecter le local du binet de service à l’amphi-gog et vice versâ.
ART. IV.– Rétablissement du point γ.
ART.V.– :Les candidats, élus caissiers, rendront compte de leur mandat tous les jours.
Fait à l’X, le 15 mars 188.
LE COMITÉ.
Les candidats ont signé des deux mains.
L’amphi-gog a même un organe spécial, le Goguenard, qui ne paraît d’ailleurs qu’au moment de l’élection des caissiers et qui contient les scies les plus abracadabrantes. Nous extrayons d’un feuilleton cette expression de l’amour polytechnicien :
« Ô projection d’un ange sur la terre ! conjuguée harmonique de mon âme ! mon cœur décrit autour de toi tous les lieux géométriques de l’amour. Qu’un rire fou nous fasse tordre en spirale logarithmique ! que ma bouche soit bitangente, que dis-je ? osculatrice à la tienne ! n’est-ce pas pour toi un déterminant nécessaire et suffisant que je te supplie de ne pas t’annuler pour moi, base de ma vie ? que ta confiance soit proportionnelle à la hauteur de mes espérances ; ne me réduis pas à ma plus simple expression ! Cette délicieuse et exponentielle fonction d’épouse ne saurait t’être équilatérale et l’espérance d’une dérivée mettra notre bonheur à son maximum. »
Le Goguenard, tout comme le Rosto et le Récréatif autres journaux de l’X, enregistre souvent de flatteuses approbations, telle celle-ci, posthume, de Victor Hugo : « Jeunes gens, Tout est l’infini. Vous êtes Prométhée complété par Fulton, Brutus s’achevant dans Saint-Just. Allez ! En vain Basile vous attaque : répondez aux insultes par des clartés, résolvez les énigmes par les lumières, les problèmes par les aurores ! »
Abréviation d’analyse ; l’ana c’est le calcul différentiel et intégral.
Après Lagrange et Prony, qui ont fondé le cours d’analyse transcendante et de mécanique rationnelle, ce cours a été professé à l’École par les plus grands géomètres : Poisson, Lacroix, Fourier, Poinsot, Cauchy, Navier, Ampère, Mathieu, Duhamel, Sturm, Liouville, Hermite, Bertrand et Jordan. L’enseignement de l’analyse a été constamment la grande préoccupation du conseil d’instruction de l’École et il a puissamment contribué à maintenir le renom scientifique de notre pays.
Lorsque Lagrange fit sa première leçon, les élèves des trois années voulurent y assister, et avec eux tous les professeurs, empressés à devenir les auditeurs de ce grand savant. « C’était là qu’il fallait être pour se faire une idée de l’enthousiasme de cette jeunesse passionnée du désir de s’instruire, afin de mieux servir le pays ; pourvoir d’habiles professeurs rendre hommage à un si grand esprit, se confondre avec les élèves, afin de prendre en quelque sorte sur le fait le génie de l’invention, et pour juger du religieux silence de ce nombreux auditoire, quand une interruption inattendue indiquait chez l’illustre géomètre une de ces profondes distractions qu’une idée imprévue venait parfois lui causer. »
Poisson était entré à l’École à dix-sept ans, le premier de sa promotion (1798). Sa maladresse en dessin était légendaire ; aussi, fait unique dans l’histoire de l’École, il fut dispensé de tout travail graphique afin de pouvoir se livrer tout entier à l’étude des mathématiques. Élève de Lagrange, tout particulièrement aimé de Saint-Simon qui, pendant trois ans, avait payé ses frais d’études, signalé durant son séjour à l’École par de remarquables travaux mathématiques, Poisson fut nommé professeur en 1806, en remplacement de Fourier ; il n’avait que vingt-cinq ans. Ses camarades et son ancien professeur, Billy, avaient eu raison de répéter :
Poisson était le modèle parfait du professeur consciencieux ; jamais il ne se fit remplacer dans son cours. Quand il abandonna le professorat pour devenir examinateur de sortie, il apporta dans ces nouvelles fonctions les mêmes qualités d’exactitude, de sincérité. Une fois seulement, raconte Arago, il voulut, par délicatesse, se faire remplacer pour l’examen de son fils aîné ; mais les élèves, l’ayant appris, envoyèrent une députation composée de tous les chefs de salle pour lui déclarer qu’ils avaient dans son impartialité la plus grande confiance et pour le supplier de ne pas se récuser. Poisson, profondément touche, disait, sans cacher son émotion, qu’il considérait cette démarche comme la plus douce, la plus honorable récompense qu’il eût jamais pu obtenir.
« La vie, disait Poisson, n’est bonne qu’à deux choses : à faire des mathématiques et à les professer. »





























