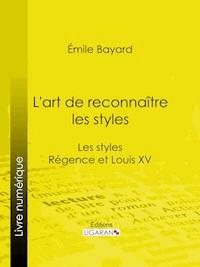
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le style Louis XIII, attristé par les guerres religieuses, devait sa gravité à cette agitation et, tel un cerveau mûri succédant à une tête de linotte – car l'art de la Renaissance, au déclin, pouvait succomber à l'élégance et au joli, déments – le style Louis XIII ramena d'un front sévère la ligne égarée."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335094763
©Ligaran 2015
En hommage
à M. le Sénateur Lucien Guillemaut
E.-B.
Le style Louis XIII, attristé par les guerres religieuses, devait sa gravité à cette agitation et, tel un cerveau mûri succédant à une tête de linotte – car l’art de la Renaissance, au déclin, pouvait succomber à l’élégance et au joli, déments – le style Louis XIII ramena d’un front sévère la ligne égarée.
Or, après Louis XIV, époque de solennité et de morgue, il est compréhensible que l’on entendît secouer le joug. Et ce fut le fait de la Régence, du règne de Louis XV et de Mme de Pompadour, étapes de volupté, d’intimité, où les mœurs dissolues communièrent avec la ligne, au point de modifier cette ligne et de l’alanguir en caresse.
C’est ainsi qu’à l’ordre et à la majesté du roi Soleil succédèrent la grâce, le confort et le caprice, le joli au beau. C’est ainsi que fleurit le règne des femmes après l’empire des hommes.
Louis XIV n’avait eu qu’un seul penchant impérieux : l’amour des grandeurs et de la gloire. Son but unique était de dominer, d’en imposer. La volupté, maintenant, a rompu ses liens rigides, et la statue de Cupidon détrônera celle de Minerve sur l’autel du sourire.
À vrai dire, tant de splendeurs, sous Louis XIV, n’allaient point sans quelque ennui. Au bout de ces perspectives infinies, à travers ces salles immenses et glaciales où l’or écrasait de sa magnificence, on eût cherché en vain un coin d’amabilité, un peu de pittoresque reposant, après tant de rectitude et d’altitude.
Point non plus de riant bosquet à l’extrémité de ces allées rigides tracées par Le Nôtre, dans ces jardins d’architecture végétale, parmi cette nature contrainte, dont les verdures sont taillées en murailles, tordues en portiques, arrondies comme des dos de courtisans, sur un signe du maître.
Tout était alors sacrifié à la parade et, la façade humaine, rehaussée elle-même d’une perruque monumentale, répondait à ces dômes imposants que le Grand Roi affectionna au couronnement de ses édifices.
Point donc d’aménité ni d’abandon, à cette heure somptueuse où la dignité ne dut jamais faillir à l’étiquette, non plus qu’à un besoin caractéristique de symétrie.
Il n’empêche que l’architecture, sous Louis XIV, offre une unité supérieure à celle des autres Bourbons, nous ajouterions même : de caractère national, si le roi et la grande aristocratie pouvaient être considérés comme la nation, à une époque aussi avancée de la civilisation moderne.
Sous le règne de ce prince, il y eut un accord d’esprit et une harmonie générale des choses, bien propres à caractériser une période d’apogée nationale et, n’était en Europe l’état général de lutte, de trouble profond dans les idées, né avec la Réforme qui neutralisa les bienfaits durables que l’on ne pouvait attendre de l’ordre intérieur national, les peuples modernes eussent pu espérer asseoir les fondations solides qui doivent porter le régime évolutif destiné à remplacer celui du Moyen Âge.
« Versailles était le trophée que Louis XIV avait érigé après avoir vaincu les derniers restes de la féodalité ; Versailles était pour ainsi dire sa monarchie elle-même. »
Sous Louis XIII, la fantaisie géniale de la Renaissance sur le thème antique avait été contrariée, mais déjà l’architecture, à cette époque, était devenue moins égoïste ; les palais royaux et les demeures privées s’attachaient davantage que précédemment à l’ensemble de l’esthétique ; c’était en somme un acheminement vers l’harmonie esthétique des villes.
Sous Louis XIV, la lourdeur et l’austérité caractéristiques du Louis XIII s’étaient amendées dans la richesse, et le Louis XVI, en revenant à l’esprit antique, marquera le retour du régime après l’orgie, que la Régence et le Louis XV avaient célébrée.
Toutefois, les réformateurs de la fin du XVIIIe siècle voulurent trop emprunter à l’antiquité et, n’observant pas d’assez près les signes de leur temps, ils demandèrent trop à une érudition défectueuse. De là résulta l’école classique, qui considère les œuvres d’art grecques et romaines non plus simplement comme des expressions du système des idées antiques, mais comme des manifestations des sentiments de la beauté absolue. Grave erreur, dogme redoutable propagé par le style de Napoléon Ier et jusqu’à nos jours désorientés encore, malgré certaines recherches fort louables de modernisme, par l’hallucinante infaillibilité des chefs-d’œuvre précurseurs.
Mais les styles reflètent les époques, et l’art y gagne en variété. Les artistes suivent l’esprit de leur temps qui a le style qu’il mérite, sans jamais que ces cristallisations d’idéal ou de satisfaction y perdent en intérêt, pourvu qu’elles soient originales.
Tout plutôt que la stérilité propre aux générations endormies sur la gloire du passé.
Aujourd’hui, notre décor est impersonnel parce que nos artistes sont encore éblouis. Napoléon Ier, en s’asseyant sur le trône de César, avait au moins eu le geste du vainqueur, tandis que l’heure présente assiste placidement au défilé des chefs-d’œuvre, dans un fauteuil d’Arlequin.
Et que voit-elle défiler en dehors du classique grec et romain, cette heure repue et expectante ?
Précisément des styles comme ceux qui vont nous occuper, les styles Régence et Louis XV dont l’originalité, même dans le décor architectural extérieur, est évidente. Car les doctrines de F. Mansard, qui inaugura le style destiné à prévaloir sous Louis XIV, n’avaient pas eu une heureuse influence sur la plupart de ses successeurs et, à partir du XVIIIe siècle, l’architecture française perdit en général son caractère d’originalité pour s’abandonner sans mesure aux imitations de l’architecture antique.
Pourtant, si une admiration sans bornes des monuments grecs et romains nous valut cette unité de l’architecture de Louis XV, que l’on se plaît à rapprocher de celle de Louis XIV – supérieurement harmonisée et plus personnelle, bien qu’à tout prendre, Gabriel vaille Mansard – à quelle frappante originalité allons-nous applaudir, en revanche, dès la Régence et sous Louis XV, en ce qui concerne l’ornementation et le mobilier !
Il serait à souhaiter que tous les écarts de vertu aient été aussi favorables à l’art que ceux reprochés unanimement au léger XVIIIe siècle.
Et ne sont-ce pas, précisément, les contrastes qui varient et rénovent l’esthétique ? Après la solennité, l’abandon ; la romance succède à la tragédie, Mars dépose ses armes fleuries aux pieds de Vénus, c’est l’arc-en-ciel après l’orage ; c’est la trêve de l’amour.
Des efforts différents vers le sentiment et la beauté engendrent des génies nouveaux, tandis que la placidité bourgeoise, la vie tempérée, ne causent aucune surprise, ni bonne ni mauvaise.
On a vu des rois épouser des bergères, pour le seul plaisir de rompre avec le protocole et d’aimer une fois selon son cœur. Il semble bien que la simplicité que nous allons goûter maintenant, après l’affectation précédente, nous reposera. Nous en trouvons la preuve dans la naissance d’un art frais et neuf.
Certes la révolution est pacifique, la distribution des houlettes enrubannées, tandis que l’on ramasse les mousquets, commence. Ce n’est qu’après Louis XVI que les dents grinceront sous la haine ; car, si l’heure de Marie-Antoinette veut jouer à la vertu, pour la forme seule des meubles, amendée, pour une sobriété de façade, la transition entre la ligne torse et la ligne droite s’est effectuée dans le calme et encore avec grâce. C’est ainsi que la rectitude, chère à Louis XIV, s’est inclinée devant le caprice plus ou moins contorsionné de la Régence et de Louis XV.
Il n’en pouvait être autrement de la courtoisie hautaine vis-à-vis de l’élégance suave.
Après la Révolution qui fit tomber tant de têtes exquises, un guerrier sera nécessaire pour revenir à l’héroïsme, autre stimulant. Le triomphe sanglant des armes succédant à la foi du carnage après l’attardement du madrigal, c’est tout le résumé du règne de Napoléon Ier, après la Révolution qui brisa les tendresses du XVIIIe siècle.
Or ces étapes se valent au point de vue artistique ; du moins ont-elles laissé des traces d’un égal intérêt, si néanmoins le goût personnel les avantage ou les discute. Une question de nature et de caractère donne aussi la préférence, en dehors de l’esthétique, à telle époque, suivant que l’on aime à être grisé de poudre de guerre ou de poudre de riz.
Toutefois il est avéré que la beauté des styles prend fin après le premier Empire, à condition cependant que le style de Napoléon Ier soit considéré – ce qui devrait être – comme la dernière manifestation d’un accord de beauté.
Autrement, derrière la vaste et intransigeante stature des styles Louis XIII et Louis XIV, les élégances similaires de la Renaissance et de la Régence, du Louis XV et du Louis XVI, échangent des sourires qui valent toutes les grandeurs. Demandez plutôt à la gravité et à la lourdeur gréco-romaine du meuble de Napoléon, déridée quelque temps par la fantaisie gracile du meuble Directoire.
Éternelles fluctuations de l’esprit et de l’opinion, plus fertiles certes, au point de vue artistique, que nos actuelles satisfactions.
Sous l’empire de la littérature et de la religion, les sentiments humains s’affirment cyniques ou réservés, toujours plus proches néanmoins de l’impulsion naturelle qui ne demande qu’à éclore selon les nuances de la mode. Et chacune de ces manifestations de la civilisation dominées par les mœurs et la politique, dicte aux divers âges, un décor, un mobilier, un idéal en rapport.
Les cathédrales, les palais et les hôtels de ville chantent tour à tour à travers les époques, des poèmes religieux, des poèmes royaux et des poèmes démocratiques.
L’hiératisme gothique marche d’accord avec la rigidité de la pierre, cette même pierre qui s’animera avec la Renaissance – et, sous Louis XIV, la carrure majestueuse du personnage s’encadrera dans une analogue carrure. À la tristesse de Louis XIII, souriante seulement sous la dentelle, succédera la gravité du Roi Soleil, pailletée de luxe. Et ce luxe correspond à la splendeur du beau et des jouissances de l’esprit, chères à l’époque. Mais, du côté prosaïque, de même qu’au règne précédent, on sera mal assis. Les aises sont interdites en public, le masque est raide sous l’impersonnalité de la perruque qui dicte un visage d’homme à l’ordonnance, et le geste sera carré, imposant comme imposé.
Des glaces à profusion répercuteront tant de majesté, et les yeux se reposeront cérémonieusement de l’éclat des ors, sur de vastes tapisseries aux sujets nobles.
De même que l’ennui pèse, les entablements qui eussent écrasé les frêles et riantes colonnettes de la Renaissance, reposent lourdement, au temps de Louis XIII, sur de solides pilastres. Il n’est pas jusqu’à l’idéal féminin qui ne s’altère alors, sous l’empire de cette massivité triomphante. « La nudité des “Madeleine au désert”, a-t-on dit judicieusement, se charge d’un embonpoint engageant, de carnations potelées, fraîches, appétissantes. »
N’a-t-on pas attribué, non sans quelque apparente logique, la sveltesse caractéristique des figures de la Renaissance, représentée par les fines créatures de Jean Goujon, entre autres, au torse plutôt court sur de longues jambes, à l’habitude que les femmes d’alors avaient de monter en croupe ?
Songez au tassement du torse tandis que pendaient les jambes, et vous évoquerez pareille évolution ethnique chez les dames roulant carrosse ou portées en chaise, dont les chairs s’épaississaient au manque d’exercice.
Bref, il y a identité entre l’individu et son ambiance, dans tous les styles, soit que l’être se modèle à son décor, soit qu’il l’inspire (la preuve en est que l’on dit les pieds, le dos, le siège d’une chaise, les pieds et l’entre-jambe d’une table) ; et cela nous explique encore pourquoi, au temps où l’on portait culotte, « les rondeurs suggestives de la jambe, avec ses fines attaches et ses renflements harmonieux, donnèrent l’idée des formes à mollet, du piétement des chaises et des tables aux quenouilles des lits, jusqu’au balustre (à mollet) triomphant dans l’architecture ».
Aussi bien dès la Régence et sous Louis XV, le geste tout comme la ligne, s’arrondira. Le corps daignera s’incliner devant la femme et le meuble fera de même pour recevoir galamment ses formes.
C’est la naissance du confort. On sera bien assis et la couche, moins maussade, sera plus douillette. La solennité guindée du XVIIe siècle s’accommodait excellemment de la ligne droite et l’on s’inclinait en équerre devant une dame ; maintenant, au XVIIIe siècle, après une onduleuse révérence, le soupirant s’agenouillera auprès de sa belle, dans le moelleux d’un coussin.
Et tout le décor alentour sourira, aussi aimable que le personnage dans la lumière tamisée, propice ; tandis que les supports des meubles eux-mêmes, seront infléchis, tournés en caresse, énamourés sous leurs couleurs tendres, sous leurs ors discrets, sous leurs tissus chatoyants.
Ce ne sont plus, en somme, les mêmes êtres qu’auparavant, ces hommes du XVIIIe siècle. De solennels, de magnifiques, ils sont devenus plus simplement des humains en ce qu’ils sacrifient plus ouvertement à leurs instincts. On dirait même qu’ils ne pensent qu’à folâtrer, tant leur cadre est badin et charmant. Cette atmosphère doucereuse qu’ils ont créée puise sa séduction précisément dans son alanguissement, dans sa volupté et sa fadeur, qui valent tout autant que la grande attitude précédente, par le contraste artistique.
Ces délicieux personnages se sont efféminés au contact même des frivolités. Leur taille, mieux prise sous le vêtement plus avantageux, a diminué d’autre part sous la perruque moins monumentale, et voici que tout se réduit à l’unisson, dans leur cercle.
Sentez-vous poindre autour de ces êtres précieux, de ces mâles défaillants, la délicatesse des mignardises et autres « mignonnes » mesquineries ? Voyez-vous le cadre se resserrer autour des petits-maîtres ?
C’est l’importance réduite des pièces, la « bonbonnière » qui commence, en place des immenses appartements, c’est le volume et le poids des meubles en diminution. L’intimité naît. Le boudoir et le bosquet, autrefois ignorés, apparaissent comme une oasis, l’un à l’intérieur, l’autre en plein air, au bout du cérémonial.
Lorsque Louis XVI monta sur le trône, il trouva le palais de Versailles défiguré par toutes les distributions nouvelles que son prédécesseur y avait ordonnées. « Fidèle image de la monarchie, écrit H. Fortoul, le château avait été profondément altéré comme elle. Ce n’étaient plus que de petits appartements, portes secrètes, escaliers dérobés. Un changement important donnait la clef de tous les autres. Le grand escalier, qu’on appelait aussi escalier des ambassadeurs, avait été supprimé ; il servait aux entrées de la cour et aux grandes cérémonies monarchiques. Il était devenu inutile sous un prince qui n’avait plus aucun souci de sa couronne, qui regardait comme une charge insupportable la majesté royale et qui mettait tout son bonheur à vivre comme un particulier et à se livrer dans l’ombre à ses fantaisies les plus basses. »
« Ainsi l’axe public du château avait disparu ; dans la monarchie comme dans le château, la pensée de Louis XIV avait été mutilée, et on ne devait plus la rétablir. »
Le désœuvrement va contribuer encore à l’excellence de cette réaction. Il bercera la plastique, il réjouira la vue et troublera le cœur de trouvailles d’art toujours plus riches, toujours plus ingénieuses. Il y aura des meubles pour chaque geste, pour chaque désir et ce sera la grâce même.
Il reste à déterminer la qualité esthétique de toutes ces inventions, de toute cette grâce, et il faut reconnaître que la Régence nous offre une décoration singulièrement indécise, soit qu’elle se réclame excessivement du Louis XIV dont elle n’est alors qu’un succédané, soit qu’elle se confonde avec le Louis XV dans la rocaille, décoration qu’elle remet au jour avec une évidente personnalité.
Dans ses deux manifestations, l’une transitoire, l’autre effective, le style Régence est fort délicat à apprécier. Nous nous efforcerons néanmoins de démêler au chapitre suivant sa curiosité décorative.
Si nous en revenons aux manifestations opposées des styles, en général, aux transformations tant morales que physiques, voulues ou subies, aussi variables que les modes et les goûts d’art, nous remarquons la lenteur de l’évolution réformatrice ou créatrice.
Il y a des styles de préparation ou de transition, entre chaque style ; c’est la période des recherches conscientes et plus souvent inconscientes, en vue de réaliser l’harmonie de l’homme avec la société qui lui convient, caractéristiquement.
La manifestation réactive de la Régence prépara le pur style Louis XV, tout comme le chaos révolutionnaire et l’étape Directoire enfanteront le pur style Empire.
Or, chacune de ces transitions, Régence et Directoire – l’élucubration révolutionnaire exceptée – a son charme propre, au point de mériter l’appellation de style. En dehors de ces transitions manifestes, il en est d’autres seulement ébauchées, noyées dans le tâtonnement et dans l’influence du passé, que le connaisseur seul discerne, mais tous les styles purs ont eu des acheminements obscurs qui nous laissent rêveur sur le sort de certain « modern-style » florissant de nos jours, prétentieusement étiqueté à notre époque.
Songez que, sous son règne, le style Régence passa inaperçu, du moins ne lui donna-t-on pas de nom particulier, et n’est-ce pas le sort de tous les styles d’être discernés seulement par les générations qui les ensevelirent ?
Hormis le cas de Napoléon Ier sacrant à son nom le trône où il prit place, il n’est pas d’exemple de styles improvisés, et cela pourrait donner une leçon d’humilité à nos conceptions architecturales et d’ameublement, pompeusement décrétées du XXe siècle.
Toutefois nous ne pouvons qu’applaudir aux tentatives originales de notre temps. Ces recherches prendront certainement rang dans l’avenir, parmi les louables transitions qui nous procureront, il faut l’espérer, l’esthétique monumentale et mobilière caractéristique de notre siècle.
Toujours est-il que si, pour la grande parade napoléonienne, on dévalisa le magasin des accessoires grecs et romains, si l’aigle conquérant et pillard s’installa soudainement dans le nid des héros antiques, cela n’est qu’une digne suite à l’étonnante épopée impériale, c’est-à-dire une manifestation sans exemple comme sans lendemain.
Il faut dire encore que, s’il n’est point extraordinaire de voir Napoléon conquérir un style comme un territoire, le génie des David, des Percier et des Fontaine, qui veillait sur cette décoration de fortune, ne fut pas étranger à son triomphe.
Mais revenons aux styles transitoires, en la personne du style Régence dit rocaille ou rococo.
La Régence marque le véritable début du XVIIIe siècle français ; elle est le premier symptôme du déséquilibre moral d’où sortira la Révolution, malgré quelque réaction plus apparente qu’effective, sous Louis XVI. D’ailleurs, pour ne pas quitter notre sujet, nous avons souligné l’identité de cette période de luxe et de volupté effrénés, de ce relâchement des mœurs et de cet abandon, avec une expression d’art aussi riche et pareillement désemparée. Sous Louis XV déjà, nous verrons prôner les meubles « à la grecque » que Louis XVI dans un accès de vertu, borné d’ailleurs au décor, consacrera. Un nuage gris succédera seulement au nuage rose, en attendant l’orage de la Révolution. Puis, ce sera l’improvisation sans goût qui naît fatalement sur les ruines, jusqu’au moment où le premier Empire rassemblera en hâte les déchets antiques pour bâcler son style.
Après, nous assistons au triomphe de l’impersonnel, c’est la décadence inventive, la bourgeoisie satisfaite des deux Restaurations, le faste immodéré et banal du second Empire. La complication étonnante et l’imprécision enfin des recherches fort intéressantes mais encore incohérentes, de nos jours.
Autant le choix, l’adaptation progressive et minutieuse de l’art classique à notre goût français sous Louis XVI étaient délicats, autant la violente irruption d’un Napoléon Ier dans le bazar gréco-romain apparaît choquante. Le style du guerrier ne peut avoir le même tact que celui du placide monarque, soit ; mais il faut remarquer que la douceur des transitions des styles entre eux depuis la Régence, nous valut une chaîne de beauté gracieuse que seule la violence rompit.
Dès le choc de la Révolution, le charme original s’est évanoui. Faute de pouvoir créer, on adapte, on restaure, on vit du passé.
On suit parfaitement le fil créateur, depuis la Renaissance, qui classe les beautés antiques et s’en fait une loi d’idéal adapté cependant au génie national. Sous la Renaissance, effectivement, l’art italien, l’art français et celui des autres pays ralliés à l’idée classique, diffèrent entre eux par des nuances éminemment typiques, au point de constituer un style original et divers.
Sous Louis XIII, on s’attache à renouveler l’art de la Renaissance qui vient de succomber à l’afféterie ; mais, si l’on emprunte à l’art flamand et à l’art italien une lourdeur évidente, cette lourdeur ne manque pas d’être originale et grandiose.
Même massivité sous Louis XIV. Cependant l’héritage du précédent règne trouvera sa personnalité dans une richesse éclatante, dans un retour plus complet aux ordres et aux détails antiques, dans cette solennité même qui n’est plus de la gravité attristée, mais de l’orgueil.
Nous avons vu enfin le charme des originalités suivantes succomber à la brutalité, et nos jours en plein espoir de rénovation.
Nous fermerons maintenant cette large parenthèse, que le désir de situer exactement notre sujet dans son atmosphère, nécessita.
Il faut, pour admirer ou critiquer de bonne foi un style, connaître ses précédents, ses influences et les conditions de son évolution, car l’art n’est qu’un tout de civilisation, de contagion et de caprice dont il importe de raisonner les réalisations entre elles.
Si les artistes enfantent individuellement, leurs chefs-d’œuvre sont solidaires d’un bloc de pensée commune, et le respect s’impose devant un nombre si restreint de « blocs » parmi tant de siècles.
C’est ainsi que cette sublime cristallisation mérite les considérations et observations qui précèdent, plus propres au développement et à la compréhension de notre sujet qu’à son ralentissement.
Nous voici donc revenu au style Régence, rocaille ou rococo, en sa genèse.
Tout d’abord constatons que les premières constructions « rocaille » remontent, en France, au XVIe siècle. C’est Bernard de Palissy qui fut le propagateur, chez nous, de ces ouvrages rustiques imitant les rochers naturels dont la mode devait s’emparer avec avidité cent ans plus tard. Car l’amour des rocailles exerça sur la décoration du mobilier, dès le XVIIe siècle, à la fin du règne de Louis XIV, une influence considérable.
Qu’était-ce, en somme, que ces rocailles offertes en protestation à la symétrie régie par l’antique depuis la Renaissance ?
Des imitations de rochers naturels, avons-nous dit, des coquilles, coquillages de toute sorte et pétrifications, mêlés à des palmes et à des rinceaux, voire à des légumes et à des fleurs ; des reproductions synthétiques de l’eau qui coule en cascade, de stalactites et autres agréments botaniques ou géologiques entraînés dans la grâce la plus désinvolte, dans la fantaisie la plus contorsionnée qui soit.
Ce n’était pas un retour simple et franc à la nature ; car, dès le premier moment, on tomba dans la convention, l’étrange, le maniéré. Aussi bien la rocaille fut très arrondie, très contournée ; c’était une imitation infiniment capricieuse et infidèle de la nature, mais qui ne manquait ni de charme ni d’originalité et dont l’architecture, les appartements, les mobiliers et l’orfèvrerie s’emparèrent.
En vérité, il faut savoir où cette ornementation tourmentée et bizarre a pris ses modèles ; sans cela, à part quelques volutes et vasques ressemblant à des coquillages, le mot rocaille n’éveillerait rien à l’esprit.
Aussi bien la rocaille stylisée est le point de départ de tout un désordre frappant.





























