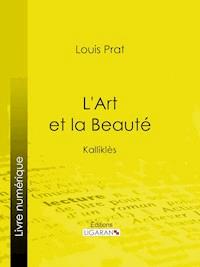
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "KALLIKLÈS : ne me fais pas voir, je t'en prie, Platon, un visage irrité. Par Athéna ! j'avais grand souci d'arriver sous le platane au moment convenu. Adresse ta réprimande à mon esclave Damon : il est le vrai coupable. J'aurais été près de toi, à l'heure dite, s'il ne m'eût désobéi. PLATON : Je ne suis pas en colère, ami ; je ne veux réprimander personne. KALLIKLÈS : Il mériterait pourtant plus qu'une réprimande, Platon."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À MON ANCIEN MAÎTRE
MONSIEUR A. PENJON
Hommage respectueux.
ARÉTA : Fille d’Aristippos, le Kyrénéen.
PLATON.
ANTISTHÉNÈS : Philosophe cynique.
AVANT LE MYSTÈRE
À quelle heure, Aréta, as-tu quitté Mégare ?
Ce matin, maître, au premier chant du coq. C’est Agathoklès, le messager, qui m’a conduit à Athènes. Il t’aime beaucoup, Platon ; il m’a parlé de toi avec un grand respect.
Dis-lui, quand tu le reverras, fille d’Aristippos, que j’ai gardé de lui un bon souvenir. Est-il toujours camus ?
Plus que jamais, Platon ; mais ses cheveux ont blanchi. Cependant il est resté plus gai que le plus gai des éphèbes : on ne saurait souhaiter un compagnon de route plus joyeux.
Belle vertu et bonne entre toutes, la gaieté ! Étais-tu seule, Aréta, dans le char d’Agathoklès ?
C’est comme si j’eusse été seule ; mes deux compagnons de route n’ont pas dit une parole.
Et qui étaient, Aréta, ces voyageurs muets ?
Un marchand venu de Korinthe et un prêtre d’Apollon qui me regardait à la dérobée, en baissant les yeux.
En baissant les yeux ! Et le marchand te regardait-il, lui aussi ?
Non certes, par Zeus-Père ! Il ne songeait qu’à dormir. Il dormait bruyamment, la bouche ouverte.
Il ronflait ?
Il ronflait, Platon, comme ronflait le célèbre disciple d’Antisthénès, la dernière fois que je l’ai vu, il y a trois mois environ, au Kranion de Korinthe.
Tu as vu Diogénès, Aréta ! Lui as-tu adressé la parole ?
Certes, mais je n’ai pas eu lieu de m’en réjouir ; ton disciple n’est pas aimable, Antisthénès.
Il est misogyne et toujours de mauvaise humeur quand on l’éveille.
Le cynique t’aurait-il adressé des reproches, fille d’Aristippos ?
Plus que des reproches, Platon ; il m’a insultée. Je l’ai trouvé couché à l’entrée du Kranion, le corps roulé dans son manteau. Aussitôt que je l’eus touché à l’épaule, il se dressa vivement sur ses jambes, et se frottant les yeux de sa main droite fermée :
– Qui es-tu, dit-il, et que me veux-tu ?
Je répondis que j’étais la fille d’Aristippos. Il reprit avec colère : « Fille d’Aristippos, tu portes à ton cou un collier d’or très pesant, des cercles d’or à tes poignets et à tes chevilles : ton péplos est tout brodé d’or. Tout cela vaut une grosse somme, dix mines peut-être ? Mes haillons, besace comprise ne valent pas deux drachmes, mais cet or qui pare ta beauté est l’insigne de l’esclavage. Je suis, moi, le libre citoyen du monde. Ton père est le philosophe des courtisanes, tu me parais être, toi, la courtisane des philosophes. Maintenant, va-t’en, laisse-moi dormir ! »
Ceux qui étaient auprès, des hommes et des femmes, des enfants surtout, riaient de moi. Je me suis enfuie le cœur plein de tristesse, pleurant, humiliée.
Le chien ignore le prix de la beauté, il ne sait qu’aboyer et mordre.
Je dois le défendre, Platon, c’est mon disciple préféré ; c’est un philosophe, c’est un homme !
C’est avec raison que tu le défends, Antisthénès. C’est un homme ! Il m’a fait voir que tous ces ornements que ma vanité se plaisait à étaler étaient sans prix. Depuis, je ne porte plus ni collier, ni bracelets, mon péplos, de même que ma tunique, sont sans broderies. Je veux que personne ne puisse plus me prendre pour une courtisane.
Je ne lui pardonne pas, Aréta, de t’avoir fait pleurer. Laissons là le cynique, plus orgueilleux, dans son humilité de parade, que le fils de Klinias revêtu de son manteau de pourpre. Raconte-nous ton voyage. N’as-tu pas rencontré sur ta route, la double théorie des fiancés, qui vont tous les ans, à cette époque, au sanctuaire d’Aphrodita ?
Je l’ai rencontrée, Platon. Nous nous sommes arrêtés un moment pour regarder la fête des fiançailles : elle est belle.
C’est une des grandes fêtes religieuses de la Hellas. Plusieurs fois, au temps de ma jeunesse, je me suis rendu à Éleusis pour la voir. Toujours je m’en suis retourné à Athènes ravi du spectacle. C’est une joie pour un vieillard de ressusciter sa jeunesse. Tu me rendrais heureux, fille d’Aristippos, si tu voulais me dire la procession des fiancés d’Éleusis.
Voici, Platon, ce que j’ai vu :
Pendant plusieurs stades, la route qui conduit de Mégare à Géphyra et à Athènes longe le golfe d’Éleusis. Ce matin, au lever d’Hélios, le golfe présentait un aspect inaccoutumé. Comme de grands oiseaux aux ailes déployées, les voiles blanches des pêcheurs semblaient jouer sur les flots. Quel spectacle ! Sur quatre rangs, dans un ordre parfait, les barques couronnées de feuillage et de fleurs, s’avançaient en longeant la côte. Elles étaient tout près de nous, au moment de notre arrivée à Éleusis. De la route, on entendait la voix grave des rameurs couverte, par moments, par la voie aiguë des jeunes filles. Bientôt, le chant monta jusqu’à nous très distinct et très pur ; je pus le reconnaître. C’était le grand hymne en l’honneur d’Aphrodita Anadyoména.
Avec celles qui devaient être leurs femmes, les pêcheurs des îles se rendaient en grande pompe au temple périptère d’Aphrodita, pour invoquer la déesse avant que fut célébrée leur union. Ces pêcheurs étaient, pour la plupart, venus de très loin, d’Égine, de Kéos, des Kyklades. Le chant peu à peu s’éloigna. Mais, aussitôt que nous eûmes dépassé Géphyra et les Courants salés, un spectacle nouveau se déroula à notre vue.
Le temple de la mère vénérable se dressait devant nous, dans sa gloire. Hélios enveloppait de sa lumière dorée le fronton et toute la partie antérieure qui fait face à la mer : les blanches colonnes, en marbre de Paros, étincelaient. Alors, s’avançant du rivage vers le temple, en une double théorie, les pêcheurs, que j’avais vus à Éleusis, accompagnés de leurs fiancées, chantaient les louanges de la déesse. Ils étaient précédés par six joueurs de flûte et par quatre citharistes. Les hommes vêtus de la courte tunique et coiffés du large pétase tenaient la gauche. Leurs mains étaient chargées de présents. Dans des paniers d’osier, les uns portaient de jeunes porcs dont les cris perçants s’entendaient au loin ; d’autres, des poissons, des dorades surtout et des éperlans. La droite était occupée par les jeunes filles. Enveloppées du blanc péplos qui descend jusqu’aux pieds, des guirlandes formées de branches de myrte et de roses entrelacées autour de la tête et qui tombaient sur les épaules, elles allaient, d’une démarche gracieuse, portant chacune une paire de colombes. Arrivés à l’entrée du temple, les fiancés, les femmes par la droite, les hommes par la gauche, gagnaient le portique où trois prêtres vêtus de blanc se tenaient debout devant des tables. Ils acceptaient en souriant les offrandes. Ensuite, deux par deux, les fiancés s’inclinaient devant le sanctuaire, suppliant la déesse de se montrer favorable à leurs amours. On les voyait enfin suivre le péristyle et descendre par les degrés opposés. Là, des groupes se formaient et se répandaient à travers la campagne.
Voilà ce que j’ai vu, Platon. Aphrodita, dans l’Attique, est toujours honorée entre les déesses.
Tu n’as pas vu les danses sacrées ?
Non, maître, et je le regrette ; Agathoklès s’impatientait ; il devait se rendre à l’Agora pour y acheter des olives et du froment. Nous sommes repartis plutôt que je ne l’aurais voulu. Bientôt après nous entrions dans Athènes, par la porte sacrée.
Et de là, tu es sans doute venue directement à l’Académie.
Il était de bonne heure encore. Je me suis arrêtée un moment à Athènes, chez Kalliklès. Il se serait fâché, Platon, si je n’étais allée le voir.
Et tu as craint de fâcher Kalliklès ?
J’aime beaucoup Kalliklès. Quand je suis arrivée, dans sa maison, il se levait à peine. Déjà, comme d’habitude, il se disputait avec Damon, l’esclave qui a soin de ses livres et qui est certainement son ami le plus cher. Quel homme extraordinaire que Kalliklès ! il pense d’après Gorgias et il agit comme si Platon était son maître.
Il n’est en rien mon disciple, Aréta.
Je veux croire que tu te trompes ; tu avoueras du moins que sa conduite dément ses paroles qui sont d’un sophiste. Il m’a exprimé sa joie de me revoir et j’ai dû, une fois encore, visiter ses collections : ses peintures, ses vases précieux, ses statuettes de dieux et de déesses, en marbre de Paros, que son ami Skopas a sculptées, jusqu’à ces amusantes poupées en argile de Tanagra d’un art si délicat et si pur, ses volumes enfin que Damon a rangés dans un ordre admirable. Il me racontait, en même temps, la journée d’hier. La discussion a été belle, paraît-il, et mon regret est très vif de n’avoir pu tenir ma place dans la première journée du Mystère .
La discussion a été belle en effet, plus belle que d’habitude, Aréta, grâce à Aglaophamos mon hôte.
C’est ce que m’a dit Kalliklès. Il a fait plus ; il a résumé pour moi, très vivement et très exactement, autant que j’en puis juger, les différents discours : la violente attaque du géomètre Eudoxos, et aussi ta réponse, Platon, qui est digne du plus grand disciple de Sokratès. Enfin, imitant les gestes et jusqu’au son de la voix, mimant l’étrange personnage, il a refait, en partie, le discours de cet Aglaophamos que tu as ramené de Sicile. C’est un homme étonnant, s’il faut en croire Kalliklès, et l’on se demande, après l’avoir entendu, s’il est le plus fou des sages ou le plus sage des fous.
Il est très étonnant, Aréta ; le plus étonnant des hommes. Par Athéna la déesse tutélaire, jamais je n’ai entendu un raisonneur plus vigoureux, plus redoutable !
J’espère qu’il me sera donné de le voir et de l’entendre, Platon.
Je l’espère aussi, fille d’Aristippos, mais il est parti ce matin, au lever du jour, sans me dire où il allait.
Sois assuré qu’il reviendra, Platon.
Quant à moi, a ajouté Kalliklès, « je me suis refusé à jouer dans le Mystère le rôle du personnage muet qu’Antisthénès a tenu dans la perfection. Gorgias, mon maître, n’eût pas désavoué quelques-uns des arguments que j’ai su aiguiser ». Mais qu’as-tu Platon ? Depuis un moment ton visage me semble plus sévère. Serais-tu fâché contre Aréta ?
Pourquoi serais-je fâché, Aréta, et à quel propos ?
Tu es de mauvaise humeur, Platon, tu ne souris plus. Ne cherche pas, je t’en prie, à me tromper. Depuis que je te connais, j’ai appris à lire sur ton visage les pensées de ton cœur.
Pardonne-moi, fille d’Aristippos. J’avais une telle hâte de te voir, qu’il me semble que Kalliklès m’a frustré d’un bien qui m’appartenait, en t’embrassant, ce matin, avant moi.
Moi aussi, Platon, j’avais hâte de te voir. Je ne suis pas restée longtemps chez Kalliklès ; j’ai refusé même de partager son repas ; je pourrais presque dire que je me suis enfuie. Plus j’approchais du Jardin, plus je marchais vite. Arrivée près des tombeaux, sitôt que j’ai aperçu les premiers arbres, je ne sais quel aiguillon m’a piquée, mais j’ai eu une envie folle de courir ; et j’ai couru comme je courais autrefois, quand j’étais petite fille et que tu me grondais, maître, parce que j’avais déchiré ma robe aux ronces du taillis. Ma joie était grande de penser que bientôt j’allais te revoir et t’embrasser sur les deux joues et sur le front, ainsi qu’on embrasse son père. Au détour de la première allée, je t’ai aperçu, avec Antisthénès, sous le platane ; j’ai couru plus vite encore et me voici près de vous, toute joyeuse.
Es-tu encore fâché contre Aréta, Platon ? Il me semble que le sourire revient se poser sur tes lèvres.
Ma mauvaise humeur s’est enfuie, chassée par ta bonne grâce et ta gaieté, fille d’Aristippos.
Je ris, maître, tant je suis heureuse de tes paroles. Voudrais-tu me rendre plus heureuse encore ?
Par Zeus-Père, ce serait mon désir le plus cher, Aréta, toi que Kalliklès appelle, à juste titre, la vivante image d’Athéna, vierge protectrice de la cité ! Comment ne marquerai-je pas d’un caillou blanc le jour où tu es venue, apportant au milieu de nos visages moroses l’éclat de ta jeunesse, de ta beauté, de ta joie ?
Maître, rappelle, je te prie, tes souvenirs. Autrefois, il y a quatre ans environ, – je n’étais déjà plus une petite fille, – tu m’as autorisée à me mêler à la troupe de tes disciples pour discuter avec eux, sous ta direction, les grands problèmes de la philosophie. Parfois Kalliklès venait nous rejoindre sous le portique, avec mon père, avec d’autres encore, les plus illustres d’entre les Athéniens, que l’éclat de ton enseignement avait attirés. J’étais assise à ta droite. À tour de rôle, tes amis, Platon, m’interrogeaient, et je m’appliquais pour eux, à distinguer le Bien du Mal, le Vrai du Faux, le Juste de l’Injuste. Mon bavardage semblait les amuser. Puis la discussion commençait – il vaudrait mieux dire la dispute – entre Kalliklès et moi. Ses discours avaient le don de m’irriter ; je le réfutais avec colère. Ces années, belles entre toutes, se sont enfuies, maître ; je ne les retrouverai plus. Comme j’étais fière du rôle que tu me permettais de jouer dans l’École ! Quand, par hasard, une de mes réponses embarrassait l’esprit subtil du sophiste, tu tournais vers moi ton noble visage, et tandis que, distraitement, ta main droite caressait mes cheveux échappés du réseau, tu disais : Aujourd’hui encore, ma fille Aréta a vaincu Kalliklès. Aréta était heureuse, orgueilleuse aussi un peu, d’être louée par Platon ! Ne voudras-tu pas, maître, me faire encore cette joie de m’appeler ta fille ?
Celle-là et bien d’autres encore, Aréta, si j’en étais capable. Qui ne serait fier de t’appeler sa fille ! Mais ne me diras-tu pas d’où te vient ce désir ?
C’est que je t’aime, Platon, comme si tu étais mon père.
Eh bien ! je serai ton père, Aréta. Écoute : tu n’ignores pas, sans doute, qu’un père a le droit de s’enquérir de tout ce que fait sa fille, tu sais aussi qu’une fille obéissante répond à toutes les questions de son père. Si je t’interroge me répondras-tu ?
Interroge, Platon, ta fille te répondra.
Hier, Kalliklès, Antisthénès et moi, je ne parle pas des étrangers, nous avons, sans toi, célébré la première journée du Mystère. Nous étions inquiets, mon enfant, de ne pas te voir près de nous. Je sais maintenant que tu as regretté de ne pas venir, je ne sais toujours pas pourquoi tu n’es pas venue.
Aréta, ma chère fille, mes paroles ont fait monter la rougeur à ton front. Pourquoi es-tu si troublée ? Pardonne-moi, je t’en prie. Le vieux Platon ne voulait pas t’offenser.
Je te croyais informé, Platon ; j’avais envoyé un message à ton neveu Speusippos.
Speusippos ne doit pas avoir reçu le message ; du moins il ne m’a pas averti.
Hier encore, Platon, mon fils avait la fièvre ; j’étais près de son berceau.
Ton fils ! Tu as donc un fils, Aréta ?
Se peut-il, Platon, que tu ignores ce que tout le monde sait à Athènes ?
Il faut bien que cela se puisse, si cela est. J’ai appris que tu avais quitté Kyréné depuis un an et que tu étais établie à Mégare dans la maison d’Eukléïdos ; c’est tout ce que je sais, ma chère enfant.
J’ai un fils, Platon ; il s’appelle Aristippos comme mon père ; il aura comme lui, je l’espère, l’esprit ingénieux et subtil. Cela te paraît étonnant, je le vois bien, que celle que tu appelais autrefois la petite Aréta soit devenue mère. Je suis mère ! Jamais pourtant, précédée du flambeau nuptial, vêtue de blanc et portant sur la tête la couronne de l’épousée, je n’ai été conduite en pompe vers la maison de l’époux.
Je regrette de t’avoir interrogée, Aréta. Tu étais si joyeuse il n’y a qu’un instant ! Maintenant te voilà, par ma faute, les yeux pleins de larmes. Garde ton secret, je t’en prie, ma chère enfant.
Je préfère parler, Platon ; je veux que tu me connaisses, je ne veux pas que tu me méprises.
Te mépriser, Aréta ! Tu m’es peut-être encore plus chère depuis que je sais que tu as souffert.
Parle, Aréta, parle sans crainte, mon enfant. Notre âge nous permet de tout entendre. Nous connaissons les hommes et les choses et notre cœur est plein d’indulgence. Je sais depuis longtemps, fille d’Aristippos, je sais à n’en pas douter que ce qui arrive, arrive nécessairement, que cela qui est ne pouvait pas ne pas être.
Mon père s’est toujours regardé comme exilé à Athènes. Depuis longtemps il caressait le projet d’aller vivre dans sa ville natale. Un mois après ton départ pour Syracuse, il me proposa de quitter l’Attique et de faire voile vers Kyréné. J’acceptai avec joie. Rien ne me retenait à Athènes. Tu n’étais plus là, tes disciples regrettaient ton enseignement ; plus que tes disciples peut-être, je le regrettais ; tu avais emporté en Sicile l’âme de la philosophie.
Nikéia fut le port d’embarquement. Jamais traversée ne fut plus heureuse ; les dieux semblaient sourire à nos projets. Vous connaissez Aristippos, amis très chers ; la nature lui a donné en partage un caractère gai. Ses bons mots, ses réparties tenaient en bonne humeur l’équipage et les passagers. Les journées, une à une, s’écoulaient joyeuses sur le grand Pontos à qui nos destinées étaient confiées. Lorsque nous approchâmes d’Apollonia mon père me disait les beautés de sa patrie : « Bientôt, Aréta, nous serons à Kyréné. C’est la plus belle ville du monde, la perle blanche des côtes de Lybie. Tu verras comme elle se dresse, majestueuse, à l’entrée du désert. Elle est grecque à moitié, à moitié égyptienne. Ses maisons blanches, très élevées, sont toutes surmontées de terrasses d’où la vue s’étend au loin. Quand le temps est clair, on aperçoit à l’horizon la grande mer bleue. Derrière Kyréné, immédiatement, commence le désert. »
Ainsi, Aristippos, séduit lui-même par ses paroles, évoqua, pour la faire surgir devant mes yeux éblouis, l’éclatante et rare beauté de Kyréné.
Tu connais la grande ville libyenne, Platon ; mon père m’a dit autrefois que tu avais, pendant quelque temps, vécu dans sa patrie.
Pendant six mois, un peu plus peut-être, j’ai été à Kyréné l’hôte de Théodoros, mon ami, le géomètre. Il était Kyrénéen comme ton père. J’allai le rejoindre de Mégare, où je vivais auprès d’Eukléïdos.
Je garde, ma chère fille, toujours vivante en mon âme, la séduisante image de Kyréné. Ton père avait le droit de vanter sa beauté. Aucune ville n’est plus belle, ni plus riche, ni plus curieuse pour un observateur ou pour un philosophe.
Moi aussi, j’aime la grande cite libyenne dont mon père est le fils glorieux. J’ai vécu là des journées heureuses, insouciante et libre. À Kyréné, les femmes ne sont pas, comme à Athènes, enfermées dans le gynécée, elles se mêlent à la vie des hommes. Cette vie indépendante convenait à ma fierté naturelle. Mon père m’avait donné pour compagne une jeune esclave libyenne qu’il avait appelée Mélaïna à cause de sa couleur ; elle est devenue ma plus chère amie. Quand tombait le soir, nous montions sur la terrasse de la maison et là, plus près du ciel, Mélaïna, de sa voix douce et monotone, me contait les légendes des peuples de Libye, la cruauté de ses dieux, les mœurs étranges de sa nation. Qui dira le charme des belles nuits de Kyréné, ses astres éclatants, brillant dans le pur éther ! De la ville en fête, une rumeur confuse montait jusqu’à nous, excitant notre rêverie.
Mon père avait eu l’intention de fonder à Kyréné une école de philosophie où il enseignerait, ainsi qu’il faisait à Athènes, les principes de sa morale. Mais vous connaissez Aristippos, amis très chers ; si ses intentions sont souvent excellentes, elles ne deviennent que très rarement des actes. Il avait fait la connaissance de quelques jeunes gens, les plus riches de la ville, qui devinrent bientôt, il l’affirmait du moins, ses disciples. Étranges disciples qui prenaient la doctrine à contresens, et qui ne tardèrent pas à devenir les maîtres écoutés de celui qui avait pour mission de réformer leur conduite. La vie est courte, disaient-ils, il faut se hâter de jouir de tous les plaisirs qu’elle nous offre. Mon père était heureux. Ses compatriotes le proclamaient le plus grand des philosophes, et, de plus en plus, il oubliait les enseignements de Sokratès. Il lui arrivait même d’oublier qu’il avait une fille. Nous restions parfois longtemps sans le voir.
Un jour, – quelle fatale journée, pourquoi les dieux immortels n’ont-ils pas écarté de ma route cet étranger ? – mon père vint à la maison accompagné d’un riche Lydien. C’était un homme qui avait dépassé la jeunesse et qui n’avait pas encore atteint la maturité. Il était vêtu d’habits de pourpre rehaussés d’or ; il était très beau. Ses cheveux noirs, qui flottaient sur ses tempes et descendaient jusque sur son cou, encadraient son visage qu’une barbe soigneusement annelée allongeait. Un parfum plus suave que celui de l’encens d’Arabie se dégageait de toute sa personne. Aristippos qui le connaissait depuis peu, nous raconta comment il l’avait rencontré dans un banquet que lui offraient ses disciples pour le récompenser d’un éloge magnifique qu’il avait composé en l’honneur de la Volupté. Il nous le présenta comme son ami le plus cher. L’étranger prit alors la parole : Il était marchand, nous dit-il. Ses trirèmes l’attendaient à Apollonia pendant qu’il visitait Kyréné où il était venu acheter aux noirs libyens de la poudre d’or et de l’ivoire. Il me complimenta sur ma beauté. Jamais il n’eût espéré rencontrer à Kyréné une divinité vivante plus belle qu’Astarté et que l’Athéna des fils d’Hellen. Moi, je rougissais de plaisir en l’écoutant. Il revint tous les jours, seul le plus souvent. Chaque fois ses mains étaient chargées de présents. C’étaient des péplos brodés d’or, des anadèmes où brillaient des pierres précieuses, des cercles d’or pour les poignets et pour les chevilles, des miroirs d’argent poli, des manteaux de pourpre et des voiles de Kos, que sais-je encore ? J’avais pour lui une grande amitié. Il me parlait d’une voix douce, un peu traînante, du grand amour que lui inspirait ma beauté. Il me disait sa joie de me ravir à mon père pour me conduire dans son pays où un palais m’attendait. D’autrefois il me contait sa vie aventureuse, ses voyages dans les pays lointains où il allait faire des échanges. Il avait visité les rivages de l’Ibérie et par-delà les colonnes d’Héraklès, en remontant très haut vers le Nord, il avait abordé les côtes sauvages, hérissées de rochers et battues par la tempête du pays des Celtes. J’ai vu là, ajoutait-il, des jeunes filles pâles dont les yeux sont verts comme l’eau des sources.
Un soir, – où trouverais-je des mots, Platon, pour te raconter ce que je dois maintenant te dire ?
Parle, sans crainte, ma chère enfant.
L’étranger et moi nous étions seuls dans la maison. Mélaïna était occupée au dehors. Tout à coup, au milieu de la conversation, comme s’il fut devenu furieux, il se jeta sur moi. Que s’est-il passé alors, dieux justes ! Comment me suis-je défendue ? Me suis-je défendue seulement ? On eût dit qu’un voile noir flottait devant mes yeux. Un philtre sans doute ou une incantation magique m’avaient enlevé tout sentiment. Hélas, ce qui devait arriver arriva, comme dit Antisthénès. Quand je retrouvai mon âme, l’étranger était à mes genoux, essayant de me consoler par de douces paroles. Et moi, lasse et blessée, honteuse, je cachais dans mes mains mon visage et je pleurais. Éros seul était coupable me disait-il. C’était, transporté par ses fureurs, qu’il s’était élancé sur moi et qu’il m’avait vaincue. Je l’écoutais à peine ; je me croyais encore en proie à un de ces rêves horribles qui nous assaillent parfois au milieu du sommeil et jettent le trouble dans notre âme. La fière Aréta était humiliée par un étranger, par un barbare. Je voyais maintenant son âme à nu, son âme basse et vile de marchand. Il me semblait hideux. Je n’éprouvais plus pour lui que du mépris et du dégoût. Comme il me suppliait encore de lui pardonner, me jurant par le Styx et les dieux immortels, qu’il emploierait ce qui lui restait de vie à me faire oublier l’injure qu’il m’avait faite, je le chassai en lui disant que je voulais oublier jusqu’à son nom.
Tu ne nous as pas dit, en effet, Aréta, le nom de l’étranger.
Je ne le dirai pas, Platon. Il est parti, il a rejoint Apollonia et ses lourdes trirèmes chargées d’or et d’objets précieux. Où est-il ? je l’ignore, je ne veux pas le savoir.
Le lendemain j’avouai à mon père l’action vile de son ami le Lydien. Il fit tous ses efforts pour me consoler, s’appliquant à me démontrer que cet accident, comme il l’appelait, faisait partie de l’ordre commun des choses naturelles. Peut-être, ajoutait-il, aurais-tu mieux fait, Aréta, de ne pas chasser le riche barbare.
Ainsi parle d’ordinaire le bon sens des hommes.
Ainsi parlait, Platon, la sagesse de mon père Aristippos ; mais Aréta ne veut pas devenir l’esclave d’un marchand lydien.
Quelque temps après mon père partit, appelé à Syracuse par Dionysos, que la noblesse de ta doctrine n’a pu corriger de ses vices.
Je ne tardai pas à m’apercevoir que je devais être mère. Quelles tristes journées j’ai vécues, enfermée dans ma maison de Kyréné, n’ayant d’autre société que celle de Mélaïna dont les douces paroles consolaient ma douleur !
Ô maître comme tu m’as trompée ! On croit toujours les paroles de ceux que l’on aime, j’ajoutais une foi aveugle à tes discours. Tu m’avais enseigné de si belles maximes sur le culte qui est dû à Aphrodita Ourania. Je pensais, puisque tu l’avais dit, que la Beauté doit être aimée pour elle-même, qu’elle mérite d’être conquise par des soins assidus, qu’il est honteux de vouloir la ravir par la violence. Je répétais souvent cette parole qui est belle : l’amour est une communion des âmes en leur beauté réciproque. Qu’il y a loin de la triste réalité à ce beau rêve que tu m’avais autrefois appris à rêver ! Comme je suis tombée de haut ! Je reconnais maintenant que la doctrine de mon père, moins belle sans doute, est, moins que la tienne, éloignée de la vérité. Il faut avoir le courage de regarder les choses telles qu’elles sont, et les choses sont laides ; il ne faut pas se faire illusion sur ce que valent les hommes : les hommes sont méchants. Si la vie ne peut nous donner autre chose que des sensations, dont les unes sont pénibles, les autres agréables, ce serait folie que de ne pas s’appliquer à éviter la douleur. Telle est ma philosophie maintenant, Platon, j’ai abandonné à jamais des illusions qui m’ont été chères. Quant à cet Éros que tu m’avais appris à aimer, je le hais maintenant : il est la cause de toutes nos souffrances. Il n’est pas vrai que le pur amour existe. Le culte des hommes s’adresse seulement à l’Aphrodita Pandémos, à l’impudique déesse qui offre son corps aux passants. Comment douterais-je de cette vérité ? Depuis que je suis revenue à Mégare, les jeunes gens, les hommes et les vieillards eux-mêmes, tous me regardent avec les yeux du marchand lydien.
Tu te trompes, Aréta, ma chère enfant. Éros n’est pas la cause de tes souffrances.
Ô Dieu menteur, Dieu méchant, au méprisant sourire, fléau des hommes et des dieux, toi qui te ris des larmes des jeunes vierges, que d’autres te tressent des couronnes, moi, ta victime, je te maudis !
Éros est le plus ancien et le plus puissant des dieux.
Il est surtout le plus cruel !
J’ai dit mon histoire, Platon, elle est triste. Mais le passé s’éloigne de plus en plus ; et chaque jour je m’efforce d’oublier. Ce n’est pas la mémoire comme tu le disais, maître, qui est la plus précieuse de nos facultés, c’est l’oubli, le grand et divin Léthé dont les eaux nous purifient des anciennes souillures. C’est l’oubli qui nous permet de regarder non plus en arrière mais en avant de nous. Grâce à l’oubli, je ne désespère pas d’être heureuse. Je suis mère ; mon enfant est beau, tu l’aimerais, Platon, si tu pouvais voir l’eurythmie de ses membres et la grâce de son sourire.
Ne le verrai-je donc pas, Aréta ?
Plus tard, quand il aura grandi, je le conduirai au jardin d’Akadémos, mais jamais, à moins qu’il ne préfère désobéir à sa mère, il ne sera ton disciple, ô Platon.
Mon disciple ! Il est si jeune encore, Aréta, et je suis si vieux !
Je lui enseignerai, Platon, à ne pas demander à la vie plus qu’elle ne peut donner ; il sera le disciple de sa mère. Ma vie s’écoulera désormais près de lui, insouciante et, je l’espère, heureuse.
Ô Aréta tu es jeune et tu es belle. Éros que tu veux chasser de la présence reviendra quelque jour. « Ma bien-aimée, dira-t-il, viens près de moi ; écoute, dans le bois tout proche, le chant des tourterelles, viens. » Et sa voix sera douce et tu obéiras à sa voix.
J’espère que tu te trompes, Platon.
Je suis certain Aréta de ne pas me tromper.
Regarde là-bas, Platon, au milieu de l’allée ce gros homme qui s’avance suivi d’un esclave. On dirait un tonneau qui marche. Par Zeus-Père, c’est notre Kalliklès accompagné par Damon, ils vont lentement. Permets, maître, que je coure à leur rencontre.
Va mon enfant !
À Antisthénès. Avec quelle rapidité, ami très cher, notre Aréta passe du rire aux larmes, et des larmes revient au rire ! Cela n’est-il pas étonnant ?
Comment répondre ô Platon ? La femme est plus mystérieuse que le fleuve Okéanos, et le rire est voisin des larmes. Ainsi l’ont voulu les Immortels !
KALLIKLÈS : Sophiste.
PLATON.
ARÉTA : Fille d’Aristippos, le Kyrénéen.
ANTISTHÉNÈS : Philosophe cynique.
AGLAOPHAMOS : Prêtre d’Orpheus.
DAMON : Esclave de Kalliklès.
LES DISCIPLES DE PLATON.
(Au jardin d’Akadémos.)
Ne me fais pas voir, je t’en prie, Platon, un visage irrité. Par Athéna ! j’avais grand souci d’arriver sous le platane au moment convenu. Adresse ta réprimande à mon esclave Damon ; il est le vrai coupable. J’aurais été près de toi, à l’heure dite, s’il ne m’eût désobéi.
Je ne suis pas en colère, ami ; je ne veux réprimander personne.
Il mériterait pourtant plus qu’une réprimande, Platon. Je ne lui avais pas laissé ignorer que tu serais mécontent si nous arrivions en retard, et tout de même, malgré mon ordre, il s’est refusé à presser le pas.
Un homme ne doit pas marcher plus vite que ne le veulent ses jambes.
Voilà comme il répond ! Il cherche dans sa mémoire, afin d’expliquer ses actes, un antique proverbe, et, s’il n’en trouve pas, sa fantaisie ne tarde pas à en forger un nouveau. Il n’est pas dans l’Attique un esclave plus désagréable. Sous prétexte qu’il a de l’amitié pour moi, il ne me laisse pas un instant de repos ; il me tourmente nuit et jour par ses conseils, qui ressemblent à des ordres. Si je résiste, Damon, pour me punir, reste plusieurs jours sans me parler : son visage s’allonge, il prend un air sévère, il boude tout comme s’il était un homme libre. Par le Grand Chien ! amis très chers, Kalliklès est devenu l’esclave de son esclave.
Si tu n’avais pas un esclave, Kalliklès, tu ne serais pas son esclave.
Si j’ai un esclave ! Antisthénès, hélas ! j’en ai plusieurs ! – c’est que la divine nécessité, à laquelle, c’est du moins ce que tu enseignes, personne ne saurait désobéir, a décidé, dans son éternelle sagesse, que j’aurais des esclaves.
Elle a donc décidé que tu obéirais à un esclave.
Pourquoi le maître se refuserait-il à suivre les conseils de l’esclave, quand ces conseils n’ont en vue que le bien ou l’intérêt du maître ?
Ô Damon, comme je regrette de t’avoir conduit au Mystère ! N’es-tu pas honteux de parler, sans être interrogé ? Vois ! tu fais rire Aréta à mes dépens.
Laisse-la rire, maître, elle est jeune ; son tour viendra de pleurer.
Son tour est déjà venu, Damon. – Kalliklès, les dieux me sont témoins que je riais de ton visage qui voudrait être courroucé et qui n’est que plaisant.
Ris, mon enfant, le rire convient à ton âge et à ta beauté. Kalliklès ne se plaindra jamais de ton rire, même si c’est lui qui le provoque. Et toi, Damon, demande à Platon s’il veut te permettre d’assister au Mystère, et trouve en ce cas, en dehors du cercle, une place d’où tu puisses écouter. Mais, par les dieux immortels ! je t’en prie, fais-nous grâce de ton bavardage ; ne parle pas, à moins que Platon ne t’ordonne de parler.
Ô Platon, voudras-tu autoriser un humble esclave qui admire en toi le génie le plus pur que la Hellas ait enfanté, à suivre le Discours ?
Tu es, pour moi, non pas un esclave mais l’ami de Kalliklès. Je n’oublie pas, Damon, que j’ai été vendu moi-même comme esclave.
Aux disciples.
Enfants, faites près de vous une place à Damon. Il est l’ami de Kalliklès, mon ami.
Je te remercie, ô chorège.
L’heure est venue, de rendre à la mémoire de Sokratès le culte qui lui est dû.
Mais, Platon, je n’aperçois pas ton hôte. Peut-être s’est-il rendu invisible ? Il nous a dit hier qu’il en avait le pouvoir ; ou bien Aglaophamos nous aurait-il quittés cette nuit afin de regagner ces îles Fortunées où commandent les prêtres ? S’il était parti j’en serais désolé.
J’ignore où est mon hôte, Kalliklès ; il est sorti ce matin, de très bonne heure. Je ne l’ai pas revu depuis.
Maître, au lever d’Hélios, j’ai aperçu ton hôte assis au pied des lauriers-roses qui bordent le Képhysès. Il semblait méditer profondément, j’ai craint de l’aborder.
Moi, maître, j’ai vu Aglaophamos, il y a une heure environ, appuyé contre le tombeau d’Harmodios. Il avait l’air très affligé, ses habits étaient souillés de boue.
J’ai entendu dire, maître, que ce matin, à l’Agora, le prêtre d’Orpheus avait été injurié par les marchands et par les artisans. Des enfants l’ont poursuivi longtemps de leurs huées et de leurs railleries ; ils tournaient en ridicule sa vieillesse et lançaient des ordures sur ses vêtements.
Que les dieux immortels protègent l’hôte qu’ils m’ont envoyé ! Que la bienfaisante Athéna veille sur la vie d’Aglaophamos ! Ô populace d’Athènes, ton esprit sera donc toujours le même ! Incapable de reconnaître le génie, tu ne sauras même pas respecter un vieillard !
Le dieu dont il est le représentant sur la terre protégera ton hôte, Platon.
Bientôt, je l’espère, Aglaophamos nous sera rendu.
Je veux l’espérer aussi, Kalliklès.
Ô Platon, se peut-il que des hommes d’Athènes prennent du plaisir à tourmenter un vieux théologue ?
Cela n’est que trop possible, ma chère enfant.
Laissons aux dieux le soin de protéger mon hôte. Nous sommes assis sous le platane afin d’écouter Kalliklès.
Tu nous as promis, ami très cher, de nous démontrer que l’Art était l’unique ouvrier du bonheur des hommes. Je m’attends certes, à ce que, sur une telle question, tu nous proposes des idées nouvelles, ingénieuses, inattendues et subtiles, dignes du plus joli diseur d’Athènes ; mais je te supplie, Kalliklès, de prendre garde que le Discours ne s’écarte de la voie qui lui a été marquée.
Par Zeus-Père, Platon, je te promets de prendre garde.
Choisis, pour arriver au but, le chemin qui te paraîtra le plus agréable, mais, par Athéna, le chorège te supplie de ne pas oublier que le Discours tend vers un but. L’âme de l’homme est-elle ou non immortelle ? C’est le problème à discuter, c’est ce problème qu’il serait beau de résoudre.
Tu as connu mon divin maître, Kalliklès. Son ironie te fut souvent redoutable ; mais il savait trouver dans son cœur des paroles consolantes pour panser les blessures que son amour pour la vérité faisait à l’amour-propre des hommes. Il n’était pas possible de le connaître sans l’aimer, et tu l’aimais. Souviens-toi que c’est sa mémoire que le Discours doit honorer. L’Église socratique a été instituée en vue de réparer l’injustice et la méchanceté de ceux qui ont fait mourir le plus juste des hommes et le meilleur !
Ô maître, quel crime épouvantable les fils d’Athéna ont commis en te condamnant à la mort ignominieuse réservée par les lois, aux ennemis des dieux ! Ils t’ont présenté comme un impie, ils t’ont accusé d’avoir introduit à Athènes des dieux nouveaux, de faux dieux, toi dont l’âme était d’essence divine et vivait en étroite communion avec le Divin ! Ils t’ont accusé d’avoir voulu corrompre la jeunesse ! Ils t’ont fait mourir ! Blessés de ton calme fier, de ton refus d’en appeler à leur indulgence, toi, digne de tous les honneurs civiques, toi, qui restas jusqu’à ton dernier souffle fidèle aux lois de la patrie ! Ils pleurent ta mort, maintenant, ils vouent, aux divinités de l’Hadès, Mélétos, Lycon et Anytos, eux, leurs complices !
Quelques années après la mort de Sokratès, le jour où fut reprise, sur le théâtre d’Iakkhos, la tragédie de Palamédès, on peut dire que, poète vengeur, Euripidès sortit de la tombe pour reprocher durement aux Athéniens le crime qu’ils avaient commis. Eukléïdos de Mégare était au nombre des spectateurs. C’est de lui que je tiens ce fait inoubliable.
Au moment où le Chœur, se tournant vers les gradins, lançait à pleine voix ces vers du plus tragique de nos poètes, ces vers qui arrivèrent droit à la conscience de ceux que le remords tourmentait déjà :
les vieillards aussitôt éclatèrent en lamentations ; les jeunes gens pleuraient aussi, gagnés qu’ils étaient par l’émotion des vieillards.
Les Athéniens comprenaient enfin qu’ils avaient sacrifié méchamment le gardien de la cité.
Tel a été l’homme, Kalliklès, que ton discours doit honorer. Se peut-il, dis-moi, que tant de sagesse soit perdue à jamais et tant de bonté, et tant d’éloquence ? Le rossignol des Muses n’est-il pas quelque part où il chante encore sa divine chanson ?
C’est la question que le chorège te pose, ô Kalliklès ?
Il ne serait pas beau que le Discours laissât sans réponse la question que tu as posée, ô chorège. Je répondrai donc que parmi les âmes des hommes, quelques-unes seulement me paraissent dignes de jouir de la vie qui ne finira pas. Les autres, les plus nombreuses, n’ont que faire de l’immortalité. Elles végètent un temps sur la terre, ont l’air de vivre, puis, quand leur corps usé ne les peut plus soutenir, elles s’évanouissent et disparaissent à jamais, comme s’évanouissent dans les airs les fumées de l’âtre. Seules d’entre les âmes, les meilleures persistent, et les plus nobles.
L’âme de Sokratès est de ce nombre, du moins je l’espère et le veux croire. J’aime à me la représenter, aux aguets, tout près de la trappe du ciel que décrit le vieil aède, écoutant les paroles qui s’élèvent, portées par l’air subtil, du tronc de ce platane vénérable jusqu’aux plaines de l’éther. Elle est là, attentive et curieuse. Je l’imagine souriante et joyeuse le plus souvent, parfois courroucée, selon que le Discours approche de la vérité qu’elle doit maintenant connaître ou s’en éloigne.





























