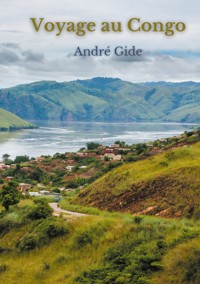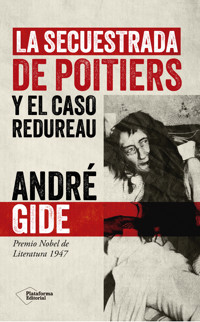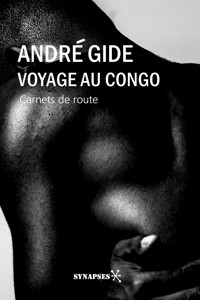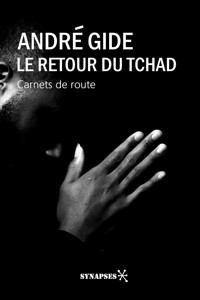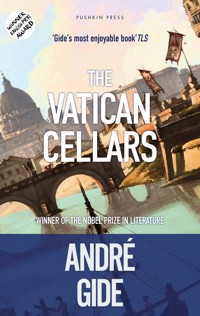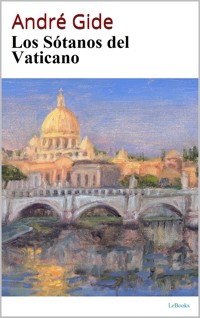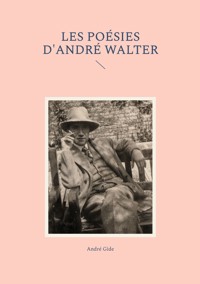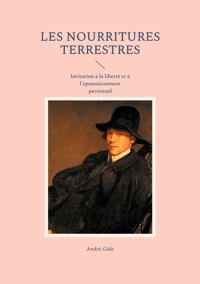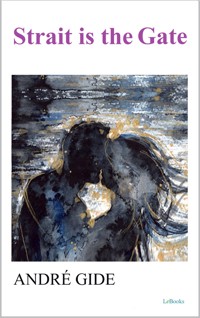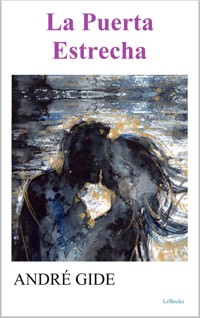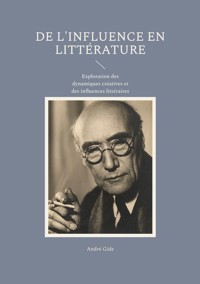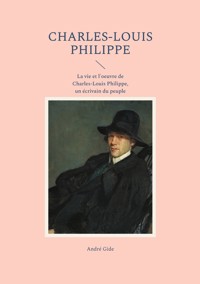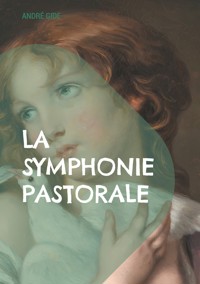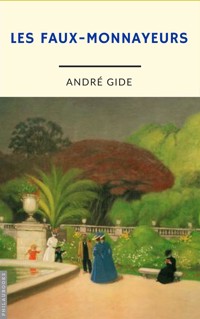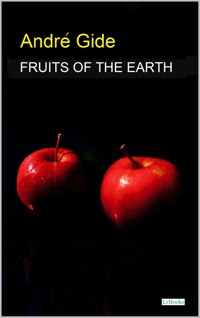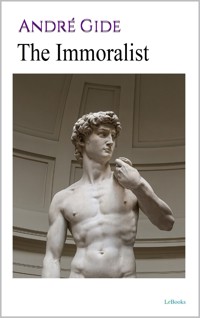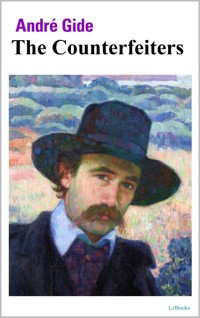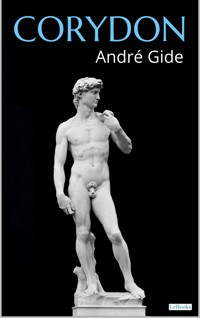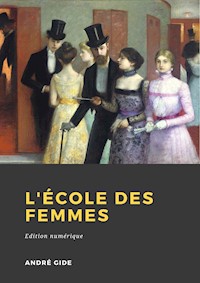
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Librofilio
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
L'École des femmes est un roman d'André Gide publié en avril 1929 dans La Nouvelle Revue française des éditions Gallimard. Il constitue le premier tome d'un triptyque composé de Robert (1930) et Geneviève (1936), qui offrent des points de vue familiaux différents sur les mêmes événements. Le roman est présenté comme le journal intime d'Éveline X, envoyé à un éditeur (supposément André Gide) par sa fille, Geneviève, après la mort de sa mère des suites d'une épidémie lors de la Première Guerre mondiale où Éveline s'est enrôlée comme infirmière.
À PROPOS DE L'AUTEUR
André Gide (1869 - 1951) était un auteur français et lauréat du prix Nobel de littérature (en 1947). La carrière de Gide s'étend de ses débuts dans le mouvement symboliste à l'avènement de l'anticolonialisme entre les deux guerres mondiales. Auteur de plus de cinquante livres, au moment de sa mort sa nécrologie dans le New York Times le décrivait comme "le plus grand homme de lettres contemporain de France" et "jugé le plus grand écrivain français de ce siècle par les connaisseurs littéraires".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L'École des femmes
André Gide
– 1927 –
L’ÉCOLE DES FEMMES
À EDMOND JALOUX
en amical souvenir de nos conversations de 1896.
1er août 1928.
Monsieur,
Après bien des hésitations, je me décide à vous envoyer ces cahiers, copie dactylographiée du Journal que m’a laissé ma mère. Elle mourut le 12 octobre 1916 à l’hôpital X…, où depuis cinq mois elle donnait ses soins aux contagieux.
Je ne me suis permis d’y changer que les noms propres. Je vous laisse libre de publier ces pages si vous pensez que leur lecture puisse n’être pas sans profit pour quelques jeunes femmes. Dans ce cas, L’École des Femmes serait un titre qui me plairait assez, si vous n’estimez pas indécent de s’en servir après Molière. Il va sans dire que les mots « première partie, seconde partie, épilogue » sont rajoutés par moi.
Ne cherchez pas à me connaître et permettez-moi de ne pas signer cette lettre de mon vrai nom.
GENEVIÈVE D…
PREMIÈRE PARTIE
7 octobre 1894.
Mon ami,
Il me semble que c’est à toi que j’écris. Je n’ai jamais tenu de journal. Je n’ai même jamais rien su écrire que quelques lettres. Et je t’en écrirais sans doute si je ne te voyais pas tous les jours. Mais si je dois mourir la première (ce que je souhaite, car la vie sans toi ne me paraît plus qu’un désert), tu liras ces lignes ; il me semblera, te les laissant, te quitter un peu moins. Mais comment songer à la mort quand nous avons devant nous toute la vie ? Depuis que je te connais, c’est-à-dire depuis que je t’aime, la vie me paraît si belle, si utile, si précieuse que je n’en veux rien laisser perdre ; je sauverai dans ce cahier toutes les miettes de mon bonheur. Et que ferais-je chaque jour, après que tu m’as quittée, sinon revivre des instants écoulés trop vite, évoquer ta présence ? Avant de t’avoir rencontré je souffrais, je te l’ai dit, de sentir ma vie sans emploi. Rien ne me semblait plus vain que ces occupations mondaines où m’entraînaient mes parents et où je vois mes amies prendre tout leur plaisir. Une vie sans dévouement, sans but, ne pouvait pas me satisfaire. Tu sais que j’ai sérieusement songé à me faire garde-malades ou petite sœur des pauvres. Mes parents haussaient les épaules lorsque je leur parlais de cela. Ils avaient raison de penser que toutes ces velléités céderaient lorsque j’aurais rencontré celui dont mon âme pourrait s’éprendre. Pourquoi papa ne veut-il pas admettre aujourd’hui que celui-là, ce soit toi ? Tu vois comme j’écris mal. Cette phrase que j’écris en pleurant me semble affreuse. Aussi pourquoi l’ai-je relue ? Je ne sais si j’apprendrai jamais à bien écrire. En tout cas ce ne sera pas en m’appliquant.
Je disais donc qu’avant de t’avoir rencontré je cherchais un but à ma vie et maintenant tu es mon but, mon occupation, ma vie même et je ne cherche plus que toi. Je sais que c’est à travers toi, par toi, que je puis obtenir de moi le meilleur ; que tu dois me guider, me porter vers le beau, vers le bien, vers Dieu. Et je demande à Dieu de m’aider à vaincre la résistance de mon père ; et, comme pour la rendre plus efficace, j’écris ici ma fervente prière : Mon Dieu, ne me forcez pas à désobéir à papa. Vous savez que c’est Robert que j’aime, et que je ne pourrai jamais être qu’à lui.
À vrai dire, ce n’est que depuis hier que je comprends quel peut être le but de ma vie. Oui, ce n’est que depuis cette conversation, dans le jardin des Tuileries, où il m’a ouvert les yeux sur le rôle de la femme dans la vie des grands hommes. Je suis si ignorante que j’ai malheureusement oublié les exemples qu’il m’a donnés ; mais j’ai du moins retenu ceci : c’est que ma vie entière doit être désormais consacrée à lui permettre d’accomplir sa glorieuse destinée. Naturellement ce n’est pas là ce qu’il m’a dit, car il est modeste ; mais c’est ce que j’ai pensé, car je suis orgueilleuse pour lui. Je crois du reste que, malgré sa modestie, il a une conscience très nette de sa valeur. Il ne m’a pas caché qu’il était très ambitieux.
– Ce n’est pas que je tienne à parvenir, – m’a-t-il dit avec un sourire charmant ; – mais je tiens à faire réussir les idées que je représente.
J’aurais voulu que mon père pût l’entendre. Mais papa est si buté à l’égard de Robert qu’il aurait pu voir là ce qu’il appelle de… Non ! je ne veux pas même l’écrire. Comment ne comprend-il pas que par de telles paroles ce n’est pas à Robert qu’il fait du tort mais à lui ? Ce que j’aime en Robert précisément, c’est qu’il n’ait pas de complaisance envers lui-même, qu’il ne perde jamais de vue ce qu’il se doit. Près de lui il me semble que tous les autres ignorent ce que l’on peut vraiment appeler : dignité. Il ne tiendrait qu’à lui de m’en écraser mais, lorsque nous sommes seuls, il a souci de ne me la faire jamais sentir. Même je trouve que parfois il exagère un peu lorsque, par crainte que je ne me sente trop petite fille auprès de lui, il s’amuse à faire lui-même l’enfant. Comme je le lui reprochais hier, il a pris soudain un air très grave et a murmuré avec une sorte de nostalgie ravissante :
– L’homme n’est qu’un enfant vieilli, – en reposant sa tête sur mes genoux car il s’était assis à mes pieds.
Il serait vraiment lamentable que tant de mots charmants, si profonds parfois, si chargés de sens, soient perdus. Je me promets d’en noter ici le plus grand nombre possible. Il aura plaisir à les retrouver plus tard, j’en suis sûre.
C’est tout de suite après que nous avons eu l’idée du journal. Et je ne sais pourquoi je dis : nous. Cette idée, comme toutes les bonnes, c’est lui qui l’a eue. Bref, nous nous sommes promis d’écrire tous deux, c’est-à-dire chacun de notre côté, ce qu’il a appelé : notre histoire. Pour moi c’est facile car je n’existe que par lui. Mais quant à lui, je doute qu’il y parvienne, lors même que le temps ne lui manquerait pas. Et même je trouverais mauvais d’occuper par trop sa pensée. Je lui ai longuement dit que je comprenais qu’il avait sa carrière, sa pensée, sa vie publique, que ne devait pas se permettre d’encombrer mon amour ; et que, s’il devait être toute ma vie, je ne pouvais pas, je ne devais pas être toute la sienne. Je serais curieuse de savoir ce qu’il a noté de tout cela dans son journal ; mais nous avons fait un grand serment de ne pas nous le montrer l’un à l’autre.
– C’est à ce prix seulement qu’il peut être sincère, – m’a-t-il dit en m’embrassant, non pas sur le front mais exactement entre les yeux, comme il fait volontiers.
Par contre, nous sommes convenus que celui de nous deux qui mourrait le premier léguerait son journal à l’autre.
– C’est assez naturel, – ai-je dit un peu sottement.
– Non, non, – a-t-il repris sur un ton très grave. – Ce qu’il faut se promettre c’est de ne pas le détruire.
Tu souriais quand je disais que je ne saurais pas quoi y mettre, dans ce journal. Et en effet voici que j’en ai déjà rempli quatre pages. J’ai bien du mal à me retenir de les relire ; mais, si je les relisais, j’aurais plus de mal encore à me retenir de les déchirer. Ce qui m’étonne, c’est le plaisir que déjà je commence à y prendre.
12 octobre 1894.
Robert a été brusquement appelé à Perpignan auprès de sa mère dont il a reçu d’assez mauvaises nouvelles.
– J’espère que cela ne sera rien, – lui ai-je dit.
– On dit toujours cela, – a-t-il répliqué avec un grave sourire qui laissait voir combien au fond il était préoccupé. Et je m’en suis voulu tout aussitôt de ma phrase absurde.
S’il fallait enlever de ma vie tous les gestes, de ma conversation toutes les phrases, que je dis et que je fais par banalité, que resterait-il ? Et dire qu’il a fallu le contact d’un homme supérieur pour me faire m’en apercevoir ! Ce que j’admire en Robert, c’est précisément qu’il ne dit rien et ne fait rien comme n’importe qui ; et, avec cela, rien en lui de prétentieux, de recherché. J’ai longtemps cherché le mot qui convenait pour caractériser son aspect, ses vêtements, ses propos, ses gestes ; « original » est trop marqué ; « particulier »… « spécial »… Non ; c’est au mot « distingué » que je reviens ; et je voudrais qu’on n’eût employé ce mot pour nul autre. Cette extraordinaire distinction de tout son être et de ses manières, je pense qu’il ne la doit qu’à lui-même, car il m’a laissé entendre que sa famille était assez vulgaire. Il dit qu’il ne rougit pas de ses parents : mais ceci même laisse entendre qu’une nature moins droite et moins noble pourrait en rougir. Son père était, je crois, dans le commerce. Robert était très jeune encore quand il l’a perdu. Il n’en parle pas volontiers et je n’ose l’interroger. Je crois qu’il aime beaucoup sa mère.
– C’est d’elle seule que vous auriez raison d’être jalouse, m’a-t-il dit lorsque nous ne nous tutoyions pas encore. Il avait une sœur plus jeune que lui, qui est morte.
Je veux profiter de son absence et du temps qu’elle me laisse, pour conter ici comment nous nous sommes connus. Maman voulait m’entraîner chez les Darblez qui donnent un thé où l’on doit entendre un violoncelliste hongrois extrêmement remarquable, paraît-il ; mais j’ai prétexté une violente migraine pour qu’on me laisse tranquille et seule… avec Robert. Je ne comprends plus comment j’ai pu me laisser prendre si longtemps aux « plaisirs du monde », ou plutôt je ne comprends que trop que ce que j’en aimais c’était ce qui flattait ma vanité. À présent que je ne cherche plus que l’approbation de Robert, peu m’importe de plaire aux autres, ou c’est à cause de lui et pour le plaisir que je vois bien qu’il en éprouve. Mais, en ce temps si proche et qui me paraît déjà si lointain, quel prix n’attachais-je pas aux sourires, aux approbations, aux éloges, à l’envie même et à la jalousie de quelques compagnes après que, sur un second piano, j’eus (et assez brillamment, j’en conviens) tenu la partie de l’orchestre dans le cinquième concerto de Beethoven tandis que Rosita exécutait le solo ! Je faisais la modeste, mais combien j’étais flattée de recevoir plus de félicitations qu’elle ! « Rosita, ça n’a rien d’étonnant ; c’est une professionnelle ; mais Éveline… » Ceux qui applaudissaient le plus étaient des gens qui n’entendaient rien à la musique. Je le savais, mais acceptais leurs louanges dont j’aurais dû sourire… Je pensais même : « Après tout, ils ont plus de goût que je ne croyais. » C’est ainsi que je me prêtais à cette parade absurde… Si ; je vois bien l’amusement qu’on y peut prendre : c’est celui de la moquerie. Mais, dans une société, c’est toujours moi qui me parais le plus ridicule. Je sais que je ne suis ni très jolie ni très spirituelle, et ne comprends pas bien ce que Robert a pu trouver en moi qui méritât qu’il s’en éprenne. Je n’avais pour briller dans le monde d’autre ressource que mon passable talent de pianiste, et, depuis quelques jours, j’ai abandonné le piano, définitivement sans doute. À quoi bon ? Robert n’aime pas la musique. C’est le seul défaut que je lui connaisse. Mais, par contre, il s’intéresse si intelligemment à la peinture que je m’étonne qu’il n’en fasse pas lui-même. Comme je le lui disais, il a souri et m’a expliqué que lorsqu’on était « affligé » (c’est le terme dont il s’est servi) de dons trop divers, la grande difficulté était de ne pas accorder trop d’importance à ceux de ses dons qui méritaient le moins d’en avoir. Pour s’occuper vraiment de la peinture, il aurait dû sacrifier trop d’autres choses, et ce n’est pas en peignant, m’a-t-il dit, qu’il estimait pouvoir rendre le plus de services. Je crois qu’il veut faire de la politique, mais il ne me l’a pas dit expressément. Du reste, quoi que ce soit qu’il entreprenne, je suis certaine qu’il réussira. Et même ce qui pourrait m’attrister un peu, c’est de sentir qu’il a si peu besoin de mon aide pour réussir n’importe quoi. Mais il est si bon qu’il feint de ne pouvoir se passer de moi, et ce jeu m’est si doux que je m’y prête sans y croire.
Je me laisse entraîner à parler de moi, ce que je m’étais pourtant promis de ne pas faire. Combien l’abbé Bredel avait raison de nous mettre en garde contre les pièges de l’égoïsme qui sait prendre parfois, nous disait-il, le masque du dévouement et de l’amour. On aime à se dévouer, pour le plaisir de penser que l’on est utile, et l’on aime à l’entendre dire. Le parfait dévouement est celui qui ne serait connu que de Dieu et qui n’attendrait que de Lui le regard et la récompense. Mais je crois que rien n’enseigne mieux la modestie, que d’aimer quelqu’un de valeur. C’est auprès de Robert que je comprends le mieux ce qui me manque, et, le peu que je suis, je voudrais l’ajouter à lui… Mais j’étais partie pour raconter le début de notre histoire ; et d’abord, comment nous nous sommes rencontrés.