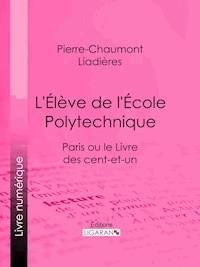
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Si, après avoir visité le Panthéon et le chef-d'oeuvre qui en décore le dôme, vous descendez de ces régions aériennes vers le quartier fangeux de la place Maubert, arrêtez-vous un moment au coin de la rue Mouffetard, dont une partie s'enorgueillit aujourd'hui du nom de Descartes : quelques bâtiments de modeste apparence entourent une cour assez spacieuse..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 38
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Paris, ou le Livre des Cent-et-Un publié en quinze volumes chez Ladvocat de 1831 à 1834, constitue une des premières initiatives éditoriales majeures de la « littérature panoramique », selon l’expression du philosophe Walter Benjamin, très en vogue au XIXe siècle. Cent un contributeurs, célèbres pour certains, moins connus pour d’autres, appartenant tous au paysage littéraire et mondain de l’époque, ont écrit ces textes pour venir en aide à leur éditeur qui faisait face à d'importantes difficultés financières… Ainsi ont-ils constitué une fresque unique qui offre un véritable « Paris kaléidoscopique ».
Le présent ouvrage a été sélectionné parmi les textes publiés dans Paris ou le Livre des Cent-et-Un. De nombreux titres de cette fresque sont disponibles auprès de la majorité des librairies en ligne.
Si, après avoir visité Le Panthéon et le chef-d’œuvre qui en décore le dôme, vous descendez de ces régions aériennes vers le quartier fangeux de la place Maubert, arrêtez-vous un moment au coin de la rue Mouffetard, dont une partie s’enorgueillit aujourd’hui du nom de Descartes : quelques bâtiments de modeste apparence entourent une cour assez spacieuse. Celui qui s’élève en face de vous se distingue par une architecture moderne, deux paratonnerres et un cadran de Lepaute. Depuis le commencement du dix-neuvième siècle, les sciences, le désintéressement, le patriotisme y ont fixé leur séjour : c’est l’École polytechnique.
L’origine de cette école, destinée à une si immense célébrité, remonte aux temps les plus orageux de notre première révolution. Lamblardie, directeur des ponts-et-chaussées, en conçut la première idée en 1793 ; Monge l’accueillit en homme qui devinait son avenir, et en hâta l’exécution avec ce zèle persévérant qui fut une de ses vertus. Deux membres du comité de salut public se rencontrèrent aussi qui, doués d’une merveilleuse aptitude à pressentir les grands résultats, et du vif désir de les faire éclore, comprirent, comme l’illustre Monge, combien était vaste et féconde la pensée de Lamblardie. Leur influence, au sein de la Convention nationale, fit le reste. C’étaient Carnot et Prieur de la Côte-d’Or. Ce dernier se signala surtout dans les luttes actives qu’il fallut soutenir pour sauver une institution que sa célébrité rendit redoutable dès sa naissance ; aussi le nom de Prieur doit-il briller au premier rang parmi ceux de ses fondateurs.
Instituée le 7 vendémiaire an III, sous le nom d’École des travaux publics, l’École polytechnique ne dut celui qui est devenu si populaire à tant de titres, qu’à une loi du 15 fructidor de la même année. Lamblardie en fut le premier directeur. Les hommes les plus illustres dans les sciences physiques et mathématiques se firent gloire d’initier à leurs savantes recherches des élèves dignes de les entendre. On est dispensé d’éloges quand on peut citer des noms tels que ceux de Lagrange, de Monge, de Berthollet, de Fourcroy, de Laplace, de Chaptal, de Guyton-Morveau, de Vauquelin, de Fourier et de Prony.
L’ouverture des cours eut lieu le 1er nivôse an III, au Palais-Bourbon. Ce fut dans ce local qu’on installa l’École polytechnique jusqu’au 11 novembre 1805, époque de sa translation au Collège de Navarre. Les élèves étaient logés en ville chez des personnes désignées par le directeur et chargées de surveiller leur conduite. Dès le premier jour se manifesta parmi eux cet amour de vérité, de justice et de sage indépendance qui, se transmettant de promotion en promotion, les rendit suspects à toutes les susceptibilités qui, jusqu’en 1830, ont traversé le pouvoir. La Convention qui tremblait devant son ouvrage, et n’osait avouer ses terreurs, voulut dissoudre l’école sous prétexte d’économie ; le faible Directoire l’accusa d’aristocratie ; Napoléon de républicanisme ; la Restauration d’impérialisme. J’ignore si des évènements récents ont fait peser sur elle quelques soupçons éphémères ; mais placé par mon âge au milieu, de la chaîne qui unit les plus anciens élèves aux plus modernes, touchant d’une main les hommes de l’école républicaine, et de l’autre les jeunes gens de l’école de juillet, participant ainsi de leurs pensées communes, j’atteste qu’aujourd’hui comme autrefois il n’existe dans l’esprit des élèves d’autre opposition que celle qui résulte de la nature même de leurs études, études, rigoureuses, inflexibles, qui ne souffrent pas que les corollaires démentent les principes, et qui, dans la marche d’un système, ne tiennent point assez compte des frottements qui l’entravent.





























