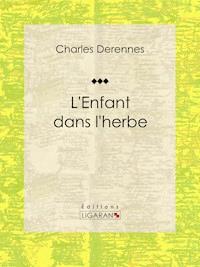
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "C'est une erreur à la fois kantienne et romantique, de nous croire, chacun de nous, divisés en trois : passé, présent, avenir. Bref, un seul homme en divers personnages. Nous vivons selon beaucoup plus de catégories et sur beaucoup plus de dimensions ou de plans que nous ne le croyons à l'ordinaire. Ce sont là des notions dès à présent tangibles et qui provoqueront prochainement un nouvel ordre de lumières dans le monde de la Pensée."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335077292
©Ligaran 2015
À MADAME GUSTAVE DERENNES
Ou plutôt à toi, maman,
Ton petit Charles, – ce vieux Charles !
C’est une erreur à la fois kantienne et romantique, de nous croire, chacun de nous, divisés en trois : passé, présent, avenir. Bref, un seul homme en divers personnages. Nous vivons selon beaucoup plus de catégories et sur beaucoup plus de dimensions ou de plans que nous ne le croyons à l’ordinaire. Ce sont là des notions dès à présent tangibles et qui provoqueront prochainement un nouvel ordre de lumières dans le monde de la Pensée.
L’Avenir, l’Avenir, mystère !… Voilà ce que nous a conté le plus effarant inventeur de mots qui ait grondé dans la Jungle intellectuelle de cette boule. Grondé ? Non. Jacassé. En dehors de Booz endormi et de la Tristesse d’Olympio, il est le primaire, le primate et le Bandar-Log. Et qu’on veuille bien prendre en considération que je l’admire littérairement, et que je répète ici que c’est une faiblesse de n’avoir pas conscience de sa grandeur ! Mais l’avenir ne saurait passer à mes yeux pour un mystère, et tout est là de ce que je lui reproche au début de ce livre de bonne foi.
L’Avenir est déjà en nous ; il est en nous comme le Hasard, naguère somptueusement expliqué par Maeterlinck. Nous sommes nos auteurs, nos créateurs à chaque division infinitésimale de seconde, à chaque caresse d’un atome du temps. Le présent n’est qu’un Dieu toujours prêt à mourir. Notre avenir est un capital sûr et sans mystère. C’est bien plutôt le passé qui nous échappe, alors que pour vraiment vivre, il le faudrait posséder tout entier.
Au fond, nous ne savons guère, pour la plupart, quand nous sommes nés. En tout cas, nous ne sommes nés que quelques mois après notre inscription aux registres civils, et la plaisanterie ou la parade dont nous sommes les meneurs de jeu ne commence que lorsque notre mémoire s’est décidée à frapper les trois coups.
Cette régisseuse a le bras plus long que nous ne le supposons en général. Autant mon adolescence, qui n’eut pourtant rien d’inquiet, me demeure aujourd’hui obscure, autant mon enfance m’est lumineuse. Je sais que je suis né et que j’ai poussé dans l’herbe ; c’est une bien réconfortante certitude ; c’est en moi un palais intérieur, aux assises délicieuses et magnifiques, et que j’essaie pieusement de rebâtir, à présent que j’ai dépassé le milieu du chemin. Mon avenir est sûr, puisque je sais que ce sera là mon œuvre de tous les instants. Œuvre dont mon présent s’honore. Il faut à chaque seconde nous rebâtir nous-mêmes. C’est un secret d’immortalité. La besogne est difficile. Mais Dieu n’a pas invité tout le monde à tenter d’être à son image et de se hausser à son niveau.
Dans le trésor qui s’efforce à chaque instant de nous fuir, parmi les matériaux de la réédification voulue et nécessaire, il faut d’abord distinguer les souvenirs réels, directs, et les souvenirs provoqués, reconstitués, – ou rêvés. La régisseuse a le bras long, ai-je dit. Je suis sûr de posséder directement un souvenir datant de douze mois après mon inscription aux registres. J’ai conté cela dans Vie de Grillon. Je marchais déjà tout seul, des canards me firent peur dans l’herbe d’une prairie riveraine de la Garonne – je les vois comme si j’y étais encore ! – et ils furent cause que, étant tombé de terreur le derrière dans l’herbe, je ne consentis à me resservir utilement de mes jambes que quelques trois mois plus tard.
Je les revois ! Ils étaient terribles et formidablement lustrés ; ils parlaient un langage tout à fait différent de celui de mon père, de ma mère, et de ma bonne, Julie, laquelle d’ailleurs – c’est une justice à lui rendre – n’a jamais parlé et ne parlera jamais que le gascon. Elle est dans la voie de la vérité. Je les revois, ces monstres ! Ils devaient être à peu près de ma taille, que dis-je ? Ils me dominaient de leur bec couleur de hampe de maïs dépanouillée, de leur poitrine raide comme une armure, de leur langage mystérieux, – et de leur effroi.
C’est là que je suis né véritablement, un an après que l’indique mon livret militaire. Et le derrière dans l’herbe. Je n’ai donc pas encore tout à fait quarante ans, en réalité…
Le derrière dans l’herbe. Nature, je ne suis pas romantique et je m’en veux un peu de vous parler ici au vocatif… Je m’en excuse, à l’occasion d’une commémoration exceptionnelle de ma venue réelle en ce monde. Pour le reste, contrairement à ce que fit ce jacques de Jean-Jacques, je ne vous aime que dans la mesure où vous me chérissez ; ne vous vexez pas, c’est toujours de la sorte que je me suis comporté avec les femmes, qui sont belles, inconscientes, animales et divines comme vous.
Vous m’avez à ma naissance accueilli dans votre herbe. J’y suis resté longtemps. J’y reviens pour toujours.
À peine est-on né à la vie qu’il faut se mettre à l’apprentissage du rêve. Les songes qui visitent les enfants endormis, et même éveillés parfois, sont prodigieux. Ils se mêlent aux souvenirs directs, comme aussi font les histoires de maman, et de Julie, ma bonne. Mais il ne faut sous aucun prétexte accueillir ces mensongers et fictifs visiteurs avec méfiance. Ou alors, il n’y aurait plus de place pour la poésie et la musique dans ce que nous appelons la vie. Lors de la réédification voulue et nécessaire, ils seront les objets d’art, les chansons et les belles musiques du palais réel, et ses parfums, et les caressés dignes d’enchanter le propriétaire, le seigneur, le maître.
Nous ne faisons pas assez de cas du rêve, je parle du rêve au sens physique et strict, et non pas romantique de ce beau mot.
Nous oublions qu’il est à peu près la moitié de notre vie, et qu’il y aurait bien peu de chemin à parcourir pour en arriver à ne le plus très bien distinguer de ce que nous appelons le vrai. Freud, à ce propos, a ouvert une porte, mais la porte étroite, utilitaire, un peu moins praticable, et comme médicamentaire. Toute une psychologie neuve, étonnamment vierge, serait pourtant à fonder sur l’étude de cet ordre de phénomènes qui constituent une imposante part de notre vérité. Psychologie qui tiendrait compte de l’ensemble de ce que nous sommes, psychologie libérée des catégories kantiennes de l’entendement, ces béquilles pour esprit faibles.
Car il n’y a dans le rêve ni temps ni espace. Cela est un fait d’expérience. La couronne d’un ciel de lit tombe sur le crâne de Maury, et c’en est assez pour que ce psychiatre imagine, avant de s’éveiller, tout un épisode révolutionnaire, avec ascension de l’échafaud à la clef, qui durerait bien cinq actes et même, moralement, vingt-quatre heures, si quelque égaré s’avisait de l’utiliser pour un drame en vers. Quand je vois une horloge ou un réveil dans mes songes, l’aiguille tourne follement ou demeure sereinement immobile, personne avisée et qui sait bien qu’elle n’a rien à faire en pareil lieu. Le pauvre cher Proust pourrait aller rechercher ailleurs le temps perdu, qu’il a maintenant retrouvé ; et, pas plus que la mesure du temps, n’existe ici celle de l’espace. Toute notion de géographie et de locomotion s’abolit. Maintes fois m’advient-il de nommer dans mon sommeil des noms de villes réelles, chéries et connues, et ce sont pourtant d’autres villes, d’autres spectacles, et j’y vais sans utiliser express, auto ou avion.
En rêve encore, nous possédons maintes fois, existant alors à un nombre probablement infini de dimensions, la suzeraineté de cette dimension profondeur où aspira malencontreusement Icare, mais que les seuls plongeurs pouvaient s’enorgueillir d’utiliser, avant que nous fussions parvenus à nous offrir des ailes artificielles, aussi infirmes en cela que ma sœur la Chauve-Souris. En rêve, nous possédons couramment le don de lévitation, la science de nous mouvoir dans la dimension profondeur sans ailes artificielles ou autres, de voler avec nos pieds. Sigmund Freud attribue aux rêves de ce genre un caractère de refoulement érotique. Si cela lui fait plaisir, je n’y vois pas le moindre inconvénient : poète à sa façon, il se sera souvenu sans doute que l’Enfant Amour avait des ailes. M. Bergson a une interprétation plus objective du don de la lévitation en rêve : le dormeur croit voler parce que ses pieds ne touchent pas le bois du lit, objet solide. C’est franc, c’est loyal, c’est français ; c’est d’un admirable esprit accoutumé à secouer l’oppressant fardeau des brumes germaniques.
Il n’y a qu’un malheur : c’est que le dormeur, de la plante de ses pieds, quand il ne touche pas le bois de sa couche, touche néanmoins ses draps, lesquels représentent un corps solide, eux aussi.
Rêves bien-aimés, épris si volontiers des têtes enfantines, laissez-moi me méfier un instant de vous, et aussi des évocations « parasites » qu’ont pu me fournir par la suite les souvenirs de maman et de Julie me parlant à moi-même de moi. Le souvenir qui suit celui des canards dans la dimension temps, je suis sûr qu’il n’a été vécu qu’en dehors de toute dimension ; je suis sûr de n’être jamais allé à Clairac avant l’âge de dix ou douze ans, et pourtant je m’y vois, à une distance que je situe à trente-sept ans d’ici, assis dans l’herbe avec mes parents et des amis, – au bord du Lot, cette fois. On goûte. C’est : l’été. Toutes les flatteries de ma rivière natale, ses nymphes, dont la plus belle est Divone, me les dispensent ; j’ai les yeux agacés d’un fracas miroitant de soleil et d’eau, la caresse râpeuse à mai langue d’un goût vanillé de confitures de prunes et celle, plus lisse et bocagère d’une peau de brugnon, sœur de mes lèvres d’alors. Mille autres détails aussi précis s’imposent, durant qu’il écrit, au commencement de vieil homme que je suis, frère indigne du petit Charles, légitimement martyrisé par lui-même, et qui porte des yeux brûlés de toutes les étoiles et de toutes lampes qu’il n’a pu jamais se guérir d’allumer en lui. Mille détails. La cloche de l’église, le sifflet du train Bordeaux-Cette, vers Tonneins… Et ce petit goût de la fleur de trèfle incarnat, qu’on trouve bon d’ajouter à la couleur du temps, même après la fraîcheur lisse du brugnon et la mélodie vanillée de la confiture de prunes.
Or, tout cela est faux selon les hommes, la vie et la Déesse nue qui s’accoude à la margelle du puits vénérable. C’est un rêve que j’ai fait, entre tant d’autres, dans le lit de noyer, raccourci à mon usage, où j’ai grandi et où je compte bien mourir. Un rêve entre tant d’autres plus réels que le réel ; entre tous ceux où les villes étaient des fleurs de papier peint ou des nymphéas aux feuilles de marbre, hautement ou largement posées sur des océans d’hydrargyre et d’azur ; entre tous ceux où les joues des petites filles faisaient rager mes lèvres, étant moins lisses qu’elles ; entre tous ceux où Peau-d’Âne me racontait son histoire, pour mon plaisir à jamais renouvelé ; où j’allais et venais de Clarecrose à Jolibeau, où Noctu tombait toute tiède du ciel dans ma main, les alouettes rôties dans ma bouche.
Je n’ai pas changé.
Mais il s’agit de réédifier. Laissons les bords du Lot pour ceux de la Garonne, le paysage du rêve pour celui où, douze mois plus tôt, commença la vie. La prairie en est à son juin et tout le concert des graminées y fait ondoyer ses violons et ses cors. Nous sommes en Aquitaine, mais la Gascogne est en face, sur la rive gauche, et l’on y appelle une femme hemm au lieu de femna ; les choses et les gens s’y assourdissent comme les voyelles ; on commence à parler bas ; on sait que lorsque l’on raconte des histoires d’un canal traversant une ample rivière sur un pont, ce n’est plus une blague, comme il faudrait prendre la chose à Marseille.
Il y a des êtres monstrueux, qui seront si bons, plus tard, accommodés à la rouennaise, un gosse assis raide, le derrière dans l’herbe, les menottes crispées au foin mûrissant par lequel il est hautement dépassé, contre la pile du pont qui sert à charrier de l’eau, sans galéjade, en face de peupliers qui ressemblent, étant douze, à douze points d’exclamation imprimés en plein ciel.
– Ça y est, il a encore attrapé des taches de « vert » sur son pantalon de coutil blanc. Toujours à se traîner dans l’herbe !
Ainsi parlait Julie. Ma mère soupirait :
– Des taches qui ne « sautent » pas, quand c’est du coutil blanc !
Après tout, comme les taches de vert ne « sautent » pas, c’étaient peut-être les mêmes, une fois de plus, et tout simplement agrémentées de quelques petites sœurs. Alors, pour me punir, on m’obligeait à manger, ce dont j’avais horreur. Ça m’a passé. Julie m’asseyait de force sur le banc du jardin de Jolibeau, ou encore, de préférence, sur une des trois marches du seuil, et elle tentait d’introduire dans ma bouche les seuls mets qu’il me fût, à l’époque, possible d’accepter : un petit pigeon… ou un petit « farci »… Et même fallait-il qu’elle me contât l’histoire du mariage de la Flûte et du Tambour, ou une autre plus belle encore, sans quoi je n’aurais pas marché. Marcher, en l’occasion, il faut le traduire par ouvrir la bouche ; c’était l’admiration qui me le faisait faire à l’insu de moi. Avec mon sale caractère… C’est que je me connais !
La Flûte méritait son nom, car elle ressemblait dans mon esprit à la fille aînée d’un épicier de ma rue natale, installé à l’endroit où on la quitte pour la route qui mène vers Peyragude-de-Penne, en qui tous les beaux âges du monde communient et se rejoignent, où la Vierge miraculeuse et chrétienne apparaît à ses fidèles sous l’espèce d’une statue de jeune femme tenant entre ses bras un enfançon ailé.
Le Tambour était plus difficile à identifier ou à situer. Il manquait de sonorité, j’entends par là que je ne lui devinais pas de visage. Quand je connus de vue le félibre Victor Delbergé, cela s’arrangea. J’en fus bien content. J’ai toujours aimé à mettre de l’ordre dans mes idées, à coller mes images sur des albums nets.
Après cinq heures, lorsque l’on a mangé presque malgré soi du pigeon ou du farci, et que l’on a un peu moins de quatre ans, c’est déjà, même en été, la nuit qui tombe. Les chauves-souris en sont les premières gouttes… Les premières étoiles ? Les yeux des chats. L’herbe affecte des colorations voluptueusement fantaisistes ; on éprouve alors que le rouge est le complémentaire du vert ; mon pantalon de coutil blanc ressemblait à un linge près duquel aurait saigné, en le frôlant, un lapin fraîchement sacrifié, et dont le cadavre m’eût amusé un instant. J’en avais honte, de mon vert, à présent que j’avais mangé !… Honte au point d’en pleurer (si j’en avais subi l’envie) des larmes de sang, en lieu et place de mes ordinaires larmes, que je ne galvaudais pas, mais qui étaient vertes et sucrées au soleil, un peu comme l’herbe, – dans le temps dont ici je parle.
Car, maintenant, quand il m’en arrive, des larmes, elles sont amères, couleur de bitume et piquent aux yeux.
– Ça, c’est quoi, Julie ?
– C’est des bêtes qui mènent leur sabbat.
– Elles sont filles de la Flûte et du Tambour ?
– Ma parole (et Dieu m’en excuse !) ce drôle est en train de tourner à l’innocent !
Ce fut l’indignation, cette fois, qui me fit tomber, le derrière dans le gazon ras, devant la troisième marche du perron. La lune en son premier croissant, peu après, allait se montrer comme l’ongle neuvement coupé d’un individu, doigt qui m’eût signifié d’en haut : « Tu as raison. Ne te laisse pas faire, à la longue ! » Mais la lune n’était pas encore là. Ou si pâle qu’il ne vaut pas la peine d’en parler.
Les crapauds adolescents chantaient dans les bassins et les prises d’eau du laboratoire à légumes du vieux Pile. Le maître à danser des poules, notre autre voisin, entreprenait leur rééducation, encore, vaillamment, jusqu’au bout, bien qu’elles se fussent éveillées de bonne heure et montrassent le goût du sommeil ; il était sévère, il était impitoyable : on avait par instant l’impression désolante qu’il était bien capable d’arriver à ses fins avant de mourir. Chaque goutte égrenée et chue du bout de buis qu’animait sa bouche sans dent sembla se transformer soudain en une de ces bestioles rouges qui sortaient d’une fissure du perron ; ces bestioles, je croyais légitime, pour des raisons de moi seul connues et que je n’avais pas à dévoiler, de les considérer comme le produit de l’union du Tambour et de la Flûte.
Le gros vieux lézard du seuil, je l’appelais Filon et je lui jouais le vilain tour de le jeter de temps en temps dans le bassin, pour en faire momentanément une réduction de crocodile à la mesure de ma taille et de ma pensée ; il apparut au bord de son antre et me regarda d’un œil mauvais.





























