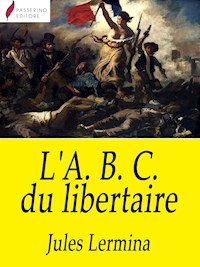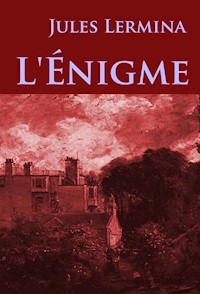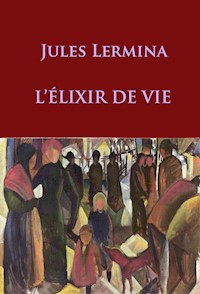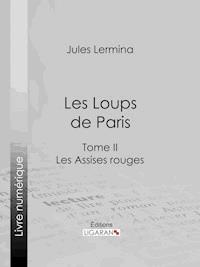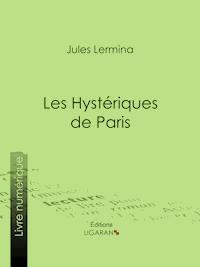Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : Dans "L'énigme", Jules Lermina nous plonge au coeur d'un mystère captivant, typique des premiers romans policiers français. L'intrigue se déroule dans un cadre urbain du XIXe siècle, où l'atmosphère est à la fois sombre et intrigante. Un crime énigmatique secoue la communauté locale, et le protagoniste, un détective perspicace, se lance dans une enquête complexe pour démêler les fils de cette affaire. À travers une série de rebondissements habilement orchestrés, Lermina explore les méandres de l'esprit humain et les motivations profondes qui poussent les individus à commettre l'irréparable. Le lecteur est invité à suivre les indices disséminés avec soin, tout en découvrant les secrets cachés derrière les façades respectables des personnages. L'auteur utilise un style narratif fluide et descriptif, rendant chaque scène vivante et palpable. Ce récit, bien qu'ancré dans son époque, soulève des questions intemporelles sur la justice, la moralité et la vérité. "L'énigme" se distingue par sa capacité à maintenir le suspense jusqu'à la dernière page, offrant une expérience de lecture enrichissante et stimulante pour les amateurs de littérature policière. À travers cette oeuvre, Lermina démontre son talent pour le genre, posant les bases de nombreuses conventions du roman policier moderne. L'AUTEUR : Jules Lermina, né le 27 mars 1839 à Paris, est un écrivain prolifique dont les contributions ont marqué le paysage littéraire français. Bien qu'il ait débuté sa carrière dans le journalisme, Lermina s'est rapidement tourné vers la fiction, où il a trouvé sa véritable vocation. Ses oeuvres couvrent un large éventail de genres, mais il est surtout reconnu pour ses romans policiers et ses récits fantastiques. Lermina a su captiver ses lecteurs grâce à son habileté à créer des intrigues complexes et des personnages mémorables. Il a également écrit sous plusieurs pseudonymes, ce qui témoigne de sa créativité et de sa volonté d'explorer différents styles narratifs. Parmi ses oeuvres notables, on trouve "L'énigme" et "Le Fils de Monte-Cristo", qui illustrent son talent pour le suspense et l'aventure. Bien que moins connu que certains de ses contemporains, Lermina a néanmoins laissé une empreinte durable dans la littérature française, influençant de nombreux auteurs ultérieurs dans le genre du roman policier. Il est décédé le 23 juin 1915, laissant derrière lui un héritage littéraire riche et varié.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 80
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
I
Après avoir brillamment servi la France pendant de longues années, M. de Morlaines, général de brigade, avait pris sa retraite. C’était un homme de soixante ans, encore vert, doué d’une exquise distinction, rappelant le type de ces anciens gentilshommes dont la parole était sacrée, dont la délicatesse n’admettait ni faux-fuyants ni compromis quand il s’agissait de tenir un engagement.
M. de Morlaines était veuf. C’était même la perte de sa femme Hortense, née des Chaslets, qui l’avait engagé à renoncer à l’état militaire. Sa douloureuse tristesse s’accommodait mal de la vie active : il avait renoncé à toute ambition et était venu s’installer auprès de Paris, à Vitry, dans une petite propriété où il avait trouvé le repos dont il avait besoin, s’adonnant à des travaux de jardinage et satisfaisant des goûts qu’il n’avait pas perdus pendant sa longue carrière de soldat.
Son fils, Georges de Morlaines, âgé de vingt-cinq ans, avait été promu depuis peu, au grade de lieutenant de vaisseau et à l’époque où s’ouvre ce court récit, était engagé dans un grand voyage d’exploration.
Le général s’était trouvé seul, à un âge où plus que jamais l’homme a besoin de sentir auprès de lui une affection toujours en éveil. Le cœur refroidi, glacé par les regrets, éprouve de douloureuses angoisses, quand autour de lui tout est vide et silencieux. Auprès du général vivait une vieille gouvernante, veuve d’un ancien soldat, un peu rêche, un peu grondeuse, heureuse de la domination qu’il lui abandonnait et portant à M. de Morlaines, à son fils et surtout peut-être à la mémoire de la morte une profonde affection, plus instinctive d’ailleurs que raisonnée. Il est ainsi des dévouements quasi brutaux qui s’imposent avec une sorte de violence. Germaine était sans douceur. Les soins qu’elle rendait à son maître étaient pour elle l’exercice d’un droit. Il lui appartenait ; son affection était un joug qu’il lui était enjoint de supporter, si lourd que le fît la bonté massive de cette créature inintelligente. M. de Morlaines subissait d’ailleurs avec passivité cette obsession de complaisances inévitables, quand se produisit un événement qui devait changer singulièrement sa propre situation et celle de Germaine.
Une de ses parentes éloignées mourut ; dans une lettre, écrite au milieu des angoisses suprêmes, elle s’adressait à lui et le suppliait de recueillir auprès de lui sa fille, Marie Deltour, qui allait rester sans fortune et sans appui.
M. de Morlaines n’hésita pas. Sans consulter Germaine, – heureux peut-être d’agir d’après son initiative propre, il répondit aussitôt à la pauvre femme que sa fille était attendue. La diligence qu’il mit à cette bonne action en doubla le prix. Car Madame Deltour, avant de s’éteindre, eut l’ineffable satisfaction de savoir que le sort de sa fille bien-aimée était assuré.
Seulement, dans sa précipitation, le général ne s’était point enquis de ce qu’était celle qui allait venir sous son toit. Aussi fut-ce avec une profonde surprise et une sorte d’effroi que M. de Morlaines vit arriver aux Petites-Tuileries, comme il appelait sa propriété dans le pays, une femme aux allures distinguées, au visage frais et doux, Marie Deltour, en un mot, âgée de vingt-six ans à peine, et charmante sous ses vêtements de deuil.
Germaine, irritée tout d’abord de n’avoir point été appelée à donner son avis, voua à la nouvelle venue une de ces haines d’autant plus âpres que toutes les circonstances en démontrent plus évidemment l’injustice. Marie Deltour, intelligente et modeste à la fois, prouva, dès les premiers temps de son séjour aux Petites-Tuileries, combien elle était reconnaissante au général de la bienveillance qu’il lui témoignait. Elle se montra affable avec Germaine, respectueusement dévouée à M. de Morlaines qui se prit bientôt pour elle d’une affection croissant peut-être moins vite cependant que l’antipathie de Germaine pour « l’usurpatrice ».
Marie Deltour était blonde : ses traits fins, attristés par la douleur que lui avait causée la mort de sa mère, respiraient une placidité qui n’était point sans noblesse. Elle avait ce grand mérite d’être active sans brusquerie, toujours occupée sans excès de mouvement. À son arrivée, Germaine lui avait soudainement cédé sa place auprès du général, comme si c’eût été punir celui-ci de sa dissimulation que de le priver des soins ou plutôt des exigences de sa despotique gouvernante. Le général se sentit entouré d’une atmosphère toute nouvelle. Cette robuste nature, un peu sauvage, comme tout ce qui s’enveloppe forcément de la rudesse militaire, s’amollissait, se civilisait au contact de cette affabilité toujours égale, indulgente aux caprices et souriante aux colères involontaires. Et comme le cœur était jeune, comme il y avait déjà quatre ans que madame de Morlaines était morte, le général, un beau soir d’automne, alors que Marie soutenait résolument contre lui une lutte de trictrac, M. de Morlaines posa nettement son cornet sur la table, se renversa en arrière sur son fauteuil, joignit ses deux mains, croisa les doigts, fit craquer les jointures, brouma trois ou quatre fois, puis, devenant, ma foi, rouge jusqu’aux oreilles :
– Mademoiselle Marie, dit-il, voulez-vous que nous causions ?...
– Pourquoi non ? fit la jeune fille. Le trictrac vous fatigue ?
– Me fatiguer... moi !... mais sapr... ! je suis solide... me fatiguer ! par exemple.
Il paraît que cette hypothèse lui tenait fort à cœur en ce moment spécial, car il se leva brusquement et fit quelques pas, affirmant par le redressement de sa taille et la netteté du coup de jarret la vigueur qui lui restait...
– Je n’ai pas voulu vous blesser, dit Marie.
– Je le sais bien, chère enfant... n’êtes-vous pas la bonté vivante ?...
– Causons donc, puisque vous le voulez...
– Ah ! c’est vrai ! j’ai dit que nous allions causer... Eh bien !... Allons !
Il répéta plusieurs fois ce mot : Allons ! Mais il ne disait rien de plus. Marie le regardait en souriant, non sans quelque malice.
Mais l’homme qui avait galopé en plein feu ne pouvait hésiter plus longtemps ; il reprit :
– Pardonnez-moi cette question à brûle-pourpoint... mais comment se fait-il que, jeune et jolie et bonne comme vous l’êtes, vous ne songiez pas à vous marier ?
Marie baissa la tête et pâlit légèrement. Quand elle regarda de nouveau le général, il vit que ses yeux étaient humides.
– Je vais vous répondre, lui dit-elle de sa voix qui tremblait un peu. Aussi bien je ne sais pas mentir et je veux vous dire toute la vérité. J’ai aimé et j’ai été aimée une fois dans ma vie, j’avais vingt ans. Mais celui que j’avais choisi et en qui j’avais mis toute l’espérance de ma vie, m’a oubliée et en a épousé une autre...
– Ah ! c’est mal ! s’écria M. de Morlaines. C’est presque un crime...
– Il faut être indulgent, reprit plus doucement encore Marie Deltour dont le visage s’éclaira d’une expression de charité radieuse. J’étais pauvre... il était riche. Il était ambitieux, son intelligence lui donnait ce droit... son père combattit son penchant. Il résista longtemps, puis il comprit ou crut comprendre que nous n’étions pas nés l’un pour l’autre... Un jour, il m’a dit adieu en me suppliant de lui rendre ma parole, me déclarant, d’ailleurs, que si je l’exigeais, il tiendrait ses serments... Je mis ma main dans la sienne, et, le regardant bien en face, je lui dis : « Obéissez à votre père ! » Il partit, et je ne l’ai plus revu depuis...
M. de Morlaines mordait ses moustaches avec colère. Cette simplicité dans le sacrifice l’enthousiasmait et l’encolérait à la fois.
– Voici tout mon pauvre roman, reprit Marie. Je ne me marierai pas... ma résolution est prise... et bien prise, je vous assure.
Il y eut un moment de silence.
M. de Morlaines s’était assis de nouveau, enveloppant de son regard franc et honnête la tête charmante de cette enfant qui lui semblait héroïque... puis ses lèvres s’agitèrent, mais il n’en sortit aucun son.
Qu’avait-il donc à dire qui fût si pénible pour sa timidité ?... Quelques minutes se passèrent ainsi. Puis, comme prenant une résolution soudaine, M. de Morlaines plongea sa main dans sa poche, en tira son portefeuille qu’il ouvrit, y prit une lettre, et, la tendant toute dépliée à Marie Deltour :
– Lisez, je vous en prie... je n’ose parler... je suis un enfant !... mais promettez-moi de me répondre en toute franchise...
Marie était redevenue calme. De sa main passée sur son front elle avait écarté la douloureuse vision évoquée tout à l’heure. Elle prit la lettre...
– Si vous vouliez lire tout haut, dit le général, il me semble que j’aurais plus de courage...
Elle le regarda curieuse, un peu effrayée peut-être. Puis elle reporta ses yeux sur la lettre et se mit à lire.
« Mon cher et bien aimé père, était-il écrit, vous me comblez de joie en me consultant sur des projets qui sont pour vous d’un intérêt si grave et si touchant à la fois... vous pouviez agir sans me rien demander, et certes vous connaissez trop bien le respect et l’amour que je vous ai voués pour supposer que je ne me fusse pas incliné devant la décision prise. Mais puisque vous m’appelez à l’honneur de vous adresser mes humbles et affectueux avis, je vous répondrai avec toute la franchise que vous réclamez de moi...