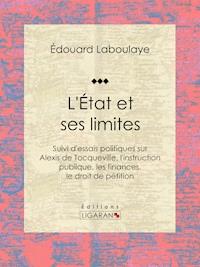
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Depuis que les méthodes d'observation ont renouvelé les sciences physiques, en montrant partout des lois générales qui règlent et expliquent l'infinie variété des phénomènes, il s'est fait une révolution de même ordre dans les études qui ont l'homme pour objet. Que se proposent aujourd'hui la philosophie de l'histoire, l'économie politique, la statistique, sinon de rechercher les lois naturelles et morales qui gouvernent les sociétés?"
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335049855
©Ligaran 2015
J’ai réuni dans ce volume un certain nombre d’études politiques qui, pour la plupart, ont un même objet : déterminer la sphère du pouvoir et celle de la liberté, montrer que l’État n’est bienfaisant que dans la limite de ses attributions légitimes, prouver qu’il ne peut pas remplacer l’activité de l’individu par le mécanisme d’une administration. S’il est une vérité méconnue en France, c’est celle-là ; Dieu sait si notre ignorance nous coûte cher ! Quand on observe la longue suite de nos révolutions depuis 1789, on voit que les partis divisés sur tout le reste sont toujours d’accord en un point ; ils regardent le pouvoir et la liberté comme deux ennemis irréconciliables qui se disputent l’humanité. Pour les libéraux de la vieille école, affaiblir le pouvoir, c’est fortifier la liberté ; pour les partisans de l’ordre à tout prix, écraser la liberté, c’est fortifier le pouvoir ; double et fatale illusion qui n’enfante que l’anarchie ou le despotisme.
Quand l’autorité est désarmée, la liberté dégénère en licence, et se perd par ses propres excès : « Ce que vous voulez faible à vous opprimer, dit justement Bossuet, devient impuissant à vous protéger. » Quand, au contraire, la liberté est sacrifiée, vous avez un pouvoir qui n’est ni soutenu, ni contenu ; c’est le règne de l’intrigue et de l’ambition. Ces systèmes absolus sont mauvais par cela même que chacun d’eux étouffe une des forces vives de la société.
Où donc est la conciliation du pouvoir et de la liberté ? Dans une juste vue des choses. Il faut en arriver à comprendre que l’autorité et la liberté ne sont pas deux puissances ennemies, faites pour s’entre-dévorer éternellement ; ce sont deux éléments distincts qui font partie d’un même organisme ; la liberté représente la vie individuelle ; l’État représente les intérêts communs de la société. Ce sont deux cercles d’action qui n’ont ni le même centre, ni la même circonférence ; ils se touchent en plus d’un point, ils ne doivent jamais se confondre.
Les intérêts que l’État est chargé de défendre ne s’étendent point à tout ; c’est ce que j’ai tâché de prouver dans l’étude sur l’État et ses limites ; j’ai montré en même temps que cette délimitation était aujourd’hui le grand problème de la science politique, et que tous les esprits éclairés en donnaient la même solution. À l’État les intérêts généraux ou politiques, la paix et la justice ; à l’association les intérêts sociaux, à l’individu le soin et la responsabilité de sa personne et de sa vie ; c’est par cette juste conception que les sociétés modernes diffèrent des sociétés antiques, qui, placées dans d’autres conditions, réduites au mur d’une cité, étrangères au christianisme, n’ont jamais eu le respect de l’individu.
On ne s’étonnera pas de trouver dans ce volume des études sur M. de Tocqueville et sur les États-Unis. De tous les publicistes français M. de Tocqueville est celui qui a le mieux senti que la faiblesse des sociétés modernes, c’est la centralisation ; que leur vraie force, c’est la liberté individuelle et l’association. Il est notre précurseur dans la voie féconde où s’engage la civilisation. Quant aux Américains, nos anciens et fidèles alliés, c’est le peuple qui a le mieux résolu les questions qui nous agitent. Depuis soixante-dix ans nous nous épuisons à conquérir la liberté ; depuis soixante-dix ans l’Amérique en vit ; c’est sa fortune et sa gloire. Les tristes convulsions de la guerre civile ont ébranlé des âmes faibles ; c’est la liberté qu’ils accusent de ce qui est le crime de l’esclavage ; pour nous, vieil ami de l’Amérique, ces épreuves si noblement affrontées n’ont fait que nous rendre plus chère la patrie de Washington ; tous nos vœux sont pour une Amérique grande, forte, unie et libre. Il nous la faut pour faire contrepoids à l’Angleterre, et maintenir l’indépendance des mers ; il nous la faut pour donner au monde l’exemple d’une démocratie riche, pacifique, morale et éclairée ; il nous la faut enfin pour qu’au milieu de tous nos orages il y ait au-delà de l’Océan un abri sûr où la liberté brille comme un phare inextinguible, et jette ses rayons sur le vieux continent.
Versailles, 1er août 1863.
Depuis que les méthodes d’observation ont renouvelé les sciences physiques, en montrant partout des lois générales qui règlent et expliquent l’infinie variété des phénomènes, il s’est fait une révolution de même ordre dans les études qui ont l’homme pour objet. Que se proposent aujourd’hui la philosophie de l’histoire, l’économie politique, la statistique, sinon de rechercher les lois naturelles et morales qui gouvernent les sociétés ? Entre l’homme et la nature il y a sans doute cette différence, que l’un est libre tandis que l’autre suit une course inflexible ; mais cette condition nouvelle complique le problème et ne le change pas. Quelle que soit la liberté de l’individu, quelque abus qu’il en fasse, on sent que Celui qui nous a créés a dû faire entrer ces diversités dans son plan ; le jeu même de la liberté est prévu et ordonné. En ce sens il est vrai de dire avec Fénelon que l’homme s’agite et que Dieu le mène. Nos vertus, nos erreurs, nos vices, nos malheurs même, tout en décidant de notre sort, n’en servent pas moins à l’accomplissement de la suprême volonté.
Découvrir ces lois qui régissent le monde moral, telle est l’œuvre que se propose le philosophe politique. Aujourd’hui on ne croit plus que Dieu, mêlé sans cesse à nos passions et à nos misères, soit toujours prêt à sortir du nuage, la foudre en main, pour venger l’innocence et châtier le crime. Nous avons de Dieu une idée plus haute ; Dieu choisit son heure et ses moyens, non pas les nôtre. Veut-il nous punir ou nous ramener, il lui suffit de nous livrer à notre propre cœur ; c’est de nos désordres mêmes que sort l’expiation.
Si on n’attend plus de la justice divine ces coups de théâtre qui dénouent le drame de façon terrible et soudaine, encore moins s’imagine-t-on qu’un grand homme paraisse subitement au milieu d’une société inerte, pour la pétrir à son gré, et l’animer de son souffle, ainsi qu’un autre Prométhée. Le génie a sa place dans l’histoire, et plus large qu’on ne la lui mesure de nos jours, mais le héros n’arrive qu’à son heure ; il faut que la scène lui soit préparée. À vrai dire, ce n’est qu’un acteur favori qui joue le premier rôle dans une pièce qu’il n’a pas faite. Pour que César soit possible, il faut que la plèbe romaine, avilie et corrompue, en soit tombée à demander un maître. À quoi bon la vertu de Washington, si ce grand homme de bien n’eût été compris et soutenu par un peuple amoureux de la liberté ?
On sent cela ; mais par malheur la science est nouvelle et mal établie. Rassembler les faits est une œuvre pénible et sans éclat ; il est plus aisé d’imaginer des systèmes, d’ériger un élément particulier en principe universel, et de rendre raison de tout par un mot. De là ces belles théories qui poussent et tombent en une saison : influence de la race ou du climat, loi de décadence, de retour, d’opposition, de progrès. Rien de plus ingénieux que les idées de Vico, de Herder, de Saint-Simon, de Hegel ; mais il est trop évident que, malgré des parties brillantes, ces constructions ambitieuses ne reposent sur rien. Au travers de ces forces fatales qui entraînent l’humanité vers une destinée qu’elle ne peut fuir, où placer la liberté ? Quelle part d’action et de responsabilité reste-t-il à l’individu ? On dépense beaucoup d’esprit pour tourner le problème au lieu de le résoudre ; mais qu’importent ces poétiques chimères ? la seule chose qui nous intéresse est la seule qu’on ne nous dise pas.
Si l’on veut écrire une philosophie de l’histoire que puisse avouer la science, il faut changer de méthode et revenir à l’observation. Il ne suffit pas d’étudier les évènements qui ne sont que des effets, il faut étudier les idées qui ont amené ces évènements, car ces idées sont les causes, et c’est là que paraît la liberté. Quand on aura dressé la généalogie des idées, quand on saura quelle éducation chaque siècle a reçue, comment il a corrigé et complété l’expérience des ancêtres, alors il sera possible de comprendre la course du passé, peut-être même de pressentir la marche de l’avenir.
Qu’on ne s’y trompe pas. La vie des sociétés, comme celle des individus, est toujours régie et déterminée par certaines opinions, par une certaine foi. Alors même que nous n’en avons pas conscience, nos actions les plus indifférentes ont un principe arrêté, un fondement solide. C’est ce qui explique l’universelle influence de la religion. Si l’on prend un homme au hasard, ce qui frappe à première vue, c’est son égoïsme et ses passions ; peut-être même en toute sa conduite n’aperçoit-on pas d’autre mobile ; si l’on prend toute une nation, on voit qu’au-dessous de ces passions individuelles qui se contrarient et se balancent, il y a un courant d’idées communes qui finit toujours par l’emporter. Ouvrez l’histoire ; il n’est pas un grand peuple qui n’ait été le porteur et le représentant d’une idée. La Grèce n’est-elle pas la patrie des arts et de la philosophie, Rome le modèle du gouvernement et de la politique, Israël l’expression du monothéisme le plus pur ? Aujourd’hui, qu’est-ce qui représente pour nous la science, n’est-ce pas l’Allemagne ? l’unité, n’est-ce pas la France ? la liberté politique, n’est-ce pas l’Angleterre ? Voilà une de ces vérités évidentes qui s’imposent à la science, et qu’il lui faut examiner.
Faire l’histoire des idées, en suivre pas à pas la naissance, le développement, la chute ou la transformation, c’est aujourd’hui l’étude la plus nécessaire, celle qui chassera de l’histoire ce nom de hasard qui n’est que l’excuse de notre ignorance. Ainsi observées, la religion, la politique, la science, les lettres, les arts ne sent plus quelque chose d’extérieur, l’objet d’une noble curiosité, c’est une part de nous-mêmes, un élément de notre vie morale. Cet élément, nous l’avons reçu de nos pères comme le sang qu’ils nous ont donné ; le rejeter est impossible ; le modifier, voilà notre œuvre de chaque jour. C’est là le règne de la liberté.
Ces altérations qui se font peu à peu par l’effort de l’esprit humain, c’est le plus curieux et le plus utile spectacle que nous offre l’histoire. Les générations sont entraînées par certains courants qui, partis d’une faible origine, grossissent lentement, puis s’épandent au loin, et après avoir tout couvert du bruit de leurs eaux, s’affaiblissent et se perdent comme le Rhin en des sables sans nom. Cherchez l’origine de la réforme, il vous faudra remonter en tâtonnant jusque dans la nuit du Moyen Âge ; mais au temps de Wiclef et de Jean Hus, on entend l’idée qui monte et qui gronde, prête à tout renverser. Deux siècles après Luther le fleuve est rentré dans son lit ; de cette furie religieuse qui a bouleversé l’Europe il ne reste que des querelles de théologiens ; c’est à d’autres désirs que l’humanité s’abandonne. Où commence ce violent amour d’égalité qui triomphe avec la révolution française ? nul ne le saurait dire, mais longtemps avant 1789 on sent le souffle de l’orage, on voit tomber pierre à pierre cette société décrépite, que ne relie plus ni la foi politique ni la foi religieuse ; chaque jour précipite la ruine qui va tout écraser. Ce vieux chêne féodal, à l’ombre duquel tant de générations ont grandi, qui le fait éclater ? une idée !
Ces forces terribles qui changent la face du monde, ne peut-on les suivre que dans l’histoire ? Faut-il que l’explosion les ait épuisées pour qu’elles nous livrent leur secret. Quand l’idée est toute vivante, n’en peut-on mesurer la puissance ? est-il impossible d’en calculer la courbe et la projection ? Pourquoi non ? L’humanité n’a-t-elle pas assez vécu pour se connaître elle-même ? Qui empêche de constituer les sciences morales à l’aide de l’observation ? En viendra-t-on à la découverte de lois certaines, finira-t-on par prévoir l’avenir ? oui et non, suivant le sens qu’on attache au mot de prévision. L’astronomie nous annonce à jour fixe une éclipse qui n’aura lieu que dans un siècle, elle ne peut nous dire quel temps il fera demain ; elle connaît la marche fixe des corps célestes, mais les phénomènes variables de l’atmosphère lui échappent. Ainsi en est-il de la science politique. Elle ne dira pas ce que la France fera ou voudra dans six mois ; il y a dans nos passions une inconstance qui défie le calcul ; mais peut-être dira-t-elle avec assez de vraisemblance ce que la France ou l’Europe penseront dans dix ans sur un point donné.
Cette assertion, même ainsi réduite, paraîtra sans doute téméraire ; j’en veux faire l’expérience à mes dépens. Au risque de passer pour faux prophète, je me propose d’étudier une idée qui, méconnue aujourd’hui, réussira, selon moi, dans un prochain avenir. Cette idée, qui du reste n’est pas nouvelle, mais dont l’heure n’a pas encore sonné, c’est que l’État, ou si l’on veut la souveraineté, a des limites naturelles où finit son pouvoir et son droit. En ce moment, si l’on excepte l’Angleterre, la Belgique, la Hollande et la Suisse, une pareille idée n’a point de cours en Europe. L’État est tout, la souveraineté n’a pas de bornes, la centralisation grandit chaque jour. À ne considérer que la pratique, jamais l’omnipotence de l’État n’a été plus visiblement reconnue ; à considérer la théorie, cette omnipotence est sur le déclin. Tandis que l’administration avance de plus en plus, la science combat cet envahissement, elle en signale l’injustice et le danger. Combien de temps durera cette lutte ? il est difficile de le dire ; mais il y a une loi pour les intelligences, et il est permis de croire sans trop de présomption que si aujourd’hui une minorité d’élite combat pour la vérité, cette minorité finira par avoir avec elle le pays tout entier.
Pour connaître à fond l’idée régnante, l’idée que se font de l’État ceux qui, en Europe, sont à la tête des affaires, il faut rechercher comment cette idée s’est formée, car elle a une généalogie ; elle est fille des siècles, et c’est justement parce qu’elle a grandi peu à peu qu’elle vieillira de même. Son passé nous répond de l’avenir.
Chez les Grecs et chez les Romains (ce sont nos ancêtres politiques), l’État ne ressemble qu’en apparence à nos gouvernements modernes. Il y a un abîme entre les deux sociétés. Chez les anciens, point d’industrie, point de commerce, la culture aux mains des esclaves ; on n’estime, on ne considère que le loisir ; la guerre et la politique, voilà les seules occupations du Romain. Quand il ne se bat pas au loin, il vit sur la place publique dans le perpétuel exercice de la souveraineté ; c’est une fonction que d’être citoyen. Électeur, orateur, juré, juge, magistrat, sénateur, le Romain n’a et ne peut avoir qu’une vertu ; le patriotisme ; qu’un vice : l’ambition. Ajoutez qu’il n’y a point de classe moyenne, et qu’à Rome on trouve de bonne heure l’extrême misère près de l’extrême opulence, vous comprendrez que chez les anciens la liberté n’est que l’empire de quelques privilégiés.
Sous un pareil régime, on n’imagine point que personne ait des droits contre la cité ; l’État est le maître absolu des citoyens. Ce n’est pas à dire que le Romain soit opprimé ; mais, s’il a des droits, ce n’est pas en sa qualité d’homme, c’est comme souverain. Il ne songe pas à une autre religion que celle de ses pères ; le Jupiter Capitolin peut seul défendre les enfants de Romulus. La pensée n’est pas gênée, car on peut tout dire sur le Forum ; la parole est publique, l’éloquence gouverne. La liberté n’est pas menacée, qui oserait mettre la main sur un citoyen, fût-il en haillons ? On pousse si loin le respect du nom romain, que la peine s’arrête devant le coupable. Que le condamné abdique, comme un roi qui descend de son trône, qu’il se fasse inscrire en quelque autre cité, la loi ne le connaît plus, la vengeance publique est désarmée.
Il est peu nécessaire de juger ces antiques constitutions, elles n’ont pour nous qu’un intérêt de curiosité ; nous avons d’autres besoins et d’autres idées. Une société industrieuse et commerçante a mieux à faire qu’à passer des journées oisives au forum ; la vie publique n’est plus qu’une faible part de notre existence ; on est homme avant d’être citoyen, et si les modernes ont une prétention politique, c’est moins de gouverner par eux-mêmes que de contrôler le gouvernement. D’un autre côté, l’imprimerie a détruit l’importance de la place publique, et créé une force autrement redoutable qu’une centaine de plébéiens rassemblés autour de la tribune : c’est l’opinion, élément insaisissable, et avec lequel cependant, il faut compter. Enfin la religion n’est pas pour nous une vaine cérémonie, elle nous impose des devoirs et nous donne des droits sur lesquels l’État n’a point de juridiction. L’imitation de l’antiquité ne peut donc que nous égarer ; nos pères en ont fait la rude expérience quand des législateurs malhabiles ont essayé de les travestir tour à tour en Spartiates et en Romains ; mais peut-être nous reste-t-il de cet antique levain plus que ne le comporte notre société.
Tant que Rome fut une république, c’est-à-dire une aristocratie toute-puissante, cette noblesse qui jouissait d’une liberté souveraine ne sentit pas le danger de sa théorie de l’État. Cette poignée de privilégiés pillait le monde sans se soucier de la servitude qu’elle répandait au dehors, de la corruption qu’elle semait au-dedans ; mais quand le peuple eut appris à se vendre, il suffit d’une main hardie pour en finir avec le monopole de quelques grandes familles ; sous la pression de la servitude universelle, la liberté romaine fut écrasée ; tout fut province, il n’y eut plus dans le monde d’autre loi que le caprice de l’empereur.
Ce qu’était ce despotisme, qui embrassait tout, et auquel on ne pouvait échapper que par la mort, il nous est difficile de l’imaginer, nous qui vivons au milieu d’une civilisation adoucie par le christianisme, et tempérée par le voisinage d’autres peuples libres et chrétiens. Tout était dans la main de César, armée, finances, administration, justice, religion, éducation, opinion, tout jusqu’à la propriété et à la vie du moindre citoyen. Aussi ne faut-il pas s’étonner que de bonne heure les Romains aient adoré l’empereur. Vivant, c’est un Numen, une divinité protectrice : mort, c’est un Divus, un des génies tutélaires de l’empire. Dans le langage de la chancellerie, cette main qui scelle les lois est divine, les paroles de l’empereur sont des oracles ; dans ses titres pompeux, ce souverain d’un jour ne laisse même pas à Dieu son éternité.
Comment gouvernait l’empereur ? par lui-même sous les premiers Césars, comme on en peut juger par les lettres de Trajan à Pline ; plus tard, à mesure que les dernières libertés municipales s’évanouissent, c’est l’administration, ce sont les bureaux qui pensent et agissent pour le monde entier. Qui étudie les inscriptions, qui ouvre le code de Théodose ou celui de Justinien, se trouve en face d’une centralisation qui va toujours en grandissant, jusqu’à ce qu’elle ait étouffé la société sous son effroyable tutelle. Si l’on veut se faire une notion juste de ce que pouvait être l’empire au moment de l’invasion barbare, que l’on considère la Chine d’aujourd’hui. On y apprendra comment, par l’excès même du gouvernement, les règles les plus sages, appliquées par des magistrats intelligents, peuvent en quelques siècles énerver un peuple obéissant et le mener à l’esclavage et à la mort.
Parmi les causes de la décadence impériale, il faut placer, et non au dernier rang, la fausse idée que les Romains se faisaient de l’État. C’était l’antique notion de la souveraineté populaire. En théorie la république durait toujours, le prince n’était que le représentant de la démocratie, le tribun perpétuel de la plèbe. Quand les jurisconsultes du troisième siècle étudient le pouvoir de l’empereur, ils en arrivent à cette conclusion : que la volonté du prince a force de loi ; Quod principi placuit legis habet vigorem ; la raison qu’ils en donnent est que le peuple lui a transmis tous ses pouvoirs. C’est ainsi que de l’extrême liberté ils tirent l’extrême servitude.
Contre cette théorie qui les écrasait, on ne voit pas que les Romains aient jamais protesté. Tacite regrette la république, et félicite Trajan d’avoir mêlé deux choses qui, à Rome, n’allaient guère de compagnie : le principat et la liberté ; mais il n’imagine pas qu’on puisse limiter la souveraineté. Des magistratures divisées, annuelles et responsables, voilà tout ce qu’avait imaginé la sagesse des anciens ; c’était une garantie politique qui protégeait l’indépendance du citoyen ; la garantie détruite, tout fut perdu et sans retour.
Pour introduire dans le monde une meilleure notion de l’État, il fallut une religion nouvelle. C’est l’Évangile qui a renversé les idées antiques, et qui par cela même a ruiné l’ancienne société et créé les temps nouveaux.
« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » est un adage que nous répétons souvent, sans nous douter que dans cette maxime aujourd’hui vulgaire il y avait un démenti donné à la politique romaine, une déclaration de guerre au despotisme impérial. Là où régnait une violente unité, le Christ proclamait la séparation ; désormais dans le même homme il fallait distinguer le citoyen et le fidèle, respecter les droits du chrétien, s’incliner devant la conscience de l’individu ; c’était une révolution.
Les empereurs ne s’y trompèrent pas, les grands empereurs moins que les autres. De là le caractère des persécutions, caractère qu’on n’a pas assez remarqué. C’est au fanatisme, c’est à la cruauté des princes qu’on fait remonter la cause des persécutions ; rien n’est moins vrai : le crime fut tout politique. Ce fut au nom de l’État, au nom de la souveraineté enfreinte et des lois violées qu’on emprisonna et qu’on tua les chrétiens. Ôté ce monstre de Néron qui livre les premiers fidèles au supplice pour détourner la haine populaire sur une secte méprisée, quels sont les empereurs qui persécutent ? Est-ce Commode ? il est entouré de chrétiens ; est-ce Héliogabale ? il ne pense qu’à sa divinité syrienne ; est-ce Caracalla ? il n’y a guère de martyrs sous le règne du fratricide. Ceux qui versent le sang des chrétiens, ce sont les princes les plus sages, les plus grands administrateurs : Trajan, Marc-Aurèle, Sévère, Dèce, Dioclétien. Et pourquoi ? c’est qu’ils veulent maintenir à tout prix l’unité de l’État ; or, cette unité est absolue ; elle comprend la conscience comme le reste ; il lui faut l’homme tout entier. Quels reproches fait-on aux chrétiens ? ce sont des athées, des ennemis de l’État, des séditieux en révolte contre les lois. Ces accusations nous semblent aussi puériles qu’odieuses, les Romains les trouvaient justes ; à leur point de vue ils avaient raison. Les chrétiens étaient des athées au sens des lois romaines, puisqu’ils n’adoraient pas les dieux de la patrie, et que pour les anciens il n’y en avait point d’autres ; ils étaient des ennemis de l’État, puisque toute la police de l’empire reposait sur la religion et l’absolue soumission du citoyen ; c’étaient des séditieux, puisqu’ils se réunissaient secrètement au mépris des lois jalouses qui défendaient toute espèce de collège ou d’association. Les reproches que les païens adressaient aux chrétiens sont ceux-là même que sous Louis XIV on faisait aux protestants. Dans une société, qui par l’idée de l’État se rapprochait de la société romaine, les protestants étaient aussi des gens qui méprisaient la religion nationale, qui brisaient l’unité de gouvernement, qui se réunissaient malgré la défense des lois ; c’étaient d’abominables séditieux que le juge envoyait aux galères sans douter de leur crime. Les premiers chrétiens, les protestants du dix-septième siècle avaient-ils raison de ne point obéir à la loi politique ? Je réponds oui, c’était leur droit et leur devoir ; ils suivaient l’ordre que donne l’Évangile. Mais ce devoir et ce droit, les magistrats, romains ou français, ne le comprenaient pas ; il en sera ainsi chaque fois que l’État, tirant tout à soi, ne voudra rien reconnaître en dehors de sa souveraineté ; monarchie ou république, ce sera toujours la tyrannie.
À vrai dire, cette conception de l’État était si générale et si forte, que les premiers chrétiens ne se révoltent qu’à demi contre la loi qui les écrase ; ils n’ont même pas l’idée d’une réforme politique qui leur ferait une place dans l’empire. Tout ce qu’ils demandent, c’est qu’on ferme les yeux sur leurs paisibles réunions, c’est qu’on les tolère, de la même façon qu’on a toléré les juifs au Moyen Âge, comme un peuple inférieur dont l’État ne s’inquiète pas. Tertullien est convaincu que si l’empire romain venait à tomber, le monde finirait ; il lui est plus facile de croire au bouleversement de toutes choses qu’à la transformation de ce gouvernement qui l’opprime. Origène est, je crois, le premier, qui, avec la hardiesse et le génie d’un Grec, ait envisagé d’une autre façon l’avenir ; lui seul en son temps osa prévoir que le christianisme pourrait devenir la religion universelle sans que la terre et les cieux en fussent ébranlés.
C’était là un de ces éclairs qui passent et s’éteignent dans la nuit. Personne ne releva l’idée d’Origène, personne ne mit en doute l’éternité de l’empire. La souveraineté de l’État n’était pas un article de foi politique moins arrêté ; cette idée avait jeté de si profondes racines que le christianisme n’en put triompher ; à vrai dire, l’Église ne l’essaya même pas. Lorsque Constantin, qui devait aux chrétiens une part de sa fortune, associa l’Église à sa puissance, il n’y eut guère qu’Athanase qui eut je ne sais quelle noble inquiétude, et qui s’effraya de voir des magistrats poursuivre violemment l’hérésie. Les évêques entrèrent avec joie dans les cadres de l’administration impériale ; ils prirent aux pontifes païens leurs privilèges, leurs titres, leurs honneurs, comme ils prenaient au paganisme ses temples et ses fondations ; rien ne fut changé dans l’État, il n’y eut que quelques fonctionnaires de plus, et au-dessus d’eux l’empereur, espèce de Janus religieux, grand pontife des païens, évêque extérieur des chrétiens. Qu’on me comprenne bien ; autant que personne je reconnais que le christianisme a fait une révolution morale, et la plus grande qu’ait vue le monde ; l’Évangile a répandu sur la terre une doctrine et une vie nouvelles ; nous en vivons depuis dix-huit siècles, et je ne vois pas que cette sève divine s’affaiblisse ; tout ce que je veux dire, c’est qu’au quatrième siècle, l’Église, la hiérarchie, prit dans l’État la place de l’ancien pontificat païen, avec quelques prérogatives de plus. Les évêques furent bientôt de vrais officiers publics, inspecteurs des magistrats, défenseurs des cités, protecteurs des pauvres et des opprimés ; parfois aussi sujets plus que dévoués et agents trop dociles du divin empereur. Qu’on ne m’oppose pas Ambroise, repoussant du parvis de son église Théodose encore tout sanglant d’une vengeance abominable ; tous les évêques n’étaient pas des Ambroises ni des Athanases ; avant même d’être baptisé, Constantin rougissait de l’indiscrète et sacrilège flatterie d’un évêque, qui publiquement ne craignait pas de comparer l’empereur au fils de Dieu ; cet évêque ne laissa que trop de successeurs.
Était-ce bassesse d’âme, ambition vulgaire ; n’était-ce pas l’excès d’un respect religieux pour l’empereur ? Les évêques ne voyaient-ils pas dans le chef de l’État un agent divin, un représentant de Dieu sur la terre ? Ce sentiment n’expliquerait-il point, sans le justifier, un dévouement qui trop souvent alla jusqu’à la servilité ? C’est à cette opinion que j’incline ; autrement, comment comprendre cette étroite liaison de l’épiscopat et de la royauté qui a duré jusqu’à nos jours ? Bossuet ne va guère moins loin que les évêques de Byzance, cependant ce n’était pas une âme ordinaire. Au fond, c’est la vieille idée de la souveraineté de l’État qui a pris un déguisement chrétien. Pourvu que le prince serve l’Église et défende les saines doctrines, tout lui appartient, l’âme aussi bien que le corps de ses sujets. Sous ce masque, on reconnaît l’idolâtrie païenne, le mépris de la conscience et l’adoration de l’empereur. Veut-on savoir ce qu’une pareille théorie emportait de danger pour la religion, que l’on voie ce que devint l’Église grecque. De Constantin à Justinien, la législation ne change pas d’esprit, l’empereur ne fait rien sans consulter les évêques qui emplissent sa cour ; où en arrive-t-on ? à la servitude de l’Église, servitude qui ne s’est jamais relâchée et qu’aujourd’hui on peut étudier en Orient, et mieux encore à Moscou.
Tandis que l’empire étend chaque jour cette administration qui l’épuise, les barbares s’approchent, et sont bientôt au cœur des provinces. Des bandes farouches ont facilement raison d’une société qui, depuis longtemps désarmée par la jalousie de l’État, n’a même plus le désir de se défendre. Ces barbares apportent avec eux une idée nouvelle, qui fait leur force ; ils ont un souverain mépris pour cette prodigieuse machine qui charme les modernes. Ils ne comprennent rien au peuple qu’ils défendent ou qu’ils pillent. Pour le Romain, l’État est tout, le citoyen n’est rien ; pour le Germain, l’État n’est rien, l’individu est tout. Chaque chef de famille s’établit où il veut, ut fons, ut nemus placuit, gouverne sa maison comme il l’entend, reçoit la justice de ses pairs ou la leur rend, s’enrôle en guerre sous le chef qu’il choisit, ne reconnaît de supérieur que celui à qui il se donne, ne paye d’impôt que s’il le vote, et pour la moindre injustice en appelle à Dieu et à son épée. C’est le renversement de toutes les idées romaines, c’est le contre-pied de la société impériale. Chez les Germains une prodigieuse liberté, une sécurité médiocre ; chez les Romains une sécurité très grande, sauf la crainte du prince et de ses agents, une police vigilante et inquiète, point de liberté.
Cette fière indépendance dura plus d’un jour. Quand le Germain se fut établi en maître dans les provinces que lui abandonnait la faiblesse impériale, il façonna la propriété à son image, et la voulut libre comme lui. Sous les deux premières races, quelle est l’ambition des grands et de l’Église, qui, elle aussi, devient un pouvoir barbare ? c’est d’obtenir une immunité, c’est-à-dire le droit de gouverner sans contrôle un domaine peuplé de nombreux vassaux. La justice, la police, l’impôt tiennent à la terre, et la suivent en toutes mains. La féodalité n’est que la floraison de ce système ; c’est la confusion de la propriété et de la souveraineté. Chaque baron est maître de sa terre, chef dans la guerre, juge dans la paix. C’est envers lui seul que ses vassaux ont des devoirs, seul il est obligé envers le suzerain ou le roi. Nous voilà bien loin de l’empire. Plus de centralisation, plus d’unité, une hiérarchie confuse ; à chaque échelon, des droits différents, des engagements divers ; le contrat partout, nulle part l’État. Aucune administration, point d’armée, point d’impôt ; rien qui ressemble ni au système romain, ni à notre société moderne.
Cependant il ne faut pas prendre cette confusion pour l’anarchie ; l’anarchie ne dure pas cinq siècles ; quel peuple la supporterait aussi longtemps ? Si odieuse que la féodalité soit restée dans l’histoire, il ne faut pas non plus lui attribuer toutes les misères du temps. C’est une erreur commune que de s’en prendre à une institution tombée, et de rejeter sur elle tous les vices et toutes les souffrances ; rien ne prouve que le servage n’eût pas été aussi rude sous une royauté sans limites. Les colons romains n’étaient pas moins foulés que les serfs du Moyen Âge ; la Russie nous montre des paysans esclaves sous une noblesse impuissante et un empereur absolu. Tout au contraire, l’État où les barons prirent le dessus, l’Angleterre, fut aussi le premier pays où s’affaiblit et disparut la servitude. Il y avait donc dans la féodalité autre chose que le despotisme des seigneurs, il y avait une sève féconde ; cette sève qui se cachait sous le privilège, c’était la liberté. Autrement, comment expliquer cette floraison du treizième siècle qu’on ne peut comparer qu’aux plus beaux âges de l’histoire ? Un art nouveau naît et s’épanouit, les poètes chantent et transforment des patois vulgaires en des langues qui ne doivent plus mourir ; la France, l’Allemagne, l’Angleterre, se couvrent de cathédrales, de monastères, de châteaux. Bien aveugle ou bien injuste qui dans ce renouvellement de toutes choses ne reconnaît pas la seule force qui régénère l’humanité.
Toutefois, l’esprit germanique ne suffit pas pour rendre raison de cette renaissance ; il faut faire une grande part à l’Église, véritable mère de la société moderne ; mais cette Église, à qui nous devons ce que nous sommes, ce n’est plus l’Église impériale, c’est une Église transformée, et si je puis me servir de ce mot, germanisée.
En effet, quand les barbares eurent brisé l’empire ; ils se trouvèrent campés au milieu d’un peuple qui n’avait ni leur langue, ni leurs idées, ni leurs mœurs. Entre les vainqueurs et les vaincus il n’y avait qu’un lien commun, la religion. Ce fut l’Église qui rapprocha et qui fondit ensemble ce qu’on nommait la civilisation et ce qu’on nommait la barbarie ; deux États relatifs, et alors moins séparés que jamais.
Ce rôle tutélaire de l’Église explique l’influence qu’elle eut sous les deux premières races, et qu’elle conserva durant le Moyen Âge. Émancipés par la chute de l’empire, les évêques se trouvaient à la fois chefs des cités, conseillers du roi germain, dépositaires de la tradition romaine, aussi puissants par leurs lumières que par leur caractère sacré. Tout les soutenait : l’amour des vaincus, le respect des conquérants, le courant des idées. Dès le premier jour de l’invasion, l’Église, ressaisie de son indépendance naturelle, suivit une politique qui lui livra le monde. Ce fut, toute proportion gardée, la politique romaine appliquée au gouvernement des esprits. Et d’abord l’Église n’entendit plus se soumettre aux autorités de la terre, mais elle ne s’en tint pas là. Portée par l’opinion, Rome, d’auxiliaire se fit maîtresse, et rêva de s’assujettir le pouvoir temporel ; non pas toutefois qu’elle voulût régner par les prêtres, la fierté germanique ou féodale y eût résisté : tout ce que demandait un Grégoire VII ou Innocent III, c’est que les rois s’avouassent vassaux spirituels, fils obéissants de l’Église, et lui reconnussent le dernier ressort.
Dès lors il y eut une conception de l’État toute différente de l’idée romaine, deux puissances se partagèrent le monde, et ce ne fut pas à la force brutale, mais à l’autorité religieuse, c’est-à-dire au pouvoir moral et intellectuel, qu’on assigna la suprême direction des affaires humaines. Clovis aux genoux de saint Remy, Charlemagne couronné par le pape, rendaient hommage au droit nouveau. Désormais la religion était en dehors et au-dessus de l’État. C’est la première et la plus grande conquête des temps modernes, elle nous a délivrés de la divinité des empereurs, cette honte du peuple romain. Sans doute l’Église et l’État ont trop souvent noué une alliance dont la conscience a été victime, mais du moins n’a-t-on jamais vu un prince qui, en vertu de la souveraineté, s’attribuât le droit de régler la croyance et d’imposer la foi. Ce n’est pas comme César, c’est comme fils aîné de l’Église que Louis XIV persécutait les protestants ; il s’inclinait devant l’Évangile en le violant. La loi même dont il se réclamait déposait contre lui et réservait l’avenir.
L’Église féodale comme l’Église barbare prit au sérieux ce gouvernement des esprits que l’opinion lui déférait. Il lui fallut l’âme tout entière des générations nouvelles, elle ne laissa au prince que le corps. Foi, culte, morale, éducation, lettres, arts, sciences, lois civiles et criminelles, tout fut en sa main. C’est de cette façon que le Moyen Âge résolvait la difficile question des limites de l’État.
Ce partage entre le pouvoir temporel et l’Église n’était-il qu’un despotisme à deux têtes ? Non, l’Église fut longtemps libérale, et, l’hérésie mise de côté, ne s’effraya pas de la liberté. Rien de plus libre, par exemple, que cette turbulente université de Paris, où l’on accourait de toute l’Europe pour remuer les problèmes les plus téméraires. En un temps où le doute n’était que la maladie de quelques âmes aventureuses, comme celle du malheureux Abailard, cette liberté, il est vrai, offrait peu de dangers ; on peut tout discuter quand les solutions sont connues d’avance ; mais ne soyons pas injustes envers l’Église, c’est la liberté qu’elle croyait donner, l’opinion ne lui demandait pas plus qu’elle n’accordait. À tout prendre, au temps de Gerson, l’enseignement était plus hardi qu’au temps de Bossuet, et l’université plus indépendante qu’on ne le permettrait aujourd’hui.
La féodalité n’avait pas étouffé les idées romaines, il y eut dès l’origine une sourde réaction contre les abus et les violences de la conquête ; plus tard, contre le pillage des barons. Sous le règne de Philippe le Bel, la réaction est victorieuse, le droit romain est sorti de la poudre ; c’est avec le Digeste et le Code que les légistes commencent à miner les libertés féodales. Leur idéal, c’est l’État romain, c’est l’unité et l’égalité sous un chef qui ne relève que de Dieu. Une foi, une loi, un roi, c’est leur devise ; le roi de France, disent-ils, est empereur en son pays ; ils ont traduit à son profit la maxime impériale, Quod principi placuit legis habet vigorem : SI VEUT LE ROI, SI VEUT LA LOI.
La guerre contre la féodalité dura plus de trois siècles. Le peuple opprimé y soutint vaillamment ceux qui prenaient sa cause en main ; mais tandis qu’en Angleterre les barons, pour défendre leurs privilèges, y associaient le pays et tiraient des coutumes nationales tout ce qu’elles pouvaient contenir de libertés, les rois de France se contentèrent d’accorder au peuple qui les avait appuyés ces garanties civiles que tout pouvoir absolu peut donner sans s’affaiblir. Philippe le Bel et ses successeurs abattirent les barons et réduisirent à l’obéissance ces tyrans subalternes, mais ce fut pour employer à leur seul profit toutes les forces de la France. L’égalité y gagna, mais non la liberté.
Ce serait une trop longue histoire que de suivre cette lutte perpétuelle de la royauté contre le vieil esprit d’indépendance. L’habileté, la force, la ruse, les armes, les lois, les jugements, rien ne fut épargné pour reconquérir la souveraineté, pour reconstruire pierre à pierre l’édifice impérial. Soumettre au roi les châteaux, les villes, les campagnes, contraindre les têtes les plus fières à plier sous le joug commun, préparer l’unité législative, agrandir l’administration, centraliser le gouvernement, ce fut le travail constant de nos rois et de leurs conseillers. Les princes changent, non pas la tradition ; Charles V et Louis XI, François Ier et Henri IV, Richelieu et Louis XIV poursuivent une même pensée : établir l’unité par le despotisme de l’État. L’idée était grande, le moyen excessif ; on peut se demander où il menait la France. Admirer en bloc l’œuvre de nos rois, comme l’a fait longtemps l’école libérale, c’est pousser trop loin l’amour de l’uniformité. Nous avons payé assez cher les fautes du pouvoir absolu pour qu’il nous soit permis de critiquer cette politique à outrance, qui, après avoir tout nivelé, n’a pas même pu maintenir la monarchie.
Ce n’est pas qu’on puisse regretter la chute de la noblesse féodale ; les barons ne défendirent que leurs privilèges, et ne firent rien pour les libertés nationales. Leur égoïsme les perdit. La noblesse française a de brillants souvenirs ; elle était brave et chevaleresque, mais elle n’eut jamais d’esprit politique, et courut à Versailles pour y solliciter, comme un honneur, la domesticité royale. Ce n’est pas ainsi que dure une aristocratie.
Quant au clergé, il semble qu’il aurait pu jouer un autre rôle, et mieux résister aux empiétements de la royauté. Au quinzième siècle, parmi les misères du schisme, l’Église gallicane est toute vivante ; dans les conciles de Bâle et de Constance, l’Europe n’écoute que des prélats et des docteurs français ; l’université de Paris est l’honneur et le rempart de la chrétienté. Un siècle plus tard, tout est éteint. Le concordat a scellé la servitude de l’Église ; elle est retombée au point où l’avait mise Constantin. Le prince la protège et l’enrichit ; au besoin même, il la défend contre l’hérésie, mais en même temps il en nomme les chefs, et se sert de l’épiscopat comme d’un moyen de gouvernement. On sait quel est le résultat de ces alliances inégales ; la force d’une Église est une force d’opinion qui ne vaut que par la liberté ; se mettre dans la main de l’État, c’est abdiquer.
Le règne de Louis XIV est l’apogée de la monarchie. Si l’on veut chercher dans l’histoire un gouvernement qui ressemble à celui de Trajan ou d’Adrien, c’est là qu’il faut s’arrêter. L’unité est faite, les dernières résistances se sont évanouies avec la Fronde ; ce qui restait de libertés féodales ou municipales a été détruit ; le parlement est muet ; on a exterminé le schisme et l’hérésie ; c’est le prince qui protège la religion, les sciences et les lettres ; en d’autres termes, la conscience et la pensée lui appartiennent, comme la vie et les biens de ses sujets. L’œuvre est accomplie, l’État n’a plus de limites ; c’est le système romain dans ses beaux jours. Voilà ce qu’ont admiré nos pères, et au premier rang Voltaire, qui n’aurait pas conduit l’opinion s’il n’avait eu les défauts autant que les qualités de l’esprit français. Quand il donne au siècle le nom du grand roi, c’est à peine s’il aperçoit quelques ombres sur ce soleil si brillant à son aurore, si triste à son déclin. Voltaire ne sent pas qu’Auguste, Louis XIV, et tous ces princes qui élèvent leur grandeur sur la ruine de la liberté, ne laissent après eux que des générations sans énergie. Ce sont des prodigues qui dissipent les économies de leurs pères, et ne lèguent que la misère à leurs héritiers.
La grandeur du roi cachait les vices du régime ; Bossuet, ce beau génie, écrivait, en toute sincérité, la Politique tirée de l’Écriture sainte, véritable apologie du despotisme. Ce n’est pas qu’au milieu de ces centons sacrés on ne trouve de sages conseils offerts aux souverains, mais ce sont des conseils, rien de plus. Pour Bossuet, qui confond l’anarchie et la liberté, les sujets n’ont aucun droit, non pas même la propriété, qui ne soit une concession de l’autorité ; par conséquent, ils ne peuvent prétendre à aucune garantie. On ne partage pas avec le prince. Les rois sont choses sacrées ; c’est à Dieu seul qu’il appartient de les punir, s’ils abusent du troupeau raisonnable que le Ciel leur a confié. La piété, la crainte de Dieu, voilà le seul contrepoids de la puissance absolue ; la désobéissance du sujet est un crime de lèse-majesté divine et humaine. La théorie de l’évêque de Meaux, c’est la servitude sanctifiée. Quand on part de pareils principes, on en arrive forcément à trouver l’esclavage un état juste et raisonnable ; Bossuet est descendu jusque-là !
Il en est tout autrement de Fénelon. Dans ses plans de gouvernement, que M. de Larcy vient de remettre dans leur véritable jour, on trouve des réformes chimériques ; Fénelon ne peut dépouiller le personnage de Mentor ; mais il a des vues politiques, le sentiment que la monarchie absolue ne peut durer. Fénelon, qui n’a pas oublié les vieilles franchises de la nation, n’attaque pas le droit du prince ; mais, pour lui, ce droit est limité par les antiques franchises ; aussi réclame-t-il la liberté municipale et provinciale ainsi que les États généraux. Enfin, et ceci dépasse de beaucoup la portée de son temps, il veut une Église indépendante, alliée et non pas sujette de l’État. Si le duc de Bourgogne eût vécu, s’il eût appliqué les conseils de son précepteur, qui peut dire si dès le commencement du dix-huitième siècle la France ne serait pas entrée paisiblement dans les voies de la liberté ?
Tandis que Louis XIV s’enivrait de sa puissance, l’Angleterre s’agitait au milieu des révolutions ; ces révolutions se faisaient sous l’empire d’idées toutes différentes des nôtres. La réforme religieuse entraînait une rénovation politique ; une fois encore un changement de religion amenait un changement dans l’État. C’est ce double élément spirituel et politique qu’il nous faut étudier.
La Réforme ouvre une ère nouvelle dans le monde ; c’est le retour du principe individuel, une protestation contre le pouvoir absolu, qu’il porte la tiare ou la couronne. Que Luther n’ait pas senti où sa doctrine le portait, qu’il ait cru simplement ramener l’Église à sa pureté originelle, qu’il ait vu dans la Bible un livre divin, qui, librement consulté, donnerait aux fidèles, éclairés par le Saint-Esprit, des réponses infaillibles et toujours les mêmes, cela se peut ; Luther n’est ni le premier, ni le seul qui ait été surpris par l’orage même qu’il avait déchaîné ; ce qui n’est pas moins certain, c’est que le moine de Wittemberg renversait du même coup le principe catholique et monarchique ; il rendait à l’individu le dernier ressort qui, jusque-là, appartenait à l’Église et à l’État. Volontairement ou non il brisait les cadres de l’ancienne société, et Leibnitz a pu lui adresser ce magnifique éloge :
Ce qui se trouvait au fond de la Réforme, c’était, on ne l’a pas assez vu, la vieille indépendance germanique. À chacun le droit d’obéir à sa conscience, de choisir sa foi, de constituer son Église, voilà ce que réclamèrent bientôt les protestants. De là à discuter l’obéissance civile, à mettre dans l’État la liberté qui régnait dans l’Église, il n’y avait qu’un pas ; ce pas fut aisément franchi. C’était si bien un réveil de l’esprit germanique, que la Réforme ne conquit que les peuples de race allemande ou gothique. Reçue sans obstacle dans les pays Scandinaves, triomphante en Angleterre, en Hollande, et dans le nord de l’Allemagne, elle échoua en Pologne, aussi bien que chez les nations de langue latine. En Allemagne même elle ne put réussir le long du Rhin et du Danube, là où d’anciennes tribus celtiques, colonisées par les Romains, faisaient le fond de populations encore reconnaissables sous l’écorce germanique. Je ne pousse point à outrance l’influence de la race ; je ne prétends pas que le sang d’un peuple décide seul de la religion qu’il adopte ; il y eut des protestants en France, en Italie, en Espagne ; ce que je soutiens, l’histoire à la main, c’est que là où le protestantisme trouva le vieux levain germanique, il fut maître des âmes et emporta tout.
La Réforme inquiéta les princes ; c’était une révolution semblable à celle que le christianisme était venu faire dans l’empire romain. L’organisation politique, fondée sur l’étroite alliance de l’Église et de l’État, craquait de toutes parts ; la conscience et la pensée échappaient au souverain. Ces esclaves révoltées revendiquaient non seulement la liberté, mais l’empire. On ne voulut point céder à ce souffle terrible ; on essaya de noyer les nouveautés dans le sang des martyrs ; la persécution enfanta la révolte et la guerre. Ces guerres intérieures, ces luttes fratricides qui épuisèrent l’Europe, aboutirent à ce fait considérable, qu’après l’acharnement du combat, les deux communions, impuissantes à se réduire et à s’entamer l’une l’autre, furent obligées de se tolérer mutuellement. En France comme en Allemagne, il fallut souffrir que la minorité gardât sa religion ; en d’autres termes, l’État fut forcé d’abdiquer devant la conscience, le nombre fut obligé de respecter le droit. La liberté religieuse, c’est l’âme des sociétés modernes, c’est la racine de toutes les autres libertés. On ne coupe pas en deux l’esprit humain ; si l’individu a le droit de croire, il a le droit de penser, de parler et d’agir ; les sujets n’appartiennent plus au prince, l’État est fait pour eux, non pour lui. C’est ce que sentit Louis XIV ; son instinct despotique ne s’y trompa guère. Le protestantisme était la négation du droit divin, un démenti donné à la politique traditionnelle de la monarchie. En écrasant les réformés, on croyait assurer à jamais l’unité ; mais, derrière les protestants, on rencontra les jansénistes, et quand on eut rasé Port-Royal, on se trouva en face des philosophes. La pensée était libre, et se riait du grand roi.
En Angleterre, la Réforme prit deux faces diverses. Pour la noblesse et le clergé, ce ne fut qu’une rupture avec Rome, l’Église resta étroitement unie à l’État. Pour la bourgeoisie et le peuple, ce fut une émancipation politique autant que religieuse ; la foi populaire, c’était le calvinisme qui rompait avec l’État, et faisait de chaque communauté de fidèles une république qui se gouvernait elle-même, et dans laquelle chacun avait le droit de prophétiser, c’est-à-dire de parler sur toutes choses. Poursuivi par la royauté, le puritanisme triompha avec Cromwell. Ce triomphe politique fut de courte durée, mais le germe républicain resta dans la société anglaise, et ce qui en fut porté dans les plantations du nouveau monde enfanta les États-Unis.
Si la première révolution avait été calviniste et démocratique, la seconde, celle de 1688, fut anglicane et conservatrice. Le changement politique se fit, comme la réforme religieuse, aux moindres frais possibles. On renversa le roi, mais non la royauté ; on reprit la tradition nationale, dédaignée par Charles II, attaquée par son frère ; c’était une tradition de liberté. Quand on lit l’histoire de Henri VIII ou de l’impérieuse Élisabeth, on ne voit pas que l’Angleterre fût moins assujettie que le continent ; les idées du siècle et la nécessité de résister à la monarchie espagnole avaient concentré le pouvoir entre les mains d’un maître ; mais sous ce despotisme, accepté comme le rempart de l’indépendance et de la grandeur nationales, s’était conservé le vieil esprit saxon. Les idées et les lois romaines n’avaient jamais pénétré en Angleterre ; la liberté y était éclipsée, mais non détruite. L’indépendance communale, le jury civil et criminel, le parlement, le vote de l’impôt, ne sont pas des conquêtes et n’ont pas de date chez les Anglais, c’est la common law qui les établit, en d’autres termes, ce sont les coutumes que les Saxons ont apportées dans la Grande-Bretagne, coutumes dont le développement a été quelquefois retardé, mais qui n’ont jamais cessé de vivre. C’est ce qui explique comment, en 1688, l’Angleterre, reprenant possession d’elle-même, constitua, sans trop de secousses, ce libre gouvernement qui l’a mise à la tête de la civilisation.
La révolution de 1688 eut son politique : c’est Locke. Quand on lit le Traité du gouvernement civil, il faut quelque effort pour se persuader que l’auteur de ce livre est contemporain de Bossuet. Locke pense et écrit comme les philosophes français de la seconde moitié du dix-huitième siècle ; il a de plus qu’eux le bon sens et la modération qui tiennent à l’expérience, deux qualités qui, en général, ont manqué à nos théoriciens. Pour Locke, la société civile est un contrat par lequel chaque homme abandonne une part de son indépendance naturelle, afin de jouir en paix, comme citoyen, de la liberté qu’il réserve. Par conséquent, l’État n’est pas tout. Il est institué pour une certaine fin, qui est la conservation des propriétés, c’est-à-dire de ce que chacun possède en propre : la vie, la liberté, les biens. Ces choses-là ne sont pas des concessions de l’autorité ; elles nous appartiennent en notre qualité d’hommes ; ce sont des droits naturels auxquels on ne peut renoncer. Si le prince envahit ces libertés, il viole le contrat d’où il tire son pouvoir ; les sujets sont dégagés de leur obéissance, l’insurrection est l’ultima ratio des peuples que la tyrannie dépouille de leurs droits. Ce n’est pas ici le lieu de discuter un système qui a plus d’une partie faible ; ce qu’on ne peut contester à Locke, c’est le mérite d’avoir nettement proclamé qu’il y a des bornes à la puissance publique, et que si l’État est souverain, il ne s’ensuit pas qu’il soit absolu.
L’influence des idées anglaises sur la France fut considérable au dernier siècle ; deux de nos plus grands publicistes, Voltaire et Montesquieu, ont emprunté à Locke, ou rapporté de la Grande-Bretagne, leurs vues les plus hardies. Le doute religieux et le doute politique nous venaient d’Angleterre en même temps ; or, c’est toujours par le doute que commencent les réformes ; le changement des affaires humaines n’est que la traduction matérielle du changement des idées.
Voltaire s’attacha à deux nobles causes : la tolérance et l’humanité. Si les protestants sont rentrés dans la grande famille, si la torture et les supplices ont été chassés de nos lois, on le doit au défenseur de Sirven, de La Barre et de Calas ; ce n’est pas son moindre titre devant la postérité. Mais ces réformes criminelles que Voltaire réclamait avec tant d’esprit et de passion, c’était une nouvelle conquête sur le droit absolu du prince, un nouvel effort pour faire rentrer l’autorité civile dans les limites qu’elle ne doit pas franchir. Luther avait enlevé à l’État la conscience humaine, Voltaire lui arrachait le corps du citoyen. Ce n’était pas une médiocre victoire. Les lois criminelles sont toujours en rapport avec la constitution. À Rome, sous la république, elles étaient douces et protectrices ; sous l’empire, elles devinrent féroces et sanguinaires. Dans un pays libre, l’accusé est un innocent jusqu’au jugement prononcé ; dans un pays despotique, l’accusé est un coupable dès que la main de la police l’a saisi ; les égards que mérite le malheur, les droits sacrés de la défense, tout disparaît devant l’intérêt de l’État. Adoucir les lois criminelles, faire pénétrer le jour dans les procédures, intéresser le magistrat à la protection de l’accusé, c’est une des œuvres les plus saintes que puisse se proposer un ami de l’humanité. C’est au respect de la personne qu’on mesure la vraie grandeur de la civilisation.
Montesquieu passa deux années en Angleterre ; il en revint fortement touché de ce qu’il avait vu ; on sent qu’en écrivant l’Esprit des lois il a toujours la constitution anglaise sous les yeux. Pour un Français du dix-huitième siècle, en un temps où l’on ne s’occupait du gouvernement que pour le chansonner, c’était un spectacle étrange que celui d’un pays où un couvreur se faisait apporter la gazette sur les toits pour la lire. Les pages où Montesquieu expose le jeu des pouvoirs publics en Angleterre sont des plus justes et des plus profondes ; aussi, un des meilleurs jurisconsultes de la Grande-Bretagne, Blackstone, né fait-il que suivre Montesquieu quand il veut expliquer aux Anglais leur propre gouvernement. Il y a, dans l’Esprit des lois, plus d’un chapitre qui n’a pas moins d’importance que celui de la Constitution d’Angleterre ; mais ce dernier, bientôt développé et systématisé par Delolme, fit une fortune singulière ; plus d’une fois il a exercé une influence visible sur notre destinée politique. Cette influence a eu peut-être quelques inconvénients ; je me hâte de dire que ce n’est pas la faute de Montesquieu.
Quand on étudie l’Esprit des lois, on voit que l’auteur envisage la politique comme un problème des plus complexes, et qu’il en recherche successivement toutes les données. « Les lois, dit-il, doivent être relatives au physique du pays, au climat…, à la qualité du terrain, à sa situation, à sa grandeur, au genre de vie des peuples ; elles doivent se rapporter au degré de liberté que la constitution peut souffrir, à la religion des habitants, à leurs inclinations, à leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs, à leurs manières. Enfin, elles ont des rapports entre elles ; elles en ont avec leur origine, avec l’objet du législateur, avec l’ordre des choses sur lesquelles elles sont établies. C’est sous toutes ces vues qu’il faut les considérer. C’est ce que j’entreprends de faire dans cet ouvrage. J’examinerai tous ces rapports ; ils forment tous ensemble ce que l’on appelle l’ESPRIT DES LOIS. »
Rien de plus clair que cette déclaration ; mais les contemporains de Montesquieu n’ont pas eu l’intelligence aussi large. Éblouis par l’aspect extérieur de la constitution britannique, séduits par le mécanisme ingénieux dont on leur expliquait la marche et le secret, surtout pressés d’agir, ils ont laissé à l’écart toutes ces libertés personnelles et locales qui sont le fond même des institutions anglaises ; ils ont cru qu’il suffisait d’emprunter à l’Angleterre son organisation politique, pour lui emprunter son génie et répandre aussitôt la liberté sur le continent. Ce fut l’erreur des constituants les plus sages, ce fut l’illusion de l’auteur de la Charte, et plus tard du parti libéral. Tous se réclamaient de Montesquieu, et avec raison ; mais il fallait le suivre jusqu’au bout, et ne pas prendre une façade pour l’édifice tout entier.
À côté de l’école anglaise, dont Voltaire, Montesquieu et Delolme sont les représentants, il y eut une école française, qui assaillit par un autre côté le despotisme de l’État, c’est l’école des physiocrates. Ce n’est pas que Quesnay ni Turgot soient jaloux de l’autorité ; au contraire, c’est du prince qu’ils attendent la réforme des abus, et une meilleure direction de la société ; mais en un point considérable, ils attaquent l’omnipotence de l’État. Ils veulent la liberté de l’agriculture et du commerce avec la réforme de l’impôt. Leur devise, qu’on a souvent raillée (ce qui est plus aisé que de comprendre), est : laissez faire, laissez passer ; appliquée au travail national, cette devise est d’une grande justesse. Quesnay ne dispute à l’État ni la défense du pays au dehors, ni le maintien de l’ordre et de la sécurité au-dedans. Il ne marchande pas à l’autorité ses prérogatives comme le fait l’école d’Adam Smith ; mais en ce qui touche l’industrie, il se défie de l’administration, et avec raison. Presque toujours elle gêne, et là même où elle croit protéger, le plus souvent elle détruit. J’en donnerai un curieux exemple pour l’ancienne France. Tout le monde sait que, sous le règne de Louis XVI, Parmentier a popularisé la culture de la pomme de terre ; c’est à cet excellent homme, à ses efforts, à ses sacrifices que nous devons cette précieuse ressource contre la disette. Mais la pomme de terre avait été apportée en Europe à la fin du seizième siècle ; comment s’est-il écoulé deux cents ans avant qu’on s’aperçût de son utilité ? Pour la France, la réponse est aisée : à son arrivée, la pomme de terre donnait la lèpre, disaient les médecins du temps ; au dix-septième siècle, elle donnait la fièvre ; l’administration, toujours éclairée, avait suivi l’opinion des médecins ; elle ne cessa de protéger la santé publique contre un danger chimérique qu’en 1771, après qu’un avis de la Faculté eut rassuré les esprits. Nous nous croyons plus sages. Y a-t-il si longtemps qu’un illustre maréchal déclarait que, pour notre agriculture, l’entrée des Cosaques serait moins désastreuse qu’une invasion de moutons étrangers ? Cependant, malgré cette menace, une courte expérience a montré aux plus aveugles qu’il y avait tout au moins une liberté que la France pouvait supporter sans trouble et sans ruine : la liberté de la boucherie !
Quel que fût leur amour de l’autorité, Quesnay et ses disciples n’en revendiquaient pas moins une liberté féconde et qui tient à toutes les autres. Dès qu’on veut ménager le travail et la richesse, ne faut-il pas des garanties contre les dépenses excessives de l’État, contre les folies de la guerre ou de la paix ? Qu’est-ce que ces garanties, sinon la liberté politique ? Les réformes de Turgot, les assemblées provinciales de Necker furent un premier essai d’émancipation que la révolution écrasa dans sa fleur, mais qu’il serait injuste d’oublier. Il faut lire les procès-verbaux de ces assemblées pour voir avec quelle ardeur le clergé, la noblesse et le tiers état s’occupèrent d’améliorations populaires : suppression de la corvée, extinction de la mendicité, routes, canaux, instruction publique, toutes ces questions sont résolues avec une admirable libéralité. On dit que la France ne sait pas user de sa liberté ; il est vrai que souvent elle est restée très froide à l’endroit de ses privilèges électoraux, qui ne lui profitaient guère ; mais chaque fois qu’on a chargé la province, le département ou la commune du soin de leurs propres affaires, je ne vois pas que le pays se soit montré ni indifférent ni incapable. Turgot et Necker nous avaient bien jugés en mettant la liberté à la base de l’édifice ; c’est toujours là qu’il en faut revenir.
À la veille de 1789, il y avait donc en France des gens éclairés, qui, partis de points différents, élèves de Voltaire, de Montesquieu ou de Turgot, avaient ceci de commun qu’ils sentaient la nécessité de réduire le despotisme de l’État ; mais, par malheur, à côté de cette école libérale, grandissait un parti ardent qui confondait le pouvoir du peuple avec la liberté, et qui était prêt à sacrifier tous les droits à la souveraineté populaire ; ce parti, qui devait triompher, se rattachait à Rousseau.
Quand on lit à tête reposée le Contrat social, ou les rêveries de l’honnête Mably, rêveries qui sont de même origine que le Contrat social, on se demande comment des modernes se sont laissé prendre à ces pastiches de l’antiquité, à ces sophismes transparents ; cependant il est visible que la doctrine de Rousseau, si fausse qu’elle soit, n’a rien perdu de son influence. On la trouve au fond de toutes nos révolutions ; c’est toujours la théorie païenne : la liberté, c’est la souveraineté ; le droit, c’est la volonté de la nation.
Écoutons Rousseau. Pour lui, le problème de la politique, c’est de « trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s’unissant à tous, n’obéisse pourtant qu’à lui-même





























