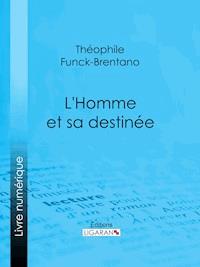
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "L'homme étant un être intelligent ne saurait vivre sans notions morales, sans se faire des idées générales sur ce qui lui est agréable ou pénible, sur ce qui lui semble préférable ou lui paraît mériter le dédain. Il le fait pour lui-même d'abord. Il le fait ensuite pour les autres parce qu'il vit en société."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À MA FILLE
Je te dédie, je te donne et je te lègue ce livre, ma chère Claudine. Bien avant ta naissance, j’en publiai les premières études. J’écrivais alors : « Si nous ne possédons ni la finesse d’esprit ni l’élégance d’un de La Rochefoucauld, – elles étaient de son siècle, – nous avons, en retour, des vues plus élevées et des principes plus généreux, qui sont du nôtre. » Depuis, les sombres évènements de notre histoire, nos haines sociales et politiques grandissantes, nos méfiances et nos injustices réciproques m’ont fait revenir sur ce jugement. C’est que la morale est la science même de la vie. Pour la comprendre dans toute sa portée, il ne suffit pas d’en avoir entrevu les principes dans sa jeunesse, il faut l’avoir vécu.
Trouvant ces lignes sur ma table, tu écrivis en marge : Bravo !ce qui me donna encore à réfléchir. Il ne suffit pas plus d’avoir vécu la morale que d’en avoir entrevu les principes, il faut qu’elle renaisse dans l’enthousiasmede la jeunesse, qui seule, grâce à la pureté de son cœur et à la fraîcheur de sa pensée, peut lui donner la vie et la réalité. Il en est comme de la pluie du ciel : elle ne devient féconde qu’absorbée par les nouvelles semences.
Ton affectionné père.
LA MORALE SOCIALE ET LA MORALE INDIVIDUELLE
L’homme est un être, ou si l’on veut, un animal perfectible par l’entente avec ses semblables. Nous ne tenons pas à l’expression d’animal parce qu’aucune espèce animale vivant en société, vertébrés, insectes ou mollusques, ne se perfectionne par le fait de l’existence en communauté. Cela est le propre de l’homme. Il se développe intellectuellement, moralement et même physiquement à mesure que croît son entente avec ses semblables ; il dépérit et se dégrade à mesure que cette entente diminue ; lui fait-elle complètement défaut, il redevient une bête.
Les sourds et muets, avant l’éducation qu’on est parvenu à leur donner, grâce à la découverte du langage des signes, restaient des bêtes ou ce qu’on est convenu d’appeler des idiots. Quelques années de solitude complète suffisent pour faire retomber l’homme le plus intelligent dans un état voisin de l’idiotie. Son intelligence redevient celle de la bête : ne vivant plus que selon ses instincts, sa moralité s’éteint, ses traits s’épaississent, ses organes se déforment. Ce n’est pas depuis sa naissance, c’est du moment où il commence à s’entendre avec ses semblables au moyen de signes ou de sons, que son intelligence s’éveille, que sa moralité s’accuse, et que toutes les facultés de son organisme se raffinent. Il en résulte qu’il y a pour l’homme, nous ne dirons pas deux morales, mais une seule qui prend des aspects fort divers selon qu’on la considère comme pratiquée par la société dans laquelle il vit ou par chaque individu pris isolément, et forme la morale sociale et la morale individuelle. La première détermine les progrès des hommes et fixe les lois de la civilisation des peuples, la seconde règle la conduite de chaque homme en vue de ses progrès au sein de cette civilisation.
C’est pour ne pas les avoir distinguées suffisamment l’une de l’autre, qu’on a inventé un monde de morales différentes, les unes aussi peu consistantes que les autres. On n’enseigne pas à l’homme la civilisation, il faut qu’il la mérite à travers des efforts séculaires ; mais on lui enseigne sa conduite personnelle, et cet enseignement dépend toujours du degré de civilisation de ceux dont il le reçoit.
La religion et l’instruction publique, les lois et les institutions, les arts et les lettres sont l’expression de la morale sociale à laquelle les hommes se sont élevés par leur entente les uns avec les autres, et la conduite que chacun observe ou croit devoir observer dans l’existence de l’ensemble, constitue la morale individuelle. Hors de-là tout n’est qu’illusion et chimère, décadence et dégradation.
De toutes les sciences la philosophie est la plus vaste, la politique la plus difficile, la médecine la plus complexe ; mais la morale est la plus profonde. Elle pénètre l’homme jusque dans les manifestations les plus insignifiantes de son être, et en poursuit les conséquences dans l’histoire de l’humanité entière. Toute morale qui arrache de ces données l’un ou l’autre élément, raison, sentiment ou instinct, est moins que de la science, elle n’est que pure sophistique.
Nous ne connaissons dans l’histoire qu’un homme, un seul, qui ait envisagé la morale à ce point de vue, et cet homme est resté tout à fait inconnu comme moraliste. Nous voulons parler de Domat, l’ami de Pascal. Il est vrai qu’il n’a pas écrit un livre de morale, mais une introduction à un traité des lois qu’il publia par ordre de Louis XIV ; lui-même n’avait recueilli ses pensées que pour l’instruction de ses enfants. C’est de cette infinie modestie qu’est sortie l’œuvre la plus parfaite qui subsiste dans la science de la morale.
Qui n’a été autant charmé par la forme que révolté par le fond de ces pensées de Pascal :
« Trois degrés d’élévation du pôle renversent toute la jurisprudence. Un méridien décide de la vérité ; en peu d’années de possession, les lois fondamentales changent ; le droit a ses époques. Plaisante justice qu’une rivière borne ! Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà.
Il y a sans doute des lois naturelles ; mais cette belle raison corrompue a tout corrompu.
De cette confusion arrive que l’un dit que l’essence de la justice est l’autorité du législateur ; l’autre, la commodité du souverain ; l’autre, la coutume présente, et c’est le plus sûr : rien, suivant la seule raison, n’est juste de soi ; tout branle avec le temps. La coutume fait toute l’équité, par cette seule raison qu’elle est reçue : c’est le fondement mystique de son autorité. Qui la ramène à son principe l’anéantit.
Pourquoi me tuez-vous ? Eh quoi ! Ne demeurez-vous pas de l’autre côté de l’eau ? Mon ami, si vous demeuriez de ce côté, je serais un assassin, et cela serait injuste de vous tuer de la sorte ; mais puisque vous demeurez de l’autre côté, je suis un brave, et cela est juste.
Comme la mode fait l’agrément, ainsi fait-elle la justice. »
Pascal, à sa mort, légua ses papiers à son ami Domat, l’auteur des Lois civiles dans leur ordre naturel et du Traité des lois qui les précède.
D’Aguesseau écrivait à son fils : Personne n’a mieux que Domat approfondi le véritable principe de la législation. Il descend jusqu’aux dernières conséquences ; il les développe dans un ordre presque géométrique ; toutes les différentes espèces de lois y sont détaillées avec les caractères qui les distinguent. C’est le plan général de la société civile le mieux fait et le plus achevé qui ait jamais paru, et je l’ai toujours regardé comme un ouvrage précieux que j’ai vu croître et presque naître entre mes mains.
Ou Domat n’a pas été l’ami de Pascal, ou je trouverai dans son Traité des lois l’explication des désespérantes opinions de notre plus grand, de notre plus admirable penseur ! Telle fut l’impression que j’eus à la lecture des lignes de d’Aguesseau. Je connaissais trop bien le caractère si entier, si complet de nos hommes du dix-septième siècle pour en douter un instant.
Depuis de longues années, en effet, je ne me rappelle pas avoir éprouvé une jouissance pareille à celle que m’a donnée la lecture de ce remarquable traité.
Il m’a paru infiniment supérieur à l’Esprit des lois. Montesquieu emprunta à l’un des chapitres, De la nature et de l’esprit des lois, jusqu’au titre de son œuvre, qui est devenue si célèbre, tandis que celle de l’ami de Pascal a été complètement oubliée. Elle renfermait cependant, comme l’assure d’Aguesseau, « le plan général de la société humaine le mieux fait et le plus achevé qui ait jamais paru » ; tandis que celle du président à mortier se condense dans une série de théories, les unes non moins étranges et illusoires que les autres, qui ne répondent ni à la réalité ni aux faits de l’histoire.
Domat répète jusqu’à des passages entiers de Pascal, explique sa pensée, la ramène à des principes indiscutables, et montre en même temps l’enchaînement qui existe entre ces principes, les lois de la morale sociale et les législations positives, si contradictoires qu’elles semblent. Il dépasse même Pascal, et prouve que « vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà », peut devenir vérité en deçà et erreur au-delà de la Loire, sans que les principes de la justice et de l’équité en soient moins immuables.
Malheureusement, les hommes du dix-septième siècle sont loin de nous ; nous devons transformer leurs pensées en pensées modernes, sous peine de ne pas les comprendre. Travail d’une difficulté extrême, et qui explique l’oubli dans lequel le Traité des lois est tombé. Non seulement Domat assure, fidèle encore en cela à son ami, que la loi fondamentale de l’homme est Dieu, qu’il en est le principe et la fin ; mais il explique en outre les fautes, les erreurs des hommes par le péché originel et la chute d’Adam. Déjà au dix-huitième siècle, lorsqu’on rencontrait de semblables affirmations, on avait pris l’habitude de fermer les livres sans plus se donner la peine de chercher si leurs auteurs, croyants sincères, n’avaient pas été de merveilleux penseurs.
Domat en est un exemple.
Remplaçons dans son traité, puisqu’en matière de droit et de morale sociale elle nous heurte, l’expression « Dieu principe et fin de l’homme » par « la nécessité de l’accord de nos idées entre elles », loi absolue qui se manifeste dans le moindre de nos jugements aussi bien que dans tous les progrès et toutes les découvertes des sciences ; la seconde expression, qui sous forme d’argument nous froisse encore davantage, « le péché originel et la chute de l’homme », traduisons-la par celle dont Domat lui-même se sert pour l’expliquer, « l’amour-propre » ; ces changements faits, qui ne portent en somme que sur les mots, écoutons sa doctrine :
« On ne peut prendre une voie plus simple et plus sûre pour découvrir les premiers principes des lois qu’en supposant deux premières vérités qui ne sont que de simples définitions : l’une que les lois de l’homme ne sont autre chose que la règle de sa conduite ; et l’autre que cette conduite n’est autre chose que les démarches de l’homme vers sa fin.
Connaître la fin d’une chose, c’est simplement savoir pourquoi elle est faite ; et on connaît pourquoi une chose est faite, si, voyant comme elle est faite, on découvre à quoi sa structure peut se rapporter. »
Ainsi Domat lui-même, par la méthode qu’il indique, nous autorise à faire les changements que nous venons de proposer. Si, d’une part, la structure intellectuelle de l’homme le conduit à croire en l’existence de Dieu, à l’être infini, au souverain bien, d’une autre part elle est régie par la loi qui domine tous ses efforts intellectuels, toutes ses croyances et hypothèses : la recherche de l’accord de ses idées entre elles, accord qui, pour lui, constitue la vérité. Quant à l’amour-propre, source, suivant Domat, de nos erreurs et de nos fautes, il est l’opposé de l’amour d’autrui, duquel proviennent, d’après lui, toutes les relations sociales, sous quelque forme que ce soit.
La recherche de la vérité et l’amour d’autrui, voilà donc selon Domat les deux principes, les deux lois absolues qui servent de fondement à toute formation, à tout développement de la société des hommes.
« Mais avant que de passer outre et de faire voir l’enchaînement qui lie toutes les lois à ces deux premières », continue Domat, répondant à Pascal, « il faut prévenir la réflexion qu’il est naturel de faire sur l’état de cette société qui, devant être fondée sur ces deux premières lois, ne laisse pas de subsister sans que l’esprit de ces deux lois y règne beaucoup, de sorte qu’il semble qu’elle se maintienne par d’autres principes. Cependant, quoique les hommes aient violé ces lois capitales, et que la société soit dans un état étrangement différent de celui qui devait être élevé sur ces fondements…, il est toujours vrai que ces lois… essentielles à la nature de l’homme subsistent immuables, et qu’elles n’ont pas cessé d’obliger les hommes à les observer ; et il est certain aussi, comme la suite le fera voir, que tout ce qu’il y a de lois qui règlent la société dans l’état même où nous la voyons, ne sont que la suite de ces premières.
Ainsi, hors de l’homme, les cieux, les astres, la lumière, l’air sont des objets qui s’étalent aux hommes comme un bien commun à tous, et dont chacun a tout son usage ; et toutes les choses que la terre et les eaux portent ou produisent, sont d’un usage commun aussi, mais de telle sorte qu’aucun ne passe à votre usage que par le travail de plusieurs personnes ; ce qui rend les hommes nécessaires les uns aux autres, et forme entre eux les différentes liaisons pour les usages de l’agriculture, du commerce, des arts, des sciences, et pour toutes les autres communications que les divers besoins de la vie peuvent demander.
Le premier de ces usages est celui de lier les esprits et les cœurs des hommes entre eux.
Le second usage est d’appliquer les hommes à tous les différents travaux… nécessaires pour tous leurs besoins. Ainsi la loi du travail est également essentielle à la nature de l’homme… et cette loi est aussi une suite naturelle des deux premières, qui, en appliquant l’homme à la société, l’engagent au travail qui en est le lien, et ordonnent à chacun le sien, pour distinguer, par les différents travaux, les divers emplois et les diverses conditions qui doivent composer la société.
Ainsi se sont formés… entre les hommes destinés à vivre en société, les liens qui les y engagent : et comme les liaisons générales entre tous les hommes…, sujettes aux mêmes lois, sont communes à tout le genre humain, il s’est ajouté à ces liaisons générales et communes à tous d’autres liaisons et d’autres engagements particuliers de diverses sortes, par lesquels les hommes se lient de plus près entre eux.
Ces engagements particuliers sont de deux espèces : la première est de ceux qui se forment par les liaisons naturelles du mariage entre le mari et la femme, et de la naissance entre les parents et les enfants ; et cette espèce d’engagement comprend aussi les engagements des parentés et des alliances, qui sont la suite de la naissance et du mariage.
La seconde espèce renferme toutes les autres sortes d’engagements qui approchent toutes sortes de personnes les unes des autres, et qui se forment différemment, soit dans les diverses communications qui se font entre les hommes, de leur travail, de leur industrie et de toutes sortes d’offices, de services et d’autres secours, ou dans celles qui regardent l’usage des choses ; ce qui renferme les différents usages des arts, des emplois et des professions de toute nature, et tout ce qui peut lier les personnes selon les différents besoins de la vie, soit par des communications gratuites ou par des commerces.
L’engagement du mariage est le fondement non seulement des lois qui règlent tous les devoirs du mari et de la femme, mais aussi des lois de l’Église et des lois civiles qui regardent le mariage et les matières qui en dépendent, ou qui s’y rapportent.
… C’est encore sur le même engagement que sont fondées les lois qui font passer aux enfants les biens des parents après leur mort, parce que les biens étant « nécessaires » (donnés) aux hommes pour tous les différents besoins de la vie,… il est de l’ordre naturel qu’après la mort des parents les enfants recueillent leurs biens, comme un accessoire de la vie qu’ils ont reçue d’eux.
La seconde espèce d’engagements donne à chacun sa place dans la société où il vit, marque sa situation, les relations qui le lient aux autres, les devoirs propres au rang qu’il occupe, et place chacun dans le sien par la naissance, par l’éducation, par les inclinations et par les autres effets de sa conduite, qui rangent les hommes.
« On voit dans toutes ces sortes d’engagements et dans tous les autres qu’on saurait penser » que les hommes ne les contractent que par « l’exercice de l’amour mutuel, et que tous les différents devoirs que prescrivent les engagements ne sont autre chose que les divers effets que doit produire cet amour, selon les conjonctures et les circonstances. Ainsi, en général, les règles qui commandent de rendre à chacun ce qui lui appartient, de ne faire tort à personne, de garder toujours la fidélité et la sincérité, et les autres semblables, ne commandent que des effets de l’amour mutuel. Car aimer, c’est vouloir et faire du bien ; et on n’aime point ceux à qui on fait quelque tort, ni ceux à qui on n’est pas fidèle et sincère.
On fait ici ces réflexions pour faire voir que, comme c’est cette seconde loi qui est le principe et l’esprit de toutes celles qui regardent les engagements, ce n’est pas assez de savoir, comme savent les plus barbares, qu’il faut rendre à chacun ce qui lui appartient, qu’il ne faut faire tort à personne, qu’il faut être sincère et fidèle, et les autres règles semblables, mais qu’il faut, de plus, considérer l’esprit de ces règles et la source de leur vérité dans la seconde loi, pour leur donner toute l’étendue qu’elles doivent avoir. »
– Je prie le lecteur de bien marquer cette façon de voir de Domat : ce n’est pas dans la raison abstraite que ces règles prennent leur principe et leur force, c’est dans l’amour mutuel, dans la réalité vivante de nos affections, et les engagements qui lient les hommes entre eux, sous quelque forme que ce soit, sont la suite de ces affections et la source de ces règles.
Par cette manière d’envisager l’origine des lois naturelles, Domat creuse un abîme entre lui et les autres théoriciens de droit naturel et de morale, et donne une vue des conditions de la vie sociale individuelle tellement élevée, que personne après lui ne la comprendra plus.
« Les fautes », continue-t-il, « que l’on voit dans la société de contraire à l’ordre est une suite naturelle…, non plus de l’amour mutuel dont le caractère était d’unir les hommes dans la recherche de leur bien commun…, mais de cet autre amour tout opposé dont le caractère lui a justement donné le nom d’amour-propre, parce que celui en qui cet amour domine ne recherche que des biens qu’il se rend propres, et qu’il n’aime dans les autres que ce qu’il peut rapporter à soi. »
Mais on voit par la conduite de la société « qu’une aussi méchante cause que notre amour-propre et un poison si contraire à l’amour mutuel qui devrait être le fondement de la société, se transforme en des remèdes qui la font subsister ; car c’est ce principe de division qui réunit encore les hommes en mille manières et qui entretient la plus grande partie des engagements. On pourra juger de cet amour-propre dans la société, et du rapport d’une telle cause à un tel effet, par les réflexions qu’il sera facile de faire sur la remarque qui suit. »
– L’amour-propre « n’ayant pas dégagé l’homme de ses besoins, et les ayant au contraire multipliés, il a aussi augmenté la nécessité des travaux et des commerces, et en même temps la nécessité des engagements et des liaisons ; car aucun ne pouvant se suffire seul, la diversité des besoins engage les hommes à une infinité de liaisons sans lesquelles ils ne pourraient vivre.
Cet état des hommes portent ceux qui ne se conduisent que par l’amour-propre, à s’assujettir aux travaux, aux commerces et aux liaisons que leurs besoins rendent nécessaires ; et pour se les rendre utiles, et y ménager et leur honneur et leur intérêt, ils y gardent la bonne foi, la fidélité, la sincérité, de sorte que l’amour-propre s’accommode à tout pour s’accommoder de tout ; et il sait si bien assortir ses différentes démarches à toutes ses vues, qu’il se plie à tous les devoirs, jusqu’à contrefaire les vertus ; et chacun voit dans les autres, et s’il s’étudiait, verrait en soi-même les manières si fines que l’amour-propre sait mettre en usage pour se cacher et s’envelopper sous les apparences des vertus mêmes qui lui sont les plus opposées. »
– L’amour-propre nous oblige à nous conformer aux devoirs qui dérivent de l’amour mutuel, car l’amour-propre aussi bien que l’amour mutuel sont sujets à la première loi : la recherche de l’accord de nos idées, et, par suite, de nos actes et de nos sentiments, aurait pu continuer Domat, car il conclut : « C’est cette lumière qui fait connaître à l’homme les règles naturelles de l’équité : tous les hommes ont dans l’esprit les impressions de la vérité de ces lois naturelles : qu’il ne faut faire tort à personne ; qu’il faut rendre à chacun ce qui lui appartient ; qu’il faut être sincère dans les engagements, fidèle à exécuter ses promesses, et autres règles semblables de la justice et de l’équité, car la connaissance de ces règles est inséparable de la raison, ou plutôt la raison n’est elle-même que la vue et l’usage de toutes ces règles. »
– La raison n’est donc pas, pour Domat, une entité abstraite qui impose ses vérités à la pensée humaine, mais elle est simplement la vue et l’usage des lois naturelles ; et sous cette forme elle n’a rien pu corrompre, comme le veut Pascal, mais étant incomplète par elle-même et dépendante du développement des affections humaines, elle ne peut interpréter et appliquer les lois naturelles que dans la mesure de ce développement. Façon vivante, concrète de comprendre la raison, qui suffit à Domat pour exposer d’une manière magistrale comment les lois arbitraires surgissent des lois naturelles, du même coup qu’il confirme cette pensée de Pascal : Il y a sans doute des lois naturelles, mais cette belle raison corrompue a tout corrompu.
« Les lois naturelles sont toutes celles qui sont la suite nécessaire des deux premières lois, et qui sont tellement essentielles aux engagements qui forment l’ordre de la société, qu’on ne saurait les changer sans ruiner les fondements de cet ordre.
On voit par cette première idée de la nature des lois naturelles… qu’elles ont leur origine dans les deux premières lois dont elles ne sont qu’une extension ; et que, par exemple, ces règles naturelles de l’équité, qui ont été remarquées, et les autres semblables, ne sont autre chose que ce que l’esprit de la seconde lui demande en chaque engagement, et ce qu’il y marque d’essentiel et de nécessaire. »
– Domat joute dans ces passages à l’expression de lois naturelles celle d’« immuables » que nous avons omise, parce que suivant notre façon de penser plus étroite, c’est-à-dire plus abstraite, nous n’observons point de quelle façon ample Domat la conçoit. Pour nous une loi immuable est une loi qui ne saurait changer, une loi absolue, la loi considérée en soi, tandis que l’ami de Pascal considère les lois naturelles qu’il dit immuables, non pas en elles-mêmes, mais dans les rapports dont elles sont l’expression. Sans les obligations de ne faire tort à personne, de rendre à chacun ce qui lui appartient, sans la sincérité dans le langage et la fidélité dans les promesses, aucune société humaine n’est possible, fût-ce celle d’une bande de sauvages ou de brigands qui, tout en méconnaissant les lois naturelles à l’égard des autres, les observent cependant entre eux. C’est en ce sens que Domat entend l’expression immuables, et qu’il distingue avec raison les lois naturelles et immuables des deux premières lois, seules vraiment absolues.
« De ce caractère des lois naturelles » qui dérivent de l’amour d’autrui et qui sont immuables quant à l’existence de la société, mais qui ne sont observées par les individus que pour autant que leur amour-propre et leurs passions personnelles ne les en détournent point, « il est résulté », reprend Domat, « la nécessité d’établir des lois arbitraires ou positives pour régler les difficultés qui naissent de leur application.
Ainsi, pour un premier exemple de la nécessité des lois arbitraires, c’est une loi naturelle que les pères doivent laisser leurs biens à leurs enfants après leur mort, et c’est aussi une loi qu’on met communément au nombre des lois naturelles, qu’on puisse disposer de ses biens par un testament. Si on donne à la première de ces deux lois une étendue sans aucune borne, un père ne pourra disposer de rien, et si on étend la seconde à une liberté indéfinie de disposer de tout, comme faisait l’ancien droit romain, un père pourra priver ses enfants de toute part en sa succession, et donner tous ses biens à des étrangers.
On voit par ces conséquences si opposées, qui suivraient de ces deux lois entendues indéfiniment, qu’il est nécessaire de donner à l’une et à l’autre quelques bornes qui les concilient.
Ainsi, pour un autre exemple, c’est une loi naturelle que celui qui est le maître d’une chose en demeure toujours le maître, jusqu’à ce qu’il s’en dépouille volontairement, ou qu’il soit dépouillé par quelque voie juste et légitime ; et c’est une autre loi naturelle aussi que les possesseurs ne soient pas toujours en péril d’être troublés jusqu’à l’infini, et que celui qui a possédé longtemps une chose en soit cru le maître, parce que les hommes ont naturellement soin de ne pas abandonner à d’autres ce qui leur appartient, et qu’on ne doit point présumer sans preuves qu’un possesseur soit usurpateur.
Si on étend trop la première de ces deux lois, qui veut que le maître d’une chose ne puisse en être dépouillé que par de justes titres, il s’ensuivra que quiconque pourra montrer que lui ou ceux dont il a les droits ont été les maîtres d’un héritage, quand il y aurait plus d’un siècle qu’ils eussent cessé de le posséder, rentrera dans cet héritage et en dépouillera le possesseur, si avec cette longue possession il ne peut montrer un titre qui ait ôté le droit de ce premier maître. Et si, au contraire, on étend trop la règle qui fait présumer que les possesseurs sont les maîtres de ce qu’ils possèdent, on fera perdre injustement la propriété à tous ceux qui ne se trouvent pas en possession.
Il faut remarquer dans tous ces exemples et dans les autres semblables des lois arbitraires qui sont des suites des lois immuables, que chacune de ces lois arbitraires a deux caractères qu’il est important d’y reconnaître et de distinguer, et qui font comme deux lois en une. Car il y a dans ces lois une partie de ce qu’elles ordonnent, qui est un droit naturel, et il y en a une autre qui est arbitraire. Ainsi, la loi qui règle la légitime des enfants, renferme deux dispositions : l’une, qui ordonne que les enfants aient part dans la succession de leurs pères, et c’est une loi immuable ; et l’autre qui règle cette portion à un tiers ou une moitié, ou plus ou moins, et celle-ci est une loi arbitraire. Car ce pouvait être ou les deux tiers, ou les trois quarts, si le législateur l’avait ainsi réglé.
Nous avons donc en France, comme partout ailleurs, l’usage des lois naturelles et des lois arbitraires ; mais avec cette différence entre ces deux sortes de lois, que tout ce que nous avons de lois arbitraires est compris dans les ordonnances et dans les coutumes, et dans les lois arbitraires du droit romain et du droit canonique que nous observons comme des coutumes. » La coutume fait toute l’équité, avait dit Pascal.
Mais pour les lois naturelles, comme nous n’en avons le détail que dans les livres du droit romain, et qu’elles y sont avec peu d’ordre, et mêlées avec beaucoup d’autres qui ne sont ni naturelles, ni de notre usage, leur autorité s’y trouve affaiblie par ce mélange, qui fait que plusieurs ou ne veulent ou ne savent pas discerner ce qui est sûrement juste et naturel de ce que notre raison et notre usage ne reçoivent point.
La justice universelle de toutes les lois consistedans leur rapport à l’ordre de la société, dont elles sont les règles ; mais il y a cette différence entre la justice des lois naturelles et la justice des lois arbitraires, que les lois naturelles étant essentielles aux deux premières lois et aux engagements qui en sont les suites, elles sont essentiellement justes, et que leur justice est toujours la même dans tous les temps et dans tous les lieux.
« Mais quoique les lois naturelles ou immuables soient essentiellement justes et qu’elles ne puissent être changées, il faut prendre garde de ne pas concevoir par cette idée des lois naturelles, que parce qu’elles sont immuables et qu’elles ne souffrent point de changement elles soient telles qu’il ne puisse y avoir d’exception d’aucune des lois qui ont ce caractère. »
– Domat en donne différents exemples ; le plus curieux, il l’emprunte à Pascal même, et l’expose dès la seconde page de son admirable traité, comme pour résumer d’avance la doctrine entière : « Il n’y a personne qui ne sente par l’esprit et le cœur qu’il n’est pas permis… de tuer ou de voler les autres, et qui ne soit plus pleinement persuadé de ces vérités qu’on ne saurait l’être d’un théorème de géométrie. Cependant ces vérités mêmes que l’homicide et le vol sont illicites, tout évidentes qu’elles sont, n’ont pas le caractère d’une certitude égale à celle des premiers principes dont elles dépendent, puisqu’au lieu que ces principes sont des règles dont il n’y a point de dispense ni d’exception, celles-ci sont sujettes à des exceptions et à des dispenses. » Domat cite des faits de la Bible ; prenons l’exemple de Pascal : « Pourquoi me tuez-vous ? Eh quoi ? ne demeurez-vous pas de l’autre côté de l’eau ? Si vous demeuriez de ce côté, je serais un assassin, et cela serait injuste de vous tuer de la sorte. »
– La justice universelle de toutes les lois, vient de nous dire Domat, consiste dans leur rapport à l’ordre de la société. Je suis donc un assassin justement puni par les lois si je tue quelque membre de cette société et en compromets la sécurité ; mais si ceux de l’autre côté de l’eau attaquent cette même société et en compromettent l’existence, pour la même raison aussi je deviens un brave en défendant, et peut-être un héros en sauvant cette société. Le principe est le même.
« Il est facile de reconnaître, reprend Domat, que les exemptions et les dispenses aux lois naturelles ont leur fondement sur l’Esprit des lois, et qu’elles sont elles-mêmes d’autres lois qui n’altèrent pas le caractère des lois immuables, dont elles sont des exceptions, et qu’ainsi toutes les lois se concilient les unes avec les autres, et s’accordent entre elles par l’esprit commun qui fait la justice de toute ensemble. Car la justice de chaque loi est renfermée dans ses bornes. » – Une loi est juste, avait dit Pascal, parce qu’elle est loi, « et aucune ne s’étend », continue son ami, « à ce qui est autrement réglé par une autre loi ; et il paraîtra dans toutes sortes d’exceptions et de dispenses qui sont raisonnables qu’elles sont fondées sur quelques lois. De sorte qu’il faut considérer les lois qui souffrent des exceptions comme des lois générales qui règlent tout ce qui arrive communément ; et les lois qui font des exceptions et des dispenses, comme des règles particulières qui sont propres à de certains cas, mais les unes et les autres sont des lois également justes, selon leur usage et leur étendue. »
– Et Domat expliquera jusqu’au célèbre aphorisme de son ami : erreur en deçà, vérité au-delà des Pyrénées. « Il faut enfin remarquer sur les lois naturelles, qu’il y en a quelques-unes qui, quoiqu’elles soient reconnues pour telles dans toutes les polices, n’ont pas néanmoins partout la même étendue et le même usage. Ainsi il n’y a point de police où l’on ne reconnaisse qu’il est du droit naturel que les frères et les autres collatéraux succèdent à ceux qui ne laissent ni descendants ni ascendants ; mais ce droit est considéré bien différemment en divers lieux. Car, dans les provinces de ce royaume qui se règlent par les coutumes, le droit des héritiers du sang est tellement regardé comme une loi naturelle, que ces coutumes ne reconnaissent pas même d’autres héritiers… Mais dans les autres provinces qui ont pour leur coutume le droit écrit, chacun a la liberté de priver ses collatéraux, et même ses frères, de tous ses biens, et même de les donner à des étrangers. »
Domat nous a dit que de l’amour mutuel dérivent tous les devoirs, devoirs qui deviennent des engagements, lesquels, se transformant en morale sociale, deviennent coutumes et droits. Dans la législation de Rome, qui fut rédigée alors que les affections et les liens de famille s’étaient relâchés, la loi en devint l’expression ; tandis que dans nos provinces à populations plus jeunes, à affections plus fortes, les droits de famille se maintinrent de la même façon qu’elles s’étaient formées à l’origine même de Rome.
« La coutume fait toute l’équité, » nous dit Pascal ; « par cette seule raison qu’elle est reçue, c’est le fondement mystique de son autorité. » Et son ami nous explique que, « la loi étant une coutume et la coutume une loi », l’une et l’autre sont, suivant leur étendue, l’expression des engagements contractés et transmis de génération en génération.
Enfin, la doctrine de Domat nous explique jusqu’au passage de Pascal le plus empreint, en apparence, de son scepticisme désespérant : « Il est juste que le juste soit suivi, il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi… Il faut donc admettre ensemble la justice et la force ; et pour cela faire que ce qui est juste soit fort et que ce qui est fort soit juste. »
D’après Domat, le juste provient des affections humaines, de l’intelligence que les hommes en acquièrent, et des engagements, des coutumes qui en dérivent. Lors donc « qu’il est nécessaire de suivre le fort », le fort pour cette raison n’est pas le juste. Mais dès qu’il naît entre le fort et le faible des affections, des engagements, des obligations réciproques, il en surgira des droits pour tous deux, droits qui s’imposeront au fort en même temps qu’ils soutiendront le faible. Momentanément la force peut primer le droit, mais il n’existe d’état social qu’à la condition que le droit prime la force. Le passage de Pascal ne signifie autre chose, sinon que les hommes pour pouvoir vivre en société doivent obliger le fort à être juste, et que pour pouvoir maintenir l’état social qu’ils ont fondé, il faut que le juste soit toujours fort.
Malgré ces rapports si frappants entre les doctrines des deux amis, dont l’une achève et complète l’autre, celle de Pascal n’en reste pas moins l’acte d’accusation le plus véhément qui ait jamais été dressé contre la raison humaine. Tandis que la doctrine de Domat, dans son incomparable sérénité, paraît vraiment, comme l’écrit d’Aguesseau, le plan le plus parfait de la société qui ait jamais paru, Pascal s’efforce de trouver dans la raison humaine la raison divine qu’il aime et qu’il veut, et, dans son impuissance de la découvrir, ne voit de salut que dans un abandon complet à Dieu. Domat, moins vaste dans ses ambitions, mais aussi plus pondéré, ne comprend la raison humaine que dans l’application des devoirs qui dérivent de nos affections mutuelles et de l’intelligence de ces devoirs, fondements, sous le nom de lois naturelles, de tout état social, et sources des lois positives ou arbitraires. Tous deux sont animés d’une foi également sincère ; mais tandis que le premier, emporté par la sienne, écrase cette pauvre raison, le second nous en donne la théorie la plus pure et la plus complète, en lui obéissant tout simplement. C’est qu’on ne découvre pas la raison humaine : elle s’impose, que ce soit sous la forme primitive et irréfléchie de croyances et de coutumes, ou sous celle plus savante et plus tardive de sciences et de lois.
Il en résulte que plus les peuples, dans leur origine, développent leurs affections et se donnent la conscience des devoirs qui en dérivent, plus ils se donnent aussi des coutumes fortes, des traditions vigoureuses, une civilisation élevée. Mais à mesure aussi que la conscience de ces devoirs faiblit et que les fortes affections se perdent, l’intelligence des devoirs se trouble, les peuples se dégradent. Alors surgissent en morale les théories les plus absurdes. Les uns ne voient plus que dans l’imposition tyrannique de leur prétendue raison, les autres dans l’abandon absolu de tout amour-propre, les troisièmes dans l’intérêt individuel ou les jouissances personnelles, les derniers enfin dans l’intérêt social, l’avenir de l’humanité ; tandis que tous ces principes, par leur caractère exclusif et abstrait, ne sont que les symptômes d’un état social en décomposition.
La morale sociale s’est corrompue. Jusqu’à quel point et à quelles conditions la morale individuelle peut-elle parvenir à la relever ?
L’homme étant un être intelligent ne saurait vivre sans notions morales, sans se faire des idées générales sur ce qui lui est agréable ou pénible, sur ce qui lui semble préférable ou lui paraît mériter le dédain. Il le fait pour lui-même d’abord. Il le fait ensuite pour les autres parce qu’il vit en société.
Ainsi les hommes, dès leurs origines, se formèrent des notions de devoirs et de droits d’après l’observation de leurs goûts et de leurs mutuelles affections. Grâce à leur besoin d’union et d’entente, et en dépit de leurs luttes et de leurs discordes, ils parvinrent à établir des règles de conduite, et, poussés par leurs espérances et leurs terreurs, ils les placèrent sous l’égide de leurs croyances religieuses, reflets de ces terreurs et de ces espérances, afin de leur donner plus de force et d’autorité.
Ainsi naissent les civilisations. Les croyances prennent un caractère de plus en plus élevé, les règles de conduite se perfectionnent jusqu’au moment où, les croyances disparaissant devant l’expérience, chacun revient à se former des idées ou des théories particulières sur les règles ou les principes qu’il entend observer.
De la sorte, lors de l’affaiblissement des croyances religieuses en Grèce, Socrate identifia le bien et la science du bien et supposa qu’il suffirait de connaître le danger pour être courageux, de savoir ce que c’est que la vertu pour la pratiquer ; Diogène et les cyniques qui lui succédèrent firent consister le bien dans l’application des instincts naturels de l’homme ; puis Épicure et les siens s’efforcèrent de restreindre cette théorie en distinguant l’exagération des plaisirs de leur usage modéré, tandis que Zénon et ses disciples, les stoïciens, crurent que ce n’était que par le mépris du mal et le dédain de la douleur que l’homme pouvait atteindre la félicité.
Vint le Christ qui enseigna, au nom du Dieu créateur, une morale toute nouvelle. Venu sur terre pour racheter par ses souffrances les péchés de tous, il proclama par la parole et par l’exemple qu’il fallait pardonner les offenses, aimer le prochain, se dévouer les uns aux autres, et promit une récompense éternelle à quiconque suivrait ses préceptes. Il trouva des apôtres innombrables, des martyrs, des héros pour répandre son enseignement dans le monde. Les peuples et les États incapables de se régénérer disparurent, et une civilisation nouvelle surgit au sein des nations jeunes, naïves de cœur, fraîches d’esprit.
En même temps que se formèrent leurs traditions sociales, l’Église se constitua. Elle prêcha la charité, la miséricorde aux forts, la patience, la soumission, l’amour aux faibles, et porta jusque dans le moindre hameau, jusque dans la hutte du plus pauvre et du plus délaissé ses espérances, ses conseils et ses consolations. Son autorité grandit. Elle assuma un rôle tantôt politique, tantôt administratif ou judiciaire, dirigea les universités et les écoles, prodigua l’enseignement. La nouvelle civilisation ne cessa de croître et de s’étendre jusqu’au moment où les esprits, par suite de leur développement, s’en prirent aux dogmes mêmes qui formaient la base de leurs connaissances morales.
Les dogmes ne furent ni élargis ni fortifiés, mais transformés, restreints ou brisés. Leur autorité se modifia ou disparut. La morale perdit son unité. Des théories de toute sorte sur la destinée de l’homme, ses devoirs et ses droits, la nature du bien et du mal, reparurent. Lorsque les croyances communes qui forment, dès l’origine, le ciment intellectuel des peuples disparaissent, les individus sont obligés de chercher en eux-mêmes un soutien à leur jugement, à leurs affections et à leurs actes.
Nous ne nous arrêterons ni à la qualité, elles valent ce qu’elles ont vécu, ni à la quantité, elles sont innombrables, de toutes les théories particulières qui depuis les grandes luttes religieuses se sont répandues sur l’Europe : morale de l’égoïsme et de l’intérêt bien ou malentendu, morale mystique ou morale de sentiment, morale à principes immuables ou changeants. Si louable qu’ait été l’intention de leurs auteurs, si belles qu’aient été leurs aspirations, toutes les théories particulières s’effondrent devant cette question : Répondent-elles à tous les faits de l’histoire, à tous les caractères de l’humanité ?
Au lieu de confondre nos petites aspirations personnelles avec les grandes impulsions du genre humain et de faire de nous-même le centre de tout horizon, considérons l’humanité et son histoire, et voyons comment les morales ont pris naissance et se sont fondées sur les croyances religieuses. Ces croyances sont le reflet non seulement de tous les sentiments, de toutes les pensées, de tous les actes des hommes, mais encore de toutes les choses du ciel et de la terre. Ce sont elles qui créent les coutumes et forment les mœurs, décidant du juste et de l’injuste dans les législations et les luttes des peuples entre eux. Que signifient, en présence de ces immenses manifestations de l’esprit humain, quelques théories personnelles sur la nature du bien et du mal ? Simples règles de conduite, inventées à défaut de mieux, propres à leurs auteurs et à leur école, si tant est qu’ils soient parvenus à en fonder une, que peuvent-elles comme soutien des volontés et direction des passions, en regard de ces forces de foi et de tradition qui fondent et maintiennent les civilisations ?
Que l’on invente les doctrines les plus sages, les préceptes les plus admirables, tant qu’ils ne sont pas soutenus par une foi vive ou une science infaillible, ils restent, comme tous les rêves, l’expression de l’état des esprits du moment.
Les certitudes humaines ne se fondent que sur la foi ou sur la science. C’est pour avoir fait des astres leurs dieux que les hommes en ont observé si minutieusement les mouvements, et qu’après des siècles d’efforts, ils ont découvert les lois de la gravitation. De même ce n’est qu’en étudiant et comprenant la puissance de la foi, que la science de la morale peut s’élever jusqu’à la vérité. Croire en leur antagonisme est déjà une théorie personnelle et la preuve d’un esprit incomplet.
Les hommes tirent profit des forces de la nature selon les connaissances qu’ils en ont et usent de leurs forces propres d’après la science qu’ils en possèdent. Aussi l’esprit humain n’est-il pleinement satisfait que par la découverte des causes et la connaissance des lois qui en régissent l’action. Or c’est précisément par leur interprétation de la nature et de l’origine des choses que les croyances religieuses ont de tous les temps acquis leur influence sur la destinée des hommes, comme ce n’est que par l’étude des causes qui déterminent la destinée des hommes que la science de la morale peut acquérir l’autorité de la vérité.
La science de la morale procède toutefois en sens inverse des croyances religieuses. Tandis que celles-ci étendent leurs dogmes jusqu’à la direction de chaque volonté humaine, c’est de l’étude des conditions et du caractère de ces volontés que relève la morale. Elle grandit avec chaque amélioration apportée à l’éducation de l’enfant, déchoit à chaque faute qu’on y commet ; elle s’étend avec toute législation bien entendue, se corrompt avec toute loi mal faite ; elle s’élève avec la prospérité des peuples et se perd à leurs époques de décadence. Les familles incapables de refaire leur santé morale ou physique, les nations impuissantes à se régénérer, les États réfractaires à toute entente s’éteignent et disparaissent pour faire place à d’autres, comme les individus sont détruits par les accidents qu’ils n’ont su prévoir, les maladies qu’ils n’ont su conjurer ou les vices auxquels ils se sont abandonnés.
La véritable science de la morale n’est pas plus celle des livres, que les croyances religieuses d’un peuple ne sont les formules gravées sur les murs de ses temples. Quand nous parlons de la morale, nous entendons parler d’une science réelle, vivante, et qui, si elle existe dans l’idée, entraîne sa conséquence dans les actes. Comme la science de la physique nous a amenés à nous servir de la vapeur pour voyager, comme celle de la chimie nous a permis de nous éclairer avec du gaz, il existe une science du bien, dont la pratique est une conséquence forcée des connaissances que nous avons acquises en morale.
Autant la science de la morale se rapproche par son caractère universel des croyances religieuses, autant elle s’éloigne des théories particulières. Celui qui s’imagine la posséder parce qu’il en connaît l’un ou l’autre élément, se trompe à l’égal du médecin qui croirait connaître la nature d’une maladie parce qu’il en connaît quelques symptômes. Mais nous sommes ainsi faits ; nous ne comprenons pas que la vraie science puisse se trouver au-delà de celle que nous croyons posséder, ni que la vérité entière puisse être différente du fragment dont nous sommes capables de juger. En toute science cependant tenir compte du connu et de l’inconnu, est une des conditions du progrès dont elle est susceptible.
La science de la morale est l’œuvre des siècles ; toute science y concourt, chacun y contribue. Aussi notre ambition se borne-t-elle à examiner la destinée de l’homme au point de vue de cette coordination des efforts de tous. Nous espérons ainsi mettre la morale, à l’exemple de ses sœurs, sur la voie du progrès et de la vérité.
Combien de définitions n’en a-t-on pas données : la science du bien ou de l’honnête, celle des mœurs, celle de la volonté, celle de l’amour, celle du plaisir, celle de l’intérêt, celle des devoirs que nous dicte la conscience, celle de la raison qui les commande. Il est une définition que toutes supposent et qui les embrasse toutes : la morale est la science des conditions du bonheur humain. Ce bonheur, chacun le veut, chacun le cherche, n’eût-il aucune idée de l’existence d’une science morale ; et aucune doctrine, sous quelque forme qu’elle se présente, n’a un autre objet.
Que n’a-t-on pas écrit, invoquant le fatum des anciens et le dogme de la prédestination, faisant appel aux lois de la nature et de l’histoire, aux forces physiques et à leur action brutale, à l’organisme humain et à ses nécessités, à l’ignorance et à l’inconscience, à l’hérédité et à l’atavisme, pour prouver que l’aveugle fatalité domine les actes des hommes ? Tout a servi pour montrer l’homme, simple machine, déterminé dans chacune de ses affections et dans chacun de ses mobiles. Que n’a-t-on épuisé tous les arguments ! on aurait transformé les théories en une science véritable et donné le moyen même de triompher de la fatalité. Depuis la foudre qui tonne dans les cieux jusqu’au feu qui éclate dans les profondeurs des mines, de quelles forces, de quels dangers l’homme ne s’est-il pas rendu maître parce que, grâce à son intelligence, il en a acquis la science ?
Tout est déterminé en nous et autour de nous : la maladie et la santé, le milieu dans lequel nous vivons, l’éducation que nous avons reçue, l’instruction que nous avons acquise. Jouets de tous les caprices de la société au sein de laquelle nous vivons, lorsque, après mûre délibération, nous croyons accomplir un acte en pleine liberté, c’est une préférence inconsciente ou une habitude invétérée qui décident notre choix. Une impressionnabilité plus ou moins grande, une vue myope ou presbyte, une oreille dure ou sensible, une mémoire plus ou moins fidèle, déterminent non seulement nos actes, mais fixent encore les traits les plus saillants de notre caractère, décident de la carrière que nous embrassons, en un mot, de toute notre vie. Qui peut faire un geste qui ne soit l’expression exacte de la constitution de ses organes ? Évoquer un souvenir qui ne soit le produit de la nature de sa mémoire ? Éprouver une sensation autre que celle que ses nerfs lui transmettent ? Ou suivre un instinct différent de ceux qui le poussent ? Tout est déterminé en l’homme. Il apporte en venant au monde ses défauts et ses qualités, aussi bien physiques que moraux. Comme les lions engendrent les lions, les hommes naissent les uns des autres. Toute leur constitution, jusqu’à la manière dont ils conçoivent leur personnalité, est d’instinct et de race. Il y a des races aristocratiques et des races esclaves, des races travailleuses et des races parasites. Une pile électrique entre les mains d’un opérateur nous fait sourire ou grimacer comme cette pile intérieure que nous appelons le système nerveux. J’ai faim, j’ai froid, j’ai sommeil ; suis-je libre de ressentir ces besoins ? et si j’ai conscience de pouvoir lever ou ne pas lever mon bras parce que c’est une action indifférente, ai-je la même conscience de pouvoir à ma guise éprouver la faim et la soif, le froid et le chaud, l’amour et la haine, la colère et la satisfaction ? Enfin, aussi peu que dépend de nous notre naissance, aussi peu dépendent de nous notre jeunesse et notre vieillesse. Comme les plantes poussent, fleurissent et se fanent, ainsi nous naissons, agissons et mourons suivant des lois immuables.
Loin de combattre la doctrine des fatalités, nous voudrions qu’on en fit une science rigoureuse, découvrant les lois qui régissent notre existence, surprenant les causes qui déterminent nos volontés et nos passions, notre hérédité et nos habitudes, nos connaissances et nos erreurs, nos vertus et nos fautes, car dès ce moment nous serions vraiment et entièrement libres dans nos volontés et nos sentiments.
Ce n’est pas parce qu’il a conscience de ses actes que l’homme est libre. Tout être sensible et capable de se mouvoir se rend compte des impressions qu’il reçoit et des actes qu’il accomplit.
Il ne l’est pas davantage à cause qu’il a le choix entre des actes divers et la conscience de pouvoir faire ou ne pas faire une chose. L’ignorance des mobiles qui le déterminent fait seule naître cette conscience et l’illusion de liberté que donne la délibération dans le choix.
Pour échapper aux objections, quelques défenseurs du libre arbitre ont inventé l’indifférence de la volonté. Une volonté indifférente, c’est-à-dire qui ne veut rien, n’existe pas plus qu’une sensation qui ne sent rien, ou une affection qui n’aime pas.
D’autres se crurent obligés de concevoir l’homme placé entre les principes innés du vrai, du beau et du bien et ses passions, ses goûts, ses désirs, et ils attribuèrent le mot de liberté au choix qu’il pouvait faire entre eux. Or l’homme qui se décide en faveur du beau est déterminé par sa préférence du beau, comme celui qui suit ses désirs les plus vils est entraîné par eux. Le premier est naturellement plus parfait, le second l’est moins. La perfection relative des hommes n’est pas plus une preuve de liberté que l’existence de fruits doux et de fruits amers.





























