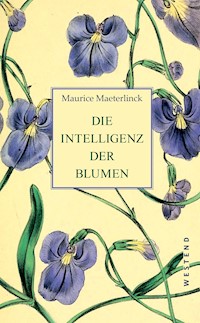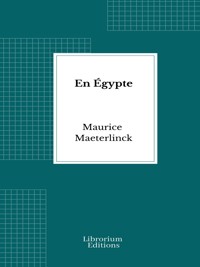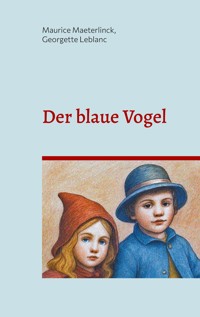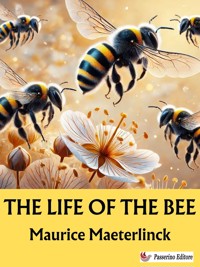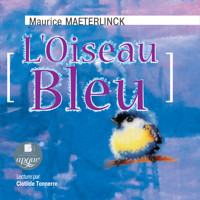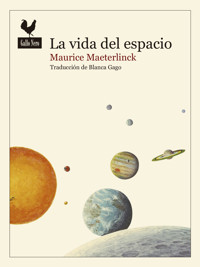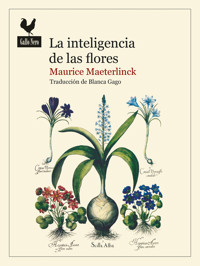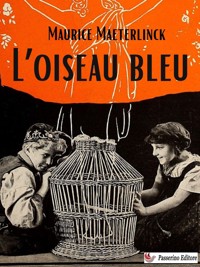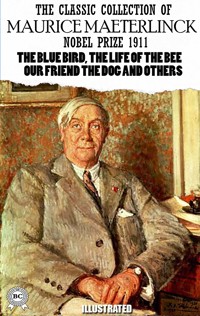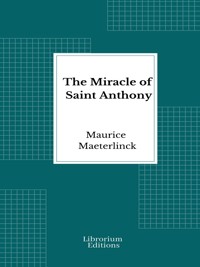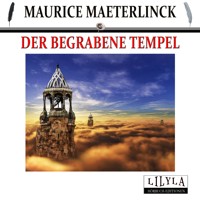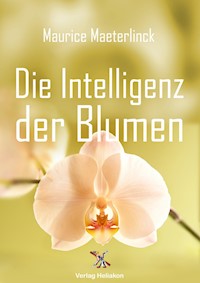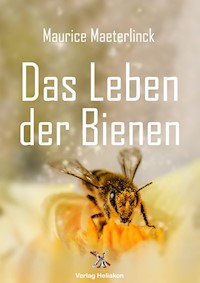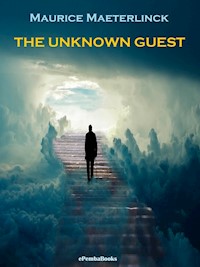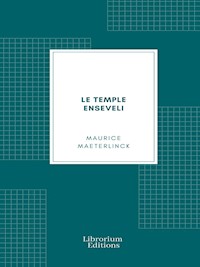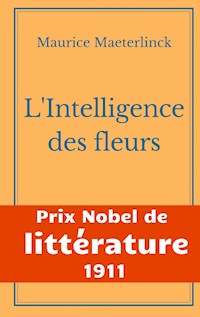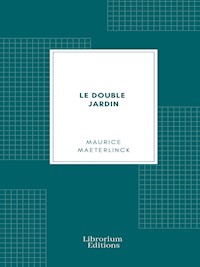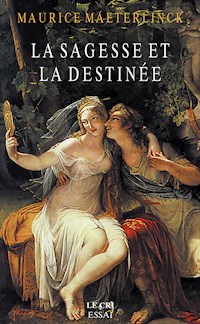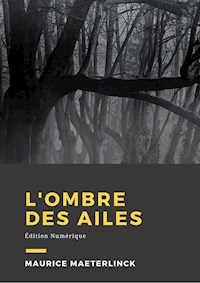
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Librofilio
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Il est certain que de toutes ces ombres, l'homme a su tirer quelque lumière. Il ne faut pas déprécier la région des ombres ; c'est notre véritable séjour, nous y sommes chez nous, nous y demeurerons plus longtemps que dans ce que nous appelons la réalité ; car nous ne sommes que l'ombre de ce que nous croyons être, l'ombre de nous-mêmes.
Nous ne voyons point nos pensées ; nous n'apercevons que l'ombre de leurs ailes.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Maurice Maeterlinck, né le 29 août 1862 à Gand (Belgique) et mort le 6 mai 1949 à Nice (France), est un écrivain francophone belge, prix Nobel de littérature en 1911.
Figure de proue du symbolisme belge, il reste aujourd'hui célèbre pour son mélodrame
Pelléas et Mélisande (1892), sommet du théâtre symboliste mis en musique par Debussy en 1902, pour sa pièce pour enfants
L’Oiseau bleu (1908), et pour son essai inspiré par la biologie
La Vie des abeilles (1901), œuvre au centre du cycle d'essais
La Vie de la nature, composé également de
L'Intelligence des fleurs (1910),
La Vie des termites (1926),
La Vie de l’espace (1928) et
La Vie des fourmis (1930).
Il est aussi l'auteur de treize essais mystiques inspirés par Ruysbroeck l'Admirable et réunis dans
Le Trésor des humbles (1896), de poèmes recueillis dans
Serres chaudes (1889), ou encore de
Trois petits drames pour marionnettes (1894, trilogie formée par
Alladine et Palomides,
Intérieur, et
La Mort de Tintagiles).
Son œuvre fait preuve d'un éclectisme littéraire et artistique (importance de la musique dans son œuvre théâtrale) propre à l'idéal symboliste.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’ombre des ailes
Maurice Maeterlinck
– 1936 –
L'OMBRE DES AILES
Ce qu'on dit n'est que l'ombre de ce qu'on pense ; ce qu'on pense n'est que l'ombre de l'esprit, et l'esprit n'est que l'ombre d'une ombre.
Mais l'ombre d'une ombre n'est-elle pas moins décevante et moins dangereuse qu'une fausse clarté ?
Il est certain que de toutes ces ombres, l'homme a su tirer quelque lumière. Il ne faut pas déprécier la région des ombres ; c'est notre véritable séjour, nous y sommes chez nous, nous y demeurerons plus longtemps que dans ce que nous appelons la réalité ; car nous ne sommes que l'ombre de ce que nous croyons être, l'ombre de nous-mêmes.
Nous ne voyons point nos pensées ; nous n'apercevons que l'ombre de leurs ailes.
Il faut « chercher en gémissant », disait Pascal. Pourquoi en gémissant ? Il faut chercher sérieusement, loyalement et sans trêve, mais non point dans les larmes ou la crainte. On parle aussi du tourment, de l'angoisse, de l'infini. Pourquoi ? L'infini ne devrait pas nous tourmenter ou nous angoisser, mais nous rassurer. Plus on l'interroge, plus on se persuade qu'il ne peut rien nous réserver de plus inattendu que la vie. Selon le point où l'on se place, elle est pour nous le pire ou le meilleur moment.
Il n'est pas question d'enseigner ou de démontrer quoi que ce soit, mais de tâtonnements dans une nuit qui ne nous veut aucun mal. Le véritable titre de ce livre eût été : A tâtons, mais il a déjà servi plus d'une fois et les Ailes l'ont emporté.
Qu'est-ce que s'interroger ou questionner l'inconnu ? C'est dialoguer avec son ombre, et l'ombre peut-elle savoir ce qu'ignore le malheureux qui la projette ?
Tenez pour mort celui qui vous a fait du mal. Vous ne lui en voudrez plus, vous n'aurez plus l'idée de vous venger. Faut-il le voir dans sa tombe pour être convaincu qu'il est mortel, qu'il ne vit déjà plus ?
Je remarque que dans les songes, nous ne prenons pas la mort au sérieux. Elle ne nous fait pas peur en tant que mort. Nous ne la voyons pas. En tout cas, pour ce qui me concerne, je n'ai jamais vu un mort dans mes rêves. Je n'y ai vu que des vivants qui ne vivaient plus sur la terre. Dans nos cauchemars, nous luttons frénétiquement contre des dangers absurdes et épouvantables, nous connaissons des fuites et des poursuites démentielles, mais ne voyons jamais la mort qui est au bout. Pour le dormeur qui représente la vie profonde, la vie instinctive de notre être, elle ne semble pas exister. Si l'observation était générale, ne serait-ce pas un curieux indice ?
« Il faut que nous naissions coupables ou Dieu serait injuste », dit Pascal. Mais ne fut-il pas injuste en nous faisant naître coupables ?
Ne craignons rien. Nous irons où va tout le monde, c'est-à-dire partout ou nulle part.
Quelle est la force, physique, chimique ou mécanique, qui, dans les plantes qui n'ont pas de cœur, fait monter l'eau à raison de dix à cent cinquante centimètres (notamment dans les lianes) par heure ? La capillarité qui elle-même est inexpliquée, ne suffit pas à l'expliquer.
Le Dr Robert A. Millikan, l'un de nos plus illustres physiciens, parlant de Sir James Jeans, l'un de nos plus illustres astronomes, dont les opinions sur les énigmes de l'univers ne sont pas conformes aux siennes, dit : « La seule chose dont nous puissions être parfaitement sûrs, c'est que tous deux, sur ce point, nous ne savons rien. »
De même Sir Arthur S. Eddington déclare : « Il y a, actuellement, quelque chose de radicalement faux dans les conceptions fondamentales de notre physique, et nous ne savons pas comment le redresser. »
Parce que nous croyons parfois comprendre quelques petites choses dans notre vie quotidienne, nous nous imaginons que nous sommes, ipso facto, capables de comprendre n'importe quoi, que tout est fait pour que nous le comprenions, que nous sommes faits pour comprendre tout ; et que ce que nous ne comprenons point est incompréhensible en soi, négligeable, absurde, illogique et fou ; ou plutôt n'existe pas, ne peut pas exister.
Notre soif de justice vient uniquement de l'idée anthropomorphe que nous nous faisons de Dieu. Si nous n'étions pas convaincus que notre Dieu est un homme (et comment serait-il autre chose, puisque c'est nous qui l'avons fait ?) nous ne lui demanderions pas plus de justice que nous n'en demandons à une locomotive qui écrase un enfant ou quelques fourmis. Mais qui ou quoi nous permet de dire que Dieu est un homme plutôt qu'un singe ou une puce ? Le singe et la puce sont aussi bien que nous des créatures de Dieu et doivent lui ressembler comme nous nous flattons de lui ressembler. Il est donc autre chose, et ce n'est pas en enflant jusqu'à l'éclatement toutes nos forces et toutes nos facultés que nous nous rapprocherons de Lui.
Nous serons débarrassés d'un grand souci, de la principale cause de nos erreurs, de nos déceptions, de nos tourments, quand nous ne chercherons plus la justice hors de nous.
Dans les grandes catastrophes, ce qui nous accable bien plus que les conséquences matérielles ou les douleurs physiques, c'est l'injure à notre moi. Le point central, le seul point sensible est atteint et l'ensemble se désagrège. première réaction est la stupéfaction et l'indignation. Elles sont telles qu'on oublie le principal et le reste ; et lorsqu'elles sont passées, on commence déjà à s'habituer au malheur.
Ne reste-t-il aux atomes, invisibles parcelles de la matière qui firent partie de l'homme, aucun souvenir de l'extraordinaire aventure ? Mais que peuvent ces parcelles noyées dans l'infini ?
Demandez aux mourants, aux meilleurs, aux plus sages, à ceux qui non seulement gardent toute leur lucidité, mais dont les facultés intellectuelles se sont épurées par l'approche de la fin : « Qu'avez-vous à me dire ? Quel est le grand secret que vous apprit la vie et quel est le mot d'ordre ? » Ils ne répondront pas, ils ne savent pas encore.
L'avenir dévore le présent que le passé se met à digérer, si bien que le malheureux présent n'a jamais une minute à lui.
Si l'on n'avait pas élevé les agneaux pour les tuer, ils n'auraient jamais vécu. Eût-ce été préférable ? A qui le demander ? La question est la même pour tout ce qui existe Mais comme ce qui est ne peut plus ne plus être, elle ne se pose point.
Était-il possible de ne pas vivre ? Non puisque nous vivons ou avons vécu. Ne pas vivre, c'eût été rester dans le néant. Mais le néant n'est pas. S'il était possible ou imaginable, ce serait de la vie ou l'existence sous une autre forme ; et dès lors, il ne serait plus ce néant qui ne peut être qu'à condition de n'être point. Nullissimum Nihilum, disait Bossuet, qui aimait à chercher la grandeur dans le Néant.
Nous croyons que nous apprendrons quelque chose quand nous serons morts. Mais que pourrions-nous apprendre ? L'univers ou Dieu lui-même sait-il ce qu'il est ? Qu'est-ce que savoir ce qu'on est ? Comment voulez-vous qu'il s'explique ? Il remonterait aux causes ? Mais les causes elles-mêmes sont causées, et l'on arriverait à la cause sans cause de toutes les causes de la sagesse hindoue. Mais fussions-nous dix mille fois plus intelligents, nous ne l'atteindrions que pour trouver derrière elle une autre cause qui n'aurait plus de nom ni de forme et que nous ne dépasserions jamais si nous étions cette cause même. A moins qu'il n'y ait pas de cause, et que la notion de cause ne soit qu'une infirmité de notre cerveau.
C'est défendable. Qu'est-ce qu'une cause ? Consultons les grands dictionnaires. « Une cause, dit Littré, c'est ce qui fait qu'une chose est ou s'opère. » « C'est le principe d'un être ou d'une chose », affirme Larousse. « C'est, déclare Bescherelle, le principe qui produit ou concourt à produire un effet, qui fait qu'une chose est, a lieu. »
C'est tout, c'est-à-dire à peu près rien. Nous restons à la surface. Il faudrait autre chose qu'un homme pour pouvoir la trouer. Cherchez les mots Dieu, espace, temps, infini, éternité, mort vie, électricité, etc., vous aurez la même déception, parce que nous ignorons la signification réelle et profonde de presque tout ce qui existe Le dictionnaire est le cénotaphe de notre sagesse et le tombeau de notre ignorance.
Il est naturel qu'il y ait quatre, cinq, six sept, huit ou n dimensions. Si, au lieu de croître en hauteur, nous nous étions allongés comme des êtres extra-plats, nous n'en connaîtrions que deux, serions satisfaits, et probablement aussi intelligents qu'aujourd'hui.
Connaissant deux ou trois dimensions supplémentaires, nous entrerions dans la mort et en sortirions sans nous en apercevoir, car la mort n'est qu'une dimension inconnue de notre être. L'étude, à peine commencé, de l'hyperespace, nous permettra peut-être de nous en rendre compte.
Parce que nous ne pouvons traverser un rocher, ce n'est pas une raison pour que d'autres ne s'y promènent comme nous le ferions dans un nuage.
Un monde immatériel peut être aussi plein de réalités aussi résistantes que les nôtres.
L'univers n'a pas été créé ; il est une création continue, ce qui, au demeurant, ne l'explique pas davantage.
Si j'étais Dieu, je mettrais au premier rang des élus ceux qui ne crurent pas en moi tel qu'on me présentait.
On s'accoutume au malheur plus vite qu'on ne s'y attendait. On ne s'accoutume pas au bonheur parce qu'il est bref et que, durant le peu de temps qu'on le possède, on ignore ce qu'il est.
J'ai connu une « Voyante » qui, en état de train se, avait exactement prévu tous les malheurs qui lui arriveraient : remariage avec un homme plus jeune qu'elle, sorte de Don Juan qui buvait, scènes tragiques, ruine, misère, mort dans l'indigence totale, etc. Mais elle ne savait pas ou avait oublié qu'elle les avait prédits. N'est-ce pas en plus net, en plus gros, ce qui nous attend tous ?
Et si quelqu'un, ayant sténographié ce qu'elle disait, le lui avait mis sous les yeux au moment qu'elle allait lier son sort à l'homme fatal, aurait-elle tenu compte de ses avertissements ? Il est fort probable qu'elle n'y aurait pas cru, car on trouve des exemples analogues dans les annales métapsychiques. Nous sommes trop souvent nos propres Cassandres. Après quoi nous nous plaignons du Destin, qui, de quelque façon, nous a presque toujours avertis.
On peut remarquer que Jésus, dans les Évangiles, s'exprime souvent comme le « Contrôle », c'est-à-dire comme l'esprit désincarné qui inspire le médium et parle au nom-des morts. Cet esprit désincarné doit faire passer sa pensée à travers l'épaisseur matérielle du médium, et du médium, à travers l'obstacle charnel de celui qui consulte ce dernier. C'est pourquoi Jésus n'expose presque jamais une doctrine méthodiquement développée, mais procède par allusions, par ellipses, par paraboles ou allégories, à petites phrases détachées, fragmentaires, discontinues, souvent énigmatiques, chargées de sens cachés ou tronqués et n'ayant parfois qu'un lointain rapport avec l'objet en question. N'est-ce pas exactement ce qui se produit dans les séances spirites ? Le Christ parle presque toujours comme parlerait un mort. C'est pourquoi, sur bien des points, nous ne savons pas encore exactement ce qu'il a voulu dire.
Afin de prendre patience, disons-nous que tout ce qui nous choque, nous indigne ou nous désespère ne se passe qu'à la surface de notre terre et que nous n'avons pas le droit de juger l'univers d'après elle. Elle ne sera peut-être pas toujours ce qu'elle est aujourd'hui ; et bien des choses qui nous rendent malheureux ne dépendent que de nous et de ceux qui nous ont précédés.
Il est à présumer que d'autres mondes, invisibles à nos yeux, sont tout différents.
Dans l'espace infini qui nous enveloppe, il n'y a pas seulement des astres que nous voyons parce qu'ils sont de la même substance que notre globe, mais des mondes que nous n'apercevons point, à travers lesquels nous passons sans nous en douter, parce que nos yeux ne sont pas faits pour les voir, nos oreilles pour les entendre, nos mains pour les palper. Pourquoi nos sens seraient-ils les seuls juges de ce qui peut être ou n'être point ? Ils nous feraient un univers bien petit, bien précaire et bien indigent. Ne condamnons pas à la légère, sur des témoignages incertains et souvent puérils, ce qui remplit tout l'espace et toute l'éternité.
Et n'oublions pas que, même sur cette terre où nous sommes nés, d'où nous sommes sortis, dont nous sommes pétris, nous ne percevons pas la centième, voire la millième partie de ce qui se passe.
Sommes-nous aussi loin qu'on le croit des mystiques, des grands visionnaires de la foi ? Le retour en Dieu, la fusion, l'immersion totale dans le divin, n'est-ce pas le retour, la fusion, l'immersion dans l'infini qui nous attend après la mort ? Qu'importe que cet infini n'ait pas de visage ? Dieu n'en a pas non plus. Nous ne savons pas ce qu'est cet infini, mais les croyants ne savent pas davantage ce qu'est leur Dieu.
Aimeriez-vous vivre éternellement, seul à seul, face à face, avec le Jéhovah de l'Ancien Testament ?
N'est-il pas le Dieu-le-Père du Nouveau Testament ? Son caractère s'est-il amélioré depuis qu'il nous sacrifia son Fils, afin de racheter des fautes que lui seul avait mises en nous ?
Depuis, le péché originel ne continue-t-il pas de nous induire en tentation ? Il doit pourtant savoir si, oui ou non, il nous a donné la force de vaincre cette tentation. S'il nous l'a donnée, nous ne succomberons point, et le coup sera nul. S'il ne l'a pas donnée, nous tomberons dans le péché, et l'épreuve n'aura été qu'un traquenard. Au surplus, elle était inutile puisqu'il savait d'avance où elle aboutirait. Nous est-il défendu de chercher un Dieu qui ait d'autres idées ?
L'éternelle contemplation face à face de la mystique chrétienne ? Oui. A condition que ce soit la face du Dieu que j'ai créé, et non point celle du vôtre. Ce sera ma récompense ou mon châtiment.
Pourquoi le néant est-il impossible ? Parce que, s'il était possible, il ne serait plus le néant.
Une fois pour toutes, nous devrions éliminer l'idée du néant. Il fausse la plupart de nos pensées. Il n'existe que dans l'apathie, l'aveuglement de notre intelligence. Nous appelons néant tout ce que nous ne comprenons point. Mais ce que nous ne comprenons point n'a pas le droit de peser sur notre vie.
Il semble que la lumière d'une étoile lointaine doive se répandre de tous côtés dans l'infini, s'y diffuser, s'y diluer et s'y perdre. Nullement. Quelle que soit la position toujours changeante de notre terre dans l'empyrée,
à travers l'inconcevable grouillement stellaire, elle vient directement nous chercher, comme si nous étions seuls au monde, comme si elle ne brillait que pour nous. Cette puissance, cette vertu prodigieuse serait-elle uniquement réservée à la lumière ? Proclame-t-elle, met-elle en action la communion de tout ?
Que serait un Dieu qui ne connaîtrait pas le futur ? Il faudrait croire qu'il ne l'a pas créé. Mais qui l'aurait créé ?
Sans être Dieu nous pouvons plus ou moins retrouver et connaître le passé. Il devrait en être de même pour l'avenir. Est-ce la grande barrière qui nous sépare encore de la divinité ?
Pouvons-nous imaginer que nous n'existons pas, que nous n'existions pas avant d'exister ? Comment ferions-nous, que verrions-nous ? Est-il plus facile ou plus raisonnable d'imaginer que nous n'existerons plus ?
La lumière d'une étoile qui nous parviendra dans quelques milliers d'années, existe déjà même pour ceux qui ne la verront pas, comme existe déjà l'événement tragique qui ne nous atteindra qu'à la fin de notre vie. Donc, tout dépend de notre œil.
Savons-nous que nous mourons ? Saurons-nous jamais que nous sommes morts ? Qu'est-ce qu'un malheur qui ne nous frappera que lorsque nous ne pourrons plus le ressentir ?
Il faudrait attendre la mort comme nous attendons le sommeil dans nos nuits d'insomnie.
Ne croyons pas que la plus haute, la plus téméraire, la plus généreuse de nos pensées soit la moins raisonnable. Avant la fin de notre vie, nous constaterons que la plus basse, la plus timorée, la plus égoïste avait tort.
Supposons que dans une petite ville de quinze mille habitants, passe un Christ qui ressuscite trois morts déjà dans les cercueils dont on se prépare à clouer les couvercles. Quelles seront les réactions des parents, des amis, de toute la ville et des morts eux-mêmes ? Quelles vérités, quels sentiments secrets émergeront de l'ombre ? Quelle humanité nouvelle naîtra du miracle ? Ce qu'un Dieu seul pourrait faire aujourd'hui, qui nous dit que l'homme ne le fera pas demain ?
Mais l'effet d'une résurrection, Jésus l'avait prévu dans la parabole du Mauvais riche. Du fond de l'enfer, celui-ci dit à Abraham : « Je vous supplie, père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, où j'ai cinq frères : afin qu'il leur atteste ces choses, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourments. » Abraham lui repartit : « Ils ont Moïse et les prophètes ; qu'ils les écoutent. » « Non, dit-il, père Abraham ; mais si quelqu'un des morts va les trouver, ils feront pénitence. » Abraham lui répondit : « S'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne croiront pas non plus quand quelqu'un des morts ressusciterait. » (Luc, XVI, 27-31.)
LE VIDE
Les physiciens d'aujourd'hui s'accordent à reconnaître que dans l'air il y a deux mille fois plus de vide que de plein. Ce qui forme le plein, ce sont les molécules. Mais dans chacune de ces molécules, le vide l'emporte aussi sur le plein. Le même vide, proportionnellement plus grand, se retrouve dans l'infini sidéral où les mondes, alors même qu'ils s'entassent et s'agglomèrent, comme dans la Voie Lactée , n'occupent que des points lumineux dans l'espace sans bornes.
Qu'est-ce que le vide ? Sur notre terre, les profanes disent que c'est l'air. Mais l'air n'est qu'un mélange de gaz également formé de plus de vide que de plein. Et dans l'infini sidéral, où il n'y a plus trace d'air, qu'est-ce que le vide ? On insinue, sans oser l'affirmer, que c'est l'éther. Ce qui revient à dire que le vide c'est l'éther ou que l'éther c'est le vide, et n'explique rien du tout.
Le seul vide que nous puissions plus ou moins nous représenter, est celui que fait dans une ampoule, dans un tube ou une cloche, la machine pneumatique ou la trompe d'Alvergniat. Ce n'est qu'un vide relatif et conventionnel qui ne répond à aucune réalité ; un vide qui n'est que de l'air raréfié qui a d'autres propriétés que l'air à la pression normale. Savons-nous ce qui, dans le tube ou l'ampoule, remplace l'air que nous avons expulsé ?
Saurons-nous jamais en quoi consiste l'autre vide, le vide absolu, bien proche du néant et qui paraît être, si l'on peut dire, le tout ou la substance de l'univers ?
Si le vide de l'univers n'était rien, le rien ou le néant l'emporterait des milliers, voire des millions de fois sur ce qui existe et se rapprocherait de l'inexistence. Il est plus croyable que c'est ce rien qui est tout ; et que le reste n'est qu'une façon d'exister de ce rien.
Ce que nous appelons vide, dans l'espace, n'est que ce que nous ne voyons pas. Mais il est fort possible que ce vide le remplisse aussi profusément que ce que nous voyons. Nos yeux et nos sens ne sont pas les souverains arbitres de ce qui est ou de ce qui n'est pas.
Au surplus, le vide absolu serait encore de l'espace, au lieu que le néant, s'il était encore de l'espace, ne serait plus le néant.
Il semble impossible que cet univers continue d'exister sans que jamais quelqu'un y comprenne quelque chose.
Mais qu'est-ce que comprendre quelque chose ? Savoir ce qu'il est ? Pourquoi il est ? D'où il vient ? Où il va ? En attendant, nous savons déjà qu'il ne vient de nulle part, qu'il ne peut aller nulle part, sans rester en lui-même, puisqu'il est partout, et qu'il n'a d'autre raison d'être que d'être ce qu'il est. Qu'espérons-nous en outre ?
Peut-être n'apprendrons-nous ce que nous sommes que lorsque nous serons morts. Mais lorsque nous serons morts, serons-nous encore ?
LAZARE
Si je rencontrais Lazare le ressuscité, que lui demanderais-je d'abord ? Mais pourrait-il me répondre, me dire ce qu'il a vu ? Ne serait-il pas devant moi comme le médium devant le désincarné qui ne peut se faire entendre ?
Et s'il me disait : « J'ai vu Dieu », le croirais-je ? le comprendrais-je ? Les soi-disant messagers de l'au-delà que nous interrogeons ne nous ont jamais dit que ce que nous diraient des hommes moins intelligents qu'ils n'étaient de leur vivant.
Pour nous mettre dans l'atmosphère du grand miracle, représentons-nous l'intérieur de Lazare le lendemain de sa résurrection. Les juifs qui, comme le dit l'Évangile selon saint Jean, étaient venus en grand nombre (multi autem ex judaeis), voir Marthe et Marie, « pour les consoler de la perte de leur frère », ont quitté Béthanie, moins épouvantés de la mort que du retour à la vie. Il ne reste dans la cuisine rocheuse où s'est achevé le repas du soir, que quelques voisins et Marthe qui, dans un coin, lave le suaire et les bandelettes de l'ensevelissement. On y voit aussi Marie qui met sous clef « la livre d'huile de vrai nard précieux » (libram unguenti nardi pistici pretiosi) qui, au dire de Judas, valait trente deniers et dont cinq jours plus tard elle oindra les pieds du Seigneur. On y découvre enfin, au fond de la salle, Lazare, écroulé sur un banc et livide dans l'ombre. Il est encore hagard et hébété d'avoir passé de la vie à la mort et de la mort à la vie, comme ne l'avait fait aucun homme. Il n'a pas entièrement repris ses esprits. Quand on l'interroge sur ce qu'il a vu de l'autre côté du sépulcre, il ne sait plus, ne se rappelle pas, ne se rend pas compte. Ce n'est pas un secret qu'il veut garder, c'est un secret qu'il a perdu. Mais lorsqu'on lui parle de son jardin, de ses figuiers, de ses oliviers, du souper qu'il vient de faire, il se réveille, revient sur terre et s'intéresse aux plus petites choses de l'existence, aussi simplement, aussi sincèrement que s'il n'avait pas séjourné durant quatre jours dans l'autre monde et commencé de se décomposer au point d'empester le tombeau (Jam foetet