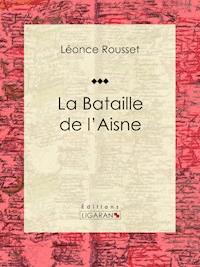
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
"La Bataille de l'Aisne, écrit par Léonce Rousset, est un livre captivant qui plonge le lecteur au cœur d'un des épisodes les plus marquants de la Première Guerre mondiale. À travers une plume précise et immersive, l'auteur retrace avec minutie les événements qui ont conduit à cette bataille décisive.L'ouvrage nous transporte sur les lignes de front de l'Aisne, où les armées françaises et allemandes se font face dans une lutte acharnée. Léonce Rousset nous fait vivre les combats, les stratégies militaires, mais aussi les conditions de vie extrêmes des soldats, confrontés à la boue, au froid et à la peur constante.Au-delà de la description des affrontements, l'auteur nous offre une réflexion profonde sur les conséquences de cette bataille sur le cours de la guerre et sur la société de l'époque. Il met en lumière les enjeux politiques, les rivalités entre les généraux, mais aussi les sacrifices et les souffrances endurées par les soldats.La Bataille de l'Aisne est un livre essentiel pour comprendre l'ampleur des combats de la Première Guerre mondiale. Léonce Rousset nous offre un récit poignant, mêlant habilement faits historiques et témoignages, qui nous plonge au cœur de l'horreur de la guerre. Un ouvrage incontournable pour tous les passionnés d'histoire et les amateurs de récits de guerre.
Extrait : ""Dès la fin de l'année 1916, gouvernements et états-majors alliés étaient arrivés à cette conviction que les Allemands, dont l'échec devant Verdun avait changé tous les plans, s'efforceraient de reprendre, au printemps de Tannée suivante, l'initiative des opérations sur les divers fronts."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335016529
©Ligaran 2015
Ceux qui croiraient trouver ici une résurrection ou un prolongement des discussions passionnées qu’a soulevées l’offensive brusquement interrompue du 16 avril 1917, se tromperaient grandement. Ce petit livre n’est ni un acte d’accusation, ni un panégyrique. Il ne cherche point à mettre sur la sellette des personnes dont les sentiments intimes ne peuvent être suspectés et dont les intentions demeurent à l’abri du blâme. Pas davantage, il ne dresse de réquisitoire contre qui que ce soit, ni n’oppose les uns aux autres des hommes qui, animés d’un même désir de bien faire, n’étaient divisés que sur la manière de le réaliser. Il se borne à exposer, avec franchise et vérité, des faits ou mal connus ou parfois complaisamment dénaturés. En un mot, il se borne à apporter une contribution loyale à l’histoire de la dernière guerre et une pierre à l’édifice monumental que cette histoire constituera plus tard.
Un périlleux émoi, dont le souvenir est encore dans toutes les mémoires, gagna les esprits il y a deux ans et demi, lorsqu’on apprit tout à coup que l’attaque grandiose sur laquelle étaient fondés de si vastes espoirs prenait fin sans que se fût produite la rupture escomptée des lignes allemandes. Des pertes formidables, disait-on, et hors de toute proportion avec les résultats acquis, avaient paralysé l’élan de nos soldats. Des fautes grossières de conception, de préparation et d’exécution étaient les causes efficientes de ce dénouement démoralisateur, que d’aucuns n’hésitaient pas à qualifier de désastreux. De là à prétendre que les armées françaises étaient confiées à des généraux incapables qui, par le fait d’une présomptueuse assurance en leur propre mérite, venaient de gaspiller un sang précieux, il n’y avait qu’un pas. Il fut franchi au grand dommage de l’esprit public et de l’état moral des armées. Des exécutions aveugles, ou tout au moins imprudentes, suivirent, qui donnèrent un semblant de satisfaction aux réclamants les plus acharnés, mais désorganisèrent le commandement. Celui-ci en fut atteint non seulement dans son prestige, mais dans son autorité même, et s’il ne s’était pas trouvé là un général à l’âme droite, à l’esprit ferme, à la main experte, dont l’inflexible rigidité disciplinaire se tempérait d’une humanité bienveillante – j’ai nommé Pétain – on ne sait ce que le vent de folie qui venait de s’élever tout à coup et qu’enflaient des bouches scélérates aurait fait de ces soldats naguère encore si vaillants, si dévoués, si patients et si disciplinés.
La crise d’avril-mai 1917 est une des plus graves de cette longue guerre. Heureusement conjurée, elle n’a eu que des effets momentanés et circonscrits. Mais elle reste une grande leçon, et mérite pour cela qu’on l’étudie dans sa genèse, dans ses causes diverses et dans son développement. C’est ce travail que j’ai cherché à faire, en m’appuyant non pas sur les dires de tel ou tel, mais sur des documents certains. Je l’ai accompli sans parti pris, sans opinion préconçue d’aucune sorte. Je n’ai d’autre prétention que de le voir accueilli comme une œuvre de bonne foi.
L.R.
DE LA CONFÉRENCE DE CHANTILLY À CELLE DE COMPIÈGNE
Dès la fin de l’année 1916, gouvernements et états-majors alliés étaient arrivés à cette conviction que les Allemands, dont l’échec devant Verdun avait changé tous les plans, s’efforceraient de reprendre, au printemps de l’année suivante, l’initiative des opérations sur les divers fronts. Elle avait même gagné jusqu’aux milieux parlementaires, puisque, dans un rapport fait en octobre 1916 à la Commission de l’armée sur les munitions d’artillerie, M. Violette ne se faisait point faute de nous menacer d’une nouvelle surprise, contre laquelle il croyait urgent de se précautionner par avance : « Si nous sommes prudents, disait-il, c’est dès la fin de février que nous reprendrons les opérations actives, et pour une raison capitale : c’est que notre infanterie est encore capable de fournir un effort considérable ; mais ce serait courir un risque formidable que de se résigner, sur des positions même beaucoup mieux préparées, à s’exposer à une tentative comme celle de Verdun… J’ai la conviction que l’initiative de la grande bataille est une question de vie ou de mort pour la France et qu’ainsi nous ne sommes pas libres d’attendre le 15 avril pour l’entreprendre. » La Commission de l’armée acquiesça.
Il existait au surplus d’autres raisons en faveur d’une contre-offensive préalable sur le front occidental. D’abord la supériorité numérique des alliés tendait à décroître, tandis que l’ennemi créait, avec ses réserves, de nouvelles divisions. On craignait en outre que, du côté français, la pénurie de charbon et d’acier n’aboutît bientôt à une diminution de la production, correspondante à une augmentation sensible de celle de l’Allemagne. De là, la nécessité de prévenir l’adversaire, d’autant plus que l’expérience, après avoir clairement démontré la coûteuse inutilité des luttes dites d’usure et des engagements à effectifs limités, affirmait tous les mérites d’une autre méthode plus profitable, celle des batailles de rupture puissantes, rapides et brusquées, suivies de l’exploitation aussi complète que possible des résultats acquis. Le 12 novembre 1916, dans une conférence tenue à Chantilly sous la présidence du général Joffre, le nouveau système reçut une officielle consécration.
Il fut décidé en effet :
1° Que la décision de la guerre serait recherchée désormais, par la reprise, aux premiers beaux jours, d’offensives concordantes mettant en œuvre le maximum de moyens ;
2° Qu’une attaque puissante, à but décisif‚ serait préparée et montée, à pareille époque, sur le front franco-anglo-belge ;
3° Que pour éviter les retards et le défaut d’unité qui s’étaient produits antérieurement, les alliés devaient se tenir prêts à entamer la lutte dans la première quinzaine de février si les circonstances l’exigeaient, la date effective des opérations à entreprendre restant à fixer dans le moindre délai possible. En conséquence, le général Joffre établit un plan comportant le déclenchement d’une bataille générale, livrée par nous entre la Somme et l’Oise, et par les Anglais entre Bapaume et Vimy. Une opération latérale devait être faite sur l’Aisne par le groupe d’armées du Centre. Seulement, faute de pouvoir disposer d’assez d’artillerie, cette opération ne commencerait que quinze jours après l’attaque principale, et conséquemment elle devenait, qu’on le voulût ou non, indépendante de celle-ci.
Sur ces entrefaites, le général Joffre, élevé à la dignité de maréchal de France, quitta le commandement en chef des armées du Nord et du Nord-Est et y fut remplacé par le général de division Nivelle, qu’il avait désigné lui-même éventuellement, et pour le cas où il disparaîtrait, au choix du gouvernement.
Le nouveau commandant des armées du Nord et du Nord-Est jouissait d’une réputation militaire justifiée par la ténacité dont il avait fait preuve, à la tête de la IIe armée, dans la défense de Verdun, et aussi par l’esprit de décision et de hardiesse qu’il avait affirmé dans la reprise des positions importantes dont l’ennemi s’était rendu maître devant cette place en 1916. On attribuait au surplus ses succès – et ceci aussi bien dans l’armée que dans le Parlement et le public – à une nouvelle méthode de guerre, imaginée et appliquée par lui. On lui faisait donc pleine et entière confiance, encore que, comme on le verra plus loin, ses procédés parussent à certains un peu trop hasardeux.
En ce moment, tout à fait d’accord avec l’instruction du général Joffre en date du 16 décembre 1916 sur le but et les conditions d’une action offensive générale, il estimait qu’une attaque dépourvue de profondeur n’assurerait pas le rendement maximum des forces mises en œuvre, et limiterait l’exploitation possible des résultats obtenus. L’intervalle de temps nécessité par la préparation d’artillerie sur les objectifs successifs de l’attaque laissait toujours à la défense le temps de se ressaisir, de faire intervenir les réserves et d’organiser au fur et à mesure de la progression du mouvement, des lignes pour les replis successifs. Aussi n’admettait-il l’offensive que sous la forme d’une bataille de rupture, extrêmement rapide et soudaine, qui paralysât l’adversaire et ouvrît le champ libre à une vaste exploitation. Et il traduisait ses intentions sous la forme suivante :
Les opérations de quelque importance engagées jusqu’ici ont établi :
1° Que la rupture de front (pénétration jusqu’en arrière du gros des batteries ennemies) est possible, à condition de se faire d’un seul coup par attaque brusquée en 24 ou 48 heures ;
2° Que pour battre une profondeur suffisante (8 kilomètres), il est nécessaire de pousser le plus en avant possible l’artillerie lourde de destruction à longue portée ou, en cas d’insuffisance, d’employer à cette destruction un certain nombre de batteries longues ;
3° Que cette rupture doit être immédiatement suivie d’une exploitation latérale audacieuse visant la destruction des batteries, l’occupation des lignes de ravitaillement ennemies et la conquête des voies ferrées nécessaires à notre propre ravitaillement ;
4° Qu’il importe de constituer, le plus en avant possible, une tête de pont, à l’abri de laquelle se concentrent les troupes destinées à livrer bataille aux forces ennemies encore disponibles.
En résumé, trois temps aussi rapprochés que possible : rupture, exploitation latérale, exploitation en avant en vue de la bataille. Toutes ces opérations, dans lesquelles le facteur vitesse a une importance prépondérante, doivent être préparées dans le plus grand détail.
Il avait dit également : « Le but que les armées franco-britanniques doivent atteindre, est la destruction de la masse principale des forces ennemies. Ce résultat ne peut être obtenu qu’à la suite d’une bataille décisive, livrée avec une force numérique considérable, à toutes les forces de l’ennemi. » Quelques jours plus tard, le 2 janvier 1917, il donnait encore plus de développement à sa pensée. « Il s’agit, disait-il, d’une seule et même bataille… qui aura une durée prolongée… Elle doit avoir pour résultat la destruction et la retraite des armées ennemies. » Il insistait sur « le caractère de violence, de brutalité et de rapidité que doit revêtir l’offensive, et en particulier son premier acte, la rupture ». Mais en ayant bien soin d’insister sur ce point que si les opérations « doivent se poursuivre avec toute la vigueur et l’audace nécessaires… il ne faut pas cependant confondre audace avec témérité ». On ne saurait rien trouver à reprendre à ces instructions, éparses dans les communications du grand quartier général, et qui sont manifestement dictées par une exacte conception de la guerre. Elles témoignent chez le chef qui les dictait d’un sens militaire très droit, allié à une indomptable fermeté.
Mais elles ont un caractère très général et ne visent que les principes supérieurs. Il fallait au surplus, et en même temps qu’on les donnait, entamer la préparation même de l’affaire et, sous ce rapport, la première question qui se posait était celle relative au théâtre sur lequel le drame devrait se dérouler. Le choix du général en chef s’appuya sur les considérations que voici :
Tout d’abord, on devait écarter la région comprise entre les Flandres et le canal de la Bassée, laquelle, pour des raisons climatériques ou de terrain sur lesquelles il n’est pas besoin d’insister, ne pouvait se prêter avant l’été à de grands déploiements de troupes. Au contraire, le secteur Arras-Bapaume paraissait très favorable à l’attaque des Britanniques, d’autant plus que celle-ci y serait facilitée par la nature du sol, par les aménagements existants, enfin par la forme saillante du front ennemi au sud d’Arras. Le général Haig était tout disposé à s’y engager.
Convenait-il maintenant d’assigner aux troupes françaises le front de la Somme avec prolongement par l’Avre jusqu’à Lassigny, comme l’avait indiqué le général Joffre ? On pensa que sur ce théâtre de l’offensive de 1916, la densité des forces ennemies, la puissance de l’artillerie de position allemande, l’obstacle même formé par la rivière, devaient faire abandonner ce champ de bataille usé et ravagé, et que, dès lors, le front compris entre l’Avre et Lassigny, considéré isolément, deviendrait trop étriqué pour servir de base à une large offensive. Mais alors où entamer celle-ci ?
Une étude attentive du terrain situé plus à l’Est, démontrait qu’aucun aménagement préalable n’était possible avant les abords de l’Aisne et la Champagne. Toutefois, il semblait dangereux de trop s’écarter du front anglais et surtout d’abandonner le bénéfice d’une action convergente des alliés contre le grand saillant dessiné par l’ennemi entre Arras et Reims. À plus forte raison devait-on éviter de s’étendre jusqu’à la Meuse et la Woëvre, où d’ailleurs il eût fallu, comme en Flandre, attendre la belle saison, et encore moins vers la Lorraine et l’Alsace, beaucoup trop excentriques pour se prêter à des mouvements combinés.
Pour ces divers motifs, la région de l’Aisne paraissait encore la plus favorable. Mais nous n’avions là qu’une seule tête de pont, entre Vailly et Berry-au-Bac. La prendre comme axe de l’attaque nous menait droit sur la position formidable du Chemin des Dames, dont la possession, on l’avait vu en 1914, est indispensable à une armée opérant dans le Laonnois, ne serait-ce que parce qu’elle lui donne des observatoires d’artillerie extrêmement précieux. Par contre, les secteurs envisagés pouvaient être rapidement organisés, tant à raison des travaux déjà exécutés que des chemins de fer existants. Mieux encore : la forme en équerre donnée à la base générale de l’offensive permettait, par l’allongement de celle-ci, des combinaisons plus variées, en même temps qu’une menace d’enveloppement se dessinerait sur le saillant Roye-Soissons. Sans compter qu’on évitait cette interruption un peu longue dans l’effort que, par l’attaque retardée de l’Aisne, le plan primitif admettait. C’est donc sur la région s’étendant de l’Aisne à la Champagne que le haut commandement, en fin de compte, jeta son dévolu.
C’est au début de 1917, dans les premiers jours " de janvier, que le général en chef, fixé sur les ressources en artillerie dont les alliés comptaient bientôt disposer, établit un plan d’ensemble sur les assises que voici :
a) Une offensive menée par les armées britanniques en direction générale de Cambrai, et une offensive menée par le groupe des armées du nord (français) en direction générale de Saint-Quentin, dans le but initial de fixer par une bataille de front le maximum de forces ennemies, puis de préparer la mise à exécution du plan d’exploitation.
b) Une offensive menée par le principal groupe d’armées français, au-delà de l’Aisne en direction générale du nord, dans le but de manœuvrer les forces ennemies fixées par l’attaque des armées britanniques et du groupe d’armées du nord, puis de battre les disponibilités nouvelles que pourront amener les Allemands.
c) Enfin, la reprise, ou la continuation, de la bataille offensive par toutes les armées d’attaque, soutenues par toutes les disponibilités qui pourront être réunies (unités fraîches ou unités reconstituées), dans le but de précipiter la désorganisation et la défaite complète de l’ennemi.
Dans la pensée du général Nivelle – et il l’exprimait fort clairement – l’ensemble de toutes ces attaques ne devait constituer qu’une seule et même bataille, mais une bataille dans laquelle les différentes armées engagées travailleraient à tour de rôle au profit les unes des autres. Ainsi, l’affaire de l’Aisne n’était engagée que la dernière, de façon à ce que les troupes chargées de la mener « ne rencontrassent, au début, qu’un minimum de forces et pussent progresser rapidement sur les derrières de l’ennemi. On voit reparaître ici, au moins dans son ensemble, l’idée maîtresse de l’ancien programme établi à Chantilly.
Il y avait cependant quelques variantes qui, même, allaient progressivement s’accentuer. Le plan du général Joffre comportait une attaque britannique entre Arras et la Somme, et une attaque française entre la Somme et l’Oise. Il découlait, en principe, de la manœuvre continue et liée sur un front plus ou moins développé, mais presque rectiligne. Une attaque secondaire devait, il est vrai, être déclenchée au nord de l’Aisne, à travers le massif du Laonnois, mais, faute d’artillerie lourde en quantité suffisante, cette attaque était reculée jusqu’après que la réussite de l’affaire principale, entre Somme et Oise, aurait libéré le matériel indispensable, c’est-à-dire qu’elle était remise à quinze ou vingt jours plus tard. Or, un pareil retardement ne s’accordait pas avec les conceptions du général Nivelle, qui, ne pouvant compter ni sur un accroissement d’effectifs ni sur une dotation en canons beaucoup plus riche, songea à tourner la difficulté en faisant relever les troupes françaises par des éléments britanniques sur une certaine partie du front.
C’est ce que, dans une lettre du 21 décembre, il exposait à sir Douglas Haig, après l’avoir tâté de vive voix deux jours auparavant. Il lui demandait de vouloir bien, avant le 25 janvier, prendre à sa charge le front compris entre Bouchavesne et la route d’Amiens à Roye. Mais le général anglais accueillait cette requête avec quelque réserve. Il voulait bien renoncer, jusqu’à nouvel ordre, à ses projets de dégagement de la côte belge, par une offensive sur Ostende et Zeebruge. Mais il subordonnait formellement son acquiescement à l’envoi de six nouvelles divisions qu’il avait demandées en Angleterre. Et nul ne savait quand celles-ci arriveraient.
Sur ces entrefaites, le général Nivelle fut invité à se rendre à Londres, devant le War Committee. Là, il exposa ses projets et leurs développements immédiats. Il ajouta que le temps travaillait pour l’ennemi qui, vainqueur en Roumanie, activait fiévreusement ses fabrications et ses formations nouvelles. Il montra que l’intérêt bien entendu des alliés leur commandait de prendre sans retard l’initiative des opérations et, par sa parole persuasive, enleva son auditoire. Tout ce qu’il demandait fut accordé en principe. Seulement il ne put obtenir, pour la fin de la relève, une date plus rapprochée que les premiers jours de mars, et, pour l’entrée en action des armées britanniques, une fixation moins éloignée que le 1er avril.
Malheureusement on avait oublié de compter avec l’engorgement des voies ferrées, qui ne donnaient qu’un rendement insuffisant pour assurer les transports de troupes en temps opportun. Cette difficulté fut soumise à une conférence interalliée, qui, réunie à Calais les 26 et 27 février, s’efforça d’y parer de son mieux, mais qui, tout de suite aussi, s’occupa d’une question autrement grave, autrement importante et dominatrice, celle de l’unité du commandement.
Sur ce point, le siège de M. Lloyd George était aux trois quarts fait. Dans une conversation privée, tenue quelques jours auparavant, le 14 février, le premier ministre anglais avait nettement exprimé son opinion, enregistrée immédiatement par l’un des auditeurs :
Pour ma part, disait-il, j’ai une entière confiance dans le général Nivelle, et la certitude absolue qu’il est seul capable de mener les opérations à bonne fin cette année même. Mais, pour cela, il faut qu’il puisse disposer en dernier ressort de toutes les troupes opérant sur le front français, des nôtres comme des armées françaises.
Je fais tous mes efforts pour entraîner vers ce but l’avis de mes collègues, mais ne puis garantir le succès, à moins que le général Nivelle et le gouvernement français ne prennent nettement position à ce sujet, en déclarant que, pendant la bataille, la direction générale doit être unique, suivant une modalité à arrêter entre nous.
À mon avis, le War Committee doit entrer en contact, au plus tôt, avec le général Nivelle et le Comité de guerre français, en particulier avec MM. Briand, Ribot et Albert Thomas, dans lesquels nous avons une réelle confiance.
Sans doute, le prestige dont jouit le maréchal Haig sur le peuple et l’armée britannique ne permettront probablement pas de le subordonner purement et simplement au commandement français ; mais si le War Committee reconnaît que cette mesure est indispensable, il n’hésitera pas à donner des instructions secrètes dans ce sens au maréchal, et au besoin à remplacer ce dernier s’il ne donnait pas en toute sympathie et déférence l’appui de toutes ses forces quand il en sera requis.
Nous comprenons parfaitement que la direction générale revient au commandement français qui combat sur son propre territoire, dispose de forces plus importantes que les nôtres, et possède une instruction technique que nous nous plaisons à reconnaître plus élevée que celle de nos états-majors. Mais encore une fois, il faut que les deux comités de guerre soient d’accord sur le principe, car son application ne sera pas agréable au maréchal Haig, à qui il faudra l’imposer.
Je serais désireux de savoir le plus tôt possible quelle décision prendront le gouvernement et le commandement français sur l’opportunité de cette réunion et des conversations que je propose. S’ils les acceptent, je serais heureux de les voir exprimer très librement leur façon de penser sur tous les sujets, car, tous, nous avons trop longtemps masqué nos opinions sous des formules courtoises qui ne devraient plus être de mise entre alliés aussi intimement liés que nous le sommes.
Tous mes efforts tendent à terminer cette guerre par la victoire, et dans le plus bref délai possible. Mais nous n’y arriverons qu’en évitant de rester aussi distants les uns des autres et de nous renfermer dans une dignité nationale mal comprise et dangereuse par ses conséquences .
Impossible, on le voit, d’être plus net, ni plus loyalement déférent. Comme le chef du gouvernement français, M. Aristide Briand, était imbu d’idées identiques et animé de sentiments au moins aussi résolus, l’accord, on le devine, ne fut pas long à se faire. Quelques heures plus tard, le document que voici était rédigé, et revêtu de la signature, non seulement des deux premiers ministres – qui avaient eu soin de spécifier qu’ils possédaient pleins pouvoirs – mais des deux généraux en chef, dont l’un faisait preuve, dans l’intérêt commun, d’une abnégation digne des plus grands éloges et de tous les respects.
Le Comité de guerre français et le Comité de guerre britannique approuvent le plan d’opérations sur le front occidental, tel qu’il leur a été exposé, le 25 février 1917, par le général Nivelle et le maréchal sir Douglas Haig.
De plus, attendu que l’objet essentiel des opérations militaires projetées est de rejeter l’ennemi hors de France ; attendu d’autre part que l’armée française dispose d’effectifs plus considérables que l’armée anglaise, le Cabinet de guerre britannique reconnaît que la direction générale des opérations doit être confiée au général en chef français.
Dans ce but, le Cabinet de guerre britannique s’engage à aviser le field-marshall commandant les forces britanniques qu’il aura à se conformer, pour ses plans d’opérations, aux directives stratégiques générales du commandant en chef des armées françaises.
On a prétendu que l’unité de commandement, si désirable à tous égards, n’avait jamais existé avant la grande offensive de 1918. Le document qui précède démontre le contraire et redresse une première erreur de l’opinion. Ce n’est malheureusement pas la seule que nous aurons à relever.





























